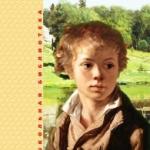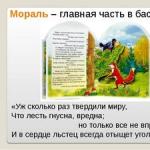Types de connaissances en philosophie brièvement et clairement. Le concept de cognition et de connaissance
1. La cognition comme problème philosophique.
2. Connaissances sensuelles et rationnelles et leurs formes.
Z. Le problème de la vérité en philosophie et en science.
Lors de l'étude de la première question "La connaissance comme problème philosophique" il faut comprendre que l'étude de l'essence de la connaissance est l'une des principales tâches de la philosophie. La théorie de la connaissance (épistémologie) est la section la plus importante de nombreux systèmes philosophiques, et parfois sa principale composante.
Cognition- c'est un ensemble de processus par lesquels une personne reçoit, traite et utilise des informations sur le monde et sur elle-même.
L'activité cognitive vise en fin de compte à répondre aux besoins et aux intérêts matériels et spirituels historiquement émergents des gens et, à cet égard, est inextricablement liée à l'opportunité activités pratiques. Cette dernière est une condition préalable historique, la base et l'objectif le plus important de la connaissance.
Ces choses, phénomènes, processus spécifiques qui sont directement dirigés activité cognitive les gens sont appelés objet de connaissance . Celui qui exerce une activité cognitive s'appelle sujet de connaissance .
Le sujet peut être un seul individu, groupe social(par exemple, la communauté des scientifiques) ou la société dans son ensemble. D'ici connaissances- il s'agit d'une interaction spécifique entre le sujet et l'objet, dont le but principal est de fournir, en fonction des besoins du sujet, des modèles et des programmes qui contrôlent le développement de l'objet.
De cette façon, épistémologieétudie un type particulier de relation entre le sujet et l'objet - cognitif. Les « relations de connaissance » comprennent trois composantes : le sujet, l'objet et le contenu de la connaissance (savoir). Pour comprendre l'essence de la cognition, il faut analyser la relation entre : 1) le sujet qui reçoit la connaissance et la source de la connaissance (objet) ; 2) entre sujet et savoir ; 3) entre connaissance et objet.
Dans le premier cas, il s'agit d'expliquer comment le passage de la source au « consommateur » est possible. Pour ce faire, il est nécessaire d'expliquer théoriquement comment le contenu des choses et des phénomènes connaissables est transféré à la tête humaine et transformé en contenu de connaissance.
Lorsque l'on considère le second des types de relations ci-dessus, un ensemble de questions se pose lié, d'une part, au développement par une personne de tableaux de connaissances prêts à l'emploi disponibles dans la culture (dans des livres, des tableaux, des cassettes, des ordinateurs, etc. ) D'autre part, l'appréciation par le sujet de certaines connaissances, leur profondeur, leur adéquation, leur assimilation, leur complétude, leur suffisance pour résoudre certains problèmes.
Quant au rapport entre la connaissance et l'objet, il pose le problème de la fiabilité de la connaissance, de la vérité et de ses critères.
La solution des problèmes épistémologiques en philosophie est basée sur les principes suivants.
Le principe d'objectivité . Il affirme que l'objet de la cognition (choses, phénomènes naturels et sociaux, structures de signes) existe en dehors et indépendamment du sujet et du processus de cognition lui-même. Cela implique une exigence méthodologique : les choses et les phénomènes doivent être connus objectivement, c'est-à-dire comme ils sont en eux-mêmes. Une personne ne devrait rien apporter de sa part dans les résultats de la cognition.
Principe de connaissance . Il soutient que la réalité doit être connue telle qu'elle est. Ce principe est une conclusion de toute l'histoire de la connaissance et de la pratique de l'humanité. Une personne est capable de manière adéquate, avec la plénitude nécessaire dans chaque cas spécifique, de connaître l'être naturel et social. Il n'y a pas de frontières fondamentales sur le chemin du mouvement sans fin du sujet vers une compréhension plus adéquate et plus exhaustive de la réalité.
Principe de réflexion . Ce principe est inextricablement lié au concept de réflexion, qui exprime l'essence de la compréhension matérialiste de la cognition. La première condition pour la compréhension et l'explication scientifiques de la cognition est la reconnaissance de sa nature réflexive. Le principe de réflexion peut être formulé comme suit : la cognition d'un objet est le processus de sa réflexion dans la tête humaine.
Dans les conceptions épistémologiques des époques passées, la réflexion était considérée : premièrement, comme un processus passif, semblable à une réflexion en miroir ; deuxièmement, en tant que processus basé sur la causalité mécanique (l'apparition des images est déterminée par l'impact sur les organes sensoriels de causes spécifiques) ; troisièmement, comme une description exhaustive de la méthode et des mécanismes spécifiques de formation d'une connaissance objectivement vraie. Tout cela a conduit à l'interprétation de diverses formes de connaissances dans l'esprit des approches métaphysiques et contemplatives.
Préservant le rationnel qui était dans la compréhension du principe de réflexion dans le passé, l'épistémologie moderne donne à ce principe un contenu qualitativement nouveau. Actuellement, réflexion est compris comme une propriété universelle de la matière et est défini comme la capacité des phénomènes matériels, objets, systèmes à reproduire dans leurs propriétés les caractéristiques d'autres phénomènes, objets, systèmes en cours d'interaction avec ces derniers.
Le principe de l'activité créatrice du sujet dans la cognition . L'exploration spirituelle-théorique et spirituelle-pratique du monde par une personne comprend non seulement une activité de réflexion associée à l'obtention d'informations sur le monde et sur soi-même, mais également diverses formes de créativité, la construction de nouvelles réalités objectives du «monde de la culture».
L'introduction du principe de pratique et d'activité créatrice du sujet dans la solution des problèmes épistémologiques nous permet de comprendre la véritable nature du sujet et de l'objet de la cognition, d'une part, et le mécanisme spécifique de leur relation dans la structure de l'acte cognitif, d'autre part, à un niveau qualitativement nouveau.
En épistémologie matière il n'y a pas qu'un système qui reçoit, stocke et traite l'information (comme tout système vivant). Le sujet est avant tout un phénomène socio-historique doté d'une conscience, capable d'une activité fixatrice d'objectifs, objective et transformatrice créative. De ce point de vue, le sujet de la connaissance n'est pas seulement un individu, mais aussi un groupe social, une couche, une société à une époque historique particulière.
L'épistémologie moderne aborde également l'examen d'un objet d'une manière qualitativement nouvelle. Pour le sujet, il n'est pas indifférent que quelque chose d'actuel soit ou non un objet de connaissance. D'un point de vue épistémologique, cette distinction est particulièrement intéressante.
En relation avec ce qui a été dit, il est possible de formuler un schéma général de connaissance, qui dit que le degré de maîtrise objective de la réalité dans la pratique des gens distingue l'ensemble des mesures de l'objet, qui agit à chaque époque comme base de sa réflexion dans l'esprit des gens. Une personne entre en contact avec des objets (choses, phénomènes, processus) de l'existence naturelle et sociale, dans toute leur infinie complexité. Encouragé à l'activité par ses besoins matériels et spirituels, fixant certains buts, il les prend toujours comme une sorte « d'objet partiel », ou « d'objet ».
Le sujet et l'objet en tant que côtés opposés forment une relation contradictoire. Le sujet ne peut influencer l'objet que de manière objective. Cela signifie qu'il doit avoir à sa disposition les médiateurs matériels de ses influences sur l'objet connu - mains, outils, instruments de mesure, réactifs chimiques, etc. Le progrès de la connaissance serait impossible sans l'expansion et la complication constantes de ce « monde des intermédiaires ». De même, le mécanisme d'influence de l'objet sur le sujet suppose son propre système d'intermédiaires : informations sensorielles directes, systèmes de signes divers et, surtout, langage humain.
La principale relation cognitive est la relation « image - objet ». Au sens large du terme façon on peut nommer cet état de conscience qui, d'une manière ou d'une autre, est lié à un objet. Par rapport à l'objet, on peut distinguer trois types d'images : 1) les images-savoir, reflétant la réalité objective ; 2) les images-projets, qui sont des structures mentales qui doivent ou peuvent être mises en pratique ; 3) des images-valeurs exprimant les besoins et les idéaux du sujet.
Considérant la deuxième question Cognition sensuelle et rationnelle et leurs formes" devrait se fonder sur le fait que cognition sensorielle contient des images qui donnent les sens humains.
Les formes principales du niveau sensoriel de la connaissance sont les sensations, les perceptions et les représentations. DANS sentiments chacun des sens humains reflète d'une manière spécifique les propriétés individuelles, les aspects des choses (couleur, son, odeur, dureté). la perception - une réflexion holistique des propriétés et des caractéristiques de l'objet. Représentation - une image visuelle holistique d'une chose qui surgit sur la base de l'imagination et de l'expérience sensorielle passée, conservée et reproduite dans la mémoire.
Les images sensuelles d'une personne, contrairement aux images qui donnent les organes sensoriels des animaux, sont médiatisées par l'expérience sociale et ont une activité interne (elles sont précisément contemplation vivante).
Les sensations sont la forme de base de la cognition sensorielle. Ils fournissent un lien direct entre la conscience et la réalité objective et sont le seul canal externe par lequel des informations sur le monde peuvent être obtenues.
Connaissance rationnelle. Une personne reçoit des informations par le biais de signaux naturels provenant d'objets et de signaux artificiels transmis d'un sujet à l'autre et fonctionnant dans le système langage humain. Le développement et l'amélioration du langage sont étroitement liés au développement du stade rationnel de la cognition. La langue est l'intermédiaire d'information le plus important entre le sujet et la société. Sans cela, il est impossible d'opérer avec des connaissances toutes faites. La pensée rationnelle est le fonctionnement des connaissances existant dans la langue, reliées à la réalité à travers des images sensorielles qui peuvent refléter ce qui est inaccessible aux sens.
Formes élémentaires de la pensée rationnelle (logique) - concept, jugement et conclusion. En eux, les signes sujets des choses se distinguent et se fixent dans les signes du langage.
concept reflète les caractéristiques essentielles des choses, c'est-à-dire qui sont nécessaires et suffisantes pour leur différence à un certain égard. Dans les concepts, pour ainsi dire, nos connaissances sont concentrées et résumées. Jugement, fixer tout signe du sujet, affirme ou nie quelque chose à propos de l'objet de connaissance :« la rose est rouge », « la métaphysique nie la contradiction comme source de développement », « l'atome est inépuisable ».
inférence est la liaison des jugements (opérant avec eux), donnant de nouvelles connaissances sans recourir au témoignage des sens. Par exemple, déjà dans l'Antiquité, il était conclu (jugement) que la Terre avait la forme d'une boule. Cette conclusion a été obtenue de la manière suivante. Les corps sphériques sont connus pour projeter une ombre en forme de disque. terre pendant éclipses lunaires projette une ombre en forme de disque. Il est donc rond.
Humain connaissances est l'unité du sensible et du rationnel. Les gens définissent les tâches de la cognition et interprètent ses résultats au niveau de la pensée rationnelle et reçoivent les informations nécessaires à l'aide des sens. Un scientifique ne se contente pas de regarder à travers un microscope, il vérifie certaines hypothèses (hypothèses), exécute un programme de recherche logiquement solide, interprète ce qu'il voit à la lumière de certains concepts et théories.
En étudiant la troisième question Le problème de la vérité en philosophie et en science" il faut partir du fait que les principales caractéristiques opposées de la relation de l'image cognitive, la connaissance humaine à l'objet sont la vérité et l'erreur.
Vrai est une image adéquate à l'objet réfléchi. Une image qui ne correspond pas à son objet est considérée comme illusion . Ces définitions apparemment simples donnent lieu à problèmes difficiles, dès qu'on se demande ce qu'est une correspondance et quel est le mécanisme pour l'établir.
La correspondance signifie la coïncidence des caractéristiques de l'image et de l'objet. Si chacune des caractéristiques d'un concept est associée à une caractéristique d'un objet, et inversement, alors le concept correspond à l'objet. Tout objet est multi-qualitatif, multidimensionnel, inépuisable dans ses propriétés, connexions et relations. La connaissance à ce sujet contient une quantité finie d'informations. Partant de ce qui précède, on peut formuler le problème principal de la théorie de la vérité : comment peut-on établir une correspondance final dans son contenu de connaissance à un objet infini ? Pour le résoudre, il est nécessaire de considérer les principales caractéristiques de la vérité : l'objectivité, l'absolu, la relativité, le concret et la vérification par la pratique.
En dessous de objectivité de la vérité nous comprenons le contenu de notre connaissance, qui, reflétant l'état actuel des choses, ne dépend pas du sujet de la connaissance, ne dépend ni de l'homme ni de l'humanité.
La reconnaissance de la vérité objective implique nécessairement la reconnaissance sous une forme ou une autre. vérité absolue(moment absolu) dans la cognition humaine, et vice versa, la négation de ce moment absolu entraîne la négation de la vérité objective elle-même, ce qui conduit à l'agnosticisme.
vérité absolue signifie une connaissance complète et exhaustive de l'objet. Cependant, le moment d'absoluité de la vérité est mobile, c'est une certaine limite historique, dont la connaissance s'approche à l'infini. Avec les progrès de la société, ce qui semblait être la vérité absolue se transforme en vérité relative .
La vérité absolue est la correspondance complète de l'image à l'objet ; la vérité relative exprime la dépendance de toute vérité à certaines conditions objectives, aux limites du rapprochement de notre connaissance à la réalité ; le délire exprime l'inconsistance du savoir avec le sujet.
La vérité de toute connaissance est évaluée par rapport au sujet attribué par le sujet dans certaines conditions objectives. De ce fait, le rapport même entre la vérité relative et la vérité absolue est tel que la première apparaît comme vérité précisément parce qu'elle contient un élément de vérité absolue ; le second - agit dans une certaine mesure comme la somme, le résultat de vérités relatives.
La circonstance la plus importante selon laquelle la caractérisation de toute image comme vérité absolue, vérité relative ou erreur peut être donnée non pas en général, mais seulement en relation avec certaines conditions de cognition, à l'une ou l'autre section de l'objet, s'exprime dans la position de caractère concret de la vérité , selon laquelle il n'y a pas de vérité abstraite, la vérité est toujours concrète.
La correspondance de l'image au sujet s'établit par l'activité pratique. Entraine toi est un critère objectif de vérité. Il y a une vérification pratique directe et indirecte de la vérité. Si le sujet à l'étude en pratique se manifeste exactement comme il était censé le faire, ce qui signifie que nos idées à ce sujet sont vraies.
Dans la littérature de référence sur ce sujet, voir les articles :
Nouvelle encyclopédie philosophique. En 4 volumes - M., 2001. St.: "Vérité", "Faux", "Intuition", "Théorie de l'information", "Rationalisme", "Sensualisme", "Théorie de la connaissance", "Objet", "Sujet" .
philosophique dictionnaire encyclopédique. - K., 2002. St. :
"Vérité", "Intuition", "Rationalisme", "Théorie de la connaissance", "Sub" єkt", "On" єkt.
Cognition - réflexion de la réalité par une personne et la société afin d'obtenir des connaissances pour leur utilisation ultérieure dans la pratique.
Cognition - le processus de compréhension par l'homme et la société de faits, de phénomènes et de modèles de réalité jusque-là inconnus.
Cognition Processus par lequel une personne acquiert des connaissances sur le monde et sur elle-même.
La cognition comme activité comprend la réception d'informations par les sens (cognition sensorielle), le traitement de ces informations par la pensée (cognition rationnelle) et l'assimilation matérielle de fragments connaissables de la réalité (pratique sociale).
En pensant - un processus actif de réflexion du monde objectif dans des concepts, des jugements, des théories.
S'appuyant sur une ancienne tradition philosophique remontant à l'Antiquité, il existe deux niveaux de réflexion :
- raison
- intelligence
La raison est le niveau initial auquel on pense dans le cadre d'un schéma, d'un modèle, d'une norme immuable: c'est la capacité de raisonner de manière cohérente et claire, de construire correctement des pensées, de systématiser, de classer les faits.
La raison est le niveau le plus élevé, elle se caractérise par la créativité et l'autoréflexion, l'identification des causes, les forces motrices des objets et des phénomènes.
Il y a une transition caractéristique entre eux.
Le résultat de l'activité cognitive est connaissances , lequel:
Est fixé dans la mémoire humaine ;
Transmis de génération en génération;
Elle est enregistrée sur les supports matériels appropriés (manuscrits, livres, films et bandes magnétiques, mémoire informatique, etc.).
La cognition est liée à la pratique socio-historique.
Entraine toi - activité socio-historique des personnes visant à la connaissance et à la transformation du monde, dont le résultat est le monde de la culture matérielle et spirituelle ("seconde nature").
Types de pratique :
Matériel et fabrication;
Socio-politique (réformes, révolutions, etc.) ;
Scientifique et expérimental (expérimentation mentale);
Artistique et créatif.
La pratique est inextricablement liée à la cognition et remplit certaines fonctions épistémologiques par rapport à celle-ci.
Les principales fonctions de la pratique dans le processus d'apprentissage :
La pratique est la base de la connaissance, car nous ne pouvons obtenir toutes les informations sur les objets qu'à la condition d'une interaction pratique avec eux. La pratique agit également comme source de toutes les données factuelles. Il est directement inclus dans le processus cognitif sous forme d'observation, d'examen du sujet, de questionnement, d'expérimentation.
La pratique est le but de la connaissance, car ce n'est pas fait par curiosité. La pratique oriente les connaissances vers la solution des problèmes urgents et les plus urgents. La pratique non seulement fixe des objectifs, mais aide à déterminer correctement l'objet d'étude, à comprendre ce qui est le plus significatif et le plus important. cette étape. Plus le processus de pratique se développe, plus les objets sont impliqués dans l'orbite de la cognition, plus la gamme de tâches cognitives prioritaires est déterminée de manière complète et précise.
La pratique fournit les moyens matériels de base de la cognition et détermine ainsi ses possibilités et ses limites spécifiques.
La pratique est le critère de la vérité, la pratique vous permet de vérifier et d'évaluer les résultats de la connaissance, vous permet de faire la distinction entre la vérité et l'erreur. La pratique elle-même est historiquement limitée. Le déterminant de ce qui est vrai et de ce qui est faux, la pratique n'est pas dans un sens absolu, mais dans un sens relatif, sous une certaine forme, à un certain stade de son développement. Il arrive qu'à un niveau il ne soit pas capable de déterminer la vérité, mais à un autre niveau supérieur, il acquiert une telle capacité par rapport au même complexe de connaissances. Ainsi, le critère de la vérité est la pratique prise dans le processus de son mouvement, de son développement.
2. Objets et sujets de connaissance . Déterminer la source ultime de la connaissance et caractériser les objets de la cognition implique de résoudre la série de questions suivantes : D'où la cognition tire-t-elle son matériau source ? Qu'est-ce qu'un objet de connaissance ? Quels sont les objets de connaissance ?
Source de connaissances- le monde extérieur, qui délivre finalement l'information originale à la conscience pour traitement.
L'objet de la connaissance dans sens large tout ce vers quoi nos connaissances s'orientent, entourant une personne le monde matériel (naturel et social), inclus dans la sphère des activités des personnes et de leurs relations. Au cours de l'activité pratique, une personne implique des objets et des phénomènes naturels dans la sphère de sa vie, leur donnant le statut à la fois d'objet de travail et d'objet de connaissance. Déjà pour homme primitiféléments monde extérieur comme s'ils "se détachaient" de leur base naturelle et "se connectaient" avec le système des besoins sociaux.
L'objet de la connaissance est ce qui s'oppose au sujet, ce qui est connu. L'objet de la cognition devient un tel fragment de réalité objective (ou subjective), vers lequel l'attention du sujet connaissant est dirigée, qui devient le sujet de l'activité théorique ou pratique du sujet. Les phénomènes matériels et idéaux peuvent agir comme un objet (par exemple, la conscience d'un individu est un objet pour un psychologue.)
La société est un objet particulier de connaissance. La cognition sociale a ses propres spécificités, en particulier, elle se distingue des sciences naturelles par une moindre formalisation du langage de recherche, par la présence d'une liberté suffisante pour choisir des méthodes ou des moyens spécifiques de résolution de problèmes cognitifs.
Les spécificités de la cognition sociale :
1. Le sujet connaissant est souvent inclus dans les processus qu'il étudie.
2. La base de la cognition sociale est faits sociaux , qui sont les actions des gens, les jugements des individus, les résultats des activités matérielles et spirituelles des gens. L'interprétation des faits sociaux dépend toujours de la position du chercheur.
3. De ce fait, il n'est pas toujours en mesure de se rapporter objectivement au phénomène étudié. Dans la cognition sociale, la personnalité du chercheur est toujours visible, ce qui amène moment subjectif dans la connaissance. Par exemple, une évaluation des résultats de la Seconde Guerre mondiale dans les anciennes républiques baltes soviétiques. Pour les Russes, c'est la défaite du fascisme et la libération du monde du nazisme. Pour les politiciens baltes, compte tenu des sentiments nationalistes, c'est l'occupation. D'où le transfert des monuments, et les marches des anciens SS, etc.
4. Les personnes et les groupes sociaux opèrent dans la société, poursuivant leurs propres intérêts et objectifs, ce qui complique considérablement les processus sociaux. Le plus souvent, les gens cachent les véritables motifs de leurs actions. L'histoire est pleine d'accidents, de sorte que les processus sociaux sont difficiles à étudier et imprévisibles.
5. Le développement de la société est influencé par une combinaison de divers facteurs. Les processus sociaux ne peuvent pas être répétés, dupliqués. Par exemple, nous désignons par le concept de "révolution" un certain processus. Il y a eu de nombreuses révolutions dans le monde, mais parmi elles, il n'y a pas de processus qui coïncident dans le cours et le développement.
6. Dans la cognition sociale, il est difficile d'appliquer des méthodes de cognition scientifique telles que l'expérimentation, la modélisation, même les possibilités d'observation sont ici limitées. Il est impossible d'observer le passé. Lorsque les chercheurs commencent à étudier le mode de vie d'une tribu menant un mode de vie primitif, alors sous «l'influence de la civilisation», des changements irréversibles commencent en elle.
7. La société est un objet particulier de connaissance, parce que le processus historique est l'activité des personnes poursuivant leurs objectifs. La connaissance dans ce cas agit comme une connaissance de soi.
Il existe des objets de connaissance primaires, secondaires et tertiaires :
- Objet principal de connaissance(par conséquent, la source ultime de la connaissance) est toujours une certaine partie, un fragment du monde matériel.
- Objets secondaires de connaissance(respectivement, une source secondaire de connaissances) - des images de conscience qui se forment à la suite de la réflexion d'objets primaires. La conscience et ses images agissent en tant que telles, et plus largement - tous les processus spirituels, monde spirituel de personnes.
- Objets de connaissance tertiaires- objets qu'une personne crée et étudie spécialement dans le cadre d'une activité scientifique et théorique. Ceux-ci incluent les concepts de "point", "gaz parfait", "plan", etc.
Le problème du sujet de connaissance comprend les questions suivantes : Quel est le sujet de la connaissance ? Quel rôle joue le sujet dans le processus d'interaction avec l'objet ?
Le sujet - celui qui connaît - le côté actif de la cognition, le porteur individuel et collectif de l'activité cognitive. Le sujet peut être individuel, collectif, social. groupe, classe, société dans son ensemble.
La base de la relation « sujet-objet » est l'activité pratique. Au cours de son développement, la formation d'une relation cognitive (épistémologique) est réalisée. Le sujet de l'activité devient le sujet de la cognition, l'objet de l'activité - l'objet de la cognition.
Pour jouer le rôle de sujet de connaissance, l'individu doit :
Avoir une expérience éducative;
Maîtriser les outils cognitifs existants ;
Racontez constamment votre activité cognitive avec les activités d'autres sujets connaissants.
Le sujet fait ses propres ajustements au processus cognitif :
Dans la lignée de la subjectivité individuelle (lorsque nous attribuons des propriétés et des qualités aux objets de connaissance en fonction de nos besoins et de nos intérêts) ;
Dans la lignée de la subjectivité « collective » (le sujet réalise toujours sa intérêt cognitif dans certaines conditions sociales et porte leur empreinte).
3. Types et niveaux de connaissances. Quels sont le contenu, les formes, les lois du processus de cognition ? Comment évolue la connaissance ? Aujourd'hui, la science distingue la cognition sensuelle et rationnelle, voit les possibilités cognitives de l'intuition. Existe-t-il des modèles dans ce processus ? Si oui, quels sont-ils ? Quelles sont les contradictions du processus de cognition, comment sont-elles résolues ?
La cognition en tant que forme d'activité spirituelle existe dans la société depuis sa création, et le processus de cognition se déroule dans diverses formes socioculturelles développées au cours de l'histoire humaine.
Considérez ces formes:
- connaissance ordinaire - pratique : basé sur l'expérience quotidienne, la pratique, donne des informations élémentaires sur la nature, les gens, etc. Mais les connaissances quotidiennes sont chaotiques, fragmentées, un simple ensemble d'informations et de règles;
- cognition du jeu : élément important activités non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes: jeux d'entreprise, sports, jeu d'acteur, etc. les modèles de jeu et les scénarios de jeu sont de plus en plus utilisés dans un certain nombre de sciences, où diverses options le déroulement de processus complexes ;
- connaissances mythologiques;
- connaissances artistiques - l'expression reçue dans l'art est figurative ;
- connaissances religieuses : génétiquement lié à la mythologie, il se caractérise par une combinaison d'une attitude émotionnelle envers le monde avec la foi dans le surnaturel ;
- connaissances philosophiques;
niveaux de connaissances. La cognition s'effectue à deux niveaux :
- Niveau sensuel. La cognition sensorielle est réalisée à l'aide d'organes sensoriels humains. (6) - vision, audition, etc. et il y a un caractère direct, car il se produit par contact direct avec des objets connaissables. En même temps, les organes des sens délivrent les données correspondantes à l'esprit. La cognition sensorielle est subjective, à ce niveau caractéristiques externes matière.
- Le niveau rationnel (lat. ratio - esprit, esprit, pensée) est réalisé à l'aide de la pensée . La pensée en philosophie est comprise comme un processus de réflexion généralisée et indirecte de la réalité, qui fournit la réception des propriétés essentielles des objets et des phénomènes sur la base des données de la cognition sensorielle.
La cognition rationnelle ne traite pas des objets eux-mêmes, mais de données les concernant, ce qui nous fournit une cognition sensorielle (c'est la médiation). L'esprit résume les faits, tire des conclusions, les comprend.
La connaissance rationnelle est forme la plus élevée connaissance, à l'aide de laquelle la pénétration dans l'essence des objets et des phénomènes a lieu, les lois sont révélées , théories sont créées.
Avec la cognition rationnelle, le contact direct avec le sujet n'est pas nécessaire.
Les niveaux de cognition n'existent pas isolément de la pratique ou les uns des autres. L'activité des organes des sens est toujours contrôlée par le mental ; l'esprit fonctionne sur la base des informations initiales que lui fournissent les organes des sens. Puisque la cognition sensuelle précède la cognition rationnelle, il est possible, dans un certain sens, de parler de sensuel et rationnel comme d'étapes, d'étapes du processus de cognition. Chacun de ces deux niveaux de cognition a ses propres spécificités et existe sous ses propres formes.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, une dispute éclate entre philosophes au sujet de moyens efficaces connaissance, à la suite de laquelle les directions de l'empirisme et du rationalisme ont pris forme.
Empirisme(Fr. Bacon, J. Locke) croit que la principale source de connaissance sur le monde et le début de notre connaissance est l'expérience. Plus méthode efficace connaissances pouvant servir à un grand nombre de la vraie connaissance, est la méthode de l'induction. Induction - le mouvement de la pensée du particulier au général.
Une forme d'empirisme est sensualisme qui croit que les impressions sensorielles sont à la base de nos connaissances (D. Locke).
Rationalisme(R. Descartes, G. Leibniz) estime que la source de la connaissance humaine sur le monde est l'esprit ("idées innées" de Descartes). Une méthode de cognition efficace et rigoureuse est la méthode de déduction. Déduction - le mouvement de la pensée du général au particulier.
Formes de connaissance:
Formes du niveau sensoriel : · Sentiment- un reflet des propriétés individuelles ou des qualités d'un objet qui affecte directement nos sens. Cependant, tout le sujet n'est pas donné. Les sentiments sont spécialisés. Les sensations visuelles nous donnent des informations sur la forme des objets, sur leur couleur, sur la luminosité des rayons lumineux. Les sensations auditives informent une personne sur divers vibrations sonores dans environnement. Le toucher nous permet de ressentir la température de l'environnement, l'impact de divers facteurs matériels sur le corps, leur pression sur celui-ci, etc. Enfin, l'odorat et le goût renseignent sur les impuretés chimiques présentes dans l'environnement et la composition des aliments consommés. Les sensations sont la seule source de connaissance humaine sur le monde environnant. Le manque de sensations du monde extérieur peut même conduire à une maladie mentale. Par exemple, une personne placée dans une chambre acoustique se trouvait dans une situation dite de privation sensorielle. Cette dernière se manifeste sous la forme d'expériences spécifiques d'isolement, de solitude, de "faim sensuelle", associées à une restriction importante ou à l'arrêt complet de l'afflux vers le centre système nerveux stimuli des organes sensoriels. · la perception- une image holistique d'un objet qui affecte nos sens. C'est fini forme complexe connaissances sensorielles, il caractérise plus complètement le sujet. La perception est basée sur des combinaisons diverses sortes sensations. Mais ce n'est pas seulement une somme mécanique d'entre eux. Les sensations reçues de divers organes sensoriels fusionnent en un seul ensemble dans la perception, formant une image sensuelle d'un objet. Ainsi, si nous tenons une pomme dans notre main, nous recevons visuellement des informations sur sa forme et sa couleur, par le toucher nous apprenons son poids et sa température, l'odeur transmet son odeur ; et si nous le goûtons, nous saurons s'il est aigre ou doux. Dans la perception, la finalité de la cognition est déjà manifestée. Nous pouvons nous concentrer sur un côté du sujet, et il sera "gonflé" dans la perception. Parmi les types de perceptions, on distingue la perception de l'espace, du temps et du mouvement. Les perceptions de l'homme sont plus développées et plus parfaites que celles des animaux. Comme l'a noté F. Engels, un aigle voit beaucoup plus loin qu'un homme, mais l'œil humain remarque beaucoup plus dans les choses que l'œil de l'aigle. · Représentation- préservation de l'image d'un objet dans l'esprit sans son impact direct sur les sens. Ceux-ci incluent - des images de mémoire, des images d'imagination (associées à la créativité, à la fantaisie). Quelque temps après que l'objet nous a touchés, nous pouvons rappeler son image dans notre mémoire (par exemple, souvenez-vous d'une pomme que nous avons tenue dans la main il y a quelque temps et que nous avons ensuite mangée). En même temps, l'image de l'objet, recréée par notre représentation, diffère de l'image qui existait dans la perception. Premièrement, elle est plus pauvre, plus pâle, en comparaison avec l'image multicolore que nous avions avec la perception directe de l'objet. Et, deuxièmement, cette image sera nécessairement plus générale, car dans la représentation, avec encore plus de force que dans la perception, se manifeste la finalité de la connaissance. Dans l'image évoquée de mémoire, la principale chose qui nous intéresse sera au premier plan. Dans la représentation, on peut aussi obtenir des images qui en réalité n'existent pas et n'ont jamais été directement perçues par une personne. Cela signifie que la représentation est liée non seulement à la mémoire, mais aussi à l'imagination, à la fantaisie. DANS mythologie grecque Par exemple, l'idée d'un centaure a été créée - mi-homme, mi-cheval, et le fantasme de nos ancêtres slaves a donné naissance à l'idée d'une sirène - une femme avec une queue de poisson au lieu de membres inférieurs . Cependant, toutes ces représentations sont basées sur de vrais fragments de réalité, qui ne sont que bizarrement combinés les uns avec les autres. Ainsi, dans notre idée d'un trait, les caractéristiques individuelles, les organes du corps que les animaux ont réellement (queue, sabots, cornes, etc.) sont interconnectés de telle manière qu'une image fantastique des "mauvais esprits" est obtenue. Formulaires de niveau rationnel : · concept- réflexion des propriétés les plus essentielles et les plus stables d'une certaine classe d'objets à l'aide de la pensée. Les concepts sont exprimés dans la langue sous forme de mots ou de phrases. Mais les mots et les concepts ne sont pas la même chose. Le concept signifie le sens et la signification du mot, de sorte qu'une personne ne pense pas en mots, mais en concepts. Par conséquent, la pensée n'est possible que sur une base linguistique, est étroitement liée à la parole et le nombre de concepts détermine l'intellect humain. La formation d'un concept est un processus dialectique complexe, comprenant : la comparaison (comparaison mentale d'un objet avec un autre, identification de signes de similitude et de différences entre eux), la généralisation (association mentale d'objets homogènes sur la base de certaines caractéristiques communes), abstraction (distinction de certains signes dans l'objet, les plus essentiels, et distraction des autres, mineurs, insignifiants). Tous ces dispositifs logiques sont étroitement liés les uns aux autres dans le processus de formation du concept. En développant, par exemple, le concept de "table", les gens, d'une part, sont distraits de ces caractéristiques privées qui ne sont pas essentielles à la formation de ce concept (inhérentes à de nombreuses tables réelles), telles que la forme (ronde, rectangulaire , ovale, etc.), la couleur, le nombre de pieds, le matériau à partir duquel les tables spécifiques sont faites, etc., et d'autre part, ceux caractéristiques communes, qui déterminent l'utilisation de cet élément (table) dans Vie courante. · Jugement- connexion de concepts, où il y a un bloc complet d'informations. Un jugement est cette forme de pensée par laquelle la présence ou l'absence de toute connexion et relation entre les objets est révélée (c'est-à-dire qu'il indique la présence ou l'absence de quelque chose dans quelque chose). La base objective du jugement est les connexions et les relations entre les objets. La nécessité des jugements (ainsi que des concepts) est enracinée dans l'activité pratique des personnes. Interagissant avec la nature dans le processus de travail, une personne cherche non seulement à distinguer certains objets des autres, mais également à comprendre leurs relations afin de réussir à les influencer. Les connexions et les relations entre les objets de pensée sont de la nature la plus diverse. Ils peuvent être entre deux objets séparés, entre un objet et un groupe d'objets, entre des groupes d'objets, etc. La variété de ces connexions et relations réelles se reflète dans la variété des jugements. Par exemple, la science a établi que le fer a une conductivité électrique. La présence de ce lien entre le fer et sa propriété individuelle permet de dire : « le fer est électriquement conducteur ». En même temps, il n'y a pas de transparence; perméabilité aux rayons lumineux. L'absence de lien du fer avec cette propriété détermine le jugement : « Le fer n'est pas transparent ». · inférence- une forme de pensée par laquelle de nouvelles connaissances sont dérivées de connaissances connues. L'inférence est une connexion de jugements, où de l'information de certains (prémisses) l'information des autres (conclusion) suit. C'est la conclusion de deux jugements ou plus en faveur d'un nouveau jugement. Voici un exemple classique de conclusion (syllogisme) : Tout le monde est mortel (prémisse 1). Homme de Socrate (prémisse 2). Par conséquent, Socrate est mortel (un nouveau jugement est une conséquence). En fait, nous pensons par inférences, et les concepts et les jugements agissent comme des "briques" pour construire des inférences. L'inférence est largement utilisée dans les connaissances quotidiennes et scientifiques. Alors, en regardant par la fenêtre le matin et en remarquant les toits humides des maisons, on en déduit facilement qu'il a plu la nuit dernière. L'intérêt des inférences réside dans le fait qu'elles relient non seulement nos connaissances à des structures mentales plus ou moins complexes, relativement complètes, mais qu'elles enrichissent et renforcent également ces connaissances. L'inférence en science est utilisée comme un moyen de connaître le passé, qui ne peut plus être observé directement. C'est sur la base d'inférences que la connaissance de l'occurrence de système solaire et la formation de la Terre, l'origine de la vie sur notre planète, l'émergence et les stades de développement de la société, etc. Mais le raisonnement en science ne sert pas seulement à comprendre le passé. Ils sont également importants pour comprendre l'avenir, qui ne peut pas encore être observé. Il existe même toute une direction scientifique - la futurologie (du latin futurum - le futur), prédisant le futur, les formes de sa formation. Avec les concepts et les jugements, les inférences surmontent les limites de la connaissance sensorielle. Ils s'avèrent indispensables là où les organes des sens sont impuissants à comprendre les causes et les conditions d'émergence de tout objet ou phénomène, à comprendre son essence, ses formes d'existence, ses schémas de développement, etc. Les inférences sont : - inductives, - déductives, - par analogie.4. L'intuition comme mode de connaissance. Le véritable processus de cognition ne se déroule pas comme un processus purement rationnel : il est toujours entrelacé avec formes irrationnelles (irrationnelles).
Irrationnel - extérieur à l'esprit, incommensurable avec la pensée :émotions, volonté, pulsions subconscientes, intuition, foi, etc.
DANS philosophie moderne et la science ne reconnaît plus la priorité inconditionnelle du rationnel sur l'irrationnel, par exemple, le rôle de l'intuition est très grand dans la connaissance scientifique.
L'intuition est directe discrétion immédiate vérité, non liée à une chaîne de raisonnements et de preuves cohérents, sans une conscience claire des voies et moyens d'obtenir un résultat, comme si une idée soudaine . Mais, en règle générale, l'intuition est précédée d'un puissant et long travail pensée logique.
Caractéristique principale intuition - son immédiateté et son intégrité.
Les "médiateurs" entre l'objet et le sujet connaissant au niveau sensuel sont les organes des sens, au niveau rationnel - les capacités abstraites-logiques d'une personne. Dans le cas de l'acquisition intuitive de connaissances, le processus de cognition s'effectue directement. En raison de son immédiateté, l'intuition a un haut degré d'intégrité : l'objet de la connaissance est capturé dans l'intuition dans son ensemble, mais l'esprit divise d'abord l'objet en parties, les connaît séparément, puis essaie de synthétiser les résultats.
Ainsi, les intuitions sont particulières :
Le caractère inattendu de la solution du problème ;
Inconscience des voies et moyens de sa solution;
Immédiateté de la compréhension de la vérité ;
Intégrité dans la perception des objets.
L'intuition est courante à la fois dans des conditions ordinaires, quotidiennes (dans une situation non standard qui nécessite une solution rapide dans des conditions d'informations limitées, une personne semble avoir le pressentiment qu'il faut faire ceci et pas autrement), et dans l'histoire de la culture humaine (très souvent des scientifiques, des designers, des artistes ont obtenu des résultats fondamentalement nouveaux grâce à une « perspicacité », « sur un coup de tête »).
Par exemple, A. Einstein a déclaré que l'idée de la relativité de la simultanéité lui était venue à la suite d'une soudaine supposition intuitive. Un matin, au réveil, il réalise soudain que des événements se produisant simultanément pour un observateur peuvent ne pas être simultanés pour un autre.
Notez cependant que parfois l'intuition n'est pas prise pour ce qu'elle est. Par exemple, les inférences, dont les prémisses ne sont pas formulées explicitement, et dont le résultat semble donc inattendu, ne sont pas intuitives. Il n'est pas nécessaire d'attribuer à l'intuition aussi des réactions selon le type d'automatismes du domaine des instincts.
Types d'intuition :
Selon les spécificités de l'activité du sujet, on peut distinguer technique, scientifique, quotidien, médical, artistique etc.;
De par la nature de la nouveauté du résultat, l'intuition est standardisé Et heuristique.
Intuition standardisée appelé intuition - réduction (réduction). Un exemple est l'intuition médicale de S.P. Botkine. On sait que pendant que le patient marchait de la porte à la chaise, S.P. Botkin a fait mentalement un diagnostic préliminaire. La plupart de ses diagnostics intuitifs se sont réalisés. Dans ce cas, comme pour tout diagnostic, il y a un résumé du particulier (un complexe de symptômes chez un patient) sous le général (une certaine «matrice» - un schéma de la maladie en général).
Heuristique (créatif) l'intuition est associée à la formation d'un savoir fondamentalement nouveau, de nouvelles images cognitives, sensuelles ou conceptuelles. Le même S. P. Botkin en tant que clinicien, développant la théorie de la médecine, basée sur l'intuition, a avancé une hypothèse sur la nature infectieuse de la jaunisse catarrhale (maladie de Botkin).
POUR conditions générales La formation et la manifestation de l'intuition peuvent être attribuées à ce qui suit :
1) formation professionnelle approfondie d'une personne, connaissance approfondie du problème;
2) situation de recherche, état du problème ;
3) action dans le sujet de la recherche dominante; basé sur des tentatives continues pour résoudre un problème, des efforts acharnés pour résoudre un problème ou une tâche ;
4) la présence d'un indice qui sert de déclencheur à l'intuition.
Comme un tel indice pour I. Newton était, comme vous le savez, une pomme qui est tombée sur sa tête, ce qui a provoqué l'idée la gravité; pour l'ingénieur des ponts S. Brown - une toile suspendue entre les branches, ce qui lui a donné l'idée d'un pont suspendu.
Certains chercheurs pensent que la capacité intuitive s'est apparemment formée à la suite du long développement des organismes vivants en raison de la nécessité de prendre des décisions avec des informations incomplètes sur les événements. La capacité de savoir intuitivement, en fait, est une réponse probabiliste aux conditions probabilistes de l'environnement. Dans le processus de découverte, le scientifique, en effet, ne reçoit pas toutes les prémisses et tous les moyens, donc, dans l'intuition, il fait précisément un choix probabiliste.
La nature probabiliste de l'intuition signifie pour une personne à la fois la possibilité d'obtenir une connaissance vraie et le danger d'avoir une connaissance erronée et fausse. Le physicien anglais M. Faraday, connu pour ses travaux dans le domaine de l'électricité, du magnétisme, de l'électrochimie, a écrit que personne ne soupçonne combien de conjectures et de théories qui surgissent dans la tête d'un chercheur sont détruites par sa propre critique, et à peine un dixième de toutes ses hypothèses et espoirs se réalisent. .
L'attitude envers l'intuition en Orient est complètement différente. Tout d'abord, la connaissance intuitive est aussi familière à la culture orientale que la connaissance rationnelle l'est aux Européens. Dans la culture orientale traditionnelle, l'intuition n'est pas perçue comme quelque chose d'aléatoire et de probabiliste : la connaissance intuitive est considérée comme plus élevée que la connaissance rationnelle.
La théorie de la connaissance (épistémologie) est une branche de la philosophie qui étudie les problèmes de la nature de la cognition et de ses capacités, la relation de la connaissance à la réalité, explore les conditions générales préalables à la cognition et identifie les conditions de sa fiabilité et de sa vérité.
Le sujet est une seule personne concrète, un groupe de personnes et l'humanité dans son ensemble.
L'objet est l'entière réalité existante, le processus de cognition dans tous les cas est actif.
Niveaux de connaissances :
1) Sensuel (empirique) - connaissance du monde à l'aide des sens. Il existe 3 formes de connaissances sensorielles : a) les sensations - uniquement les propriétés de l'objet, l'objet devant les yeux, à travers les sens. b) perception - une image d'un objet, directement devant les yeux, à travers les sens (une image holistique). c) représentation - une image d'un objet qui est stockée dans l'esprit sans impact direct sur les sens.
Caractéristiques de la cognition sensorielle :
Le résultat est image visuelle matière
Ne sépare pas les caractéristiques essentielles des non essentielles
subjectivement, parce que les sens de chacun sont différents
Il y a des objets et des phénomènes qui ne peuvent être connus à l'aide des sens.
Présent chez les animaux
Est la base de la connaissance rationnelle
2) Connaissance rationnelle - connaissance du monde à l'aide d'opérations mentales (comparaison, assimilation, abstraction, généralisation). Formes: a) concept - une pensée avec laquelle vous pouvez mettre en évidence le général et caractéristiques distinctives. b) jugement - une pensée qui affirme ou nie une idée précédemment formée. c) inférence - une pensée qui établit un lien logique entre les jugements.
Particularités :
Basé sur le résultat de la cognition sensorielle
Aucun effet direct de l'article
Il est possible d'étudier des objets qui ne peuvent pas être étudiés avec la cognition sensorielle.
Le résultat est une véritable connaissance du sujet
Formes (voies) de connaissance :
1. Connaissances non scientifiques : A) quotidiennes (ordinaires) : basées sur l'expérience personnelle et le bon sens, assez conservatrices, ont un langage particulier (une poignée). B) sagesse populaire: résume l'expérience des générations, exprimée sous forme d'énigmes, de proverbes et de dictons, assez contradictoires. C) artistique : le résultat est une image artistique, assez subjective, a une coloration émotionnelle, le langage des symboles (couleurs, sons) agit. D) mythologique : remplace l'explication par une histoire, sert à transmettre des valeurs culturelles et expérience de la vie gens. E) parascience (astrologie, chiromancie): pénètre dans un espace inexploré, ne traite pas de faits, mais d'hypothèses, en évitant les explications spécifiques.
2. La connaissance scientifique est la forme principale de la connaissance humaine, qui s'exprime sous la forme d'une activité mentale et sujet-pratique. Caractéristiques : objectivité, prouvée par la pratique ; ne traite que de ce qui existe réellement et peut être observé ; est systémique : fait → hypothèse → loi → théorie ; soumis à un examen constant, c'est-à-dire ouvert à la critique rationnelle; s'appuie sur l'expérience des prédécesseurs; a son propre langage scientifique; reproductibilité des résultats obtenus.
3. Cognition sociale : le sujet et l'objet de la cognition coïncident ; le rôle du facteur subjectif (lié aux intérêts des individus et des groupes) ; la société est un objet difficile à étudier, car il n'y a pas d'événements répétitifs, et aussi des personnes douées de volonté agissent; utilisation limitée de méthodes telles que l'observation et l'expérimentation.
4. Connaissance de soi - le processus de compréhension des caractéristiques de sa propre personnalité (ses intérêts, sa volonté, ses capacités). L'image du "je" est une représentation relativement stable d'une personne sur elle-même, exprimée sous forme verbale. L'estime de soi est une attitude émotionnelle envers sa propre image de soi.
Cognition est le processus de compréhension par une personne de nouvelles connaissances jusque-là inconnues.
Structure processus d'apprentissage:
- Le sujet de la cognition est un individu agissant activement, un groupe social ou la société dans son ensemble, doté d'une conscience et d'un objectif.
- L'objet de la connaissance est ce que vise l'activité cognitive du sujet. Il peut être animé (la personne elle-même, animal) et inanimé (phénomènes de la nature) ; matériel (objet réellement existant) ou idéal (hypothèse, théorie).
- Le résultat de la cognition - la connaissance - est un produit de la relation de la pensée à la réalité, existant sous une forme logiquement linguistique, sous la forme de concepts, de jugements, de symboles, de signes.
Caractéristiques des principaux types de connaissances
La question du rapport entre le sensuel et le rationnel a fait émerger deux courants philosophiques.
Empirisme- la seule source de toutes nos connaissances est l'expérience sensorielle.
Rationalisme- notre connaissance ne peut être obtenue qu'avec l'aide de l'esprit, sans compter sur les sentiments.
Mais il est impossible d'opposer le sensuel et le rationnel dans la cognition, puisque les deux stades de la cognition apparaissent comme un processus unique. La différence entre eux n'est pas temporaire, mais qualitative : le premier étage est le plus bas, le second est le plus élevé. La connaissance est l'unité de la connaissance sensuelle et rationnelle de la réalité.
Connaissances- le résultat de la connaissance de la réalité, le contenu de la conscience.
Types de connaissances :
Illusion- une connaissance qui ne correspond pas à un objet réel, mais qui est acceptée comme vérité. Un mensonge est une déformation délibérée de l'image d'un objet.
Zhiteiskoe- fondé sur le bon sens, formé à partir du quotidien des gens, réduit à énoncer des faits et à les décrire.
Pratique- la base est l'activité des personnes pour répondre à leurs besoins.
artistique- se construit sur l'image, caractérisée par l'émotivité, la subjectivité.
Scientifique- caractérisé par le désir d'objectivité, de cohérence, de cohérence, existe sous forme de concepts et de catégories, principes généraux, lois, théories.
Rationnel- reflète la réalité en termes, repose sur une pensée rationnelle.
Irrationnel- reflète la réalité dans les émotions, souvent basée sur l'intuition, n'obéit pas aux lois de la logique.
Formes de connaissance
| Scientifique- des connaissances objectives, systématiquement organisées et justifiées | |
| niveau empirique méthodes : – observations ; – expérimenter ; - la description. |
niveau théorique
méthodes : – induction (du particulier au général); - déduction (du général au particulier) ; - analyse (décomposition du tout en parties) - synthèse (combinaison des connaissances individuelles en un tout unique) |
| Peu scientifique- des connaissances disparates, non systématisées, non formalisées et non décrites par les lois | |
| pré-scientifique - prérequis pour la connaissance scientifique parascientifique - incompatible avec l'existant savoir scientifique pseudoscientifique - utilisant délibérément la spéculation et les préjugés anti-scientifique - utopique et déformant délibérément l'idée de réalité |
|
Caractéristiques de la cognition sociale :
- le sujet et l'objet de la cognition coïncident (la société s'étudie, le sociologue voit le processus de l'intérieur, puisqu'il est lui-même un participant relations publiques. Il joue donc un grand rôle évaluation personnelle phénomènes sociaux);
- les possibilités du chercheur sont limitées (il n'est pas toujours possible de mener une expérience) ;
- la complexité et la variabilité de l'objet d'étude engendrent un pluralisme des points de vue sur la société.
Quand on étudie la société, il faut appliquer approche historique concrète:
- établir la relation entre le passé et le futur ;
- identifier les schémas communs, il faut se souvenir de l'originalité et de l'originalité chemin historique peuples, pays, régions ;
- étudier les phénomènes sociaux dans leur diversité et leur interdépendance ;
- de considérer l'activité en cours comme une conséquence de la précédente.
Caractéristiques de la cognition au moyen de l'art :
- coloration émotionnelle;
- réalisée à l'aide d'images.
Image- c'est un reflet de la réalité, qui a certaines propriétés d'un objet réellement existant, réfracté à travers le monde intérieur du créateur (artiste, réalisateur, écrivain).
Canon- un ensemble de règles appliquées pour créer une image. Il se caractérise par les particularités de la vision du monde de l'époque. (Par exemple, dans la période de l'Antiquité, la beauté du corps humain, la proportionnalité est chantée; au Moyen Âge, le corps est perçu comme quelque chose de pécheur, il est donc représenté à plat, recouvert de vêtements).
Même avant l'émergence de la science, dans le cadre de leurs activités pratiques quotidiennes, les gens recevaient les connaissances dont ils avaient besoin sur les propriétés et les caractéristiques des objets et des phénomènes. Connaissances- c'est un résultat testé par la pratique de la connaissance de la réalité, son véritable reflet dans l'esprit humain. La fonction principale de la connaissance est la généralisation d'idées disparates sur les lois de la nature, de la société et de la pensée.
La connaissance peut être relative ou absolue.
connaissance relative est le reflet de la réalité avec une correspondance incomplète de l'échantillon avec l'objet.
Connaissance absolue - il s'agit d'une reproduction complète et exhaustive d'idées généralisées sur l'objet, qui assurent une correspondance absolue entre l'échantillon et l'objet.
Le mouvement de la pensée humaine de l'ignorance à la connaissance s'appelle connaissances. Sa base est le reflet de la réalité objective dans l'esprit d'une personne au cours de ses activités pratiques (industrielles, sociales et scientifiques). Par conséquent, l'activité cognitive d'une personne est causée par la pratique et vise la maîtrise pratique de la réalité. Ce processus est sans fin, puisque la dialectique de la cognition s'exprime dans la contradiction entre la complexité illimitée de la réalité objective et la limitation de notre connaissance.
Le but principal de la connaissance est la réalisation de la vraie connaissance, qui se réalise sous la forme de dispositions et conclusions théoriques, de lois et d'enseignements, confirmés par la pratique et existant objectivement, indépendamment de nous.
Il existe deux types de connaissances : sensorielles (ordinaires) et scientifiques (rationnelles). Cognition sensorielle est une conséquence du lien direct de l'homme avec l'environnement. La cognition du monde par une personne et l'interaction avec elle sont réalisées grâce au fonctionnement des organes de la vision, de l'ouïe, du toucher, du goût. La cognition sensorielle apparaît sous 3 formes, qui sont des étapes de la cognition : la sensation, la perception, la représentation (imagination).
Sentiment - c'est une réflexion par le cerveau humain des propriétés des objets ou des phénomènes du monde objectif, qui sont perçus par ses organes sensoriels. Les sensations sont la source de toute connaissance, mais elles donnent une connaissance des propriétés individuelles des objets, et une personne traite non seulement des propriétés individuelles, mais aussi de l'objet dans son ensemble, avec une combinaison de propriétés.
La contradiction entre sensation et activité est résolue par l'apparition d'une forme supérieure de connaissance sensorielle - la perception.
la perception - c'est une réflexion par le cerveau humain des propriétés d'objets ou de phénomènes dans leur ensemble, perçues par ses sens dans une certaine période de temps, et donne l'image sensuelle primaire d'un objet ou d'un phénomène. La perception est un reflet, une copie, une image d'un ensemble de propriétés, et non d'une seule d'entre elles. L'objet se reflète dans le cerveau humain. La perception donne la connaissance des objets, des choses, pas des propriétés. Mais la perception est également limitée. Il ne donne de connaissance que lorsque l'objet perçu est disponible, existe maintenant. Mais l'activité humaine a également besoin de connaissances sur les objets qui ont été perçus dans le passé ou qui peuvent être perçus (répétés) dans le futur.
La forme la plus élevée de la connaissance sensorielle est la représentation. Représentation est une image secondaire d'un objet ou d'un phénomène, qui dans ce moment le temps n'affecte pas les sens humains, mais ils doivent avoir agi plus tôt. Il s'agit d'une reproduction dans le cerveau humain en les connectant dans un système intégral. La représentation peut reproduire le passé, les images de ces objets qui agissaient autrefois sur les sens - comme pour le remettre devant nous. La représentation peut donner une connaissance du futur (par exemple, une idée de quelque chose basée sur ce que nous avons lu, entendu, etc.).
Ainsi, avec l'aide de la cognition sensorielle, nous acquérons les connaissances nécessaires sur les propriétés et les caractéristiques des choses et des phénomènes que nous rencontrons dans nos activités pratiques quotidiennes.
Connaissances scientifiques (rationnelles) - il s'agit d'une réflexion indirecte et généralisée dans le cerveau humain de propriétés essentielles, de relations causales et de connexions régulières entre objets et phénomènes. La connaissance scientifique n'est pas séparée par une ligne insurmontable du sensuel (ordinaire), car elle représente son amélioration et son développement ultérieurs. Il complète et anticipe la cognition sensorielle, favorise la prise de conscience de l'essence des processus en cours et révèle les schémas de leur développement.
La connaissance scientifique est une activité cognitive menée consciemment, qui repose sur une réflexion indirecte et généralisée des propriétés et des relations des objets et des phénomènes dans leur contradiction et leur développement. C'est un processus délibéré.
La connaissance scientifique est associée à une relation sensuelle (ordinaire) de continuité, ce qui signifie :
il a un objectif commun - donner une connaissance objective et vraie de la réalité;
la connaissance scientifique naît sur la base du sens commun de la connaissance sensorielle, c'est-à-dire et les connaissances sensorielles et scientifiques sont fondées sur le principe du réalisme.
La cognition scientifique soumet la critique rationnelle aux positions initiales de la cognition sensorielle, en utilisant pour cela des méthodes de recherche spécifiques et théoriques, et réalise ainsi des progrès dans la compréhension et l'explication des phénomènes étudiés.
Les connaissances scientifiques diffèrent des connaissances sensorielles (ordinaires) par leur nature systémique et cohérente à la fois dans le processus de recherche de nouvelles connaissances et dans l'ordonnancement de toutes les connaissances trouvées et disponibles. Il se caractérise par la cohérence, qui s'exprime dans sa construction logique, l'élimination des contradictions entre ses éléments individuels. Par conséquent, des méthodes spécifiques de construction, de systématisation et de justification des connaissances sont inhérentes aux connaissances scientifiques.
La connaissance scientifique a plusieurs caractéristiques :
se concentrer sur la production de connaissances;
une allocation claire du sujet de connaissance, qui est associée à la fragmentation de la réalité étudiée, l'allocation de ses différents niveaux structurels ;
utilisation d'outils spécialisés;
régulation par un certain ensemble de méthodes et d'autres types de connaissances normatives (principes, idéaux et normes, style de pensée scientifique);
la présence d'un langage spécialisé qui s'adapte en permanence aux spécificités des actions cognitives.
Dans la connaissance scientifique, il y a deux niveaux :
empirique;
théorique.
Au niveau empirique des faits sont collectés (événements enregistrés, phénomènes, propriétés, relations), des données statistiques sont obtenues à partir d'observations, de mesures, d'expériences et de leur classification.
Niveau théorique la connaissance est caractérisée par la comparaison, la construction et le développement d'hypothèses et de théories scientifiques, la formulation de lois et la dérivation de leurs conséquences logiques pour l'application des connaissances théoriques dans la pratique.