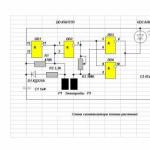Le problème de la question principale de la philosophie et diverses options pour sa solution. La philosophie en bref : la question fondamentale de la philosophie
1. Principal traditionnellement considéré en philosophie la question du rapport de la pensée à l'être, et de l'être à la pensée (conscience).
L'importance de cette question réside dans le fait que la construction d'une connaissance holistique du monde qui nous entoure et de la place de l'homme dans celui-ci dépend de sa résolution fiable, et c'est la tâche principale de la philosophie.
La matière et la conscience (l'esprit) sont deux caractéristiques inséparables et en même temps opposées de l'être. A cet égard, il y a les deux faces de la question principale de la philosophie- ontologique et épistémologique.
ontologique Le côté (existentiel) de la question principale de la philosophie réside dans la formulation et la solution du problème : qu'est-ce qui est primaire - la matière ou la conscience ?
essence épistémologique (cognitif) côtés de la question principale : le monde est-il connaissable ou inconnaissable, qu'est-ce qui est primordial dans le processus de cognition ?
Selon les aspects ontologiques et épistémologiques de la philosophie, les principales directions sont distinguées - respectivement, le matérialisme et l'idéalisme, ainsi que l'empirisme et le rationalisme.
En considérant le côté ontologique (existentiel) de la question principale de la philosophie, nous pouvons distinguer de telles directions, comme:
Idéalisme objectif;
Idéalisme subjectif;
Matérialisme;
Matérialisme vulgaire;
Dualisme;
côté épistémologique (cognitif) :
Gnosticisme;
agnosticisme;
Empirisme (sensualisme);
Rationalisme.
2. côté ontologique La question principale de la philosophie est :
Matérialisme;
Idéalisme;
Dualisme.
Matérialisme(soi-disant "lignée de Démocrite")- une direction de la philosophie, dont les partisans croyaient que dans la relation entre matière et conscience, la matière est primordiale.
Ainsi:
La matière existe réellement ;
La matière existe indépendamment de la conscience (c'est-à-dire qu'elle existe indépendamment des êtres pensants et que quelqu'un y pense ou non) ;
La matière est une substance indépendante - n'a pas besoin de son existence dans autre chose qu'elle-même;
La matière existe et se développe selon ses lois internes ;
La conscience (esprit) est une propriété (mode) de la matière hautement organisée de se refléter (matière) ;
La conscience n'est pas une substance indépendante existant avec la matière ;
La conscience est déterminée par la matière (l'être).
Des philosophes comme Démocrite appartenaient au courant matérialiste ; les philosophes de l'école de Milet (Thalès, Anaximandre, Anaximène) ; Epicure; Bacon; Locke; Spinosa; Diderot et autres
matérialistes français; Herzen; Tchernychevski; Marx; Engels ; Lénine.
La vertu du matérialisme est sa confiance dans la science. en particulier sur l'exact et le naturel (physique, mathématiques, chimie, etc.), la prouvabilité logique de nombreuses positions des matérialistes.
Le côté faible du matérialisme est une explication insuffisante de l'essence de la conscience, la présence de phénomènes du monde environnant qui sont inexplicables du point de vue des matérialistes.
Dans le matérialisme, une direction particulière se démarque - matérialisme vulgaire. Ses représentants (Vocht, Moleschott) absolutisent le rôle de la matière, sont trop emportés par l'étude de la matière du point de vue de la physique, des mathématiques et de la chimie, son côté mécanique, ignorent la conscience elle-même en tant qu'entité et sa capacité à influencer la matière en réponse.
Le matérialisme en tant que tendance dominante en philosophie était répandu dans la Grèce démocratique, les États hellénistiques, l'Angleterre pendant la période de la révolution bourgeoise (XVIIe siècle), la France au XVIIIe siècle, l'URSS et les pays socialistes au XXe siècle.
Idéalisme ("ligne de Platon")- une direction de la philosophie, dont les tenants de la relation entre matière et conscience considéraient la conscience (idée, esprit) comme primordiale.
Dans l'idéalisme, il y a deux orientations indépendantes :
Idéalisme objectif (Platon, Leibniz, Hegel et autres);
Idéalisme subjectif (Berkeley, Hume).
Fondateur idéalisme objectif considère Platon. Selon le concept d'idéalisme objectif :
Seule l'idée existe réellement ;
L'idée est primaire;
Toute la réalité environnante est divisée en « monde des idées » et « monde des choses » ;
le « monde des idées » (eidos) existe initialement dans l'Esprit du Monde (Plan Divin, etc.) ;
"le monde des choses" - le monde matériel n'a pas d'existence indépendante et est l'incarnation du "monde des idées";
Chaque chose est l'incarnation de l'idée (eidos) de cette chose (par exemple, un cheval est l'incarnation de l'idée générale d'un cheval, une maison est l'idée d'une maison, un navire est l'idée d'un navire, etc.);
Dieu le Créateur joue un grand rôle dans la transformation d'une "idée pure" en une chose concrète ;
Les idées séparées ("le monde des idées") existent objectivement indépendamment de notre conscience.
Contrairement aux idéalistes objectifs idéalistes subjectifs(Berkeley, Hume et autres) pensaient que :
Tout n'existe que dans la conscience du sujet connaissant (l'homme) ;
Les idées existent dans l'esprit humain ;
Les images (idées) des choses matérielles n'existent également que dans l'esprit humain à travers les sensations sensorielles ;
En dehors de la conscience d'un individu, ni matière ni esprit (idées) n'existent.
Une caractéristique faible de l'idéalisme est l'absence d'une explication fiable (logique) de l'existence même des «idées pures» et de la transformation d'une «idée pure» en une chose concrète (le mécanisme d'émergence de la matière et des idées).
L'idéalisme en tant que tendance philosophique a dominé dans la Grèce platonicienne, au Moyen Âge, et est actuellement répandu aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe occidentale.
Ainsi que directions principales polaires (concurrentes) de la philosophie - matérialisme et idéalisme - il y a courants intermédiaires (de compromis) - dualisme, déisme.
Dualisme comme direction philosophique a été fondée par Descartes. L'essence du dualisme chose est:
Exister deux substances indépendantes matériel (ayant la propriété d'extension) et spirituel (ayant la propriété de penser) ;
Tout dans le monde dérive (est un modus) soit de l'une, soit de l'autre des substances indiquées (les choses matérielles - du matériel, les idées - du spirituel) ;
Chez une personne, deux substances sont combinées en même temps - à la fois matérielle et spirituelle;
La matière et la conscience (esprit) sont deux faces opposées et interconnectées d'un même être ;
la question principale de la philosophie (qui est primordiale - la matière ou la conscience) n'existe pas vraiment, puisque la matière et la conscience se complètent et existent toujours. Déisme- direction en philosophie, dont les partisans
(principalement des éclaireurs français du XVIIIe siècle) ont reconnu l'existence de Dieu, qui, à leur avis, ayant une fois créé le monde, ne participe plus à son développement ultérieur et n'affecte pas la vie et les actions des gens (c'est-à-dire qu'ils ont reconnu Dieu, qui n'a pratiquement aucun "pouvoir" , qui ne devrait servir que de symbole moral). Les déistes considéraient également la matière comme étant spiritualisée et n'opposaient pas la matière et l'esprit (la conscience).
3. Côté gnoséologique la question principale de la philosophie est présentée:
Empirisme (sensualisme);
Rationalisme.
Fondateur empirisme est un F. Bacon.
Les empiristes croyaient que la connaissance ne peut être basée que sur l'expérience et les sensations sensorielles("Il n'y a rien dans les pensées (dans l'esprit) qui n'aurait pas été auparavant dans l'expérience et les sensations sensorielles").
fondateur rationalisme(de lat. rapport - l'esprit) est considéré R. Descartes.
L'idée principale du rationalisme est que la vraie connaissance (fiable) ne peut être dérivée que directement de l'esprit et ne dépend pas de l'expérience sensorielle. (Premièrement, seul le doute en tout existe réellement, et le doute - la pensée - est l'activité de l'esprit. Deuxièmement, il y a des vérités qui sont évidentes pour l'esprit (axiomes) et n'ont besoin d'aucune preuve expérimentale - "Dieu existe", " Aux angles carrés égaux", "Le tout est plus grand que sa partie", etc.)
Comme direction spéciale, irrationalisme(Nietzsche, Schopenhauer). Selon les irrationalistes, le monde est chaotique, n'a pas de logique interne et ne sera donc jamais connu par l'esprit.
Les concepts de gnosticisme et d'agnosticisme sont liés au côté épistémologique de la question principale de la philosophie.
Représentants gnosticisme(habituellement matérialistes) croient que :
Nous connaissons le monde;
Les possibilités de connaissance sont illimitées. Le point de vue opposé est tenu agnostiques
(généralement idéalistes):
Le monde est inconnaissable ;
Les possibilités de cognition sont limitées par les possibilités cognitives de l'esprit humain.
Parmi les théoriciens éminents de l'agnosticisme figurait Immanuel Kant (1724-1804). Selon Kant, l'esprit humain a de grandes possibilités, mais ces possibilités ont aussi leurs limites. Sur la base de la finitude et des limites des capacités cognitives de l'esprit humain, il existe des énigmes (contradictions) qui ne seront jamais résolues par une personne, par exemple :
Dieu existe Dieu n'existe pas
Au total, Hunt distingue quatre de ces contradictions insolubles (antinomies) (voir question 36 "La philosophie d'Emmanuel Kant").
Cependant, selon Kant, même ce qui est inclus dans les capacités cognitives de l'esprit humain ne sera toujours jamais connu, puisque l'esprit ne peut connaître que le reflet d'une chose dans les sensations sensorielles, mais ne connaîtra jamais l'essence intérieure de cette chose - "chose en soi".
4. Aujourd'hui, malgré des milliers d'années de recherche de philosophes, question fondamentale de la philosophie n'a pas été résolu de manière fiable ni du côté ontologique ni épistémologique, et est en fait problème philosophique éternel (non résolu).
Au vingtième siècle dans la philosophie occidentale, on a eu tendance à accorder moins d'attention à la question fondamentale traditionnelle de la philosophie, car elle est difficile à résoudre et perd progressivement de sa pertinence.
Jaspers, Heidegger, Camus et d'autres ont jeté les bases du fait qu'une autre question fondamentale de la philosophie pourrait apparaître à l'avenir - problème d'existentialisme c'est-à-dire le problème d'une personne, son existence, la gestion de son propre monde spirituel, les relations au sein de la société et avec la société, son libre choix, la recherche du sens de la vie et de sa place dans la vie, le bonheur.
Introduction
3. Approche moderne pour comprendre la question principale de la philosophie
Conclusion
Bibliographie
Introduction
La philosophie est un système généralisé de vues sur le monde et la place de l'homme dans celui-ci. De telles vues sont un ensemble de connaissances acquises rationnellement, basées sur des questions et le désir infatigable d'une personne d'y répondre. Mais la nature de la connaissance est telle que la réponse à une question donne souvent lieu à une foule d'autres questions et parfois non seulement clarifie, mais confond encore plus le problème, aiguisant la curiosité humaine et suscitant de nouvelles recherches.
Tout étudiant en philosophie, tôt ou tard naturellement, a intérêt à ce qu'il y ait de telles questions, problèmes en philosophie qui seraient primordiaux par rapport à tous les autres, c'est-à-dire les plus importants, les principaux, les fondamentaux. Ce sujet intéresse non seulement les débutants, mais aussi les philosophes professionnels, parmi lesquels certains y prêtent une attention sérieuse, tandis que d'autres, au contraire, ne le considèrent pas pertinent. Et pourtant, si l'on jette un regard général sur toute la longue histoire de la philosophie, il n'est pas difficile de voir que les problèmes philosophiques « éternels » concernant l'origine, la genèse, l'essence, l'univers et l'homme, ainsi que, par exemple, les le sens de la vie, la nature de la connaissance humaine, etc. etc., sont présents d'une manière ou d'une autre dans tous les enseignements philosophiques, fragmentaires ou, au contraire, sont discutés en détail dans divers ouvrages philosophiques, peu importe à qui ils appartiennent exactement et à quelle époque ils appartiennent.
1. Interprétation traditionnelle de la question principale de la philosophie
Il est difficile de trouver un philosophe qui ne révélerait pas son attitude à l'égard de ce que sont la conscience, la pensée, l'esprit, l'idéal et comment ils se rapportent à la matière, à la nature, à l'être. Cette circonstance a donné à F. Engels (1820-1895) une base en son temps pour formuler la soi-disant "question fondamentale de la philosophie", dans laquelle deux côtés sont distingués.
Le premier concerne le rapport entre le matériel et l'idéal. La question est posée ainsi : « Qu'est-ce que le primaire, la matière ou l'esprit (la conscience) ? ou, comme le disait F. Engels lui-même : « La grande question fondamentale de toute philosophie, surtout de la dernière, est la question du rapport de la pensée à l'être.
Le second volet est étroitement lié au premier et se formule ainsi : « Connaît-on le monde ? En d'autres termes : « Pouvons-nous, dans nos idées et concepts du monde réel, constituer un véritable reflet de la réalité ?
Selon la façon dont certains philosophes répondent à la première question, ils se divisent en matérialistes (qui croient que le monde est à l'origine matériel, et la conscience est un produit de cette matière) et idéalistes (qui croient qu'à la base du monde il y a quelque chose d'idéal , précédant la matière et la créatrice de celle-ci). Ces concepts seront abordés plus en détail dans la section suivante.
Dans les réponses à la question sur la connaissabilité du monde chez les philosophes, il existe également différentes approches, où deux positions extrêmes sont distinguées. L'un d'eux s'appelle l'optimisme épistémologique, selon lequel on pense que les capacités cognitives d'une personne sont en principe illimitées et qu'elle pourra tôt ou tard découvrir les lois de la nature et de la société qui l'intéressent, révéler l'essence des choses et établir la véritable image du monde. Dans ce contexte, il convient de mentionner G.V. Hegel, K. Marx et de nombreux partisans de ses enseignements.
Une autre position est prise par les agnostiques, qui croient que la connaissance complète (ou même partielle) du monde, de l'essence des choses et des phénomènes est en principe impossible. De telles vues sont les plus caractéristiques de D. Hume. En règle générale, I. Kant est également inclus ici, ce qui est controversé et suscite des discussions dans l'environnement philosophique.
2. Les grandes orientations de la philosophie : matérialisme et idéalisme
Matérialisme et idéalisme ne sont pas homogènes dans leurs manifestations concrètes. En fonction de cela, diverses formes de matérialisme et d'idéalisme peuvent être distinguées.
Il existe deux variétés d'idéalisme - objectif et subjectif.
Les idéalistes objectifs incluent ceux qui reconnaissent le début de toutes choses comme quelque chose d'intangible et d'indépendant de la conscience humaine (c'est-à-dire existant objectivement) - cela peut être Dieu, l'esprit du monde, une idée, l'esprit universel, etc. dans l'histoire de la philosophie, Platon, F. Aquinas, G.V. Hegel, V. Solovyov, N. Berdyaev et autres Dans le cas où le monde n'est vu qu'à travers le prisme de la conscience individuelle (subjective), on parle d'idéalisme subjectif, dont les principaux représentants sont J. Berkeley, D. Hume, I.G. Fichte. La forme extrême de l'idéalisme subjectif est le solipsisme. Selon laquelle on ne peut parler avec certitude que de l'existence de mon propre « moi » et de mes sensations.
Dans le cadre de ces formes d'idéalisme, il en existe diverses variétés. Par exemple, le rationalisme et l'irrationalisme. Selon le rationalisme idéaliste, la base de tout ce qui existe et de sa connaissance est l'esprit. L'une de ses directions les plus importantes est le panlogisme, selon lequel tout réel est l'incarnation de la raison et les lois de l'être sont déterminées par les lois de la logique (Hegel). Le point de vue de l'irrationalisme consiste à nier la possibilité d'une connaissance rationnelle et logique de la réalité. Le type principal de cognition est ici reconnu comme l'instinct, la foi, la révélation, etc., et l'être lui-même est considéré comme irrationnel (S. Kierkegaard, A. Bergson, M. Heidegger, etc.).
Il y a aussi beaucoup d'écoles et de tendances matérialistes dans l'histoire de la philosophie. Ainsi, les premiers philosophes parlaient de l'incréation et de l'indestructibilité de la matière. Les représentants de ce soi-disant "matérialisme naïf" comprennent d'anciens philosophes chinois : Lao-tseu, Yang Zhu ; les anciens philosophes indiens de l'école Lokayata ; philosophes célèbres de l'Antiquité: Héraclite, Empédocle, Démocrite, Épicure, etc. À l'époque moderne, alors qu'il y avait une formation et un développement actifs de la mécanique classique, le "matérialisme mécaniste" est devenu largement connu (G. Galileo, F. Bacon, J. Locke , P. Holbach , P. Gassendi, J. La Mettrie). Il est basé sur l'étude de la nature. Cependant, toute la diversité de ses propriétés et de ses relations est réduite à une forme mécaniste de mouvement de la matière.
Il existe également des variétés de matérialisme telles que, par exemple, le matérialisme cohérent, dans lequel le principe du matérialisme s'étend à la fois à la nature et à la société, et le matérialisme incohérent, dans lequel il n'y a pas de compréhension matérialiste de la société et de l'histoire (L. Feuerbach). Une forme spécifique de matérialisme incohérent est le déisme, dont les représentants, bien qu'ils aient reconnu Dieu, ont fortement rabaissé ses fonctions, les réduisant à la création de la matière et lui donnant l'impulsion initiale du mouvement (F. Bacon, J. Toland, B. Franklin, M.V. Lomonossov) . De plus, une distinction est faite entre le « matérialisme scientifique » et le « matérialisme vulgaire ». Celle-ci réduit l'idéal au matériel, la conscience s'identifie à la matière (Vogt, Moleschott, Buechner). Et, enfin, le "matérialisme dialectique" largement connu de K. Marx, F. Engels et leurs nombreux disciples, dans lequel matérialisme et dialectique sont présentés dans une unité organique.
Notons cependant que certains philosophes, appelés matérialistes et idéalistes selon cette classification, peuvent eux-mêmes ne se référer à aucune de ces tendances, considérant une telle division comme une schématisation et une simplification injustifiées. La base de ces vues est que, étant formulée directement et sous une forme catégorique, lorsque d'autres approches pour comprendre ce problème sont ignorées, la "question fondamentale de la philosophie" divise nécessairement absolument tous les philosophes en deux grands camps opposés - les matérialistes et les idéalistes. Mais ici, il est important d'aborder la question de la relation et de la nature de l'interaction entre le matérialisme et l'idéalisme. En même temps, monisme, dualisme, pluralisme sont distingués.
Le monisme est un concept philosophique selon lequel le monde a un commencement. Ce commencement est une substance matérielle ou spirituelle. Il s'ensuit que le monisme peut être de deux types - matérialiste et idéaliste. Le premier fait sortir la matière de la matière. Selon la seconde, le matériel est conditionné par l'idéal.
Le dualisme est une doctrine philosophique qui affirme l'égalité de deux principes : la matière et la conscience, le physique et le mental. Ainsi, par exemple, R. Descartes croyait que deux substances égales se trouvent à la base de l'être: la pensée (esprit) et l'étendue (matière).
Pluralisme - implique plusieurs ou plusieurs bases initiales. Elle repose sur l'affirmation de la pluralité des fondements et des commencements de l'être.
Cependant, dans l'histoire de la pensée philosophique, il existe de nombreux autres problèmes qui sont également considérés comme les plus importants ou les plus significatifs, et donc de nombreux philosophes, parlant de la substance (le principe fondamental du monde), ne sont pas enclins à la corréler avec le "question fondamentale de la philosophie". Ainsi, par exemple, pour les premiers philosophes antiques, le problème philosophique le plus fondamental était la question : « De quoi est fait le monde ? Et il leur semblait le plus important, le plus basique.
Du point de vue de la scolastique médiévale, la « question fondamentale de la philosophie » peut être formulée ainsi : « Comment une justification rationnelle de l'existence de Dieu est-elle possible ? Pour les concepts philosophiques religieux modernes, en particulier le néo-thomisme, il reste encore le principal.
La position de I. Kant semble intéressante, pour qui la question « Qu'est-ce qu'une personne ? est essentiellement la "question fondamentale de la philosophie". L'homme, de son point de vue, appartient à deux mondes différents, la nécessité naturelle et la liberté morale, selon lesquelles, d'une part, il est un produit de la nature, et d'autre part, le résultat de ce qui « en tant que libre être agissant, fait ou peut et doit faire de lui-même. »
Ce n'est pas seulement une question sur la relation entre l'être et la conscience, mais une question sur la relation entre l'homme, la nature et la pensée - trois systèmes. Les philosophes interprètent ces systèmes de différentes manières, leur relation, leur localisation et l'implication de la pensée dans le mouvement. Ainsi, Platon croit que les idées sont en dehors des choses, selon Aristote, - les idées sont en réalité, selon Kant, - la pensée est dans la tête d'une personne, et Hegel a soutenu que les idées se déplacent - dans la nature, puis dans une personne et reviennent à leur état d'origine.Idée absolue. (Gorelov A.A.)
Cette formulation de la question est traditionnelle, mais il existe différentes opinions des philosophes concernant la question principale de la philosophie.
Interprétations de la question principale de la philosophie par différents philosophes
Qu'est-ce qui est primaire, fondamental, découlant l'un de l'autre - l'être ou la conscience ?
Le problème idéologique du rapport de l'homme au monde implique le problème du rapport de l'être à la conscience. Ce problème peut être formulé de diverses manières, mais son existence même est due à la présence de la pensée et de l'âme humaines. Il y a deux aspects à la question principale de la philosophie, sur laquelle les philosophes réfléchissent - ontologique et épistémologique. Le premier versant - ontologique - implique la définition du primat de l'être et de la conscience. Le deuxième aspect - épistémologique - est la question de la connaissabilité, c'est-à-dire la question de savoir comment nos pensées et le monde qui nous entoure sont corrélés, nos idées sur le monde sont-elles correctes, sommes-nous capables de connaître le monde ?

La solution de tous les problèmes philosophiques commence par la réponse à la question principale de la philosophie. En fonction des spécificités de la réponse à cette question, des courants philosophiques et des écoles sont déterminés et développés.
Aspect ontologique de la question
Il existe deux points de vue sur le problème ontologique de la résolution de la question principale de la philosophie, divisant les philosophes en deux catégories - les idéalistes et les matérialistes. Les premiers soutenaient que la nature et toute existence matérielle étaient générées par des entités spirituelles, tandis que les seconds, au contraire, étaient convaincus que la nature et la matière étaient primaires.
Il convient de noter que les philosophes, réfléchissant sur la question de la primauté, ne résolvent pas la question de ce qui est apparu ou surgi plus tôt - la matière ou la conscience, mais la question de leur relation - comment ils se rapportent les uns aux autres, ce qui est primordial par rapport à l'un l'autre. Les idéalistes et les matérialistes comprennent la relation ontologique entre le monde et la conscience de différentes manières.

Il y a trois options pour résoudre le premier côté de la question (philosophie moniste) : le matérialisme, l'idéalisme subjectif et objectif.
Matérialisme
Le monde extérieur existe indépendamment de notre esprit, de notre conscience et de notre pensée et est primordial par rapport à eux.
L'origine du matérialisme a eu lieu dans le monde antique (Chine ancienne - taoïsme, Inde ancienne - Charvakalokayata, Grèce antique - l'école milésienne). Tout au long de son développement, une forme en a remplacé une autre - du matérialisme naturaliste de l'Antiquité à la forme mécaniste du New Age et à la forme dialectique des XIXe et XXe siècles. Représentants du matérialisme mécaniste: F. Bacon, Hobbes, Holbach, etc. Conformément à cette forme, le monde matériel est un mécanisme dans lequel tout est nécessaire, conditionné et a une raison. Cependant, cela ne s'applique qu'à la nature, et non à la société, dans laquelle, selon les matérialistes, les principes de la moralité, et non les causes mécaniques, opèrent.

La forme moderne du matérialisme est dialectique. Fondateurs : K. Marx et F. Engels. Son essence est une orientation vers la science et la pratique, la mobilisation des forces pour un changement qualitatif dans la vie de la société.
Idéalisme subjectif
Le monde extérieur est un produit de l'activité de la conscience humaine et existe grâce à elle. Parmi les représentants de l'idéalisme subjectif figurent des philosophes tels que Berkeley (1685-1753), Fichte (1762-1814) et d'autres.L'essence de l'idéalisme subjectif est l'affirmation que le monde est tel que nous l'imaginons. Tout ce que nous observons dans le monde n'est que la totalité de nos sensations. Toutes les qualités perçues sont relatives : un même objet peut apparaître grand ou petit selon la distance qui le sépare. La thèse bien connue de George Berkeley : « exister signifie être perçu », impliquant que l'être est ce qui est perçu à travers diverses sensations humaines, et on ne peut même pas discuter de l'existence objective des choses.
Idéalisme objectif
Les représentants de l'idéalisme objectif croient qu'il existe un esprit supérieur, grâce auquel le monde des choses et la conscience humaine sont apparus. Dans divers enseignements philosophiques, cet esprit (le principe spirituel le plus élevé) a un nom différent : Esprit, Idée, Brahman, etc.
Puisque cet esprit mondial existe indépendamment de la conscience humaine, d'où le nom d'idéalisme objectif. Représentants de cette tendance: en Europe - Platon, Thomas d'Aquin, Hegel, darshans orthodoxes - en Inde.
Ces directions se réfèrent à la philosophie moniste (monisme). En plus de l'enseignement moniste de la philosophie, il existe un autre concept, appelé "dualisme" - les enseignements dualistes. Le dualisme comprend les enseignements de Descartes (1596-1650), qui croit que le monde et la conscience sont indépendants l'un de l'autre.
Doctrine du compromis - déisme (G. Cherberi, Voltaire, Newton, Radichtchev, etc.). Les philosophes de cette tendance admettaient que Dieu avait créé le monde des choses et de l'homme, mais croyaient qu'il ne participait plus au développement du monde créé.
Le côté épistémologique de la question
Il existe également différentes réponses et points de vue à la question sur les possibilités de la pensée humaine de connaître le monde qui l'entoure. La majorité des gens, y compris les philosophes, répondent par l'affirmative à cette question : « le monde est connaissable », qui s'appelle optimisme épistémologique ou gnosticisme.

Dans l'Antiquité, l'agnosticisme se présentait sous la forme du scepticisme. Les sceptiques réfléchissaient à la question de la nature des choses, de la relation de l'homme avec elles et des conséquences de cette relation avec elles. Les philosophes ont soutenu que la nature des choses nous est inconnue et que les choses doivent être traitées avec scepticisme, en évitant les jugements catégoriques. Cela entraînera l'équanimité et le bonheur (pas de souffrance). Représentants du scepticisme de la Renaissance : M. Montaigne, P. Bayle. Représentants de l'agnosticisme moderne : Hume et Kant.
Dans certains domaines modernes de la philosophie, des éléments d'agnosticisme se manifestent. Par exemple, certains représentants de l'agnosticisme croient que le monde n'est pas connaissable, et ce fait est proposé d'être évalué positivement, car "la cognition rend la vie difficile".
La question principale de la philosophie reste en suspens et perd de sa pertinence. Les philosophes soutiennent que la question principale de la philosophie peut changer et que le problème principal sera la question de l'existence d'une personne, de son auto-identification, de la recherche du sens de la vie et du bonheur.
Sources utiles
- Gorelov A.A. Fondamentaux de la philosophie: un manuel pour les étudiants. établissements moyens. prof. éducation / AA Gorelov. - 15e éd., effacé. - M : Centre d'édition "Académie", 2014. - 320 p.
- Ilyin V.V. Philosophie en schémas et commentaires: Manuel / V.V. Ilyin, A.V. Mashentsev. - Saint-Pétersbourg : Peter, 2005. - 304 p.
- Krioukov V.V. Philosophie: Manuel pour les étudiants des universités techniques. Novossibirsk : Maison d'édition du NSTU, 2006.-219 p.
La question principale de la philosophie brièvement (ontologie de l'être) mise à jour : 30 octobre 2017 par : Articles scientifiques.Ru
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, les étudiants diplômés, les jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous en seront très reconnaissants.
Posté sur http://www.allbest.ru/
Introduction
La philosophie est souvent présentée comme une science abstraite très sophistiquée, séparée de la vie réelle et quotidienne. Rien n'est plus éloigné de la vérité que ce genre d'opinion. En fait, la philosophie tire tous les problèmes de la vie et les résout dans le seul but d'aider une personne dans sa vie, les vicissitudes de la vie, à s'améliorer et à se développer, à atteindre les objectifs et les idéaux souhaités, à surmonter l'adversité et à assurer le succès. La philosophie fournit à une personne un riche matériel factuel pour la réflexion, ainsi qu'une boîte à outils très efficace pour l'activité mentale.
L'étude de la philosophie est une école de pensée rationnelle, prouvée par l'expérience séculaire de l'humanité, qui vous permet d'opérer librement avec des concepts, de proposer de nouvelles idées et de critiquer des jugements bien connus, de séparer l'essentiel du non essentiel, identifier les interconnexions des phénomènes et révéler les lois qui opèrent dans le monde. La philosophie aide une personne à déterminer sa position et son orientation dans la vie, lui permet de résoudre plus raisonnablement et plus rapidement les problèmes de la vie auxquels elle est confrontée.
La pertinence de ce sujet réside dans le fait que chacun de nous est constamment, volontairement ou involontairement, confronté aux problèmes dont traite la philosophie. Celles-ci incluent : quand et comment le monde est-il né ou existe-t-il pour toujours ? Comment est-il arrangé ? Est-il dans un état de chaos, ou y a-t-il de l'ordre en lui ? Le monde est-il en train de changer ou au repos ? question philosophie matérialisme idéalisme
Dans une mesure encore plus grande, une personne est préoccupée par des problèmes qui la concernent directement. Quelle est la place de l'homme dans le monde ? Quel rôle y joue-t-il ? Quand et pour quelles raisons l'homme est-il apparu ? Quel est son but, le sens de la vie ? L'homme est-il mortel ou immortel ? Qu'est-ce qui l'attend au-delà du seuil de la vie ? Quelles sont les possibilités de l'esprit et de l'activité humaine ? Qu'est-ce que la vérité ? Comment le distinguer de l'illusion et des mensonges? Existe-t-il des analogues d'une personne dans le monde ou y est-il seul? L'homme est-il bon ou mauvais par nature ? Peut-on éradiquer le mal ? L'« époque de paix et d'harmonie universelles » peut-elle intervenir dans le développement de l'humanité ?
Ce sont les « questions éternelles de l'être ». Les gens ont cherché des réponses à ces questions dans le passé, ils le font aujourd'hui et continueront de le faire à l'avenir. Cette recherche permet à une personne de s'autodéterminer, de ne pas « se perdre », de prendre confiance en ses forces, ses pensées et ses actions, une base solide dans la vie. La philosophie est appelée à apporter des réponses à ces questions.
Le but du test est d'examiner la question principale de la philosophie, dont la solution est le matérialisme et l'idéalisme.
Pour atteindre cet objectif, les tâches suivantes sont définies :
Considérez la question principale de la philosophie et les options pour sa solution;
Étudier les deux faces de la question principale de la philosophie ;
Caractériser le matérialisme et l'idéalisme comme les deux directions principales de la philosophie moderne.
La plupart des philosophes sont convaincus que le monde a un début: soit la matière, soit la conscience, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à une position moniste (du grec. Monos - un). Ceux qui considèrent la nature, ou la matière, comme primordiale, ont commencé à être appelés matérialistes, et ceux qui considèrent la conscience comme telle, ou l'idéal, spirituel - idéalistes. Ce choix a déterminé, en fait, toute la vision du monde de ce philosophe, et après cela, sa méthodologie pour étudier les problèmes. C'est pourquoi Engels a appelé la question de la substance du monde la question fondamentale de la philosophie.
1. La question fondamentale de la philosophie
Pendant très longtemps, jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les philosophes n'ont même pas soupçonné l'existence de la question fondamentale de la philosophie, bien qu'ils y soient constamment tombés et qu'ils l'aient résolue inconsciemment par eux-mêmes.
Pour la première fois, cette question a été consciemment et clairement posée par le philosophe allemand du XIXe siècle, Friedrich Engels. "La grande question fondamentale de toute philosophie, en particulier de la dernière", a-t-il soutenu, "est la question de la relation de la pensée à l'être". L'essentiel de la question, selon Engels, est d'abord dans ce qui est premier : l'être ou la pensée, la nature ou l'esprit. Mais pourquoi une telle question est-elle la principale, et tous les philosophes sont-ils d'accord avec cela ? Répondons tout de suite à la deuxième partie de la question : tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, le philosophe français du XXe siècle Albert Camus considérait le problème du sens de la vie humaine comme le plus important. "Décider si une vie de travail vaut la peine d'être vécue ou non, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie", a-t-il déclaré. Engels F. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. - Marx K., Engels F. Soch., tome 21. S. - 88
Eh bien, la question du sens de la vie est en effet une question philosophique très importante. Mais en y répondant dans n'importe quelle version, une personne, du moins un philosophe, procède (en fin de compte) de cette version de la résolution de la question principale de la philosophie, à laquelle il adhère - consciemment ou inconsciemment. Comment? Pour comprendre cela et voir toute la signification de cette question, nous devons considérer comment elle est formée.
Rappelons, premièrement, que le sujet de la philosophie est une compréhension universelle, ou plutôt nue (en tenant compte du côté valeur de la vision du monde) de l'universel. Et, deuxièmement, n'oublions pas que toute connaissance est un processus de généralisation, puisque c'est le général qui exprime l'essence des choses et des phénomènes, comme déjà mentionné ci-dessus. Les formes d'activité cognitive humaine sont très différentes - de la connaissance quotidienne au conceptuel, de l'artistique au scientifique. Et quelle que soit la forme que nous utilisons, nous suivons toujours la ligne de généralisation.
Imaginez que devant la fenêtre se trouve une nature riche en créatures vivantes, où une variété d'animaux et de petits animaux courent. A première vue, ils sont tous différents. Mais en y regardant de plus près, il s'avère que certains d'entre eux se ressemblent, et une étude scientifique approfondie confirme qu'ils peuvent être attribués, par exemple, à la même famille. Avec une étude plus approfondie de la nature, il est révélé que littéralement tous les représentants de la faune peuvent être combinés en divers groupes apparentés: non seulement les animaux, mais aussi les poissons et les insectes, et toutes les fleurs - les bleuets. C'est ce que la science a fait. Et le processus de généralisation en vient au concept de nature vivante, car il s'avère que tous les êtres vivants (y compris l'homme en tant que représentant de la classe des mammifères) sont organiquement liés les uns aux autres, ont quelque chose en commun. Gobozov I.A. Philosophie sociale: un manuel pour les lycées / I.A. Gobozov - M. : Acad. Projet, 2010. S. - 115
Le même processus de généralisation peut être fait avec des choses inanimées et, après s'être assuré qu'elles sont toutes, en fait, liées les unes aux autres, atteindre le concept de nature inanimée.
Y a-t-il quelque chose de commun entre la nature animée et la nature inanimée ? Certainement. Tout organisme vivant est constitué d'une masse d'éléments "non vivants" en lesquels, après la fin de sa vie, il se décompose. Cela signifie que le concept de nature (ou concepts synonymes de matière, physique, etc.) sera commun à tous les êtres vivants et non vivants.
Cependant, en résumé, qu'avons-nous manqué? Conscience! Et il s'avère que le même processus de généralisation peut être fait ici que dans la nature. Bien que la conscience de chaque personne ait sa propre expression individuelle, on peut facilement trouver quelque chose de commun dans la conscience des personnes non seulement d'un groupe social, mais aussi de classes de statut social différent, de nationalités, de races et de sociétés différentes. Et en généralisant, nous arriverons au concept de conscience en général, la conscience comme phénomène.
Il existe deux options principales pour résoudre la question principale de la philosophie: le matérialisme - la primauté de la matière sur la conscience, l'idéalisme - la primauté des idées sur la matière. Platon croyait qu'il y avait un monde d'idées et un monde d'ombres. Les gens vivent dans le monde des ombres (selon les idées de Platon - dans une grotte où les idées extérieures ne pénètrent pas du tout), ne trouvant qu'occasionnellement une idée. Le philosophe est celui qui voit les deux mondes et peut en parler. Aristote ne parvient pas à isoler l'énoncé explicite de la question principale de la philosophie, respectivement, il est reconstruit à travers un certain nombre de liens médiatisés. Cela s'explique généralement par le fait que sa position, selon la classification généralement acceptée, est intermédiaire entre le matérialisme et l'idéalisme. Belskaya E.Yu. Histoire et philosophie des sciences (Philosophie des sciences). Éd. Yu.V. Krianeva, L.E. Motorine. - M. : Alpha-M, INFRA-M, 2012. - S.-134
2. Deux faces de la question principale : matérialisme etidéalisme
Je le répète, la question fondamentale en philosophie est traditionnellement considérée comme la question du rapport de la pensée à l'être, et de l'être à la pensée (conscience).
L'importance de cette question réside dans le fait que la construction d'une connaissance holistique du monde qui nous entoure et de la place de l'homme dans celui-ci dépend de sa résolution fiable, et c'est la tâche principale de la philosophie. La matière et la conscience sont deux caractéristiques inséparables et en même temps opposées de l'être. À cet égard, il y a deux faces à la question principale de la philosophie - ontologique et épistémologique.
Le côté ontologique (existentiel) de la question principale de la philosophie réside dans la formulation et la solution du problème : qu'est-ce qui est primaire - la matière ou la conscience ?
L'essence du côté épistémologique (cognitif) de la question principale : le monde est-il connaissable ou inconnaissable, qu'est-ce qui est primordial dans le processus de cognition ?
Les philosophes se sont divisés en deux grands camps selon la façon dont ils ont répondu à cette question. Ceux qui affirmaient que l'esprit existait avant la nature, et qui donc, à la fin, d'une manière ou d'une autre ont reconnu la création du monde, et chez les philosophes, par exemple chez Hegel, la création du monde prend souvent une tournure forme encore plus confuse et absurde que dans le christianisme, formait un camp idéaliste. Ceux qui considéraient la nature comme le principe principal rejoignirent les différentes écoles du matérialisme. Ostrovsky E.V. Histoire et philosophie des sciences : manuel scolaire / E.V. Ostrovsky. - M. : manuel Vuzovsky, NIC INFRA - M, 2013. - 328 p.
Le matérialisme reconnaît la matière comme primaire, la nature et la conscience, la pensée comme secondaire, dérivée de la matière. Le monde matériel qui nous entoure existe pour toujours, toujours, croient les matérialistes. Personne ne l'a créé. Il existe indépendamment de la volonté et de la conscience des gens. La conscience, dont le porteur sur Terre est une personne, est un produit, le résultat du développement et du fonctionnement de la matière, la nature.
L'idéalisme, contrairement au matérialisme, considère quelque chose d'immatériel comme primordial, à savoir la conscience, l'esprit, l'idée. L'esprit, la conscience, selon les idéalistes, existe avant la nature et indépendamment d'elle. Ils considèrent la matière, la nature comme le résultat de l'activité créatrice de la conscience, de l'esprit. Le spirituel, selon eux, engendre, détermine l'existence du matériel, la nature.
À l'heure actuelle, malgré les milliers d'années de recherche de philosophes, la question principale de la philosophie n'a pas été résolue de manière fiable ni du côté ontologique ni épistémologique et, en fait, est un problème philosophique éternel (non résolu).
Au XXe siècle. dans la philosophie occidentale, on a eu tendance à accorder moins d'attention à la question fondamentale traditionnelle de la philosophie, car elle est difficile à résoudre et perd progressivement de sa pertinence. Jaspers, Heidegger, Camus et d'autres ont jeté les bases du fait qu'une autre question principale de la philosophie pourrait apparaître à l'avenir - le problème de l'existentialisme, c'est-à-dire le problème de l'homme, son existence, la gestion de son propre monde spirituel, les relations au sein de la société et avec la société, son libre choix, rechercher le sens de la vie et sa place dans la vie, le bonheur. Engels F. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. - Marx K., Engels F. Soch., v. 21. S. - 96
3. Matérialismecomme l'un des principauxdirections de la philosophie moderne
Le matérialisme (du latin materialis - matériel) est l'une des deux principales directions philosophiques, qui résout la question principale de la philosophie en faveur de la primauté de la matière, de la nature, de l'être, du physique, de l'objectif et considère la conscience, la pensée comme une propriété de la matière, par opposition à l'idéalisme, qui considère l'esprit comme l'initiale, l'idée, la conscience, la pensée mentale, subjective.
La reconnaissance de la primauté de la matière signifie qu'elle n'a été créée par personne, mais qu'elle existe pour toujours, que l'espace et le temps sont des formes objectivement existantes de l'existence de la matière, que la pensée est inséparable de la matière, qui pense que l'unité du monde consiste en dans sa matérialité.
La solution matérialiste du deuxième côté de la question principale de la philosophie - sur la connaissabilité du monde - signifie la croyance en l'adéquation du reflet de la réalité dans la conscience humaine, dans la connaissabilité du monde et de ses lois.
Le mot "matérialisme" a commencé à être utilisé au 17ème siècle principalement dans le sens d'idées physiques sur la matière (R. Boyle), et plus tard dans un sens philosophique plus général (G. W. Leibniz) pour s'opposer à l'idéalisme.
Le contenu du matérialisme contient, tout d'abord, ce qui est commun à toutes les écoles et tous les courants du matérialisme, dans leur contraste avec l'idéalisme et l'agnosticisme, et la forme du matérialisme est liée à cette chose particulière qui caractérise les écoles et les courants individuels du matérialisme. Mais une telle distinction est à la fois relative, conditionnelle. Kanke V.A. Fondamentaux de la philosophie: manuel. - M. : Logos, 2003. S. - 223
La forme du matérialisme, influençant son contenu, y apporte des ajustements importants, grâce auxquels, par exemple, le matérialisme dialectique, non seulement dans la forme, mais aussi dans le contenu, est qualitativement différent du matérialisme vulgaire, du matérialisme métaphysique et de tous les autres types de le matérialisme, bien qu'il ait avec eux ce qui est commun à tout le matérialisme en général.
S'il s'agit d'étapes successives dans le développement d'un même type de matérialisme, alors ces étapes sont considérées comme ses étapes. Quand il y a un changement radical dans la forme du matérialisme, un changement de son ancienne forme à une nouvelle, on dit que la forme du matérialisme change. Le changement de forme du matérialisme s'opère principalement sous l'influence du progrès des connaissances scientifiques et du développement social.
En développement, les principaux types de matérialisme sont distingués:
Le matérialisme naïf ou élémentaire des anciens Grecs et Romains, qu'ils combinaient avec une dialectique naïve. La science ancienne n'est pas divisée en branches séparées ; elle a un caractère philosophique unique : toutes les branches du savoir sont sous les auspices de la philosophie et lui sont subordonnées.
Matérialisme métaphysique ou mécanique des XVIIe-XVIIIe siècles. La science se différencie rapidement, se démembre en branches distinctes qui dépassent la tutelle de la philosophie.
Il y a un fossé entre le matérialisme et la dialectique : dans le matérialisme il n'y a que des éléments de dialectique avec la prédominance d'une vision métaphysique générale du monde.
Le matérialisme dialectique, dans lequel le matérialisme et la dialectique sont organiquement combinés, de sorte qu'une unité complète de la dialectique (la doctrine du développement), de la logique (la doctrine de la pensée) et de la théorie de la connaissance est établie. La grande idée de la connexion universelle et du développement de la nature pénètre dans la science. Les sciences séparées, séparées jusqu'alors, sont mises en relation mutuelle non seulement entre elles, mais aussi avec la philosophie. La différenciation ultérieure des sciences s'effectue dans l'unité avec leur intégration.
Outre les principaux types de matérialisme, il en existait des intermédiaires - transitionnels d'un type principal de matérialisme à un autre. Dans le développement du matérialisme, les bouleversements soudains se sont toujours préparés progressivement.
Les types de matérialisme suivants ont été distingués comme transitionnels :
Matérialisme de l'Orient ancien, qui a précédé le matérialisme antique. Pour l'essentiel, il s'agissait de pré-matérialisme, puisque les premiers éléments du matérialisme dans les enseignements philosophiques de l'Orient ancien ne s'étaient pas encore complètement séparés des idées mythologiques, ne s'étaient pas encore libérés de l'anthropomorphisme et de l'hylozoïsme.
La tendance philosophique matérialiste la plus ancienne en Inde était la doctrine Lokayat. Lokayata a nié l'existence de tout autre monde que le matériel. La philosophie lokayata est apparue, apparemment, à une époque où l'ancien système tribal a été remplacé par l'État en Inde et où, avec les anciens Varnas de guerriers et de clergé (brahmanes), le Varna des marchands a commencé à se lever, et les paysans libres et les les artisans ont commencé à se démarquer des agriculteurs.
Selon la doctrine de l'être Lokayat, le monde entier est constitué d'éléments primaires matériels. En dehors de ces éléments primaires et de leurs combinaisons, il n'y a pas d'autre réalité. La croyance en l'existence de Dieu, de l'âme, du paradis, de l'au-delà est fausse, et les objets de cette foi sont inaccessibles à la perception. Les choses de la nature sont composées d'air (ou de vents), de feu (ou de lumière), d'eau et de terre. Après la mort, les organismes se décomposent à nouveau en leurs éléments d'origine. Lavrinenko V.N. Philosophie : Proc. allocation. - M. : Avocat, 1996. S. - 96
Le matérialisme de la Renaissance combinait les caractéristiques du matérialisme naïf et de la dialectique naïve avec les premiers éléments d'une vision métaphysique du monde. Ainsi, il était, à proprement parler, une transition entre le matérialisme ancien et naïf et le matérialisme métaphysique encore informe.
Francis Bacon (1561 - 1626) est le premier philosophe qui s'est consciemment donné pour tâche de développer une méthode scientifique basée sur une compréhension matérialiste de la nature.
En accord avec les esprits progressistes de son époque, Bacon a proclamé la conquête de la nature et l'amélioration de la vie humaine comme la plus haute tâche de la connaissance. Seulement cette science est capable de conquérir la nature et de la dominer, qui elle-même "obéit" à la nature, c'est-à-dire est guidée par la connaissance de ses lois.
Ainsi, Bacon distingue deux types d'expériences :
1) "fructueux"
2) "porteur de lumière"
Fructueuses, il appelle les expériences dont le but est d'apporter un bénéfice direct à une personne, lumineuses - celles dont le but n'est pas un bénéfice immédiat, mais la connaissance des lois des phénomènes et des propriétés des choses.
Le matérialisme, qui a précédé immédiatement le matérialisme dialectique et s'est en partie développé parallèlement à lui, dépassait déjà les limites du matérialisme métaphysique, contenait des éléments de dialectique, mais n'était pas encore parvenu au matérialisme dialectique et n'étendait pas le matérialisme aux phénomènes sociaux.
4. L'idéalisme comme l'une des directions de la philosophie
L'idéalisme (idéalisme français du grec. Idée - idée) est une désignation générale des enseignements philosophiques qui affirment que la conscience, la pensée, le mental, le spirituel sont primaires, fondamentaux, et la matière, la nature, le physique sont secondaires, dérivés, dépendants, conditionnés. Et, ainsi, il s'oppose au matérialisme dans la résolution de la question principale de la philosophie - à propos de la relation entre l'être et la pensée, le spirituel et le matériel, à la fois dans la sphère de l'existence et dans la sphère de la connaissance.
Bien que l'idéalisme soit apparu il y a plus de deux millénaires et demi, ce terme, en tant que désignation de l'un des deux camps combattant en philosophie, n'est apparu qu'au début du XVIIIe siècle. En 1702, l'idéaliste allemand Leibniz a décrit les hypothèses d'Épicure et de Platon comme le plus grand matérialiste et le plus grand idéaliste. Et en 1749, le matérialiste français D. Diderot appelait l'idéalisme "... le plus absurde de tous les systèmes". Ostrovsky E.V. Histoire et philosophie des sciences : manuel scolaire / E.V. Ostrovsky. - M.: manuel Vuzovsky, NIC INFRA - M, 2013. S. - 215
Avec toute l'unité fondamentale du camp idéaliste, dans la résolution de la question fondamentale de la philosophie au sein de ce camp, deux de ses principales formes doivent être distinguées :
1) L'idéalisme est objectif
2) L'idéalisme est subjectif
La première se caractérise par la reconnaissance du principe spirituel en dehors et indépendamment de notre conscience. Pour le second, l'hypothèse de toute réalité extérieure et indépendante de notre conscience est inacceptable.
L'idéalisme objectif a reçu sa première expression complète dans la philosophie de Platon.
La présence de deux formes principales d'idéalisme n'épuise pas la variété des différentes versions des systèmes philosophiques idéalistes. Au sein de ces deux formes de l'histoire de la philosophie, leurs variations ont eu lieu, déterminées par la manière dont le principe spirituel est compris : comme esprit du monde (panlogisme) ou volonté du monde (volontarisme), comme substance spirituelle unique (monisme idéaliste) ou ensemble d'éléments spirituels primaires (monadologie, pluralisme). ), comme un commencement logiquement raisonnable compris (rationalisme idéaliste), comme une variété sensorielle de sensations (empirisme et sensationnalisme idéalistes, phénoménalisme), ou comme un commencement "libre" irrégulier et illogique qui ne peut être un objet de compréhension scientifique (irrationalisme).
L'histoire séculaire de l'idéalisme est très complexe. Sous une variété de formes à différentes étapes de l'histoire, il a exprimé à sa manière l'évolution des formes de la conscience sociale en fonction de la nature des formations sociales changeantes et du nouveau niveau de développement de la science.
Les principales formes d'idéalisme, qui se sont développées plus avant dans l'histoire ultérieure de la philosophie, sont déjà apparues dans la Grèce antique.
En la personne de Platon (427 - 347 av. J.-C.), l'idéalisme grec ancien apparaît pour la première fois sous la forme d'une vision du monde, s'opposant au matérialisme. Selon Platon, le monde des choses sensibles n'est pas le monde des choses réellement existantes : les choses sensibles surgissent et périssent constamment, changent et bougent, il n'y a rien de solide et de vrai en elles. La véritable essence des choses sensibles, leurs causes sont des formes incorporelles insensibles comprises par l'esprit. Platon appelle ces causes ou ces formes des espèces et, beaucoup moins fréquemment, des idées. Le domaine des "espèces", ou "idées", selon Platon, forme un système semblable à une pyramide, au sommet de cette pyramide se trouve "l'idée" du bien. Elle détermine la connaissabilité, l'existence des objets, d'elle ils reçoivent leur essence.
Parmi les étudiants de Platon, le penseur brillamment doué Aristote s'est démarqué, qui a créé une doctrine philosophique originale - l'une des plus grandes de la philosophie grecque antique.
Les enseignements d'Aristote sont l'idéalisme objectif, qui comprend un certain nombre de dispositions essentiellement matérialistes. Cette doctrine a été formée à la suite de la critique de la doctrine des idées de Platon. Cependant, Aristote lui-même, à la suite de cette critique, n'en vient pas à nier la position idéaliste sur l'existence de causes non matérielles des choses perçues sensuellement. Selon Aristote, chaque chose est l'unité de la "matière" et de la "forme". Spirkin A.G. Philosophie: manuel. - M. : Gardariki, 2008. S. - 134
A la fin du IVe siècle av. les signes d'une crise de la démocratie esclavagiste grecque s'intensifient. A cette époque, il existe trois courants principaux de la philosophie hellénistique : le scepticisme, l'épicurisme et le stoïcisme.
Pyrrho était le fondateur du scepticisme. Selon ses enseignements, un philosophe est une personne qui aspire au bonheur. Le bonheur ne peut consister qu'en un calme imperturbable et en l'absence de souffrance.
La philosophie d'Épicure est l'étape la plus élevée du développement du matérialisme atomiste de la Grèce antique.
Epicure défend et développe le sensationnalisme matérialiste. Tout ce que nous ressentons est vrai, les sensations ne nous trompent jamais. L'école stoïcienne, fondée par Zénon, luttait contre les enseignements d'Épicure. Chez les stoïciens, un seul monde corporel est doté de propriétés divines, identifié à Dieu. A son origine et à tous les stades de son développement, l'idéalisme est étroitement lié à la religion. En fait, l'idéalisme est apparu comme un concept exprimant une vision du monde religieuse et, dans les époques suivantes, a généralement servi de justification philosophique et de justification de la foi religieuse.
Les œuvres du grand philosophe Emmanuel Kant ont joué un rôle énorme dans le développement de la philosophie. Le développement philosophique de Kant se divise en deux périodes. Dans la première période jusqu'au début des années 70, Kant a tenté de résoudre des problèmes philosophiques - la question de l'être, les questions de la philosophie de la nature, la philosophie de la religion, l'éthique, la logique, sur la base de la conviction que la philosophie peut être développée et justifiée comme une science théorique spéculative, c'est-à-dire sans recourir à des données d'expérience.
Dans la seconde période, à partir du début des années 70, Kant tente de séparer strictement les phénomènes des choses telles qu'elles existent en soi, des « choses en soi » ; celle-ci, selon Kant, ne peut être donnée dans l'expérience. Or Kant essaie de prouver que les choses en elles-mêmes sont inconnaissables, que nous ne connaissons que les « apparences » ou la manière dont ces « choses en elles-mêmes » nous affectent. Au cours de cette période, Kant explore la composition, l'origine et les frontières des différentes fonctions de la connaissance. L'enseignement qui s'est développé durant cette période était l'enseignement de l'agnosticisme. Kant lui-même l'appelait la "critique de la raison".
Kant a compris que son enseignement limite l'esprit, puisqu'il nie à l'esprit la capacité de connaître l'essence des choses, laissant derrière lui la connaissance des seuls phénomènes. Kant croyait qu'une telle limitation de l'esprit à la seule connaissance des phénomènes est nécessaire au développement de la science, puisqu'elle prive toute sorte de "preuve" logique de l'existence de Dieu, l'autre monde. Kononovich L.G., Medvedeva G.I. Philosophie: un manuel pour les établissements d'enseignement supérieur. - Rostov n / a: "Phoenix", 1999. S. - 83
Cependant, Kant croyait encore qu'il était non seulement possible mais nécessaire de croire en Dieu, puisque sans la foi il est impossible de concilier l'exigence de la conscience morale avec l'existence du mal.
La principale caractéristique de la "philosophie critique" de Kant est la réconciliation du matérialisme avec l'idéalisme, l'agnosticisme.
Le représentant le plus éminent de la philosophie classique allemande est Hegel. Son grand mérite réside dans le fait qu'il a d'abord présenté l'ensemble du monde naturel, historique et spirituel comme un processus, c'est-à-dire en mouvement, changement, transformation et développement continus, et a tenté de révéler le lien interne de ce mouvement et de ce développement. . Partant de la position dialectique sur l'unité de l'essence et du phénomène, Hegel rejette la doctrine kantienne de l'inconnaissabilité de la « chose en soi » ; dans la nature des choses, il n'y a pas de barrières insurmontables à la connaissance.
"L'essence cachée de l'univers ne possède pas en elle-même la puissance qui serait capable de résister à l'audace de la connaissance, elle doit ouvrir devant lui, déployer devant ses yeux les richesses et les profondeurs de sa nature et lui en faire jouir." Alekseev P.V. Histoire de la philosophie: manuel. - M. : Prospekt, 2008. S. - 116
Penser, selon Hegel, n'est pas seulement une activité humaine subjective, mais aussi une essence objective indépendante d'une personne, le principe fondamental, la source première de tout ce qui existe. La pensée, en comparaison avec les perceptions sensorielles, est la plus haute forme de connaissance du monde extérieur.
En fin de compte, Hegel arrive à la conclusion fantastique que la pensée humaine n'est qu'une des manifestations (bien que la plus élevée sur Terre) d'une pensée absolue, existante en dehors de l'homme - une idée absolue, c'est-à-dire Dieu. Raisonnable, divin, réel, nécessaire coïncident les uns avec les autres, selon les enseignements de Hegel. De là découle une des thèses les plus importantes de la philosophie hégélienne : tout réel est raisonnable, tout raisonnable est réel.
La forme de base de la pensée est le concept. Puisque Hegel absolutise la pensée, il déifie inévitablement le concept.
Elle, selon son enseignement, "est le commencement de toute vie et est une forme infinie et créative qui contient en elle-même la plénitude de tout contenu et en même temps lui sert de source".
Ainsi, le point de départ du système philosophique hégélien est l'identification idéaliste de l'être et de la pensée, la réduction de tous les processus au processus de la pensée.
Considérant le processus logique de la cognition comme l'auto-développement de la réalité objective, Hegel a posé la question de l'objectivité des formes logiques. Ainsi, le « noyau rationnel » de la dialectique idéaliste de Hegel est constitué de plusieurs de ses idées liées à la connaissance des lois les plus générales du développement de la nature, de la société et de la connaissance.
Conclusion
La philosophie est parfois comprise comme une sorte de savoir abstrait, extrêmement éloigné des réalités de la vie quotidienne. Au contraire, c'est dans la vie que naissent les problèmes les plus graves, les plus profonds de la philosophie. Du point de vue de la philosophie, comprendre la réalité ne signifie nullement simplement se réconcilier et s'accorder avec elle en tout. La philosophie présuppose une attitude critique envers la réalité. L'étude de la philosophie est une école qui vous permet de cultiver une culture de la pensée rationnelle - la capacité d'opérer librement avec des concepts, d'avancer, de justifier et de critiquer certains jugements, de séparer l'essentiel du secondaire, de révéler la relation entre divers phénomènes de la réalité , et enfin, identifier et analyser les contradictions dans la réalité environnante , ce qui signifie la voir dans le changement et le développement. La pensée raisonnable est une pensée solide, stricte, disciplinée qui ne permet pas l'arbitraire et est capable de défendre sa justesse et en même temps une pensée pointue, libre et créative.
Cependant, il convient de garder à l'esprit que la culture de la pensée rationnelle, que la philosophie apporte avec elle, ne peut être imposée à une personne contre sa volonté et son désir, son intérêt. Quiconque a mémorisé mécaniquement, disons, les lois de la dialectique et les exemples qui les accompagnent, non seulement ne maîtrisait pas cette culture, mais ne s'en approchait même pas.
Ainsi, j'ai considéré les problèmes philosophiques fondamentaux auxquels les gens revenaient encore et encore dans une tentative de se repenser, le monde qui les entoure et leur place dans celui-ci d'une nouvelle manière. Ce sont les problèmes de la structure de l'univers, son infinité dans le temps et dans l'espace, les problèmes de cognition du monde environnant, les problèmes de l'homme, son âme, sa conscience, sa morale, ses valeurs. Ces problèmes sont importants pour une personne, complexes et ambigus.
Par leur nature, ces questions sont parmi les « éternelles », c'est-à-dire celles qui existent tant que la philosophie elle-même existe. Ils n'ont pas perdu leur pertinence même aujourd'hui, puisque la vie nous impose de nouvelles tâches qui nécessitent notre compréhension.
La philosophie peut exciter les représentants de différentes professions d'au moins deux points de vue. Elle est nécessaire pour mieux s'orienter dans sa spécialité, mais surtout, elle est nécessaire pour comprendre la vie dans toute sa plénitude et sa complexité.
Dans le premier cas, l'accent est mis sur les questions philosophiques de la physique, des mathématiques, des connaissances techniques, des sciences biologiques, de la médecine, de la pédagogie, de l'art et bien d'autres. De telles questions se posent devant les spécialistes et demandent avec insistance leur étude. Ils sont très importants, mais ils ne sont encore qu'une partie d'un vaste champ de problèmes philosophiques. Si nous nous en tenions à eux seuls, cela appauvrirait, rétrécirait le champ de la philosophie, annulerait ses problèmes les plus intéressants et les plus importants, qui nous concernent non seulement en tant que spécialistes, mais en tant que citoyens. Et ce n'est pas moins important que le premier.
Liste des sources utilisées
1. Alekseev P.V. Histoire de la philosophie: manuel. - M. : Perspective, 2008.
2. Belskaya E.Yu. Histoire et philosophie des sciences (Philosophie des sciences): Manuel / E.Yu. Belskaya, N.P. Volkova, MA Ivanov; Éd. Yu.V. Krianeva, L.E. Motorine. - M. : Alpha-M, INFRA-M, 2012. - 416 p.
3. Buchilo N.F., Chumakov A.N. Philosophie: Manuel. - M. : EN SOI, 2003.
4. Vechkanov V.E. Histoire et philosophie des sciences : manuel scolaire / V.E. Vetchkanov. - M. : ITS RIOR, NIT INFRA-M, 2013. - 256 p.
5. Gobozov I.A. Philosophie sociale: un manuel pour les lycées / I.A. Gobozov - M. : Acad. Projet, 2010. - 352 p.
6. Kanke VA Fondamentaux de la philosophie: manuel. - M. : Logos, 2003. - 288 p.
7. Kononovich L.G., Medvedeva G.I. Philosophie: un manuel pour les établissements d'enseignement supérieur. - Rostov n / a: "Phoenix", 1999.
8. Lavrinenko V.N. Philosophie : Proc. allocation. - M. : Avocat, 1996.
9. Lybutin K.N. Feuerbach : anthropologie philosophique. - Sverdlovsk : éd. Oural. un-ta, 1988. - P.58.
10. K. Marx et F. Engels, Soch., 2e éd., volume 21, p. 283
11. Feuerbach L. Histoire de la philosophie. - M.: "Pensée", 1974. - P. 162.
12. Engels F. Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. - Marx K., Engels F. Soch., tome 21. p. 282 - 283
13. Nijnikov S.A. Philosophie: manuel. - M. : Velby, Maison d'édition Prospekt, 2008.
14. Ostrovsky E.V. Histoire et philosophie des sciences : manuel scolaire / E.V. Ostrovsky. - M. : manuel Vuzovsky, NIC INFRA - M, 2013. - 328 p.
15. Stepin VS Histoire et philosophie des sciences: Un manuel pour les étudiants diplômés et les candidats au diplôme de candidat en sciences / V.S. Intervenir. - M. : Triksta, Acad. Projet, 2012. - 423 p.
16. Spirkin AG Philosophie: manuel. - M. : Gardariki, 2008.
Ressources Internet
17. http://bibliofond.ru/
18. http://biblioclub.ru/
19. http://intencia.ru/
Hébergé sur Allbest.ru
...Documents similaires
Interprétation traditionnelle de la question principale de la philosophie. Le rapport du matériel et de l'idéal, la connaissance du monde et le reflet de la réalité. Les principales directions de la philosophie: matérialisme et idéalisme. Une approche moderne pour comprendre la question fondamentale de la philosophie.
test, ajouté le 10/03/2010
Traditions matérialistes et idéalistes dans la philosophie européenne. Matérialisme et idéalisme dans la philosophie du droit. La relation entre le problème des fondements premiers de l'être et la formation des traditions matérialistes et idéalistes dans la pensée philosophique.
dissertation, ajouté le 13/05/2016
L'essence de la philosophie, son sujet et sa place dans la culture et la vie de l'homme et de la société. Les deux faces de la question principale de la philosophie sont ontologiques et épistémologiques. L'homme et sa place dans l'univers du point de vue de la philosophie. Les principales catégories de l'image scientifique du monde.
travaux de contrôle, ajouté le 30/12/2009
Une question de philosophie et de ses côtés. Philosophes prémarxistes et non marxistes. Le noyau théorique de la vision du monde. Pensée solide, stricte et disciplinée. Matérialisme et idéalisme comme directions de la philosophie moderne. L'homme dans le concept de Feuerbach.
résumé, ajouté le 02/03/2010
Aspects ontologiques et épistémologiques de la question principale de la philosophie. Les écoles philosophiques et leurs représentants des périodes de l'hellénisme ancien et tardif, la Renaissance. Le problème de la méthode de cognition dans les écoles philosophiques de la période des temps modernes et des Lumières.
test, ajouté le 25/03/2015
La place de la philosophie parmi les autres formes de vision du monde : mythe et religion. La question principale de la philosophie et sa solution par différentes directions philosophiques. Matérialisme et idéalisme dans l'histoire de la philosophie. Méthodes de base de la connaissance. Dialectique et métaphysique. Philosophie et sciences.
résumé, ajouté le 02/06/2012
Caractéristiques du développement de la philosophie antique. Le problème du début chez les représentants du matérialisme, de l'idéalisme et des atomistes. Concept atomistique des anciens philosophes. Les principaux problèmes de l'origine de la philosophie grecque. Matérialisme et idéalisme de la philosophie antique.
résumé, ajouté le 18/04/2010
Le sujet et la définition de la philosophie. Le monde et l'homme dans leur relation complexe. Caractéristiques de la réflexion philosophique. Objectif dans le contenu et subjectif (personnel) dans la forme. La question principale de la philosophie (selon F. Engels). Formes d'idéalisme et de matérialisme.
présentation, ajouté le 16/10/2012
Caractéristiques générales de la philosophie classique allemande, ses principales orientations. Caractéristiques de la philosophie critique de I. Kant et de la philosophie idéaliste de I. Fichte et F. Schelling. Idéalisme objectif de G. Hegel. Matérialisme anthropologique L. Feuerbach.
présentation, ajouté le 12/04/2014
Le concept d'idéalisme et de matérialisme comme directions pour résoudre le problème principal de la philosophie. L'essence de l'Idée platonicienne, l'analyse du problème "comment le général existe-t-il" dans sa théorie. Les choses sont comme de « pâles copies d'idées ». Caractéristiques de la compréhension de la relation entre l'âme et le corps par Platon.
La question principale de la philosophie est la question du rapport de la conscience à l'être, de la pensée à la matière, à la nature, considérée sous deux aspects : d'une part, qu'est-ce qui est premier - l'esprit ou la nature, la matière ou la conscience - et, d'autre part, comment la connaissance de l'être monde se rapportent au monde lui-même, ou, en d'autres termes, si la conscience correspond à l'être, si elle est capable de refléter correctement le monde. Une solution cohérente à la question fondamentale de la philosophie n'est possible que si les deux aspects de celle-ci sont pris en compte.
La solution de la question principale de la philosophie prédétermine la polarisation des enseignements philosophiques, leur appartenance à l'une des deux directions principales de la philosophie - le matérialisme ou l'idéalisme. Les philosophes qui affirmaient que l'esprit existait avant la nature constituaient le camp idéaliste. Ceux qui considéraient la nature comme le principe principal rejoignirent les différentes écoles du matérialisme.
La question principale de la philosophie s'est formée historiquement et n'a pu être clairement posée qu'à l'époque moderne. La nécessité épistémologique de sa formulation réside dans le rapport réel d'une personne au monde extérieur : tout acte élémentaire de cognition et de comportement humain suppose une distinction entre le subjectif et l'objectif, la conscience et les choses conscientes. Ainsi, la question principale de la philosophie découle de la vie quotidienne des gens, de la pratique, de la connaissance. La question du primat de la matière forme le premier versant ontologique de la question principale de la philosophie. Le deuxième aspect, épistémologique, est la question de la connaissabilité du monde, si nous pouvons, dans nos idées et concepts du monde réel, constituer un véritable reflet de la réalité. La plupart des philosophes (y compris les idéalistes) considèrent que le monde est connaissable. Cela signifie que l'opposition entre matérialisme et idéalisme dans le cadre du second versant de la question fondamentale de la philosophie ne se révèle qu'en analysant les interprétations matérialistes et idéalistes du principe de la connaissabilité du monde.
Selon Alekseev P.V. et Panina A.V., la question du rapport entre matière et conscience est « fondamentale » car sans elle il ne peut y avoir de philosophie, pas de vraie philosophie. D'autres problèmes ne deviennent philosophiques que parce qu'il s'avère qu'ils peuvent être envisagés à travers le prisme du rapport ontologique et épistémologique de l'homme à l'être. Cette question est aussi fondamentale parce qu'elle n'est pas seulement un « papier décisif » pour distinguer le matérialisme scientifique de l'idéalisme et de l'agnosticisme ; elle devient en même temps un moyen d'orientation de l'homme dans le monde. L'étude de la relation entre l'être et la conscience est une condition sans laquelle une personne ne pourra pas développer son attitude face au monde, ne pourra pas y naviguer.
Ainsi, selon les options pour résoudre la question principale de la philosophie, il existe deux directions principales en philosophie: le matérialisme et l'idéalisme.
Distinguer idéalisme objectif (Platon, Hegel) et idéalisme subjectif (Kant, Berkeley, Hume).
Les idéalistes objectifs reconnaissent la connaissabilité du monde, identifient la réalité connaissable avec l'esprit. Ainsi, selon Hegel, l'être est, par essence, pensant, bien que surhumain, et la pensée humaine connaît l'être grâce à son identité essentielle avec cette réalité. Idée absolue (Dieu, Esprit du Monde), à la fois substance et sujet. C'est une substance parce qu'elle existe par elle-même et qu'elle est un but pour elle-même, et un sujet parce qu'elle est une activité, une action continue. Son travail est de se connaître. La connaissance elle-même s'exprime dans l'identification des caractéristiques déjà contenues en elle et dans leur prise de conscience. Ce qui au début existe sous la forme d'une possibilité, puis à la fin devient une réalité, une actualité.
Les idéalistes subjectifs, qui nient la possibilité de connaître le monde, rejoignent le scepticisme philosophique, l'agnosticisme. Certains agnostiques essaient d'éviter l'alternative formulée par la question principale de la philosophie, prenant la position du dualisme ou de l'éclectisme.
Des agnostiques comme l'idéaliste subjectif Hume ont soutenu que les gens ne connaissent que leurs sensations et que tout ce qui est au-delà des sensations est absolument inconnaissable. Selon les agnostiques, une personne ne peut pas "sauter" au-delà des limites de la sensation. Par conséquent, Hume a proposé, par exemple, d'éliminer complètement la question de savoir s'il existe quelque chose au-delà des limites des sensations humaines.
Contrairement à Hume, Kant admettait l'existence de « choses en soi », de choses extérieures à nous, et c'était une concession bien connue au matérialisme. Lorsque Kant a déclaré cette "chose en soi" inconnaissable, "d'un autre monde", existant en dehors de l'espace et du temps, il s'est ici comporté en idéaliste et en agnostique.
Les constructions philosophiques matérialistes tirent leur nom du fait que leurs auteurs considèrent la matière comme primordiale et rejettent l'existence d'un monde surnaturel. L'un des matérialistes les plus brillants est Holbach. Il a exposé ses idées dans l'essai "Le système de la nature".
"La nature, entendue au sens le plus large du terme", écrit Holbach, "est un grand tout, résultant de la combinaison de diverses substances, de leurs diverses combinaisons et de divers mouvements que nous observons dans l'Univers." Holbach P. Oeuvres choisies : En 2 volumes - V.1. - M., 1963, p.66
Une compréhension plus profonde de l'homme est contenue dans la philosophie de L. Feuerbach, qui s'appelle le matérialisme anthropologique. Feuerbach a exposé ses principales idées dans les ouvrages "Fondamentaux de la philosophie du futur" et "L'essence du christianisme".
Feuerbach développe son concept en opposition à l'idéalisme, qu'il considère comme une sorte de théologie. Ainsi, écrit-il : « L'idéalisme de Kant, dans lequel les choses suivent la raison, et non la raison suit les choses, n'est rien de plus que la réalisation du concept théologique de l'esprit divin, qui n'est pas déterminé par les choses, mais, au contraire, détermine eux. Cependant, l'idéalisme kantien est encore un idéalisme limité, c'est un idéalisme fondé sur l'empirisme. Feuerbach L. Oeuvres philosophiques choisies : en 2 volumes - V.1. - M., 1955, p.159
Le matérialiste allemand est plus résolu dans son attitude envers son compatriote Hegel. N'acceptant pas la théologie chrétienne, les opinions religieuses, Feuerbach a catégoriquement rejeté l'idéalisme hégélien.
La solution dialectico-matérialiste de la question fondamentale de la philosophie diffère qualitativement de la solution offerte par le matérialisme métaphysique. La conscience, la pensée, dont la base physiologique est le cerveau humain, est en même temps un produit social, un reflet de l'existence sociale des personnes. Contrairement au matérialisme précédent, la philosophie étend l'approche matérialiste à la question générale de la philosophie à la vie sociale, résolvant en conséquence la question de la relation de la conscience sociale à l'être social.
F. Engels est un représentant du matérialisme dialectique et historique. Les principes de base de cette philosophie ont été développés par lui avec K. Marx. Dans Anti-Dühring et Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, il a esquissé le contenu de la philosophie marxiste.
Ainsi, la question principale de la philosophie est la question de la relation de la conscience à l'être, du spirituel au matériel. Les philosophes-idéalistes prennent pour idée première, la conscience, les considérant comme la seule réalité fiable. Les philosophes partisans du matérialisme reconnaissent la matière, étant, comme premier, la conscience comme secondaire, et considèrent la conscience comme le résultat de l'impact sur le sujet d'un monde extérieur objectivement existant.