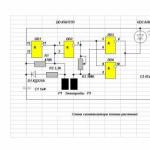Le rôle de l'intuition dans la connaissance scientifique. L'intuition et son rôle dans la cognition
Intuition - la capacité d'évaluer mentalement la situation et, en contournant le raisonnement et l'analyse logique, de prendre instantanément les bonnes décisions en fonction des données précédemment accumulées expérience de la vie, ainsi que sous l'influence de l'hérédité générique et génétique. Une solution intuitive peut surgir à la fois à la suite d'une réflexion intense sur la solution du problème, et sans elle.
L'intuition - joue le rôle le plus important et le plus décisif dans la création de nouvelles idées scientifiques et proposer de nouvelles idées.
L'intuition met l'accent sur le lien entre la cognition rationnelle et sensorielle. Il est impossible de distinguer ce savoir dans sa forme pure.
Dans l'histoire de la philosophie, le concept d'Intuition comprenait un contenu différent. L'intuition était comprise comme une forme de connaissance intellectuelle directe ou de contemplation ( intuition intellectuelle). Ainsi, Platon a soutenu que la contemplation des idées (les prototypes des choses dans le monde sensible) est une sorte de connaissance directe qui vient comme une intuition soudaine, impliquant une longue préparation de l'esprit.
Dans l'histoire de la philosophie, les formes sensuelles de la cognition et de la pensée ont souvent été opposées. R. Descartes, par exemple, argumentait : « Par intuition, j'entends non pas la foi dans l'évidence bancale des sens et non le jugement trompeur de l'imagination désordonnée, mais le concept d'un esprit clair et attentif, si simple et distinct qu'il laisse sans doute que nous pensons, ou, ce qui revient au même, un concept solide d'un esprit clair et attentif, généré uniquement par la lumière naturelle de la raison et, en raison de sa simplicité, est plus fiable que la déduction elle-même ... " .
G. Hegel dans son système combinait dialectiquement les connaissances directes et indirectes
L'intuition a également été interprétée comme une connaissance sous forme de contemplation sensuelle (Intuition sensorielle): "... inconditionnellement incontestable, claire comme le soleil ... seulement sensuelle", et donc le secret de la connaissance intuitive et "... est concentré dans sensibilité" (Feuerbach L.).
L'intuition était comprise à la fois comme un instinct qui détermine directement, sans apprentissage préalable, les formes de comportement d'un organisme (A. Bergson), et comme un premier principe de créativité caché et inconscient (S. Freud).
Dans certains courants de la philosophie, l'intuition est interprétée comme une révélation divine, comme un processus totalement inconscient, incompatible avec la logique et la pratique de la vie (intuitionnisme). Diverses interprétations Les intuitions ont quelque chose en commun - mettre l'accent sur le moment de l'immédiateté dans le processus de cognition, en contraste (ou en opposition) avec la nature médiatisée et discursive de la pensée logique.
La dialectique matérialiste voit le grain rationnel du concept d'Intuition dans la caractéristique du moment d'immédiateté dans la cognition, qui est l'unité du sensible et du rationnel.
Le processus de la connaissance scientifique, et Formes variées le développement artistique du monde ne s'effectue pas toujours sous une forme détaillée, logiquement et factuellement démonstrative. Souvent le sujet s'empare d'une pensée situation difficile, par exemple, lors d'une bataille militaire, déterminer le diagnostic, la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, etc. Le rôle de l'intuition est particulièrement important lorsqu'il est nécessaire d'aller au-delà des méthodes de cognition existantes pour pénétrer dans l'inconnu. Mais l'Intuition n'est pas quelque chose de déraisonnable ou de superraisonnable. Dans le processus de cognition intuitive, tous les signes par lesquels la conclusion est faite, et les méthodes par lesquelles elle est faite, ne sont pas réalisés. L'intuition ne constitue pas une voie spéciale de cognition qui contourne les sensations, les idées et la pensée. C'est un type particulier de pensée, lorsque des liens individuels du processus de pensée sont portés dans l'esprit plus ou moins inconsciemment, et c'est le résultat de la pensée - la vérité - qui est le plus clairement réalisé.
L'intuition suffit pour percevoir la vérité, mais elle ne suffit pas pour convaincre les autres et soi-même de cette vérité. Cela nécessite une preuve.
L'intuition signifie la même chose que la contemplation directe, la connaissance acquise au cours du développement pratique ou spirituel d'un objet, la représentation visuelle. Dans différents enseignements philosophiques la capacité de connaître directement et holistiquement un objet est comprise de différentes manières.
Par exemple, certains esthéticiens et philosophes idéalistes voient l'intuition comme quelque chose d'opposé à l'intellect, qui est censé être capable de pénétrer dans l'essence des choses. Dans ce cas, l'intuition est une sorte de perspicacité, "la plus haute révélation", semblable à la foi religieuse, ou compréhension inconsciente de la nature des objets, basée sur l'instinct.
De nombreux penseurs qui considèrent l'intuition de cette manière reconnaissent l'existence d'une réalité mystique spéciale (par exemple, Dieu), qui ne peut être connue qu'à l'aide de cette intuition. L'intuition est appréciée différemment par les philosophes (Locke, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc.) qui, bien qu'ils la distinguent de la pensée discursive (c'est-à-dire de la connaissance médiatisée fondée sur la dérivation logique d'un concept à un autre), ne les opposent pas l'une à l'autre. autre. Selon les vues des rationalistes (par exemple, Descartes), la contemplation d'un objet par les sens, ce qu'on appelle parfois l'intuition sensorielle, ne nous donne ni une connaissance fiable ni universelle. Une telle connaissance n'est atteinte que par la raison et l'intuition intellectuelle. Selon le dernier Descartes comprend forme supérieure connaissance, lorsqu'elle devient claire pour l'esprit directement, sans l'aide d'un raisonnement, d'une preuve, de la vérité de l'une ou l'autre position, d'une idée (par exemple, si deux quantités sont égales à une troisième, alors elles sont égales l'une à l'autre) . Cependant, Descartes considérait intuitivement les idées vraies qui sont de nature innée (idées innées). Le sensualiste Locke, qui a également reconnu la nature intellectuelle de l'intuition, a déclaré que de telles idées sont tirées de l'expérience. Mais ni Descartes ni Locke n'ont soulevé profondément la question du lien entre connaissance intuitive (directe) et conceptuelle (médiatisée). Hegel a exprimé des réflexions fructueuses sur la relation entre ces divers aspects d'un même processus de cognition. Philosophie marxiste reconnaît que la connaissance scientifique ne se réduit pas à une pensée logique et conceptuelle, que les sens et l'intellect (perception, imagination créatrice, capacité de synthèse, d'évaluation, etc.) jouent un rôle important dans la science. Les deux types de connaissances sont étroitement liés. Contrairement à la dialectique idéaliste de Hegel, qui voyait la source de cette connexion dans la nature de la conscience elle-même, la dialectique matérialiste (prenant en compte les données de la psychologie et des sciences naturelles) la dérive et l'étudie sur la base d'une analyse de la matière , activité pratique, objective de l'humanité. Quelle que soit la manière dont l'une ou l'autre position est obtenue, sa fiabilité est prouvée par une vérification pratique. Par exemple, la vérité de nombreux axiomes des mathématiques et des règles de la logique est perçue intuitivement non pas en raison de leur nature innée, mais parce qu'ils ont été testés dans la pratique des milliards de fois, ils ont acquis pour une personne la «force du préjugé».
jouent un rôle important dans l'acquisition de nouvelles connaissances pensée logique, méthodes et techniques de formation des concepts, les lois de la logique. Mais l'expérience activité cognitive témoigne que la logique ordinaire dans de nombreux cas est insuffisante pour résoudre des problèmes scientifiques; le processus de production de nouvelles informations ne peut pas être réduit à une pensée déployée de manière inductive ou déductive. Une place importante dans ce processus est occupée par l'intuition, qui donne à la cognition une nouvelle impulsion et une nouvelle direction de mouvement.
L'intuition, en tant que processus cognitif spécifique qui produit directement de nouvelles connaissances, est tout aussi universelle, caractéristique de toutes les personnes (bien qu'à des degrés divers), ainsi que des sentiments et de la pensée abstraite.
L'intuition se prête à l'étude expérimentale. Parmi les travaux consacrés à l'étude de l'intuition par l'expérience, on peut distinguer les travaux de Ya. A. Ponomarev, (Elton, K-Fakuoara.
La prévalence, l'universalité de l'intuition est confirmée par de nombreuses observations de personnes dans des conditions ordinaires et quotidiennes; il y a des cas fréquents où, dans une situation non standard qui nécessite une décision rapide dans des conditions d'information limitée, le sujet fait un choix de ses actions, comme s'il "prévoyait" qu'il ne fallait faire que cela, et rien d'autre.
La culture humaine connaît de nombreux cas où un scientifique, un designer, un artiste ou un musicien a réalisé quelque chose de fondamentalement nouveau dans son domaine, pour ainsi dire, par "intuition", "sur une intuition".
Dans l'histoire de la musique, les cas ne sont pas rares où une pensée musicale est venue à un compositeur au moment le plus inattendu, disons, dans un rêve.
Les plus grandes réalisations de la science théorique sont également liées à l'action de l'intuition.
Une vue intéressante d'A. Einstein sur le travail d'un physicien théoricien et ses jugements sur propre créativité
L'intuition est importante dans le domaine connaissances philosophiques. L'intuition est associée à l'idée des syllogismes d'Aristote, à l'idée de combiner philosophie et mathématiques par R. Descartes, à l'idée des antinomies de I. Kant, et bien d'autres.
Le phénomène de l'intuition est extrêmement large, tout ce qui est considéré comme intuitif ne mérite pas toujours un tel nom. Dans la pensée, par exemple, les inférences ne sont pas rares, dont les prémisses ne sont pas formulées explicitement ; le résultat de telles inférences est inattendu, mais pas du tout intuitif, comme le pensent certains scientifiques. Il n'est pas nécessaire de prendre pour intuition ce qui appartient au domaine des instincts, se caractérise par des réactions automatiques dans un environnement similaire et a des mécanismes physiologiques dans la sphère subconsciente ou inconsciente du sujet. On parle parfois d'« intuition sensorielle » comme perception par les sens (prémisses « intuitives » de la géométrie d'Euclide, etc.). Bien qu'un tel usage soit possible, il est identique à "sensitif". En tant que phénomène spécifique de la cognition, le concept d'intuition a plusieurs significations.
Nous entendons par intuition l'intuition intellectuelle (lat. intellectus - l'esprit, la capacité de réflexion d'une personne), qui permet de pénétrer dans l'essence des choses.
Et une autre caractéristique extrêmement importante est caractéristique de l'intuition - son immédiateté. Il est d'usage d'appeler connaissance directe (par opposition à indirecte) telle qu'elle ne repose pas sur une preuve logique. L'intuition n'est connaissance directe qu'en ce sens qu'au moment où une nouvelle position est proposée, elle ne découle pas avec une nécessité logique de l'expérience sensorielle et des constructions théoriques existantes. Si nous gardons à l'esprit que l'intuition se réfère à l'intellect et est associée à un reflet de l'essence des objets (c'est-à-dire si nous la distinguons du sensoriel et de l'instinctif), alors nous pouvons prendre comme définition initiale une telle définition :
L'intuition est la capacité de comprendre la vérité par l'observation directe de celle-ci sans justification à l'aide de preuves.
deux traits inhérents à l'intuition : la soudaineté et l'inconscience. La "vision" intuitive se fait non seulement accidentellement et soudainement, mais aussi sans prise de conscience évidente des voies et moyens conduisant à ce résultat.
Parfois le résultat reste inconscient, et l'intuition elle-même, avec un tel résultat de son action, n'est destinée qu'au sort d'une possibilité qui n'est pas devenue réalité. L'individu peut ne conserver (ou n'avoir) aucun souvenir de l'acte d'intuition expérimenté. Une observation remarquable a été faite par le mathématicien américain Leonard Eugene Dixon. Sa mère et sa sœur, rivales en géométrie à l'école, ont passé une longue et infructueuse soirée à résoudre un problème. La nuit, la mère a rêvé de ce problème : et elle a commencé à le résoudre à haute voix d'une voix forte et claire ; sa sœur, entendant cela, se leva et l'écrivit. Le lendemain matin dans ses bras était solution correcte, inconnu de la mère de Dixon. Cet exemple illustre, entre autres, la nature inconsciente du phénomène appelé "rêves mathématiques" et le fonctionnement au niveau inconscient de la psyché humaine.
Ainsi, la capacité intuitive d'une personne est caractérisée par : 1) le caractère inattendu de la solution du problème, 2) l'inconscience des voies et moyens de le résoudre, et 3) l'immédiateté de comprendre la vérité au niveau essentiel de objets.
Ces signes séparent l'intuition des processus mentaux et logiques qui lui sont proches. Mais même dans ces limites, nous avons affaire à des phénomènes assez divers. À personnes différentes, dans conditions diverses l'intuition peut être divers degréséloignement de la conscience, être précis dans le contenu, dans la nature du résultat, dans la profondeur de pénétration dans l'essence, dans la signification pour le sujet, etc.
L'intuition est divisée en plusieurs types, principalement en fonction des spécificités de l'activité du sujet. Les caractéristiques des formes d'activité pratique matérielle et de production spirituelle déterminent également les caractéristiques de l'intuition d'un sidérurgiste, d'un agronome, d'un médecin et d'un biologiste expérimental. Il existe des types d'intuitions telles que technique, scientifique, quotidienne, médicale, artistique, etc.
Par la nature de la nouveauté, l'intuition est standardisée et heuristique. Le premier d'entre eux s'appelle la réduction de l'intuition. Un exemple est l'intuition médicale de S. P. Botkin. On sait que pendant que le patient marchait de la porte à la chaise (la longueur de l'armoire était de 7 mètres), S.P. Botkin a posé mentalement un diagnostic préliminaire. La plupart de ses diagnostics intuitifs se sont avérés corrects.
L'intuition heuristique (créative) diffère sensiblement de l'intuition standardisée : elle est associée à la formation d'un savoir fondamentalement nouveau, de nouvelles images épistémologiques, sensuelles ou conceptuelles. Le même S. P. Botkin, s'exprimant en tant que scientifique clinicien et développant la théorie de la médecine, s'est plus d'une fois appuyé sur une telle intuition dans son activité scientifique. Elle l'a aidé, par exemple, à émettre une hypothèse sur le caractère infectieux de la jaunisse catarrhale ("maladie de Botkin").
L'intuition heuristique elle-même a ses sous-espèces. Pour nous, cette division est importante sur une base épistémologique, c'est-à-dire par la nature du résultat. Intéressant est le point de vue selon lequel l'essence de l'intuition créatrice réside dans une sorte d'interaction d'images visuelles et de concepts abstraits, et l'intuition heuristique elle-même apparaît sous deux formes : eidétique et conceptuelle. Considérons cette question plus en détail.
En principe, il est possible suivre des chemins formation..sensuel sur temps et concepts dans conscience humaine: 1) processus sensoriel-perceptif, à la suite duquel des images sensorielles apparaissent; 2) processus sensoriel-associatif de transition d'une image à une autre; 3) le processus de transition des images sensorielles aux concepts 4) le processus de transition des concepts aux images sensorielles ; 5) professionnel processus d'esprit logique conclusion, dans laquelle s'effectue le passage d'un concept à un autre.
Il est évident que les première, deuxième et cinquième directions de création d'images épistémologiques ne sont pas intuitives. Même si nous prenons une inférence "automatisée", pliée (dans le cadre de la cinquième direction), alors elle s'avérera n'être rien d'essentiellement différent d'une inférence complète et étendue ; ici, il n'y aura pas de manière spéciale de former la connaissance, comme dans les deux premiers cas. Par conséquent, l'hypothèse se pose que la formation de connaissances intuitives est associée à des processus des troisième et quatrième types, c'est-à-dire au passage des images sensorielles aux concepts et des concepts aux images sensorielles. La légitimité d'une telle hypothèse est confirmée par le fait que la nature de ces processus est en bon accord avec les traits les plus typiques de la « perception de la vérité » intuitive enregistrés dans les descriptions phénoménologiques de l'intuition : visuel dans l'abstrait-conceptuel et vice versa a lieu. Entre les images visuelles et les concepts, il n'y a pas d'étapes intermédiaires différentes d'eux; même les concepts les plus élémentaires diffèrent des représentations sensorielles. Ici surgissent des concepts qui ne sont pas logiquement déductibles d'autres concepts, et des images qui ne sont pas générées par d'autres images selon les lois de l'association sensorielle, et il est donc naturel que les résultats obtenus semblent « directement perçus ». Ceci explique aussi le caractère spasmodique de cette transformation et le processus d'obtention du résultat.
Des exemples d'intuition eidétique sont la représentation visuelle de Kekule de la structure de la molécule de benzène ou la représentation visuelle de Rutherford de la structure de l'atome. Ces représentations ne se réduisent pas à une simple reproduction des données de l'expérience sensorielle directe et se forment à l'aide de concepts. Des exemples d'intuition conceptuelle sont l'émergence du concept de quaternions chez Hamilton ou le concept de neutrinos chez Pauli. Ces concepts ne sont pas apparus à travers un raisonnement logique cohérent (bien que ce processus ait précédé la découverte), mais à pas de géant ; une grande importance dans leur formation était la combinaison des images sensorielles correspondantes («jeu combinatoire» avec des éléments figuratifs de la pensée, selon les mots de A. Einstein).
Du point de vue d'une telle compréhension de l'intuition créatrice et de ses variétés, sa définition est également donnée. L'intuition créatrice est définie comme un processus cognitif spécifique, qui consiste en l'interaction d'images sensorielles et de concepts abstraits et conduit à la création d'images et de concepts fondamentalement nouveaux, dont le contenu n'est pas dérivé d'une simple synthèse de perceptions antérieures ou de la seule fonctionnement logique des concepts existants. La nature pratique de l'homme et de la cognition détermine, à notre avis, l'intuition créatrice d'un scientifique et sa division en eidétique et conceptuel. Nous convenons que c'est dans les processus de transition des images sensorielles aux concepts et des concepts aux images sensorielles qu'il faut chercher un indice sur la nature mystérieuse de la connaissance intuitive.
L'avenir montrera à quel point cette idée du mécanisme épistémologique de l'intuition est vraie.
La rapidité avec laquelle l'intuition opère est mystérieuse. Dans la section sur la capacité mentale abstraite d'une personne, nous avons déjà prêté attention à l'existence d'une pensée non verbalisée et à une accélération significative du processus de pensée sous cette forme. On observe un phénomène étonnant : la possibilité de traiter 10 bits d'information par seconde au niveau inconscient, et seulement 10 au niveau conscient. Tout cela est une condition préalable importante pour le déploiement de processus de pensée rapides, pour fonctionner avec une énorme quantité d'informations "pures" dans la sphère subconsciente (inconsciente). Le subconscient est capable de un temps limité un énorme travail qui dépasse le pouvoir de la conscience dans le même court laps de temps.
Le facteur esthétique participe également au processus de décision intuitive. Avec n'importe quel type d'intuition - eidétique ou conceptuelle - il y a, pour ainsi dire, l'achèvement d'une image (situation) à l'intégrité.
POUR conditions générales la formation et la manifestation de l'intuition comprennent les éléments suivants. 1) solide formation professionnelle personne, connaissance approfondie du problème", 2) une situation de recherche, un état de problématicité ; 3) l'action d'une recherche dominante sur la base de tentatives continues pour résoudre un problème, d'efforts acharnés pour résoudre un problème ou une tâche ; 4) la présence d'un "indice".
Le rôle de "l'indice" ressort clairement de l'expérience suivante. Les conditions de l'activité créative ont été modélisées.Un grand nombre d'adultes (600 personnes) ont été invités à résoudre un problème appelé "Quatre points". Son libellé :
"Étant donné quatre points ; il est nécessaire de tracer trois lignes droites passant par ces quatre points, sans soulever le crayon du papier, de sorte que le crayon revienne au point de départ." Les sujets ont été choisis parmi ceux qui ne connaissaient pas le principe de résolution du problème. Le temps de dissolution a été limité à 10 minutes. Tous les sujets, sans exception, après une série de tentatives infructueuses, ont cessé de résoudre et ont reconnu le problème comme insoluble. Pour réussir, il fallait "s'échapper" au-delà des limites de la zone de l'avion, limitée par des points, mais cela ne s'est produit pour personne - tout le monde est resté à l'intérieur de cette zone. Ensuite, les sujets se sont vu offrir un "indice". Ils ont appris les règles du jeu du khalma. Selon les règles de ce jeu, ils doivent sauter par-dessus trois pièces noires en un seul mouvement de la pièce blanche afin que la pièce blanche revienne à sa place d'origine. Tout en exécutant cette action, les sujets ont tracé avec leurs mains un itinéraire qui coïncidait avec le schéma de résolution du problème, c'est-à-dire correspondant à l'expression graphique pour résoudre ce problème (les sujets ont également reçu d'autres invites). Si un tel indice était donné avant la présentation du problème, alors le succès était minime; si, après que le sujet se soit retrouvé dans une situation problématique et soit devenu convaincu de la futilité de ses tentatives pour le résoudre, le problème a été résolu.
Cette expérience simple suggère que la difficulté intrinsèque du problème surgit parce que ses conditions reproduisent directement, dans l'expérience passée du sujet, des techniques généralisées empiriquement extrêmement durcies - l'union des points par la distance la plus courte. Les sujets, pour ainsi dire, sont enfermés dans une section de la zone, limitée par quatre points, alors qu'il est nécessaire de quitter cette section. De l'expérience, il s'ensuit que des circonstances favorables se développent lorsque le sujet, cherchant en vain une solution au problème, épuise les mauvaises méthodes, mais n'a pas encore atteint le stade auquel la recherche dominante s'éteint, c'est-à-dire lorsque le sujet se désintéresse du problème, lorsque les tentatives déjà faites et échouées se répètent, lorsque la situation du problème cesse de changer et que le sujet reconnaît le problème comme insoluble. D'où la conclusion que le succès d'une solution intuitive dépend de combien le chercheur a réussi à s'affranchir du schéma, à être convaincu de l'inadéquation des chemins connus jusqu'alors et en même temps à rester passionné par le problème, à ne pas le reconnaître. comme insoluble. L'allusion s'avère décisive pour s'affranchir des courants de pensée standards et stéréotypés. La forme spécifique de l'indice, ces objets et phénomènes spécifiques qui sont utilisés dans ce cas, sont une circonstance sans importance. Son sens général est important. L'idée d'un indice devrait être incarnée dans certains phénomènes spécifiques, mais lesquels exactement - ce ne sera pas un facteur décisif.
Étant donné que le travail intuitif de la pensée se déroule dans la sphère subconsciente, se poursuit même lorsque le sujet est "déconnecté" du problème, on peut conclure qu'une telle déconnexion temporaire peut être utile.
Les chercheurs notent que la capacité intuitive s'est apparemment formée à la suite du long développement des organismes vivants en raison de la nécessité de prendre des décisions avec des informations incomplètes sur les événements, et la capacité de savoir intuitivement peut être considérée comme une réponse probabiliste à la probabilité. Conditions environnementales. De ce point de vue, puisque le scientifique ne dispose pas de tous les prérequis et moyens pour faire une découverte, dans la mesure où il fait un choix probabiliste.
La nature probabiliste de l'intuition signifie pour une personne à la fois la possibilité d'obtenir une connaissance vraie et le danger d'avoir une connaissance erronée et fausse. Le physicien anglais M. Faraday, connu pour ses travaux dans le domaine de l'électricité, du magnétisme et de l'électrochimie, a écrit que personne ne se doute combien de conjectures et de théories qui surgissent dans la tête d'un chercheur sont détruites par sa propre critique et à peine un dixième des toutes ses hypothèses et ses espoirs se réalisent. . La conjecture qui a surgi dans la tête d'un scientifique ou d'un designer doit être vérifiée. Le test de l'hypothèse, comme nous le savons, est effectué dans la pratique. recherche scientifique. "L'intuition suffit pour discerner la vérité, mais elle ne suffit pas pour convaincre les autres et soi-même de cette vérité. Pour cela, la preuve est nécessaire."
La preuve (au sens large) comprend un appel aux perceptions sensorielles de certains objets et phénomènes physiques, ainsi qu'un raisonnement logique, des arguments. Dans les sciences déductives (logique, mathématiques, dans certaines sections de la physique théorique), les preuves sont des chaînes d'inférences menant de prémisses vraies à des thèses prouvables. Sans raisonnement logique basé sur la loi de la raison suffisante, il est impossible de parvenir à l'établissement de la vérité de la position avancée.
La question est de savoir à quoi ressemble le processus de circulation des connaissances : discontinu ou continu ? Si l'on prend le développement de la science dans son ensemble, il est évident que dans ce flux général des discontinuités, dénotées au niveau individuel par des sauts intuitifs, ne se font pas sentir ; voici leurs sauts, appelés révolutions dans la science. Mais pour les scientifiques pris individuellement, le processus de développement des connaissances dans leur domaine de recherche scientifique se présente différemment : les connaissances se développent spasmodiquement, par intermittence, avec des « vides logiques », mais, en revanche, elles se développent sans sauts, puisque la pensée logique qui suit chaque "insight" méthodiquement et comble délibérément le "vide logique". Du point de vue de l'individu, le développement des connaissances est l'unité de la discontinuité et de la continuité, l'unité de la gradation et du saut. Dans cet aspect, la créativité agit comme une unité du rationnel et de l'irrationnel. La créativité « n'est pas l'opposé de la rationalité, mais son complément naturel et nécessaire. L'une ne saurait tout simplement pas exister sans l'autre. La créativité n'est donc pas irrationnelle, c'est-à-dire pas hostile à la rationalité, pas antirationnelle, comme beaucoup pensée passée ... Au contraire, la créativité , coulant inconsciemment ou inconsciemment, n'obéissant pas à certaines règles et normes, en fin de compte au niveau des résultats peut être consolidée avec une activité rationnelle, incluse en elle, peut devenir son partie intégrante ou dans certains cas conduire à la création de nouveaux types d'activités rationnelles"
Dans l'histoire de la philosophie, le problème de l'intuition reçu une grande attention. Ni Platon ni Aristote ne pourraient imaginer la créativité sans elle. La différence entre eux était seulement dans l'interprétation de l'intuition. Les philosophes des temps modernes, qui ont développé des méthodes de connaissance rationnelle de la nature, ne pouvaient pas non plus manquer de noter important intuition. R. Descartes, par exemple, croyait que la connaissance rationnelle, ayant traversé le "purgatoire" du doute méthodologique, est associée à l'intuition, qui donne les premiers principes, dont toute autre connaissance est ensuite déduite par déduction. « Les propositions qui découlent directement du premier principe peuvent être dites connues, écrivait-il, à la fois intuitivement et déductivement, selon la manière dont on les considère, alors que les principes eux-mêmes ne sont qu'intuitifs, de même qu'au contraire, leurs conséquences individuelles - uniquement par déduction.
A. Bergson attachait une grande importance au problème de l'intuition. En particulier, il attire l'attention sur l'intuition philosophique en lui consacrant un ouvrage spécial (publié en russe en 1911). Il a relié l'intuition à l'instinct, à la connaissance du vivant, au changeant, à la synthèse et à la logique - à l'intellect, à l'analyse. Selon lui, la logique triomphe dans la science, qui a pour sujet corps solides. Associant l'intuition à l'acquisition de nouvelles connaissances sous forme d'images sensorielles et conceptuelles, il fait un certain nombre d'observations subtiles ; en même temps, on peut remarquer chez lui son opposition inutilement rigide de l'intuition à la logique.
Il ne faut ni surestimer l'intuition ni ignorer son rôle dans la cognition. Discursif et intuitif sont des moyens de cognition spécifiques et complémentaires.
Dans le processus de cognition, parallèlement aux opérations et procédures rationnelles, des personnes non égales participent également. Cela ne signifie pas qu'ils sont incompatibles avec la rationalité, c'est-à-dire irrationnels. Quelle est la spécificité des mécanismes irrationnels de la cognition ? Pourquoi sont-ils nécessaires, quel rôle jouent-ils dans le processus de cognition ? Pour répondre à ces questions, nous devons découvrir ce que sont l'intuition et la créativité.
DANS vrai vie les gens font face à des situations qui changent rapidement. Par conséquent, en plus des décisions basées sur des normes de comportement généralement acceptées, ils doivent prendre des décisions non standard. Ce processus est généralement appelé créativité.
Platon considérait la créativité comme une faculté divine apparentée à un type particulier de folie. La tradition chrétienne interprétait la créativité comme la plus haute manifestation du divin dans l'homme. Kant a vu dans la créativité caractéristique génie et activité créatrice contrastée avec rationnel. Du point de vue de Kant, l'activité rationnelle, scientifique par exemple, est le destin de meilleur cas talent, mais la créativité authentique, accessible aux grands prophètes, philosophes ou artistes, est toujours le lot d'un génie. Les philosophes-existentialistes attachaient une grande importance à la créativité en tant que caractéristique personnelle particulière. Représentants psychologie des profondeurs 3. Freud, K. G. Jung, le psychiatre allemand E. Kretschmer, auteur du livre "People of Brilliance", référant entièrement la créativité à la sphère de l'inconscient, a exagéré son unicité et son irreproductibilité et, en substance, a reconnu son incompatibilité avec la connaissance rationnelle.
Les mécanismes de la créativité sont encore mal connus. Néanmoins, on peut dire avec certitude que la créativité est un produit de l'évolution biosociale humaine. Déjà dans le comportement des animaux supérieurs, des actes de créativité sont observés, quoique sous une forme élémentaire. Les rats, après de nombreuses tentatives, ont trouvé un moyen de sortir d'un labyrinthe extrêmement déroutant. Les chimpanzés qui ont appris la langue des sourds-muets ont appris non seulement plusieurs centaines de mots et de formes grammaticales, mais aussi parfois construit des phrases séparées, complètement nouvelles, rencontrant une situation non standard, des informations sur lesquelles ils voulaient transmettre à une personne. De toute évidence, la possibilité de créativité ne réside pas seulement dans les structures biophysiques et neurophysiologiques du cerveau, mais dans son « architectonique fonctionnelle ». Il s'agit d'un système spécial d'opérations organisées et interconnectées menées sites divers cerveau. Avec leur aide, des images sensuelles et des abstractions sont créées, des informations symboliques sont traitées, des informations sont stockées dans le système de mémoire, des liens sont établis entre éléments séparés et un bloc de mémoire, rappelant les informations stockées de la mémoire, regroupant et regroupant (combinant) diverses images et connaissances abstraites, etc. Puisque, en termes de structure biologique et neurophysiologique, le cerveau humain est qualitativement plus complexe que le cerveau de tous plus difficile. Cela offre une possibilité extraordinaire, presque incalculable, de traiter de nouvelles informations. La mémoire joue ici un rôle particulier, c'est-à-dire le stockage des informations précédemment reçues. Il comprend la mémoire de travail, qui est constamment utilisée dans les activités cognitives et pratiques du sujet, la mémoire à court terme, qui peut être utilisée pendant de courtes périodes pour résoudre des tâches fréquemment répétées du même type ; la mémoire à long terme, qui stocke les informations qui peuvent être nécessaires sur de longues périodes pour résoudre des problèmes relativement peu fréquents.
Quelle est la relation entre les processus rationnels et créatifs dans les activités cognitives et pratiques ? L'activité des gens est opportune. Pour atteindre un certain objectif, il est nécessaire de résoudre un certain nombre de tâches et de sous-tâches. Certains d'entre eux peuvent être résolus en utilisant des méthodes rationnelles typiques. Pour en résoudre d'autres, la création ou l'invention de nouvelles règles et techniques non standard sont nécessaires. Cela se produit lorsque nous sommes confrontés à des situations fondamentalement nouvelles qui n'ont pas d'analogues exacts dans le passé. C'est là que la créativité est nécessaire. C'est un mécanisme d'adaptation de l'homme dans un monde infiniment divers et changeant, un mécanisme qui assure sa survie et son développement. En même temps, nous parlons non seulement du monde externe, objectif, mais aussi du monde interne et subjectif d'une personne, de la variété infinie de ses expériences, états mentaux, humeurs, émotions, fantasmes, actes volitifs, etc. côté de la question ne peut être couvert par la rationalité, qui comprend un nombre gigantesque, mais toujours fini, de règles, de normes, de standards et de standards. La créativité n'est donc pas le contraire de la rationalité, mais son complément naturel et nécessaire. L'un sans l'autre ne pourrait tout simplement pas exister. Par conséquent, la créativité n'est pas irrationnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hostile à la rationalité, ni antirationnelle, comme le pensaient de nombreux penseurs du passé, elle ne vient pas de Dieu, comme le pensait Platon, ni du diable, comme de nombreux théologiens et philosophes médiévaux. a cru. Au contraire, la créativité, procédant inconsciemment ou inconsciemment, n'obéissant pas à certaines règles et normes, finalement au niveau des résultats peut être consolidée avec une activité rationnelle, incluse en elle, peut devenir sa partie intégrante ou, dans certains cas, conduire à la création de nouveaux types d'activités rationnelles. Cela s'applique à la fois à la créativité individuelle et collective. Alors, la créativité artistique Michel-Ange, Chostakovitch, les travaux scientifiques de Galilée, Copernic, Lobachevsky sont devenus partie intégrante de la culture et de la science, bien que dans sa forme originale immédiate, ils ne correspondent pas aux modèles, normes et normes établis.
Chaque personne, dans une certaine mesure, a la créativité, c'est-à-dire la capacité de développer de nouvelles méthodes d'activité, de maîtriser de nouvelles connaissances, de formuler des problèmes, de comprendre l'inconnu. Chaque enfant, apprenant un nouveau monde autour de lui, maîtrisant la langue, les normes et la culture, est essentiellement engagé dans la créativité. Mais, du point de vue des adultes, il maîtrise ce qui est déjà connu, apprend ce qui est déjà ouvert, éprouvé. Par conséquent, ce qui est nouveau pour l'individu n'est pas toujours nouveau pour la société. La véritable créativité dans la culture, la politique, la science et la production est déterminée par la nouveauté fondamentale des résultats obtenus à l'échelle de leur importance historique.
Qu'est-ce qui forme le mécanisme de la créativité, son ressort, ses particularités ? Le plus important de ces mécanismes est l'intuition. Les anciens penseurs, comme Démocrite et surtout Platon, la considéraient comme une vision intérieure, une capacité suprême esprit. Contrairement à la vision sensorielle ordinaire, qui renseigne sur des phénomènes transitoires sans grande valeur, la spéculation, selon Platon, permet de s'élever à la compréhension d'idées immuables et éternelles qui existent en dehors et indépendamment d'une personne. Descartes croyait que l'intuition nous permet de voir clairement les idées contenues dans notre âme. Mais comment exactement l'intuition est "arrangée", aucun d'entre eux n'a expliqué. Malgré le fait que les générations suivantes de philosophes européens ont interprété l'intuition de différentes manières (Feuerbach, par exemple, pensait qu'elle n'était pas enracinée dans la perception d'idées supérieures, mais dans la sensibilité même d'une personne), nous avons encore fait très peu de progrès comprendre sa nature et ses mécanismes. C'est pourquoi l'intuition et la créativité qui lui est associée ne peuvent être décrites sous une forme complète et satisfaisante par un système de règles. Cependant, la psychologie moderne de la créativité et la neurophysiologie nous permettent d'affirmer avec certitude que l'intuition comprend un certain nombre d'étapes spécifiques. Celles-ci incluent : 1) l'accumulation et la distribution inconsciente d'images et d'abstractions dans le système de mémoire ; 2) combinaison et traitement inconscients d'abstractions, d'images et de règles accumulées afin de résoudre un problème spécifique ; 3) une compréhension claire de la tâche ; 4) trouver une solution inattendue pour une personne donnée (prouver un théorème, créer une image artistique, trouver une solution de conception ou militaire, etc.) qui satisfait la tâche formulée. Souvent, une telle décision survient au moment le plus inattendu, lorsque l'activité consciente du cerveau se concentre sur la résolution d'autres problèmes, ou même dans un rêve. On sait que le célèbre mathématicien français J. A. Poincaré a trouvé une preuve mathématique importante en marchant le long du lac, et Pouchkine a trouvé la ligne poétique dont il avait besoin dans un rêve.
Cependant, il n'y a rien de mystérieux dans l'activité créatrice, et elle est sujette à une étude scientifique. Cette activité est effectuée par le cerveau, mais elle n'est pas identique à l'ensemble des opérations effectuées par celui-ci. Les scientifiques ont découvert la soi-disant asymétrie droite-gauche du cerveau. Il a été prouvé expérimentalement que chez les mammifères supérieurs, les hémisphères droit et gauche du cerveau remplissent des fonctions différentes. La droite traite et stocke principalement des informations conduisant à la création d'images sensorielles, tandis que la gauche procède à l'abstraction, développe des concepts, des jugements, donne un sens et un sens à l'information, développe et stocke des règles rationnelles, y compris logiques. Le processus holistique de la cognition est réalisé à la suite de l'interaction des opérations et des connaissances effectuées par ces hémisphères. Si, à la suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale, le lien entre eux est rompu, le processus de cognition devient alors incomplet, inefficace, voire impossible. Cependant, l'asymétrie droite-gauche ne se pose pas sur une base neurophysiologique, mais sur une base socio-psychologique dans le processus d'éducation et de formation. Il est également lié à la nature de l'activité pratique du sujet. Chez les enfants, il n'est clairement fixé qu'à l'âge de quatre ou cinq ans, et chez les gauchers, les fonctions des hémisphères sont réparties de manière opposée: l'hémisphère gauche remplit les fonctions de sensoriel, et le droit - d'abstrait cognition rationnelle.
Dans le processus de créativité et d'intuition, des transitions fonctionnelles complexes se produisent, dans lesquelles, à un certain stade, l'activité disparate consistant à opérer avec des connaissances abstraites et sensorielles, respectivement réalisées par les hémisphères gauche et droit, s'unit soudainement, conduisant au résultat souhaité, à aperçu, à une sorte d'allumage créatif, qui est perçu comme une découverte, comme un point culminant de ce qui était auparavant dans l'obscurité de l'activité inconsciente.
Nous pouvons maintenant nous tourner vers les procédures cognitives les plus importantes d'explication et de compréhension.
Ils sont généralement considérés comme des processus qui se chevauchent ou se chevauchent. Cependant, l'analyse de la cognition humaine, intensivement menée dans la seconde moitié du 19e et tout au long du 20e siècle, a révélé des différences significatives entre eux. Les néo-kantiens W. Windelband, G. Rickert et d'autres ont soutenu que la connaissance de la nature est fondamentalement différente de la connaissance de la société et de l'homme. Les phénomènes de la nature, croyaient-ils, sont soumis à des lois objectives, tandis que les phénomènes vie sociale et les cultures dépendent des caractéristiques complètement individuelles des personnes et des situations historiques uniques. Par conséquent, la connaissance de la nature est généralisante ou généralisante, et la connaissance des phénomènes sociaux est individualisante. En conséquence, pour les sciences naturelles, la tâche principale est de soumettre les faits individuels à des lois générales, et pour la cognition sociale, l'essentiel est de comprendre les attitudes internes, les motifs d'activité et les significations cachées qui déterminent les actions des gens. Sur cette base, V. Dilthey a soutenu que la principale méthode de cognition dans sciences naturelles est l'explication, et dans les sciences de la culture et de l'homme - la compréhension. Est-ce vrai? En fait, il y a à la fois de bons et de mauvais points dans cette approche. Il est vrai que les sciences naturelles modernes cherchent avant tout à établir les lois des phénomènes et à y subsumer les connaissances empiriques individuelles. Il n'est pas vrai que les sciences sociales ne reflètent pas des lois objectives et ne les utilisent pas pour expliquer les phénomènes socio-historiques et les activités des individus. Il est vrai que comprendre les points de vue, les opinions, les croyances, les croyances et les objectifs des autres est extrêmement tâche difficile, d'autant plus que de nombreuses personnes se méconnaissent ou ne se comprennent pas complètement, et cherchent parfois délibérément à induire en erreur. Il n'est pas vrai que la compréhension ne s'applique pas aux phénomènes de la nature. Tous ceux qui ont étudié les sciences naturelles ou techniques ont constaté à maintes reprises combien il est difficile et combien il est important de comprendre tel ou tel phénomène, loi ou résultat d'une expérience. Par conséquent, l'explication et la compréhension sont deux processus cognitifs complémentaires utilisés dans les connaissances en sciences naturelles, sociales et techniques.
La théorie de la connaissance distingue : les explications structurelles qui répondent à la question de savoir comment un objet est arrangé, par exemple, quelle est la composition et la relation des particules élémentaires dans un atome ; des explications fonctionnelles qui répondent à la question de savoir comment un objet fonctionne et fonctionne, par exemple, un animal, une personne individuelle ou une certaine équipe de production ; des explications causales qui répondent à la question pourquoi un phénomène donné est apparu, pourquoi exactement un ensemble donné de facteurs a conduit à telle ou telle conséquence, etc. En même temps, dans le processus d'explication, nous utilisons des connaissances existantes pour en expliquer d'autres. Le passage de connaissances plus générales à des connaissances plus spécifiques et empiriques constitue ainsi la procédure d'explication. De plus, le même phénomène peut parfois être expliqué de différentes manières, selon les lois, les concepts et les vues théoriques qui sont à la base de l'explication. Ainsi, la rotation des planètes autour du Soleil peut s'expliquer - sur la base de la mécanique céleste classique - par l'action de forces attractives. Basé sur la théorie générale de la relativité - la courbure de l'espace circumsolaire dans son champ gravitationnel. Laquelle de ces explications est la plus correcte, la physique décide. La tâche philosophique est d'étudier la structure de l'explication et les conditions dans lesquelles elle fournit une connaissance correcte des phénomènes expliqués. Cela nous rapproche de la question de la vérité de la connaissance. La connaissance qui sert de base à une explication est dite explicative. La connaissance qu'ils justifient est dite explicable. Non seulement les lois, mais aussi les faits individuels peuvent servir d'explication. Par exemple, le fait d'une catastrophe nucléaire peut expliquer le fait d'une augmentation de la radioactivité de l'atmosphère sur le territoire voisin. Non seulement les faits, mais aussi les lois de moindre généralité peuvent agir comme explicables. Ainsi, la loi d'Ohm connue du cours de physique élémentaire peut s'expliquer soit sur la base du modèle de gaz d'électrons dit de Lorentz-Drude, soit sur la base de lois encore plus fondamentales de la physique quantique.
Qu'est-ce qui nous donne le processus d'explication? Premièrement, il établit des liens plus profonds et plus forts entre divers systèmes connaissances, ce qui leur permet d'inclure de nouvelles connaissances sur les lois et les phénomènes individuels de la nature. Deuxièmement, il permet de prévoir et de prédire des situations et des processus futurs, puisque la structure logique de l'explication et de la prévision est généralement similaire. La différence est que l'explication fait référence à des faits, des événements, des processus ou des modèles qui existent ou ont eu lieu dans le passé, tandis que la prédiction fait référence à ce qui devrait se passer dans le futur. La prévision et la prévoyance sont une base nécessaire pour planifier et concevoir des activités sociales, productives et pratiques. Plus notre prédiction d'événements possibles est correcte, approfondie et raisonnable, plus nos actions peuvent être efficaces.
Quelle est la différence entre comprendre et expliquer ? On dit souvent que pour comprendre un phénomène, il faut expliquer ce phénomène. Mais ça
Posadova Ekaterina
Comprendre l'intuition et son rôle dans les travaux des philosophes ; les fonctions et les types d'intuition, ainsi que les voies de son développement.
Télécharger:
Aperçu:
MBOU "Moyenne école polyvalente N ° 89 avec une étude approfondie de sujets individuels "
Section : études sociales
Recherche
Thème : "Le rôle de l'intuition dans la connaissance du monde"
Complété par : Posadova
Ekaterina Aleksandrovna
Conseiller scientifique:
Posadova
Lyudmila Anatolyevna
Professeur d'histoire et de sciences sociales
Ijevsk, 2014
- Introduction. page 3
- Chapitre 1. Le concept d'intuition en histoire. page 5
- Chapitre 2. Structure de l'intuition. page 10
2.1. Types d'intuition page 10
2.2. Formes d'intuition p.13
2.3. Phases du processus intuitif p.14
2.3. Fonctions de l'intuition p.15
2.4. Le rôle de l'intuition p.16
- chapitre 3 page 17
- Conclusion. pages 25
- Littérature. page 26
Introduction.
Pendant de nombreux siècles, la question principale de la philosophie a été la question de la connaissance du monde. Les principaux problèmes de la cognition peuvent être brièvement résumés par les questions suivantes : Qu'est-ce que la connaissance ? Comment est-ce possible? Quels sont les moyens d'y parvenir ? Qu'est-ce que la vérité et quels sont ses critères ?
Notre bon sens, en règle générale, repose sur une confiance inébranlable dans la connaissance fondamentale du monde environnant. Mais comme il s'est avéré dans une analyse philosophique critique, il est beaucoup plus facile de déduire logiquement l'inconnaissabilité du monde que de prouver le contraire.
La philosophie a traditionnellement distingué deux types différents dans l'acte de cognition humaine : la cognition sensorielle et la cognition rationnelle. Le premier est lié à l'activité de nos organes sensoriels (vue, ouïe, toucher, etc.). La seconde implique le travail - la pensée abstraite-conceptuelle d'une personne. Bien que sensuel et connaissance rationnelle jouent un rôle énorme dans l'acquisition de nouvelles connaissances, cependant, dans de nombreux cas, ils ne suffisent pas à résoudre les problèmes. Et puis l'intuition acquiert un rôle important dans ce processus.
Pertinence du sujetdu fait qu'en conditions modernes de nombreux problèmes philosophiques sont en cours de révision, parmi lesquels l'intuition. L'intérêt pratique croissant pour l'intuition est dû au fait que Société de l'information exige des qualités et des compétences fondamentalement nouvelles d'une personne. L'intuition implique l'expansion des capacités cognitives, l'actualisation des ressources humaines potentielles. Le paradoxe de ce problème réside dans le fait que, malgré l'abondance de métaphores, d'analogies directes et indirectes, de définitions spécifiques données à plusieurs reprises à l'intuition, il n'existe pas d'explication unique généralement acceptée du phénomène. Et cela se comprend, puisque l'intuition, du point de vue de science moderne, ne se prête pas à une vérification expérimentale, elle est insaisissable. Cependant, malgré l'absence de lignes directrices communes de consolidation, le problème de l'intuition continue d'attirer l'attention des représentants de divers domaines de la connaissance. Actuellement, il y a beaucoup de recherches sur ce sujet, et j'ai décidé de me pencher dessus, en plus, je m'intéresse personnellement à ce phénomène philosophique.
Dans mon travail, je vais essayer d'aborder de nombreuses questions liées à l'intuition, en utilisant des livres sur la philosophie, la psychologie, la recherche sur l'opinion publique et les ressources Internet.
Le but de mon travail est- prise en compte du phénomène de l'intuition et détermination du rôle de l'intuition en tant qu'élément du système activité cognitive la personne.
Tâches:
Analyser le développement du concept d'intuition dans l'histoire de la philosophie ;
Considérez l'intuition et son rôle dans la connaissance du monde ;
Révéler la question de la possibilité de développer l'intuition en tant que phénomène de conscience.
CHAPITRE 1.
LE CONCEPT D'INTUITION DANS L'HISTOIRE.
Le problème de l'intuition a un riche héritage philosophique. Peut-être que peu de problèmes philosophiques dans leur développement ont subi de tels changements qualitatifs et ont été analysés par des représentants des domaines de connaissance les plus divers. La question de l'intuition s'est souvent avérée être l'objet d'une lutte acharnée entre les représentants du matérialisme et de l'idéalisme. Tout un cycle de concepts souvent incompatibles s'est formé autour de lui. Mais sans tenir compte des traditions historiques et philosophiques, il serait impossible de comprendre l'évolution la plus complexe des points de vue sur la nature de l'intuition et d'en créer une idée scientifique dialectico-matérialiste. Ainsi, l'analyse historique et philosophique dans l'étude du problème de l'intuition semble logiquement justifiée. En même temps, il ne faut pas seulement poser la question de la continuité dans le développement historique des concepts d'intuition, mais aussi tirer d'une telle analyse des conclusions importantes tant sur le plan pratique que théorique, permettant de parler de l'intuition comme l'une des problèmes réels connaissances scientifiques modernes.
Diverses interprétations de l'intuition.
Intuition - "discrétion immédiate", c'est-à-dire connaissance qui surgit sans conscience des voies et conditions de son obtention, une sorte de perspicacité qui comprend une personne qui, en règle générale, maîtrise habilement, de manière persistante et systématique tel ou tel domaine de la réalité. L'intuition est la source et la méthode de la connaissance. Dans l'histoire la notion d'intuition ou contemplation (Intuition intellectuelle). Le rôle de l'intuition dans la cognition a commencé à être étudié dès l'Antiquité.Pour la première fois, les caractéristiques des problèmes philosophiques dans la question de l'intuition ont été décrites dans les enseignements de Platon et d'Aristote. Mais c'est ici que la nature sensible de la connaissance intuitive a été rejetée. L'intuition était, pour ainsi dire, transférée dans la sphère la pensée abstraite et comment une forme de savoir théorique a acquis le statut de problème épistémologique.
Au départ, intuition signifie, bien sûr, perception : c'est ce que nous voyons ou percevons lorsque nous regardons un objet ou l'examinons de près. Cependant, dès au moins Platon, l'opposition entre l'intuition, d'une part, et la pensée discursive, d'autre part, se développe. Conformément à cela, l'intuition est une manière divine de connaître quelque chose d'un seul coup d'œil, en un instant, hors du temps, et la pensée discursive est façon humaine la connaissance, qui consiste dans le fait qu'au cours d'un raisonnement, qui prend du temps, nous développons pas à pas notre argumentation.
Alors, ont soutenu que la contemplation d'idées (prototypes de choses dans le monde sensoriel) est une sorte de connaissance directe qui vient comme un aperçu soudain, impliquant une longue préparation de l'esprit.
Aristote a relié le problème de l'intuition à la nature fondamentale et à l'infaillibilité de la connaissance scientifique. Cette tradition a été poursuivie par les auteurs médiévaux.
F. Aquin a vu dans l'intuition le domaine de la "vérité supérieure";
W. Ockham - la base de la connaissance abstraite ou discursive. Mais les philosophes antiques et médiévaux n'ont pas encore donné de définition scientifique du concept d'« intuition ». Les représentants de la philosophie moderne et de la philosophie classique allemande ont franchi d'autres étapes importantes dans la compréhension de l'intuition. Dans l'histoire de la philosophie, les formes sensuelles de la cognition et de la pensée ont souvent été opposées.