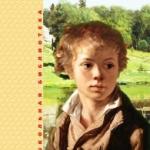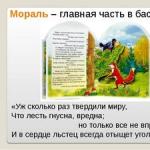Discours de femmes et d'hommes. Particularités
Lors de l'étude des caractéristiques du discours masculin et féminin, l'attention principale est portée sur les caractéristiques morphologiques, phonétiques et lexicales, car les différences de discours sont les plus perceptibles à ces niveaux.
Recherche dans le domaine En anglais ont montré que les femmes utilisent des modèles d'intonation plus diversifiés. Ils se caractérisent par une intonation exclamative et interrogative, qui se prononce d'un ton montant. Une telle intonation est perçue comme plus émotionnelle et amicale. Chez les hommes, au contraire, une intonation descendante plus régulière a été notée. Leur discours est dominant et semble plus catégorique et affirmé. De telles différences sont associées à l'émotivité féminine, ainsi qu'à la rigidité et à l'isolement des hommes. Cependant, on ne peut pas affirmer que les femmes n'utiliseront que le premier modèle et les hommes - le second. Selon la situation, l'intonation change, ce qui provoquera certaines associations chez l'interlocuteur.
Les femmes ont tendance à avoir une prononciation plus standard et, comme leur statut social est inférieur et jugé par l'apparence et le comportement, les femmes préfèrent les formes de prestige dans le domaine de la grammaire.
R. Lakoff soutient que les femmes utilisent davantage les questions disséquées inachevées en raison de leurs insécurités [R. Lakoff, 36]. Dans la plupart des cas, ils visent soit à demander ou à confirmer des informations, soit à atténuer le problème, soit à exprimer de la sympathie pour l'interlocuteur. En japonais, cette fonction est remplie par des particules modalement expressives.
En termes de vocabulaire, il n'y avait pas de différences significatives, sauf que les femmes utilisaient moins d'expressions vulgaires. Ceci est particulièrement prononcé en japonais. L'une des principales différences dans la langue anglaise est la différence dans l'utilisation des formulaires standard. En utilisant un langage normatif, une femme tente d'élever son statut dans la communication avec son interlocuteur, utilisant rarement des mots ayant un sens figuré dans son discours. Les hommes ne suivent pas les règles de la langue standard, utilisent un nouveau vocabulaire ou des mots avec de nouvelles significations.
Le discours des femmes est verbeux, avec gros montant des questions, des mots de réponse et des mots d'introduction qui enlèvent le caractère catégorique de la déclaration.
En coréen, les différences apparaissent dans les interjections, les formes polies et dans l'adressage aux membres de la famille. Par exemple, les particules finales féminines sont ajo, ojo et les particules masculines sont suumnida, suumnik "a. Lorsque les hommes utilisent des particules féminines, leur discours sonne féminin.
Des différences sont également apparues au niveau de l'écriture. Au Japon, les femmes longue durée ne pouvait pas utiliser Caractères chinois, donc la lettre phonétique "hirogana" était caractéristique style féminin des lettres. Mais si l'hirogana est finalement devenu courant, alors, par exemple, en Chine, une forme particulière d'écriture féminine, une sorte de lettre codée dans laquelle les femmes communiquaient, restait un mystère incompréhensible pour les hommes.
Ainsi, des études basées sur différents langues étrangères aider à formuler les principaux aspects théoriques influence du facteur genre sur la langue. Cependant, dans l'apprentissage d'une langue particulière, le contexte culturel et sociétal doit être pris en compte. Par exemple, si en anglais la dominance est associée à la verbosité, alors en japonais, ce qui est dit est plus important que la longueur du discours. En anglais, les différences de discours des hommes et des femmes ne sont pas codifiées, et la violation des règles d'usage ne provoque pas de réaction violente de l'interlocuteur, comme par exemple en japonais. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte les particularités du discours masculin et féminin de la langue japonaise et les spécificités de la société japonaise. Des unités spécifiques masculines et féminines sont apparues sous l'influence de facteurs sociaux, culturels et facteurs psychologiques comme la religion, la position sociale dans la société, la division du travail, les traditions historiques et culturelles du pays.
Tableau récapitulatif de quelques caractéristiques du discours masculin et féminin dans les langues
|
Aspect linguistique |
Discours de femmes |
Discours masculin |
|
intonation |
Divers Montée de l'émotivité (exclamation, interrogative) |
Plat, descendant Rigidité caractéristique, isolation |
|
prononciation |
Standard |
Des variantes sont possibles |
|
L'utilisation plus fréquente de questions décortiquées (associées à l'incertitude, à la suppression de la catégorisation) |
Questions moins fréquemment utilisées |
|
|
Moins d'impolitesse, de formes standard et polies, moins de création de mots, de préférence sens direct mots, utilisation fréquente de pronoms, noms, particules négatives non, ni |
Des expressions plus grossières, l'utilisation de mots dans de nouvelles significations, la création de mots. |
|
|
Style de discours |
Verbeux, beaucoup de questions, plus de mots de rétroaction, utilisation fréquente de mots d'introduction, particules |
Sont laconiques |
|
Un style d'écriture spécial (chinois - une forme spéciale d'écriture féminine codée, japonais - hirogana) |
Japonais - hiéroglyphes |
Vocabulaire phonétique de genre japonais
ÉTUDES AMÉRICAINES
Variantes masculines et féminines du discours dans la langue Yana
Comme vous le savez, certaines langues ont fonctionnalité suivante: chez eux, les formes utilisées par les hommes diffèrent des formes utilisées par les femmes. Bien sûr, cette caractéristique n'a rien à voir avec le genre grammatical. Dans cet article, je propose d'aborder les différences de genre en Yana, la langue du nord de la Californie, qui est (ou a été) divisée en quatre dialectes : nord, central, sud et yahi. Seules les données des deux premiers dialectes seront utilisées ici, bien que les faits principaux s'appliquent aux quatre. Apparemment, le nombre de langues dans lesquelles l'opposition des formes masculines et féminines est aussi développée que chez Yana est faible. Par conséquent, les faits présentés dans cet article seront, je l'espère, d'un intérêt général pour les chercheurs en langage et en psychologie du langage.
Pour clarifier l'essence de la question, on peut noter que dans yana il n'y a pas de catégorie de genre. D'autre part, il existe un petit nombre de radicaux verbaux qui se réfèrent exclusivement à des activités effectuées par un homme ou une femme, par exemple. ni-, ni- "l'homme marche", mais "a-" la femme marche", bu-ri-, bu-ri- "l'homme danse", mais dja-ri, dja-rT- "le la femme danse"1^ Dans ce dernier cas, la différence dans le verbe reflète probablement une différence réelle dans le caractère de la danse De plus, un certain nombre de verbes indiquant une apparence plus ou moins anormale reçoivent le suffixe -yai- lorsqu'ils se réfèrent à une femme par exemple lulmai-"un "être aveugle" (à propos d'une personne de sexe masculin), mais lulmai-yai-"un "être aveugle". Ce -yai- est une forme incorporée de l'élément suffixe -ua "personne de sexe féminin", souvent trouvé dans les noms, par exemple k!ñwi "guérisseur", mais k!uwi-ya "guérisseur", bai-djü-si "chasseur", mais bai-djú-ya "chasseur".
Formes de discours masculines et féminines à Yana. - Dans : "Teeuwen St.W.J., éd., Donum Natalicium Schrijnen". Nimègue-Utrecht, 1929, p. 79-85.
1 Pour des données sur la langue Yana, voir : S a p i g E. Yana Texts. - Univ. Californie Publ. Un m. Arch, et Ethn>, 1910, 9, pp. 1-235 ; La position de Yana dans la souche Hokan, ibid., 1917, 13, pp. 1-34 ; Yana termes de relation, ibid., 1918, 13, pp. 153-173 ; Les éléments fondamentaux de Northern Yana, ibid., 1922, 13, pp. 215 - 234 ; Analyses textuelles de trois dialectes Yana, ibid., 1923, 20, pp. 263 - 294. L'orthographe yang utilisée ici est expliquée dans ces ouvrages.
La grande majorité des mots en yana ont chacun deux variantes : la forme complète, ou masculine, et la forme réduite, ou féminine.
forme. Les termes "masculin" et "féminin" ne sont pas tout à fait adéquats, puisque les formes masculines ne sont utilisées que par les hommes pour désigner les hommes, tandis que les formes féminines sont utilisées par les femmes pour désigner les hommes, ou les femmes et les hommes pour désigner les femmes. En d'autres termes, les formes féminines sont utilisées environ trois fois plus souvent que les formes masculines. Il ne fait aucun doute que le tabou des formes masculines pour les femmes ne se pose pas, puisqu'une femme n'hésite pas à utiliser des formes masculines lorsqu'elle cite le discours d'un homme à un homme, par exemple en racontant un mythe dans lequel un personnage masculin s'adresse à un autre.
Il semble y avoir deux méthodes différentes pour juxtaposer les variantes masculines et féminines, en fonction de facteurs phonétiques et grammaticaux. La variante masculine peut coïncider avec la forme absolue, ou théoriquement basique, du mot, auquel cas la variante féminine est formée à partir du masculin par réduction phonétique de la syllabe finale ; soit la variante féminine coïncide avec la forme théoriquement de base du mot, auquel cas la variante masculine est formée à partir du féminin en ajoutant une syllabe dont le choix dépend de la catégorie de la forme donnée. Dans les deux cas, la version masculine est plus longue que la femelle. Comme nous le verrons ci-dessous, des contrastes de genre très spécifiques apparaissent dans l'interrogatif. Il faut préciser que les distinctions formelles selon le sexe ne concernent que mots complets, et non des tiges ou des éléments suffixes en soi. Ainsi, les formes masculines "ai-pa "feu", "ai-"shs^a "mon feu" correspondent aux formes féminines "ai" "feu", "ai-"shgh" "mon feu"; le contraste entre "ai-pa et" aie disparaît dès qu'un élément suffixe (par exemple "ma") est ajouté à la forme absolue ou thématique "ai-". "sorcière" correspond aux formes féminines k\ure^ (- \\a ici transformé en un oui sourd plus un r sourd, ou un hyu sourd avec un timbre en forme de 1), k\n^\-uya (-ua transformé en un y sourd avec un i -timbre figuratif) ; le contraste entre k!i\U1 et k!ida* n'est pas réalisé dans les formes signifiant "guérisseur", puisque le suffixe -ua protège l'élément k!d\*a- de la réduction.
Bien sûr, dans le présent travail, il est impossible de décrire complètement toutes les règles de formation des formes qui distinguent le sexe, car cela demanderait trop de temps. un grand nombre détails grammaticaux. On ne peut qu'illustrer les principales oppositions phonétiques et morphologiques.
Une grande classe regroupe toutes les formes nominales non monosyllabiques et de nombreuses formes verbales dans lesquelles la forme absolue, qui coïncide avec la variante masculine, se termine par une voyelle courte (a, (, et ; mais pas e, o). Dans la variante féminine correspondante , la voyelle finale est étourdie, ainsi que et la consonne précédente, si elle n'est pas aphone en elle-même. p?, g/, ks, ghs). Ainsi, la variante féminine en -g, "* peut être le résultat de la réduction des formes -gL et -si ;
par exemple. au masculin s-za-gL, au féminin n1-za-r/1, « ils disent qu'il part » ; chez le mâle r "acn", chez la femelle r" agl "lieu".

Le tableau suivant des terminaisons masculines et féminines couvre les exemples disponibles (-a remplace ici -a, -1 ou -i) :
Très rares sont les exemples d'arrêt glottal final avec une voyelle précédente dans la forme absolue - masculine. Le meilleur exemple est la terminaison douce impérative, -rn^ar" qui donne -rn^ar"a dans la version féminine, par ex. gLtt^aga" "veuillez lui dire", dans la version féminine de gLtp^ag"a.
Un sous-type spécial de la première classe principale de formes est la deuxième personne singulier na-pita (version masculine), par ex. r/TvGpita "tu dis", tfimsiwa,numa "on te dit, il te dit", "ai" pshpa "ton feu". La forme féminine parallèle ne se termine pas en *-pit" mais, comme on pouvait s'y attendre, mais simplement en -pi. Cependant, la forme masculine ne doit pas être considérée comme une combinaison de l'absolu -pi avec l'élément masculin -ta, qui serait cohérent avec la deuxième classe de formes, mais comme une forme identique à la forme absolue na-pita Cela ressort clairement du fait que l'élément -pita doit être postulé pour les formes masculines et féminines dans un interrogatif, par exemple au féminin g/GvGpita. De plus, le -ta final apparaît sans le -pi- précédent dans des formes telles que le masculin gLpshkhua "ta" je vous dis, le féminin ^shsh\ya"ta.
La deuxième classe de formes comprend toutes les formes nominales qui ne se terminent pas par une voyelle courte, tous les thèmes nominaux monosyllabiques, les démonstratifs et de nombreuses formes verbales. Toutes ces formes sont caractérisées par une syllabe masculine supplémentaire. Tous les noms dont les thèmes se terminent par des voyelles longues (a, g, d, e, o), des diphtongues (sh, ai, ig) ou des consonnes, ainsi que tous les thèmes nominaux monosyllabiques, suffisent -pa dans la version masculine, mais restent inchangés dans l'option féminine, sauf pour l'excursion (-g). Exemples:

La règle ci-dessus est quelque peu obscurcie dans certains cas par l'action lois phonétiques: par exemple, dans le dialecte du nord, la fosse syllabique finie, si elle n'est pas immédiatement protégée par la nasale suivante, passe en r et r ; de plus, r/ et p" devant les consonnes nasales deviennent des nasales sans voix avec coup de glotte. Si le topique se termine par 1 ou un Г sans voix, le suffixe -pa est assimilé à -1a, par exemple dans la variante masculine dal-la "main", au féminin dal*". Dans le dialecte Yahi, le suffixe -pa (-1a) est utilisé dans certains cas
(par exemple masculin "au-na "feu"), certains avec salut (par exemple masculin ya-hi "homme").
Aux mots démonstratifs se terminant par -e, pour former des formes masculines, on ajoute - "e". Ainsi, au masculin aidje "e" que ", au féminin aidje; au masculin aiye "e "celui-là", au féminin aiye; au masculin aige "e "là-bas (à) cela", au féminin aige.
Un nombre important de formes, principalement verbales, sont obtenues en ajoutant -"a ou -"i aux formes absolues utilisées par les femmes. Ces formulaires comprennent :
Troisième personne futurum en -si-"i, par exemple au masculin trûsi"i "il fera", au féminin t/tisi. mer masculin t/ûsi "il fait", féminin fus1.
La première personne du futurum en -sik!ô-"a, par exemple au masculin t"usiklô"a "je ferai", au féminin t"usikîô.
La troisième personne usitativa en -ta- "a, par exemple dans la version masculine de trûma" a "il avait l'habitude de faire", au féminin t "ùma.
Dubatif à la troisième personne en -k!u-"i, par exemple au masculin nisaklu"i "peut-être qu'il partira", au féminin nisâklu.
Troisième personne passive en -wa-"a, par exemple au masculin ap"djîsiwa"a "il est tué", au féminin ap"djîsiwa.
Certaines formes causales de la troisième personne ayant subi une contraction, par exemple :

Ainsi, de mô- "manger" se forment : la forme masculine môt"i "on dit qu'il mange", le féminin mot / 1, le masculin môtrê"a "on dit qu'il se nourrit", le féminin môt"ê .
7. Les formes verbales et nominales possessives, ainsi que les combinaisons adverbiales se terminant par -k "i-" a, par exemple. au masculin lautrkfi"a "on dit que son X est fort"* (résultat de la contraction du quotatif -tfi et du possessif -kfi"a), au féminin lautfk"i, au masculin rnômauk"i "a "[il mange] ça (t .e. un autre) aliment", au féminin mômaukfi, au masculin bâwisakVa "le soir", au féminin bawisak"i.
« La traduction anglaise de la forme possessive de yana est difficile à traduire en russe : on dirait que « sa est dite forte ; En raison du manque la meilleure option l'anglais substantivé his est traduit en russe par "his X". - Environ. trad.
Les impératifs constituent un groupe spécial de formes verbales. Les variantes masculines sur -"V et -"a" correspondent aux variantes féminines sur -"* et -"a, c'est-à-dire que le coup de glotte final disparaît dans les variantes féminines, par exemple dans la version masculine nisa "i" "go away !", au féminin nisa"1. L'absence de coup de glotte final est également caractéristique des impératifs féminins à la première personne de l'objet, par exemple. au masculin diwai-dja" "regarde-moi!", au féminin diwai-tc*a , au masculin diwai-krigi "regarde-nous!", au féminin diwaik"ik"".
Les formes interrogatives diffèrent des deux classes de formes que nous avons déjà considérées en ce qu'elles ont des suffixes ou enclitiques différents utilisés par les hommes et les femmes. Dans l'interrogatif normal des formes masculines, il y a un élément -p, qui nécessite un accent dynamique et un ton descendant (non montant) sur la voyelle précédente, par ex. "au"asfn "y a-t-il un incendie ?". Dans la forme féminine correspondante, la voyelle finale est allongée, conserve généralement sa qualité d'origine et reçoit un accent puissant et un ton descendant, par ex. "au" asT "y a-t-il un incendie ?". Cependant, certaines formes en -a correspondent à un interrogatif féminin en -"(, par exemple, au masculin (ts!ewal"awa-randjan "est-ce que j'ai fait du bruit?", au féminin ts!ewal"awarandjT; de plus, les formes se terminant par une diphtongue ou une consonne, se prennent en -uG au féminin, par exemple au masculin ga "layau-nan "crier", au féminin ga" layau-yT. au masculin de aidje "en" est-ce celui-là ?, au féminin aidje "e.
Un autre interrogatif, plus emphatique que le précédent, est en fait exprimé par un enclitique - pa au masculin et gi au féminin - attaché à la forme appropriée avec le sens de genre, par exemple, dans la version masculine tsllwal "asi" nuga pa "faites-vous du bruit?" , au féminin ts!ewal"asi"nukfga.
Comme nous l'avons vu, la plupart des mots en yana ont des variantes masculines et féminines distinctes. Il y a cependant des mots qui coïncident dans le discours des deux sexes. Celles-ci comprennent : 1. les particules syntaxiques (ai, indicateur de la troisième personne du sujet ; aitc", article ; dji, article avec formes possessives de la première personne ; dju, article avec formes possessives de la deuxième personne ; k*", indicateur de possessivité de la troisième personne ; gi, particule objet) ;
verbes substantifs et "c'est" et être "c'est... qui...":
certaines formes passives se terminant par une voyelle longue (par exemple ap"djTwara "il a été tué", tlml "être le destinataire du discours").
De plus, les voyelles courtes finales disparaissent avant les mots commençant par des voyelles neutres (lisses), de sorte que dans une phrase ou une phrase, la distinction de genre disparaît parfois. Dans de tels cas, la forme originale de la consonne apparaît, par exemple, la version masculine pfadi "lieu" et le féminin pfatri apparaissent dans la composition forme masculine aitcf pfad aidja "un endroit là-bas" et la forme féminine aitc" p*ad aitcf, respectivement. Il existe également des processus morphologiques qui nécessitent la réduction des formes absolues dans un mot à des formes qui coïncident avec
variantes féminines, par exemple, la variante masculine dalüwi "les deux mains" et la femelle daluoj1 prennent la forme dalua?1 dans certains cas, par exemple. au masculin daluWkVa "ses mains", au féminin dalüojikri.
En résumant ce qui a été dit, nous pouvons conclure que les variantes féminines et masculines de la langue Yana proviennent de deux sources psychologiquement différentes. Dans une minorité de cas, nous avons affaire à des particules qui distinguent le sexe. Dans l'écrasante majorité des cas, les variantes féminines s'expliquent mieux comme des formes abrégées, qui, du point de vue de leur origine, n'ont rien à voir avec le sexe, mais sont des variantes féminines isolées ou des formes réduites, motivées par le caractère phonétique et morphologique. économie de la langue. Peut-être que les formes féminines réduites sont des symboles conventionnels d'un statut moins central ou moins rituellement significatif des femmes dans la société. Les hommes, communiquant avec les hommes, parlent plus pleinement et tranquillement ; quand les femmes sont impliquées dans la communication, la voie abrégée de la prononciation est préférée ! Cette explication est plausible, mais les formes féminines en yana constituent désormais un système complexe et hautement formalisé, à bien des égards opposé au système parallèle des formes utilisées par les hommes lorsqu'ils s'adressent aux hommes.
La phrase "Nous parlons différentes langues” n'a pas été entendu par une personne rare. Mais pour nous, il a le plus souvent une connotation négative. Mais cette expression montre une autre différence entre un homme et une femme. En général, la langue que nous parlons est une, mais le discours est différent. Comment l'expliquer ? La langue est un système entier et la parole est son produit individuel. Et, comme le montrent les études et la vie elle-même, le discours d'un homme et d'une femme est très différent.
![]()
Des études de scientifiques américains citent des faits : le sexe faible parle trois fois plus que le sexe fort. Les femmes utilisent environ 20 000 mots par jour et les hommes seulement 7 000.
Le Daily Mail rapporte que les femmes parlent aussi plus vite que les hommes, passent beaucoup de temps à bavarder et aiment même entendre leur propre voix autour de leurs amis.
Et la femme psychiatre Luan Brizendine, dans son livre The Female Mind, a déclaré qu'il existe des différences entre le cerveau masculin et féminin, et qu'elles sont innées. Ce fait explique notre besoin constant de communication.
![]()
En outre, les différences d'élocution sont influencées par des facteurs tels que l'éducation, la culture et les comportements. Après tout, pendant de nombreux siècles, une femme a été douce, douce et soumise, et un homme a été son protecteur, fort, courageux, indépendant. À notre époque, les statuts et les privilèges des deux sexes sont sur un pied d'égalité, sauf qu'ils diffèrent légèrement dans les buts et les objectifs.
Les discours des hommes sont caractéristiques:
- Spécificité, précision.
- Sujets de travail, politique, sports, chasse, innovations.
- Lien vers les autorités. Comme disait Steve Jobs....
- Ironie. "Si j'étais toi, je ne triompherais pas...".
- Vocabulaire professionnel (business, technologie)
- L'abondance de mots introductifs affirmatifs "évidemment", "sans aucun doute", "bien sûr".
- La prédominance des verbes dans le discours, qui caractérise leur activité dans l'action.
- Utiliser mots obscènes(pas toujours et pas pour tout le monde, mais présent).
![]()
Les discours d'une femme sont caractéristiques:
- Émotivité, non-conflit.
- Sujets de la famille, des relations humaines, de la vie quotidienne, de la mode, de la parentalité, de la littérature et de l'art.
- Détails, détails.
- Lié à expérience personnelle films, séries, livres. "Et voici Carrie Bradshaw dans la saison 3..."
- Imitation du discours, du ton et des phrases femmes célèbres. Par exemple, la célèbre phrase de Coco Chanel "Je me fiche de ce que vous pensez de moi. Je ne pense pas du tout à toi".
- Beaucoup de mots d'introduction : « A mon avis », « Il me semble », « Peut-être ».
- La mention de mots "prestigieux" ou "élevés" : "rôle", "esthétique", "élite", "silhouette".
- Énoncés évaluatifs, le plus souvent sous la forme d'adverbes "très bon", "positif", "incroyable".
- La présence dans la langue d'un grand nombre de définitions et d'ajouts. (« spectaculaire », « imprévisible », « insupportable », etc.).
- Généralisation et exagération ("Tu es comme tout le monde !", "Tous les hommes sont pareils", etc.).
![]()
Pourquoi une telle différence à la fois dans les caractéristiques et dans la disponibilité des points, car les femmes en ont beaucoup plus ? Passons à la recherche. Ils montrent que les deux sexes utilisent le langage à des fins différentes.
Pour une femme, la parole est une sorte d'outil, une clé qui peut s'adapter à différentes serrures.
Elle, en vertu de sa ruse naturelle, ne prend pas tout au pied de la lettre et cherche partout des sens cachés. Il en va de même pour sa propre communication : la gent féminine ne dit pas toujours ce qu'elle pense, tout en analysant simultanément ses propos, en observant la réaction de son interlocuteur, en évaluant ses mimiques et son comportement.
![]()
Pour les hommes, la parole n'est qu'un moyen à utiliser dans les affaires et pour les affaires, même si c'est la séduction d'une personne qu'il aime. Contrairement aux femmes, ils ont tendance à tout prendre au pied de la lettre, car ils ont eux-mêmes l'habitude de parler clairement et clairement, comme s'ils donnaient des ordres à service militaire. Pas étonnant que les hommes aiment davantage les femmes qui leur obéissent.
![]()
Les principaux problèmes résident précisément dans la différence de discours - celui qui est présenté et celui qui est compris. Les femmes ont tendance à "s'accrocher" à chaque mot, à y chercher un sens caché, et les hommes comprennent mal vos phrases symboliques. Aussi banal que cela puisse paraître, soyez simple ! Chaque mot a sa propre signification et il est en votre pouvoir de la transmettre correctement à l'interlocuteur.
Ekaterina Tikhonova
Ou gendérologie linguistique- Il s'agit d'une section de linguistique ou, par conséquent, d'une section d'études de genre qui étudie les caractéristiques du discours des représentants de sexes différents. Notez qu'il existe deux types de genre, ou de sexe : biologique et socioculturel. sexe biologique- il s'agit d'un ensemble de caractéristiques anatomiques et physiologiques permettant de déterminer l'appartenance d'un individu à un sexe particulier. Genre socioculturel est un complexe les normes sociales, attentes, réactions, valeurs qui forment les traits de personnalité individuels. Études linguistiques de genre les différences linguistiques des genres socioculturels, qui ne coïncident pas toujours avec les différences biologiques. Dans le même temps, les caractéristiques à la fois écrites et discours oral.
Sélection du sujet
Hommes ont tendance à dominer la conversation et à choisir indépendamment le sujet du dialogue. Dans le même temps, ils ne passent guère à un autre sujet et peuvent ne pas répondre aux remarques de l'interlocuteur interrompant ou essayant de s'engager sur une autre voie, continuant obstinément à adhérer à la ligne choisie. Femmes passer d'un sujet à l'autre beaucoup plus facilement et parfois ils contribuent eux-mêmes à un tel changement à leur propre guise.
Coloration de la parole
 Contrairement au stéréotype le beau sexe ils disent moins que les forts, tandis que leurs phrases sont plus courtes. Mais là où les stéréotypes ont raison, c'est que le discours des femmes est beaucoup plus émotionnel, expressif et évaluatif. Les dames aiment vraiment les épithètes diverses, les hyperboles, les comparaisons, les suffixes diminutifs. Pour les hommes, les évaluations sont moins spécifiques, et s'ils les utilisent, elles sont plus souvent négatives que positives. Mais beaucoup d'hommes d'une manière ou d'une autre gravitent vers le vocabulaire obscène. Cependant, ce ne seront pas nécessairement des jurons, peut-être juste un vocabulaire stylistiquement réduit.
Contrairement au stéréotype le beau sexe ils disent moins que les forts, tandis que leurs phrases sont plus courtes. Mais là où les stéréotypes ont raison, c'est que le discours des femmes est beaucoup plus émotionnel, expressif et évaluatif. Les dames aiment vraiment les épithètes diverses, les hyperboles, les comparaisons, les suffixes diminutifs. Pour les hommes, les évaluations sont moins spécifiques, et s'ils les utilisent, elles sont plus souvent négatives que positives. Mais beaucoup d'hommes d'une manière ou d'une autre gravitent vers le vocabulaire obscène. Cependant, ce ne seront pas nécessairement des jurons, peut-être juste un vocabulaire stylistiquement réduit.
L'utilisation des parties du discours
Parlant de l'utilisation de certaines parties du discours, les scientifiques ne sont pas encore parvenus à un consensus sur qui utilise le plus de verbes - hommes ou femmes. Quelqu'un dit que les femmes - pour rendre leur discours plus vivant, car la vivacité et l'émotivité vont de pair.  Quelqu'un dit que ce sont des hommes, parce qu'il est plus facile avec des verbes de rendre le discours clair et dynamique, et aussi de montrer la séquence des événements.
Quelqu'un dit que ce sont des hommes, parce qu'il est plus facile avec des verbes de rendre le discours clair et dynamique, et aussi de montrer la séquence des événements.
Cependant, presque tous les experts s'accordent à dire que femmes ils utilisent plus d'adjectifs, car ils peuvent transmettre des couleurs, des détails, des nuances que les femmes aiment beaucoup. En ce qui concerne les noms, de nombreux scientifiques sont également similaires : noms masculins abstrait, tandis que les femmes sont plus "mondaines", tandis que les hommes aiment les détails, et femmes parfois ils recourent à des phrases ornées, à divers synonymes figurés. Les femmes préfèrent les pronoms personnels - je, vous, nous, il, etc. Les hommes préfèrent différencier les objets ou les phénomènes, ils utilisent donc souvent des pronoms possessifs - le mien, le vôtre, le vôtre, le sien - et des adjectifs possessifs.
Connexion des phrases dans le discours
Hommes utilisent principalement une connexion syntaxique subordonnée, ainsi que des temps, des buts et des lieux subordonnés. Ils construisent souvent des chaînes logiques, des hiérarchies, établissent une relation causale, et cette caractéristique de la pensée est visible dans cette caractéristique de leur discours. Discours de femmes contient des clauses comparatives et des clauses concessives. Le sexe fort utilise plus souvent les ordres et les femmes utilisent les demandes indirectes. Lorsqu'ils répondent à une question, les hommes veulent souvent obtenir une réponse claire, de sorte que la question est construite assez clairement. Beaucoup de femmes répondent de manière fleurie, et elles construisent également des questions - plus ouvertes que beaucoup d'hommes.
Caractéristiques du discours écrit des hommes et des femmes
Dans le texte des hommes beaucoup de mots introductifs, surtout énonçant et introduisant des relations logiques : sans doute, évidemment, donc. De plus, les représentants du sexe fort aiment tout mettre sur les étagères: "premièrement - deuxièmement", "d'une part  - d'autre part". Comme à l'oral, les hommes utilisent beaucoup noms abstraits, alors qu'ils sont généralement avares d'évaluations et ne recourent pas à une variété d'outils d'évaluation. Les hommes ne mettent pas très volontiers des points d'exclamation, s'ils utilisent des émoticônes, ils sont pour la plupart simples et, en règle générale, pas trop souvent.
- d'autre part". Comme à l'oral, les hommes utilisent beaucoup noms abstraits, alors qu'ils sont généralement avares d'évaluations et ne recourent pas à une variété d'outils d'évaluation. Les hommes ne mettent pas très volontiers des points d'exclamation, s'ils utilisent des émoticônes, ils sont pour la plupart simples et, en règle générale, pas trop souvent.
Le discours du beau sexe plus émotionnel, rempli de définitions, d'ajouts, de circonstances et d'autres membres mineurs. Certaines femmes se caractérisent par de multiples points d'exclamation et d'interrogation et un grand nombre d'émoticônes. Les femmes, contrairement à beaucoup d'hommes, n'aiment pas les réponses claires, et utilisent donc divers éléments d'incertitude ou de spéculation, comme « peut-être », « probablement », à mon avis, « peut-être ». Contrairement aux messieurs, les dames peuvent appeler les choses non pas par leur nom propre, mais utiliser divers synonymes évaluatifs, figuratifs, euphémismes, etc.
Le thème "langue et genre" a récemment été activement développé en linguistique. L'un des premiers ouvrages dans ce domaine est le livre du chercheur américain Robin Lakoff (Robin Lakoff) "Le langage et la place des femmes" ("Langage et place de la femme", 1975). Selon Lakoff, il existe les principales différences suivantes entre la version féminine de la langue et la version masculine :
- les femmes utilisent des adjectifs évaluatifs plus "vides" (par exemple "mignon");
- les femmes utilisent des formes interrogatives là où les hommes utilisent des formes affirmatives ;
- les femmes sont plus susceptibles d'utiliser des formules de politesse ;
- les femmes sont plus susceptibles d'utiliser des formes exprimant l'incertitude ("tu sais", "il me semble", "probablement", "peut-être")
- les femmes sont plus susceptibles d'utiliser des activateurs ("si mignon", "charmant");
- les femmes sont plus susceptibles d'utiliser une grammaire hypercorrecte.
Les oppositions de genre se manifestent de différentes manières dans les langues du monde. Une tentative de systématisation a été faite, par exemple, dans les travaux de J. Sherzer (Sherzer, 1995) ; Notez que les types suivants ne sont pas mutuellement exclusifs.
1. Distinctions obligatoires sur la base du masculin/féminin dans la langue. Il s'agit de sur la distinction obligatoire entre deux variantes d'une même langue - masculine et féminine (le plus souvent cette distinction est perceptible au niveau phonétique et/ou morphologique). L'un des exemples les plus célèbres est la langue des îles Caraïbes en Amérique centrale. Lorsque les Européens se sont installés pour la première fois aux Petites Antilles, ils ont remarqué que les hommes et les femmes parlaient des « langues différentes » : une partie du vocabulaire (racines) était différente, ainsi que plusieurs indicateurs grammaticaux. Lorsqu'il s'agit d'un homme, la «version masculine» a toujours été utilisée, lorsqu'il s'agit d'une femme, «femelle». Des rapports du XVIIe siècle notent que la violation des normes établies était considérée comme un crime grave.
Pour expliquer ce phénomène et des phénomènes similaires, l'hypothèse du tabou a été avancée. Lorsque les hommes sont allés sur le sentier de la guerre, on leur a peut-être demandé d'utiliser un certain ensemble de mots "masculins". Dans le même temps, il était interdit aux femmes et aux enfants de prononcer certains mots qui pourraient «avertir les ennemis», «attirer les esprits» ou «effrayer les proies», sinon la chance se serait détournée des guerriers et des chasseurs. Le facteur tabou pourrait avoir influencé la différenciation du langage selon le sexe. Cette hypothèse par rapport aux Caraïbes n'est pas confirmée (bien qu'elle ne soit pas directement réfutée) faits historiques, cependant, trouve beaucoup de parallèles typologiques.
Un exemple de langue dont le système tabou est la cause émergence de différences de genre, - Zoulou. zoulou femme mariée ne pouvait pas prononcer à haute voix les noms du père et des frères de son mari. Dans certains cas, il lui était interdit de prononcer des sons pouvant être associés d'une manière ou d'une autre à des noms tabous, c'est-à-dire qu'une femme n'avait pas le droit d'en prononcer, même le mot le plus courant, s'il contenait un son caractéristique inclus dans les noms de parents masculins. Un tel système de tabous pourrait bien conduire à diverses possibilités langues, séparées par sexe.
Un autre exemple de différenciation sexuelle est systèmes de pronoms personnels. Ainsi, en russe, en anglais et dans de nombreuses autres langues, la différenciation sur la base du genre ne se manifeste dans les pronoms qu'à la 3ème personne et uniquement au singulier: il - elle, mais ils; lui , elle , mais eux . En français, cette différenciation se retrouve aussi dans pluriel: ils-elles. En finnois et à la 3ème personne du singulier, le pronom personnel n'est pas différencié selon le genre : han. Dans certaines langues, les pronoms de la 2ème et de la 1ère personne sont également différenciés selon le sexe: par exemple, en thaï, dans une conversation polie de personnes de statut égal, un homme dira de lui-même phom et une femme - dichan.
2. Différents styles de discours pour les hommes et les femmes. Dans ce cas, le style est compris comme un ensemble de caractéristiques linguistiques - phonétiques, rythmiques, intonationnelles, morphologiques, syntaxiques, lexicales, qui sont associées au comportement de parole masculin ou féminin. Les femmes peuvent parler plus ou moins vite, plus ou moins, plus figurativement ou plus simplement que les hommes. Les femmes peuvent "avaler" les fins tandis que les hommes ne le peuvent pas, ou vice versa. Les femmes (ou, respectivement, les hommes) peuvent parler avec une intonation particulière, etc.
Il convient de noter que, comme c'est souvent le cas, les normes culturelles imprimées dans l'esprit des membres de la société peuvent ne pas coïncider avec la pratique réelle. En ce qui concerne le problème à l'étude, peu importe que de telles différences dans le discours des hommes et des femmes existent réellement dans une société particulière ; plus important encore, dans cette société on croit que les femmes et les hommes parlent différemment. Par exemple, les locuteurs natifs russes pourraient dire que les femmes parlent plus et plus vite que les hommes, mais cela ne sera pas nécessairement confirmé statistiquement.
3. Différents principes d'organisation du comportement de la parole. Des études ont montré que les hommes et les femmes se comportent différemment lors d'une conversation, utilisent le langage différemment lors d'une conversation. Dans de telles études, on calcule généralement le nombre de «distractions» du sujet principal de la conversation, le passage d'un sujet à un autre, les appels inattendus à un autre interlocuteur, l'interruption de l'interlocuteur, etc.. Cela inclut également les différences dans la fréquence des l'utilisation de certaines caractéristiques linguistiques. L'utilisation de certaines caractéristiques phonétiques, morphologiques, syntaxiques et lexicales dans le discours masculin et féminin, selon l'analyse statistique, s'avère significative (en même temps, contrairement à la situation décrite dans le paragraphe précédent, les membres de la société peuvent être sûrs que "tout le monde parle de la même manière").
Ainsi, il a été établi que les femmes anglophones ont tendance à poser des questions, à entretenir un dialogue, à exprimer leur solidarité avec l'interlocuteur, souvent à stimuler, à soutenir la conversation sous forme de réponses minimales (cf. interjections russes de ce type - "mmm" , "uh-huh" etc.). Les hommes, au contraire, interrompent souvent l'interlocuteur, ont tendance à être en désaccord avec leur partenaire, ignorent les déclarations des interlocuteurs, contrôlent plus étroitement le sujet de la conversation et sont enclins à exprimer directement leur opinion. Les femmes évitent la rivalité ouverte dans le dialogue au niveau de la parole (leur rivalité est généralement plus cachée), elles attendent des signes d'approbation et de soutien sous forme de hochements de tête, d'interjections, elles montrent elles-mêmes des signes d'intérêt et d'attention. Les racines de ces différences résident dans la dissemblance de l'éducation, les lignes directrices de base pour le comportement des garçons et des filles.
P. Trudgill (Trudgill, 1995) montre quelles options de prononciation les hommes et les femmes choisissent dans les pays anglophones selon le paramètre prestige/non-prestige. En moyenne, on observe une tendance constante à les femmes choisissent une prononciation plus prestigieuse. Évidemment, cela est également lié aux stéréotypes de comportement féminin et masculin qui existent dans cette culture.
D. Tannen (Tannen, 1982) fournit des données sur une expérience qu'elle a menée pour révéler la propension de trois groupes (Américains, Grecs d'Amérique, Grecs de Grèce) et de deux genres à interpréter la parole comme directe (ayant un sens direct et non ambigu) ou indirecte. (ayant une deuxième signification supplémentaire). Les sujets ont reçu la tâche suivante.
Le texte était donné : un couple marié est en train de parler:
Femme : John organise une fête. Tu veux y aller?
Mari : OK (bien).
Épouse : Je vais appeler et dire que nous serons là.Sur la base de cette conversation, cochez l'une des deux phrases qui, selon vous, expliquent ce que le mari voulait vraiment dire lorsqu'il a dit OK (ok) :
A : La femme veut y aller, puisqu'elle le demande. Je vais lui plaire.
B : Ma femme me demande si je veux y aller. Je voudrais dire oui.Qu'est-ce qui, dans les mots de la femme et du mari, vous fait choisir l'une des options proposées? Qu'est-ce qu'une femme ou un mari aurait à dire pour que vous choisissiez une autre option ?
L'expérience a montré qu'il existe des différences entre les groupes ethniques.
|
Sol |
Choix de l'option A, % | ||
| Grecs de Grèce | Grecs américains | les Américains | |
| Hommes | 50 | 44 | 27 |
| Femmes | 47 | 43 | 36 |
Ainsi, les femmes américaines sont beaucoup plus susceptibles que les hommes américains de chercher un second sens dans les propos de l'interlocuteur.
4. Choix de la langue par les hommes et les femmes en situation multilingue et bilingue. Les hommes et les femmes se comportent différemment dans les situations de multilinguisme et de bilinguisme. Les hommes sont plus activement impliqués dans le bilinguisme - en raison de leur activité dans le commerce, la chasse et d'autres activités qui les obligent à quitter la maison. Ainsi, dans la région frontalière de l'Autriche, où une partie de la population est bilingue et où l'on trouve à la fois des hommes et des femmes qui parlent à la fois l'allemand et le hongrois, les hommes préfèrent le hongrois, et les femmes préfèrent l'allemand comme plus prestigieux (Gal, 1978).
5. Répartition par sexe des "genres" et des rôles dans la conversation. J. Sherzer (Sherzer, 1995) note que chez les Indiens Kuna vivant au Panama, les genres purement masculins sont toutes sortes de prise de parole en public, racontant des mythes tribaux, des chants magiques ; genres féminins - chanter des berceuses, pleurer.
6. Choix par les hommes et les femmes de différents modèles de comportement de parole. La société malgache est souvent citée en exemple, dans laquelle il existe deux modèles de ce type - le discours direct et le discours indirect. Le discours direct est plus caractéristique des femmes et est utilisé dans les relations commerciales, où les femmes sont majoritairement impliquées. Le discours indirect est associé à la prise de parole en public, c'est-à-dire à la politique, d'autres domaines où se manifeste l'activité sociale, qui est principalement caractéristique des hommes.
C'est le cas avec la mise en œuvre de la fonction masculin/féminin dans différentes langues. Cela implique que la société donne aux hommes et aux femmes des rôles sociaux. Cependant, ces rôles peuvent changer avec le temps, les changements linguistiques étant généralement en retard sur les changements dans les rôles sociaux. Lorsque les rôles sociaux ou les stéréotypes sociaux entrent en conflit avec les normes linguistiques, les gens commencent à briser délibérément les formules linguistiques qui orientent une personne vers des stéréotypes basés sur la différenciation et la discrimination sexuelles. D'où «l'expulsion» du suffixe réellement désémantisé - homme dans des mots comme président (président) et le transformant en président. D'où les "pronoms complexes" adoptés dans la norme écrite actuelle de la langue anglaise dans des cas comme "Lorsqu'un enfant acquiert une langue, il (option : il/elle) n'en apprend d'abord qu'une variété"(lit. "Lorsqu'un enfant apprend une langue, il n'en apprend d'abord qu'une seule version") - ou même l'utilisation du pronom elle dans de tels cas.
Ainsi, les hommes et les femmes parlent différemment, et ces options ne dépendent pas de la situation : il n'y a quasiment pas de « situations féminines » et de « situations masculines » où une même personne choisirait telle ou telle option à son gré. Une femme parle différemment d'un homme et l'auditeur est capable de distinguer le discours des femmes du discours des hommes non seulement par le timbre de la voix. Cela devient particulièrement visible lorsque les règles sont enfreintes (cf. personnages typiques des films comiques - les hommes parlent "féminine", et vice versa).
Une analyse du fonctionnement des différentes langues indique que les femmes ont tendance à être plus conservatrices dans leur pratique de la parole que les hommes : généralement, toutes les innovations entrent dans la langue par le biais de la parole masculine. En conséquence, les formes féminines sont généralement d'origine plus ancienne que les formes masculines : les changements de langage se produisent principalement dans le discours des hommes. Ainsi, dans la langue tchouktche, dans certains dialectes, les consonnes intervocaliques sont conservées dans le discours des femmes, mais disparaissent régulièrement dans le discours des hommes: la version masculine est ank "aat, - la version féminine est ank'anat 'ces'.
Certains chercheurs défendent le point de vue selon lequel les personnes ne peuvent être considérées comme des prototypes de discours de leur groupe de genre et qu'il faudrait plutôt parler non pas de discours féminin et masculin, mais du degré de « féminité » et du degré de « masculinité » dans la discours d'un individu. La recherche sociolinguistique consiste à travailler avec des catégories socio-démographiques, mais ces catégories elles-mêmes doivent être traitées avec prudence. Les catégories sociodémographiques peuvent facilement s'avérer être un mythe, un préjugé ou une erreur, de sorte que même des catégories apparemment évidentes comme le genre ne doivent pas être utilisées sans discernement. Bien au contraire : la recherche doit être dirigée vers le processus même de construction de ces catégories : ces catégories sont constamment construites, créées et recréées par les membres du groupe eux-mêmes, et elles sont créées en grande partie précisément dans le processus d'interaction de la parole. .