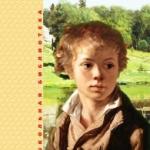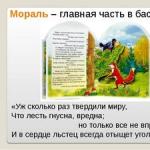lois saines. Lois phonétiques et règles orthoépiques de la langue russe
Lois phonétiques sont purement linguistiques lois internes, et elles ne peuvent être réduites à aucune autre loi de l'ordre physico-biologique.
Lois phonétiques spécifique pour les groupes de langues apparentées et pour les langues individuelles.
Les lois phonétiques (lois du son) sont les lois du fonctionnement et du développement de la matière sonore d'une langue, qui régissent à la fois la conservation stable et le changement régulier de ses unités sonores, de leurs alternances et combinaisons.
1. Loi phonétique de la fin d'un mot. Une consonne vocale bruyante à la fin d'un mot est assourdie, c'est-à-dire prononcé comme le double sourd correspondant. Cette prononciation conduit à la formation d'homophones : le seuil est un vice, jeune est un marteau, chèvres est une tresse, etc. Dans les mots avec deux consonnes à la fin du mot, les deux consonnes sont étourdies : poitrine - tristesse, entrée - monter [pΛdjest], etc.
L'étourdissement de la voix finale se produit dans les conditions suivantes :
1) avant une pause: [pr "ishol post] (le train est venu); 2) avant le mot suivant (sans pause) avec l'initiale non seulement sourde, mais aussi une voyelle, sonorante, ainsi que [j] et [c] : [praf he], [our sat], [slap ja], [ta bouche] (il a raison, notre jardin, je suis faible, ton genre).
2. Assimilation des consonnes par la voix et la surdité. Les combinaisons de consonnes, dont l'une est sourde et l'autre est exprimée, ne sont pas caractéristiques de la langue russe. Ainsi, si deux consonnes de voix différentes apparaissent côte à côte dans un mot, la première consonne est assimilée à la seconde. Ce changement de consonnes est appelé assimilation régressive.
En vertu de cette loi, les consonnes voisées devant le sourd se transforment en sourdes appariées, et les sourds dans la même position en voisées. La voix des consonnes sans voix est moins courante que l'étourdissement des consonnes vocales; la transition de exprimé à sourd crée des homophones: [dushk - dushk] (manille - chéri), [dans "oui" ti - dans "oui" t "et] (porter - conduire), [fp" yr "em" yeshka - fp " r "eem" yeschka] (entrecoupé - entrecoupé).
Devant les sonorants, comme devant [j] et [c], les sourds restent inchangés : tinder, coquin, [Λtjest] (départ), le tien, le tien.
Les consonnes voisées et sourdes sont assimilées dans les conditions suivantes : 1) à la jonction des morphèmes : [pΛhotk] (démarche), [collection] (collection) ; 2) à la jonction des prépositions avec le mot : [where "elu] (to business), [zd" elm] (with business) ; 3) à la jonction d'un mot avec une particule : [got-th] (un an), [dod`zh`by] (fille ferait); 4) à la jonction de mots significatifs prononcés sans pause : [rock-kΛzy] (corne de chèvre), [ras-p "at"] (cinq fois).
3. Assimilation des consonnes par douceur. Les consonnes dures et douces sont représentées par 12 paires de sons. Par éducation, ils diffèrent par l'absence ou la présence de palatalisation, qui consiste en une articulation supplémentaire (la partie médiane de l'arrière de la langue s'élève jusqu'à la partie correspondante du palais).
L'assimilation de douceur a un caractère régressif : la consonne s'adoucit, devenant comme la consonne douce suivante. Dans cette position, toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, ne s'adoucissent pas et toutes les consonnes douces ne provoquent pas un adoucissement du son précédent.
Toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, s'adoucissent dans les positions faibles suivantes : 1) avant le son de la voyelle [e] ; [b" ate], [c" eu], [m" ate], [s" ate] (blanc, poids, craie, villages), etc. ; 2) avant [et] : [m "silt], [n" limon "et] (mil, bu).
Avant [g], [w], [c] non appariés, les consonnes douces sont impossibles, à l'exception de [l], [l "] (comparez la fin - l'anneau).
Dentaire [h], [s], [n], [p], [e], [t] et labial [b], [p], [m], [c], [f] sont les plus sensibles au ramollissement . Ils ne s'adoucissent pas devant les consonnes douces [g], [k], [x], et aussi [l] : glucose, key, bread, fill, keep quiet, etc. L'adoucissement se produit dans le mot, mais est absent avant la consonne douce du mot suivant ([here - l "eu]; comparez [Λ tor]) et avant la particule ([grew-l" and]; comparez [rΛsli]) (voici la forêt, loutre, si elle a grandi, grandi).
Consonnes [h] et [s] s'adoucissent devant doux [t"], [d"], [s"], [n"], [l"] : [m "ês" t"], [v" iez " d "e], [f-ka avec "b], [punition"] (vengeance, partout, au box-office, exécution). L'atténuation [s], [s] se produit également à la fin des préfixes et des prépositions en accord avec avant les lèvres douces : [rz "d" iel "it"], [r's" t "ienut"], [b" ez "-n" ievo), [b "yes" -s "il] (split, stretch , sans elle, pas de puissance). Avant le ramollissement labial doux [h], [s], [d], [t] est possible à l'intérieur de la racine et à la fin des préfixes sur -z, ainsi que dans le préfixe s- et dans une préposition qui lui est conforme : [s "m" ex] , [s "in" êr], [d "in" êr |, [t "in" êr], [s "p" êt"], [s "-n" eux], [est "-pêch"], [rΛz "d" t"] (rire, bête, porte, Tver, chanter, avec lui, cuire, se déshabiller).
Les labiales ne ramollissent pas avant les dents molles : [pt "ên" h "bk], [n" eft "], [vz" at "] (poussin, huile, prendre).
4. Assimilation des consonnes par dureté. L'assimilation des consonnes par dureté s'effectue à la jonction de la racine et du suffixe, qui commence par une consonne dure : serrurier - serrurier, secrétaire - secrétariat, etc. Avant le [b] labial, l'assimilation en dureté ne se produit pas : [prΛs "it"] - [proz "b], [mllt "it"] - [mld" ba] (ask - request, thresh - thresh), etc. . [l"] n'est pas soumis à assimilation : [pol" b] - [zΛpol" nyj] (champ, extérieur).
5. Assimilation des dents avant le sifflement. Ce type d'assimilation s'étend au dentaire [h], [s] en position avant le sifflement (antéro-palatin) [w], [g], [h], [w] et consiste en l'assimilation complète du dentaire [h ], [s] au sifflement ultérieur .
L'assimilation complète [h], [s] se produit :
1) à la jonction des morphèmes : [zh at"], [rΛzh at"] (compresser, desserrer) ; [sh yt "], [rΛ sh yt"] (coudre, broder); [w "de], [rΛ w" de] (compte, calcul); [différent sh "ik], [out of sh" ik] (colporteur, chauffeur de taxi);
2) à la jonction d'une préposition et d'un mot : [bras s-zh], [bras s-sh] (avec chaleur, avec une balle) ; [bee s-zh ar], [bee s-sh ar] (pas de chaleur, pas de balle).
La combinaison de zzh à l'intérieur de la racine, ainsi que la combinaison de zhzh (toujours à l'intérieur de la racine) se transforment en un long doux [zh "] : [par zh"] (plus tard), (je conduis) ; [en w "et], [tremblement" et] (rênes, levure). Eventuellement, dans ces cas, un long dur [g] peut être prononcé.
Une variante de cette assimilation est l'assimilation de dental [d], [t] les suivant [h], [c], résultant en long [h], [c] : [Λ h "de] (rapport), (fkra tsb ] (brièvement).
6. Simplification des combinaisons de consonnes. Les consonnes [d], [t] dans les combinaisons de plusieurs consonnes entre les voyelles ne sont pas prononcées. Une telle simplification des groupes de consonnes est systématiquement observée dans les combinaisons : stn, zdn, stl, ntsk, stsk, vstv, rdts, lnts : [usny], [posn], [w" et iflivy], [g "igansk" et] , [h " ustv], [coeur], [soleil] (oral, tardif, heureux, gigantesque, sentiment, coeur, soleil).
7. Réduction des groupes de consonnes identiques. Lorsque trois consonnes identiques convergent à la jonction d'une préposition ou d'un préfixe avec le mot suivant, ainsi qu'à la jonction d'une racine et d'un suffixe, les consonnes sont réduites à deux : [ra sor "it"] (temps + querelle) , [avec ylk] (avec un lien), [kΛlo n s] (colonne + n + th) ; [Λde avec ki] (Odessa + sk + y).
Les principaux processus phonétiques se produisant dans un mot comprennent : 1) la réduction ; 2) étourdissant ; 3) voix; 4) ramollissement ; 5) assimilation ; 6) simplifier.
La réduction est un affaiblissement de la prononciation des voyelles en position atone : [house] - [d ^ ma] - [d ^ voi].
L'étourdissement est un processus dans lequel les voix s'accordent avant les sourdes et sont prononcées comme sourdes à la fin d'un mot; livre - livre [w] ka; chêne - du [p].
La voix est un processus dans lequel les sourds en position devant les voix sont prononcés comme exprimés: do - [z "] do; sélection - o [d] bore.
L'adoucissement est un processus dans lequel les consonnes dures sont douces sous l'influence des douces suivantes: depend [s ’] t, ka [s ’] n, le [s ’] t.
L'assimilation est un processus dans lequel une combinaison de plusieurs consonnes dissemblables est prononcée comme un son long [c]): volume [w] ik, ressort [w] aty, mu [w "]ina, [t"] astye, ichi [ c] a) La simplification des groupes de consonnes est un processus dans lequel, dans les combinaisons de consonnes stn, zdn, mange, dts, personnes et autres, un son tombe, bien que la lettre désignant ce son soit utilisée dans la lettre: cœur - [s "e" rts'], soleil - [fils].
8. Réduction des voyelles. Le changement (affaiblissement) des voyelles dans une position non accentuée est appelé réduction, et les voyelles non accentuées sont appelées voyelles réduites. Distinguer la position des voyelles non accentuées dans la première syllabe préaccentuée (position faible du premier degré) et la position des voyelles non accentuées dans le reste syllabes non accentuées(position faible du second degré). Les voyelles en position faible du second degré subissent plus de réduction que les voyelles en position faible du premier degré.
Voyelles en position faible du premier degré : [vΛly] (hampes) ; [arbres] (bœufs); [bi e da] (problème), etc.
Voyelles en position faible du second degré : [parʌvos] (locomotive) ; [kargΛnda] (Karaganda); [kalkla] (cloches); [p "l" et e sur] (suaire); [voix] (voix), [exclamation] (exclamation), etc.
Synchronie - (du grec sýnchronós - simultané), prise en compte d'une langue (ou de tout autre système de signes) en termes de relation entre ses parties constitutives en une période de temps. Par exemple, la forme nominative singulier"table" en synchronie a fin nulle, par opposition au génitif "stol-a".
L'identification de la dynamique de développement en synchronie est également possible en comparant plusieurs styles fonctionnant simultanément (dont le choix est déterminé par les conditions de communication) - plus solennel (élevé), conservant des traits anciens, et plus familier (bas), en où la direction du développement du langage est devinée (par exemple, une forme abrégée [chiek] au lieu de "man").
L'étude des phénomènes phonétiques en termes de synchronie est l'étude de la phonétique d'une langue particulière en ce moment comment système finiéléments liés et interdépendants.
Lois phonétiques (lois sonores) - les lois du fonctionnement et du développement de la matière sonore d'une langue, qui régissent à la fois la conservation stable et le changement régulier de ses unités sonores, leurs alternances et combinaisons
1. Loi phonétique de la fin d'un mot. Une consonne vocale bruyante à la fin d'un mot est assourdie, c'est-à-dire prononcé comme le double sourd correspondant. Cette prononciation conduit à la formation d'homophones : le seuil est un vice, jeune est un marteau, chèvres est une tresse, etc. Dans les mots avec deux consonnes à la fin du mot, les deux consonnes sont étourdies : poitrine - tristesse, entrée - monter [pΛdjest], etc.
L'étourdissement de la voix finale se produit dans les conditions suivantes :
1) avant une pause: [pr "ishol post] (le train est venu); 2) avant le mot suivant (sans pause) avec l'initiale non seulement sourde, mais aussi une voyelle, sonorante, ainsi que [j] et [c] : [praf he], [our sat], [slap ja], [ta bouche] (il a raison, notre jardin, je suis faible, ton genre).
2. Assimilation des consonnes par la voix et la surdité. Les combinaisons de consonnes, dont l'une est sourde et l'autre est exprimée, ne sont pas caractéristiques de la langue russe. Ainsi, si deux consonnes de voix différentes apparaissent côte à côte dans un mot, la première consonne est assimilée à la seconde. Ce changement de consonnes est appelé assimilation régressive.
En vertu de cette loi, les consonnes voisées devant le sourd se transforment en sourdes appariées, et les sourds dans la même position en voisées. La voix des consonnes sans voix est moins courante que l'étourdissement des consonnes vocales; la transition de exprimé à sourd crée des homophones: [dushk - dushk] (manille - chéri), [dans "oui" ti - dans "oui" t "et] (porter - conduire), [fp" yr "em" yeshka - fp " r "eem" yeschka] (entrecoupé - entrecoupé).
Devant les sonorants, comme devant [j] et [c], les sourds restent inchangés : tinder, coquin, [Λtjest] (départ), le tien, le tien.
Les consonnes voisées et sourdes sont assimilées dans les conditions suivantes : 1) à la jonction des morphèmes : [pΛhotk] (démarche), [collection] (collection) ; 2) à la jonction des prépositions avec le mot : [where "elu] (to business), [zd" elm] (with business) ; 3) à la jonction d'un mot avec une particule : [got-th] (un an), [dod`zh`by] (fille ferait); 4) à la jonction de mots significatifs prononcés sans pause : [rock-kΛzy] (corne de chèvre), [ras-p "at"] (cinq fois).
3. Assimilation des consonnes par douceur. Les consonnes dures et douces sont représentées par 12 paires de sons. Par éducation, ils diffèrent par l'absence ou la présence de palatalisation, qui consiste en une articulation supplémentaire (la partie médiane de l'arrière de la langue s'élève jusqu'à la partie correspondante du palais).
L'assimilation de douceur a un caractère régressif : la consonne s'adoucit, devenant comme la consonne douce suivante. Dans cette position, toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, ne s'adoucissent pas et toutes les consonnes douces ne provoquent pas un adoucissement du son précédent.
Toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, s'adoucissent dans les positions faibles suivantes : 1) avant le son de la voyelle [e] ; [b" ate], [c" eu], [m" ate], [s" ate] (blanc, poids, craie, villages), etc. ; 2) avant [et] : [m "silt], [n" limon "et] (mil, bu).
Avant [g], [w], [c] non appariés, les consonnes douces sont impossibles, à l'exception de [l], [l "] (comparez la fin - l'anneau).
Dentaire [h], [s], [n], [p], [e], [t] et labial [b], [p], [m], [c], [f] sont les plus sensibles au ramollissement . Ils ne s'adoucissent pas devant les consonnes douces [g], [k], [x], et aussi [l] : glucose, key, bread, fill, keep quiet, etc. L'adoucissement se produit dans le mot, mais est absent avant la consonne douce du mot suivant ([here - l "eu]; comparez [Λ tor]) et avant la particule ([grew-l" and]; comparez [rΛsli]) (voici la forêt, loutre, si elle a grandi, grandi).
Consonnes [h] et [s] s'adoucissent devant doux [t"], [d"], [s"], [n"], [l"] : [m "ês" t"], [v" iez " d "e], [f-ka avec "b], [punition"] (vengeance, partout, au box-office, exécution). L'atténuation [s], [s] se produit également à la fin des préfixes et des prépositions en accord avec avant les lèvres douces : [rz "d" iel "it"], [r's" t "ienut"], [b" ez "-n" ievo), [b "yes" -s "il] (split, stretch , sans elle, pas de puissance). Avant le ramollissement labial doux [h], [s], [d], [t] est possible à l'intérieur de la racine et à la fin des préfixes sur -z, ainsi que dans le préfixe s- et dans une préposition qui lui est conforme : [s "m" ex] , [s "in" êr], [d "in" êr |, [t "in" êr], [s "p" êt"], [s "-n" eux], [est "-pêch"], [rΛz "d" t"] (rire, bête, porte, Tver, chanter, avec lui, cuire, se déshabiller).
Les labiales ne ramollissent pas avant les dents molles : [pt "ên" h "bk], [n" eft "], [vz" at "] (poussin, huile, prendre).
4. Assimilation des consonnes par dureté. L'assimilation des consonnes par dureté s'effectue à la jonction de la racine et du suffixe, qui commence par une consonne dure : serrurier - serrurier, secrétaire - secrétariat, etc. Avant le [b] labial, l'assimilation en dureté ne se produit pas : [prΛs "it"] - [proz "b], [mllt "it"] - [mld" ba] (ask - request, thresh - thresh), etc. . [l"] n'est pas soumis à assimilation : [pol" b] - [zΛpol" nyj] (champ, extérieur).
5. Assimilation des dents avant le sifflement. Ce type d'assimilation s'étend au dentaire [h], [s] en position avant le sifflement (antéro-palatin) [w], [g], [h], [w] et consiste en l'assimilation complète du dentaire [h ], [s] au sifflement ultérieur .
L'assimilation complète [h], [s] se produit :
1) à la jonction des morphèmes : [zh at"], [rΛzh at"] (compresser, desserrer) ; [sh yt "], [rΛ sh yt"] (coudre, broder); [w "de], [rΛ w" de] (compte, calcul); [différent sh "ik], [out of sh" ik] (colporteur, chauffeur de taxi);
2) à la jonction d'une préposition et d'un mot : [bras s-zh], [bras s-sh] (avec chaleur, avec une balle) ; [bies-zh ar], [bies-sh ar] (pas de chaleur, pas de ballon).
La combinaison de zzh à l'intérieur de la racine, ainsi que la combinaison de zhzh (toujours à l'intérieur de la racine) se transforment en un long doux [zh "] : [par zh"] (plus tard), (je conduis) ; [en w "et], [tremblement" et] (rênes, levure). Eventuellement, dans ces cas, un long dur [g] peut être prononcé.
Une variante de cette assimilation est l'assimilation de dental [d], [t] les suivant [h], [c], résultant en long [h], [c] : [Λ h "de] (rapport), (fkra tsb ] (brièvement).
6. Simplification des combinaisons de consonnes. Les consonnes [d], [t] dans les combinaisons de plusieurs consonnes entre les voyelles ne sont pas prononcées. Une telle simplification des groupes de consonnes est systématiquement observée dans les combinaisons : stn, zdn, stl, ntsk, stsk, vstv, rdts, lnts : [usny], [posn], [w" et iflivy], [g "igansk" et] , [h " ustv], [coeur], [soleil] (oral, tardif, heureux, gigantesque, sentiment, coeur, soleil).
7. Réduction des groupes de consonnes identiques. Lorsque trois consonnes identiques convergent à la jonction d'une préposition ou d'un préfixe avec le mot suivant, ainsi qu'à la jonction d'une racine et d'un suffixe, les consonnes sont réduites à deux : [ra sor "it"] (temps + querelle) , [avec ylk] (avec un lien), [kΛlo n s] (colonne + n + th) ; [Λde avec ki] (Odessa + sk + y).
Les principaux processus phonétiques se produisant dans un mot comprennent : 1) la réduction ; 2) étourdissant ; 3) voix; 4) ramollissement ; 5) assimilation ; 6) simplifier.
La réduction est un affaiblissement de la prononciation des voyelles en position atone : [house] - [d ^ ma] - [d ^ voi].
L'étourdissement est un processus dans lequel les voix s'accordent avant les sourdes et sont prononcées comme sourdes à la fin d'un mot; livre - livre [w] ka; chêne - du [p].
La voix est un processus dans lequel les sourds en position devant les voix sont prononcés comme exprimés: do - [z "] do; sélection - o [d] bore.
L'adoucissement est un processus dans lequel les consonnes dures sont douces sous l'influence des douces suivantes: depend [s ’] t, ka [s ’] n, le [s ’] t.
L'assimilation est un processus dans lequel une combinaison de plusieurs consonnes dissemblables est prononcée comme un son long [c]): volume [w] ik, ressort [w] aty, mu [w "]ina, [t"] astye, ichi [ c] a) La simplification des groupes de consonnes est un processus dans lequel, dans les combinaisons de consonnes stn, zdn, mange, dts, personnes et autres, un son tombe, bien que la lettre désignant ce son soit utilisée dans la lettre: cœur - [s "e" rts'], soleil - [fils].
8. Réduction des voyelles. Le changement (affaiblissement) des voyelles dans une position non accentuée est appelé réduction, et les voyelles non accentuées sont appelées voyelles réduites. Distinguer la position des voyelles non accentuées dans la première syllabe préaccentuée (position faible du premier degré) et la position des voyelles non accentuées dans les autres syllabes non accentuées (position faible du deuxième degré). Les voyelles en position faible du second degré subissent plus de réduction que les voyelles en position faible du premier degré.
Voyelles en position faible du premier degré : [vΛly] (hampes) ; [arbres] (bœufs); [bieda] (trouble), etc.
Voyelles en position faible du second degré : [parʌvos] (locomotive) ; [kargΛnda] (Karaganda); [kalkla] (cloches); [p "l" c'est-à-dire sur] (suaire); [voix] (voix), [exclamation] (exclamation), etc.
Synchronie - (du grec sýnchronós - simultané), considération d'une langue (ou de tout autre système de signes) en termes de relation entre ses éléments constitutifs dans une période de temps. Par exemple, le nominatif singulier "stol" en synchronie a une terminaison nulle, contrairement au génitif "stol-a".
L'identification de la dynamique de développement en synchronie est également possible en comparant plusieurs styles fonctionnant simultanément (dont le choix est déterminé par les conditions de communication) - plus solennel (élevé), conservant des traits anciens, et plus familier (bas), en où la direction du développement du langage est devinée (par exemple, une forme abrégée [chiek] au lieu de "man").
L'étude des phénomènes phonétiques en termes de synchronie est l'étude de la phonétique d'une langue particulière à un moment donné comme un système tout fait d'éléments interreliés et interdépendants.
Les lois phonétiques (lois du son) sont les lois du fonctionnement et du développement de la matière sonore d'une langue, qui régissent à la fois la conservation stable et le changement régulier de ses unités sonores, de leurs alternances et combinaisons.
1. Loi phonétique de la fin d'un mot. Une consonne vocale bruyante à la fin d'un mot est assourdie, c'est-à-dire prononcé comme le double sourd correspondant. Cette prononciation conduit à la formation d'homophones : le seuil est un vice, jeune est un marteau, chèvres est une tresse, etc. Dans les mots avec deux consonnes à la fin du mot, les deux consonnes sont étourdies : poitrine - tristesse, entrée - monter [pΛdjest], etc.
L'étourdissement de la voix finale se produit dans les conditions suivantes :
1) avant une pause: [pr "ishol post] (le train est venu); 2) avant le mot suivant (sans pause) avec l'initiale non seulement sourde, mais aussi une voyelle, sonorante, ainsi que [j] et [c] : [praf he], [our sat], [slap ja], [ta bouche] (il a raison, notre jardin, je suis faible, ton genre).
2. Assimilation des consonnes par la voix et la surdité. Les combinaisons de consonnes, dont l'une est sourde et l'autre est exprimée, ne sont pas caractéristiques de la langue russe. Ainsi, si deux consonnes de voix différentes apparaissent côte à côte dans un mot, la première consonne est assimilée à la seconde. Ce changement de consonnes est appelé assimilation régressive.
En vertu de cette loi, les consonnes voisées devant le sourd se transforment en sourdes appariées, et les sourds dans la même position en voisées. La voix des consonnes sans voix est moins courante que l'étourdissement des consonnes vocales; la transition de exprimé à sourd crée des homophones: [dushk - dushk] (manille - chéri), [dans "oui" ti - dans "oui" t "et] (porter - conduire), [fp" yr "em" yeshka - fp " r "eem" yeschka] (entrecoupé - entrecoupé).
Devant les sonorants, comme devant [j] et [c], les sourds restent inchangés : tinder, coquin, [Λtjest] (départ), le tien, le tien.
Les consonnes voisées et sourdes sont assimilées dans les conditions suivantes : 1) à la jonction des morphèmes : [pΛhotk] (démarche), [collection] (collection) ; 2) à la jonction des prépositions avec le mot : [where "elu] (to business), [zd" elm] (with business) ; 3) à la jonction d'un mot avec une particule : [got-th] (un an), [dod`zh`by] (fille ferait); 4) à la jonction de mots significatifs prononcés sans pause : [rock-kΛzy] (corne de chèvre), [ras-p "at"] (cinq fois).
3. Assimilation des consonnes par douceur. Les consonnes dures et douces sont représentées par 12 paires de sons. Par éducation, ils diffèrent par l'absence ou la présence de palatalisation, qui consiste en une articulation supplémentaire (la partie médiane de l'arrière de la langue s'élève jusqu'à la partie correspondante du palais).
L'assimilation de douceur a un caractère régressif : la consonne s'adoucit, devenant comme la consonne douce suivante. Dans cette position, toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, ne s'adoucissent pas et toutes les consonnes douces ne provoquent pas un adoucissement du son précédent.
Toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, s'adoucissent dans les positions faibles suivantes : 1) avant le son de la voyelle [e] ; [b" ate], [c" eu], [m" ate], [s" ate] (blanc, poids, craie, villages), etc. ; 2) avant [et] : [m "silt], [n" limon "et] (mil, bu).
Avant [g], [w], [c] non appariés, les consonnes douces sont impossibles, à l'exception de [l], [l "] (comparez la fin - l'anneau).
Dentaire [h], [s], [n], [p], [e], [t] et labial [b], [p], [m], [c], [f] sont les plus sensibles au ramollissement . Ils ne s'adoucissent pas devant les consonnes douces [g], [k], [x], et aussi [l] : glucose, key, bread, fill, keep quiet, etc. L'adoucissement se produit dans le mot, mais est absent avant la consonne douce du mot suivant ([here - l "eu]; comparez [Λ tor]) et avant la particule ([grew-l" and]; comparez [rΛsli]) (voici la forêt, loutre, si elle a grandi, grandi).
Consonnes [h] et [s] s'adoucissent devant doux [t"], [d"], [s"], [n"], [l"] : [m "ês" t"], [v" iez " d "e], [f-ka avec "b], [punition"] (vengeance, partout, au box-office, exécution). L'atténuation [s], [s] se produit également à la fin des préfixes et des prépositions en accord avec avant les lèvres douces : [rz "d" iel "it"], [r's" t "ienut"], [b" ez "-n" ievo), [b "yes" -s "il] (split, stretch , sans elle, pas de puissance). Avant le ramollissement labial doux [h], [s], [d], [t] est possible à l'intérieur de la racine et à la fin des préfixes sur -z, ainsi que dans le préfixe s- et dans une préposition qui lui est conforme : [s "m" ex] , [s "in" êr], [d "in" êr |, [t "in" êr], [s "p" êt"], [s "-n" eux], [est "-pêch"], [rΛz "d" t"] (rire, bête, porte, Tver, chanter, avec lui, cuire, se déshabiller).
Les labiales ne ramollissent pas avant les dents molles : [pt "ên" h "bk], [n" eft "], [vz" at "] (poussin, huile, prendre).
4. Assimilation des consonnes par dureté. L'assimilation des consonnes par dureté s'effectue à la jonction de la racine et du suffixe, qui commence par une consonne dure : serrurier - serrurier, secrétaire - secrétariat, etc. Avant le [b] labial, l'assimilation en dureté ne se produit pas : [prΛs "it"] - [proz "b], [mllt "it"] - [mld" ba] (ask - request, thresh - thresh), etc. . [l"] n'est pas soumis à assimilation : [pol" b] - [zΛpol" nyj] (champ, extérieur).
5. Assimilation des dents avant le sifflement. Ce type d'assimilation s'étend au dentaire [h], [s] en position avant le sifflement (antéro-palatin) [w], [g], [h], [w] et consiste en l'assimilation complète du dentaire [h ], [s] au sifflement ultérieur .
L'assimilation complète [h], [s] se produit :
1) à la jonction des morphèmes : [zh at"], [rΛzh at"] (compresser, desserrer) ; [sh yt "], [rΛ sh yt"] (coudre, broder); [w "de], [rΛ w" de] (compte, calcul); [différent sh "ik], [out of sh" ik] (colporteur, chauffeur de taxi);
2) à la jonction d'une préposition et d'un mot : [bras s-zh], [bras s-sh] (avec chaleur, avec une balle) ; [bies-zh ar], [bies-sh ar] (pas de chaleur, pas de ballon).
La combinaison de zzh à l'intérieur de la racine, ainsi que la combinaison de zhzh (toujours à l'intérieur de la racine) se transforment en un long doux [zh "] : [par zh"] (plus tard), (je conduis) ; [en w "et], [tremblement" et] (rênes, levure). Eventuellement, dans ces cas, un long dur [g] peut être prononcé.
Une variante de cette assimilation est l'assimilation de dental [d], [t] les suivant [h], [c], résultant en long [h], [c] : [Λ h "de] (rapport), (fkra tsb ] (brièvement).
6. Simplification des combinaisons de consonnes. Les consonnes [d], [t] dans les combinaisons de plusieurs consonnes entre les voyelles ne sont pas prononcées. Une telle simplification des groupes de consonnes est systématiquement observée dans les combinaisons : stn, zdn, stl, ntsk, stsk, vstv, rdts, lnts : [usny], [posn], [w" et iflivy], [g "igansk" et] , [h " ustv], [coeur], [soleil] (oral, tardif, heureux, gigantesque, sentiment, coeur, soleil).
7. Réduction des groupes de consonnes identiques. Lorsque trois consonnes identiques convergent à la jonction d'une préposition ou d'un préfixe avec le mot suivant, ainsi qu'à la jonction d'une racine et d'un suffixe, les consonnes sont réduites à deux : [ra sor "it"] (temps + querelle) , [avec ylk] (avec un lien), [kΛlo n s] (colonne + n + th) ; [Λde avec ki] (Odessa + sk + y).
Fin du travail -
Ce sujet appartient à :
Langue littéraire russe moderne: terme et essence
La langue littéraire russe moderne est la forme la plus haute de la langue russe dans cette combinaison, la littérature moderne nécessite principalement .. la caractéristique principale langue littéraire normalisation la norme surgit dans .. la norme est un système de règles socialement conditionné et socialement conscient, la manière la plus stable de linguistique ..
Si vous avez besoin de matériel supplémentaire sur ce sujet, ou si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, nous vous recommandons d'utiliser la recherche dans notre base de données d'œuvres :
Que ferons-nous du matériel reçu :
Si ce matériel s'est avéré utile pour vous, vous pouvez l'enregistrer sur votre page sur les réseaux sociaux :
| tweeter |
Tous les sujets de cette section :
La phonétique comme science du côté sonore du langage. Aspects fondamentaux de l'étude du son
La phonétique est la science du côté sonore de la parole humaine. C'est l'une des principales sections de la linguistique (linguistique). Le mot "phonétique" vient du grec. phonetikos - "son, voix
Réalisation des voyelles en position non accentuée après les consonnes dures
Si un courant d'air passe librement par le nez ou cavité buccale, sans rencontrer d'obstacles sur son chemin, alors un son de voyelle est prononcé. Les cordes vocales sont tendues et décalées.
Réalisation des voyelles en position non accentuée après les consonnes douces
En raison de la réduction, les voyelles non accentuées sont réduites en durée (en quantité) et perdent leur son distinct (qualité). Toutes les voyelles non accentuées subissent une réduction, mais le degré de réduction de leur
La syllabe comme unité supersegmentaire. Théories des ondes sonores
Le plus petit supersegment est la syllabe. Preuve : Demander à prononcer un mot plus clairement conduit à le réciter. La définition la plus générale d'une syllabe par rapport au russe
L'intonation comme prosodie syntagmatique
Le mot "intonation" remonte au verbe latin intono "je parle fort". Habituellement, cela signifie un ensemble de caractéristiques prosodiques d'une phrase : ton, durée, intensité, etc.
Position. Positions fortes et faibles. Alternances positionnelles et non positionnelles des sons
Position en linguistique - l'environnement d'une unité d'un niveau de langue particulier, sa position par rapport aux autres unités: subphonologique - au niveau des allophones phonologique - conditions
Le phonème comme unité distinctive du langage
Les phonèmes sont les plus petites unités d'une langue, car il est impossible de les diviser en unités plus petites prononcées séquentiellement dans la chaîne de parole. En même temps, le phonème se compose d'un certain nombre de caractéristiques qui n'existent pas en dehors
Le système et la composition des phonèmes consonantiques du point de vue de MFSH et SPFS
Quatre règles dérivées par N. S. Trubetskoy pour distinguer les phonèmes des variantes de phonèmes Si, dans une langue particulière, deux sons se produisent dans la même position et peuvent se remplacer, pas m
Le système et la composition des phonèmes vocaliques du point de vue de MFSH et SPFS
(MFS) Les positions significativement faibles sont de deux types : réductibles à fortes dans les mêmes morphèmes et non réductibles à celles-ci. Pour savoir à quel phonème correspond le son d'une position faible, il faut changer les mots
Orthoépie. Les principales exigences de la norme orthoépique moderne
Orthoépie - 1) "un ensemble de normes de prononciation de la langue nationale, garantissant la préservation de l'uniformité de sa conception sonore" (L.A. Verbitskaya) et 2) la science des normes de prononciation
Les grandes étapes de la codification orthoépique
Le fondateur de la première école philologique russe est Mikhail Vasilyevich Lomonossov, qui a mis en avant le critère de l'opportunité historique dans la rationalisation des normes de la langue littéraire. Il a joué
Ancienne norme orthoépique de Moscou aujourd'hui
Partisan du choix du dialecte moscovite comme modèle universel, ce n'est pas seulement son aire métropolitaine qui s'exprime, mais aussi sa position intermédiaire parmi tous les dialectes russes. Étant essentiellement du nord de la Russie -
Sociophonétique
Sociophonetique : 1) Une direction qui étudie les liens et dépendances sociaux et phonétiques. 2) Une branche de la linguistique qui étudie la diffusion de telle ou telle prononciation, ka
Une règle qui détermine les conditions, le temps et la prévalence de l'un ou l'autre changement phonétique (voir) ou d'un groupe de changements phonétiques homogènes dans n'importe quelle langue. Puisque les changements phonétiques ne dépendent pas du sens des mots dans lesquels ils sont observés, il est clair qu'en présence des mêmes conditions phonétiques dans le même dialecte et au même moment, on doit s'attendre aux mêmes changements phonétiques, c'est-à-dire que la Ph. Z., si elle est formulée correctement, n'admet pas d'exceptions, s'étendant à une époque donnée et dans un dialecte donné à tous les mots représentant les mêmes conditions phonétiques. Par exemple, le slave commun sur nasal russe dans tous les mots où il était, changé en à, pré-choc sur vieux dans la prononciation littéraire russe dans tous les mots a changé dans mais etc. Si en réalité on observe souvent des exceptions apparentes à l'une ou l'autre F.Z., alors cela est dû 1. soit au fonctionnement de l'analogie : aller avec sur(lettre ё) vm. e- par analogie avec on va où sur(lettre ё) phonétiquement devant son solide; 2. soit par l'action d'un autre F. Z., cf. Vieux slave Sushi"sec" et sécher avec des sons à partir de Et w de face Età partir de X en raison du fonctionnement de lois phonétiques différentes; 3. ou emprunt à une autre langue ou dialecte de la même langue : en mots russes ciel, croix e avant que le solide ne passe dans sur(ё), p. h. ce sont des mots slaves de l'Église (cf. ciel dans un sens différent et folk traverser), mots belle-mère Et gâteau un côté et brème Et brandon d'autre part, ils sont tirés de différents dialectes russes. Dans le même temps, il convient de noter que tous les faits qui contredisent l'un ou l'autre F.Z. de n'importe quelle langue ne peuvent apparaître qu'après la résiliation de cette loi (dans les exemples donnés, après la résiliation de la F.Z. e dans sur avant dur).
N. D. Encyclopédie littéraire : Dictionnaire des termes littéraires : En 2 volumes / Édité par N. Brodsky, A. Lavretsky, E. Lunin, V. Lvov-Rogachevsky, M. Rozanov, V. Cheshikhin-Vetrinsky. - M. ; L. : Maison d'édition L. D. Frenkel, 1925
Voyez ce qu'est la "loi phonétique" dans d'autres dictionnaires :
loi phonétique- LOI PHONETIQUE, ou loi du son. Une règle qui détermine les conditions, le temps et la prévalence de l'un ou l'autre changement phonétique (voir) ou d'un groupe de changements phonétiques homogènes dans n'importe quelle langue. Puisque les changements phonétiques ne sont pas ... ... Dictionnaire des termes littéraires
Régularité des correspondances phonétiques, changement phonétique régulier et interdépendant. La loi de la chute des sourds à une certaine époque du développement de la langue russe. La loi de l'étourdissement des consonnes vocales bruyantes à la fin d'un mot. La loi d'assimilation des consonnes ... ... Dictionnaire des termes linguistiques
La formule du changement régulier d'un son en un autre correspondance régulière entre deux dialectes d'une langue ou entre deux états synchrones successifs de la langue) Un changement de son en un autre son est énoncé à trois ... ... Manuel d'étymologie et de lexicologie historique
loi phonétique- Voir : loi saine...
loi phonétique-, ou loi saine. Une règle qui détermine les conditions, le temps et la prévalence de l'un ou l'autre changement phonétique (voir) ou d'un groupe de changements phonétiques homogènes dans n'importe quelle langue. Étant donné que les changements phonétiques ne dépendent pas de ... Dictionnaire de grammaire : termes de grammaire et de linguistique
loi du son (loi phonétique)- Changer les sons par Certaines règles, une formule de correspondances sonores ou de transitions caractéristiques d'une langue particulière ou d'un groupe de langues apparentées. La loi de chaque langue individuelle est la loi qui détermine tel ou tel processus phonétique. ... ... Dictionnaire des termes linguistiques T.V. Poulain
LOI, loi, mari. 1. Une relation constante et nécessaire, une connexion entre les phénomènes qui existe dans le monde objectif, indépendamment de la conscience humaine (philosophique). "Le concept de loi est l'une des étapes de la cognition humaine de l'unité et de la connexion, ... ... dictionnaire Ouchakov
La loi de Meillet est une loi phonétique découverte par A. Meillet et pertinente pour Proto-slave. Il est formulé comme suit : les consonnes palatines proto-indo-européennes ne se transformaient pas en sifflante s'il y avait un s dans la racine. Exceptions ... ... Wikipédia
La loi de Zibs est une loi phonétique découverte par le linguiste allemand T. Zibs et pertinente pour la langue proto-indo-européenne. Selon cette loi, si s mobile a été ajouté à une racine commençant par un arrêt aspiré exprimé ou exprimé, ... ... Wikipedia
La loi d'Osthof est une loi phonétique indo-européenne, selon laquelle les voyelles longues étaient réduites devant une combinaison de consonnes sonores et d'arrêt. La loi a été nommée ainsi en l'honneur de l'indo-européaniste Herman Ostgof, qui l'a formulée le premier. ... ... Wikipedia
Livres
- Formation des mots nominaux indo-européens, Emile Benveniste. Le livre du célèbre linguiste français Emile Benveniste, appartenant à la jeune génération de l'école d'Antoine Meillet, explore les principaux problèmes de la formation des mots nominaux indo-européens.…
Lois phonétiques- les lois de fonctionnement et de développement de la matière sonore d'une langue, qui régissent à la fois la conservation stable et le changement régulier de ses unités sonores, de leurs alternances et combinaisons.
Lois phonétiques :
1. Loi phonétique de la fin d'un mot. Consonne bruyante à la fin d'un mot étourdi, c'est à dire. prononcé comme le double sourd correspondant. Cette prononciation conduit à la formation d'homophones : le seuil est un vice, jeune est un marteau, chèvres est une tresse, etc. Dans les mots avec deux consonnes à la fin du mot, les deux consonnes sont étourdies : poitrine - tristesse, entrée - monter [pldjest], etc.
L'étourdissement de la voix finale se produit dans les conditions suivantes :
1) avant une pause: [pr "ishol post] (le train est venu); 2) avant le mot suivant (sans pause) avec l'initiale non seulement sourde, mais aussi une voyelle, sonorante, ainsi que [j] et [c] : [praf he], [our sat], [slap ja], [ta bouche] (il a raison, notre jardin, je suis faible, ton genre). Les consonnes sonores ne sont pas étourdies: ordures, disent-ils, com, il.
2. Assimilation des consonnes par voisé et surdité. Les combinaisons de consonnes, dont l'une est sourde et l'autre est exprimée, ne sont pas caractéristiques de la langue russe. Ainsi, si deux consonnes de voix différentes apparaissent côte à côte dans un mot, la première consonne est assimilée à la seconde. Ce changement de consonnes s'appelle assimilation régressive.
En vertu de cette loi, les consonnes voisées devant le sourd se transforment en sourdes appariées, et les sourds dans la même position en voisées. La voix des consonnes sans voix est moins courante que l'étourdissement des consonnes vocales; la transition de exprimé à sourd crée des homophones: [dushk - dushk] (manille - chéri), [dans "oui" ti - dans "oui" t "et] (porter - conduire), [fp" yr "em" yeshka - fp " r "eem" yeschka] (entrecoupé - entrecoupé).
Devant les sonorants, comme devant [j] et [c], les sourds restent inchangés : tinder, coquin, [Ltjest] (départ), le vôtre, le vôtre.
Les consonnes voisées et sourdes sont assimilées dans les conditions suivantes : 1) à la jonction des morphèmes : [pLhotk] (démarche), [collection] (collection) ; 2) à la jonction des prépositions avec le mot : [where "elu] (to business), [zd" elm] (with business) ; 3) à la jonction d'un mot avec une particule : [got-th] (un an), [dod`zh`by] (fille ferait); 4) à la jonction de mots significatifs prononcés sans pause : [rock-klzy] (corne de chèvre), [ras-p "at"] (cinq fois).
3. Assimilation des consonnes par douceur. Les consonnes dures et douces sont représentées par 12 paires de sons. Par éducation, ils diffèrent par l'absence ou la présence de palatalisation, qui consiste en une articulation supplémentaire (la partie médiane de l'arrière de la langue s'élève jusqu'à la partie correspondante du palais).
L'assimilation par la douceur a un effet régressif caractère : la consonne s'adoucit, devenant comme la consonne douce suivante. Dans cette position, toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, ne s'adoucissent pas et toutes les consonnes douces ne provoquent pas un adoucissement du son précédent.
Toutes les consonnes, appariées en dureté-douceur, s'adoucissent dans les positions faibles suivantes : 1) avant le son de la voyelle [e] ; [b" ate], [c" eu], [m" ate], [s" ate] (blanc, poids, craie, villages), etc. ; 2) avant [et] : [m "silt], [n" limon "et] (mil, bu).
Avant [g], [w], [c] non appariés, les consonnes douces sont impossibles, à l'exception de [l], [l "] (comparez la fin - l'anneau).
Dentaire [h], [s], [n], [p], [e], [t] et labial [b], [p], [m], [c], [f] sont les plus sensibles au ramollissement . Ils ne s'adoucissent pas devant les consonnes douces [g], [k], [x], et aussi [l] : glucose, key, bread, fill, keep quiet, etc. L'adoucissement se produit dans le mot, mais est absent avant la consonne douce du mot suivant ([here - l "eu]; comparez [L thor]) et avant la particule ([grew-l" and]; comparez [rLsli]) (voici la forêt, loutre, si elle a grandi, grandi).
Les consonnes [h] et [s] s'adoucissent avant le doux [t"], [d"], [s"], [n"], [l"] : [m "ks" t "], [v" iez " d "e], [f-ka avec "b], [punition"] (vengeance, partout, au box-office, exécution). L'atténuation [s], [s] se produit également à la fin des préfixes et des prépositions en accord avec avant les lèvres douces : [rz "d" iel "it"], [r's" t "ienut"], [b" ez "-n" ievo), [b "yes" -s "il] (split, stretch , sans elle, pas de puissance). Avant le ramollissement labial doux [h], [s], [d], [t] est possible à l'intérieur de la racine et à la fin des préfixes sur -z, ainsi que dans le préfixe s- et dans une préposition qui lui est conforme : [s "m" ex] , [s "in" kr], [d" in "kr |, [t" in "kr], [s" p "kt"], [s "-n" im], [est "-pkch"] , [rLz "d" kt "] (rire, bête, porte, Tver, chanter, avec lui, cuire, se déshabiller).
Les labiales ne ramollissent pas avant les dents molles : [pt "kn" h "bk], [n" eft "], [vz" at "] (poussin, huile, prise).
4. Assimilation des consonnes par dureté. L'assimilation des consonnes par dureté est effectuée à la jonction de la racine et du suffixe, commençant par une consonne solide : serrurier - serrurier, secrétaire - secrétariat, etc. Avant le [b] labial, l'assimilation en dureté ne se produit pas : [prLs "it"] - [proz "b", [mllt "it"] - [mlld" ba] (ask - request, thresh - thresh), etc. . [l "] n'est pas soumis à assimilation: [sol" b] - [zLpol "nyj] (champ, extérieur).
5. Assimilation des dents avant de grésiller. Ce type d'assimilation s'étend à dentaire[h], [s] en position devant le sifflement(antéropalatin) [w], [g], [h], [w] et consiste en l'assimilation complète du dentaire [h], [s] au sifflement ultérieur.
L'assimilation complète [h], [s] se produit :
1) à la jonction des morphèmes : [zh at "], [pL zh at"] (comprimer, desserrer); [sh yt "], [rL sh yt"] (coudre, broder); [w "de], [rL w" de] (compte, calcul); [rLzno sh "ik], [out of sh" ik] (colporteur, chauffeur de taxi);
2) à la jonction d'une préposition et d'un mot : [bras s-zh], [bras s-sh] (avec chaleur, avec une balle) ; [bies-zh ar], [bies-sh ar] (pas de chaleur, pas de ballon).
La combinaison de zzh à l'intérieur de la racine, ainsi que la combinaison de zhzh (toujours à l'intérieur de la racine) se transforment en un long doux [zh "] : [par zh"] (plus tard), (je conduis) ; [en w "et], [tremblement" et] (rênes, levure). Eventuellement, dans ces cas, un long dur [g] peut être prononcé.
Une variante de cette assimilation est l'assimilation de dental [d], [t] les suivant [h], [c], résultant en long [h], [c] : [L h "de] (rapport), (fkra q ] (brièvement).
6. Simplification des combinaisons de consonnes. Les consonnes [d], [t]dans les combinaisons de plusieurs consonnes entre les voyelles ne sont pas prononcées. Une telle simplification des groupes de consonnes est systématiquement observée dans les combinaisons : stn, zdn, stl, ntsk, stsk, vstv, rdts, lnts : [usny], [posn], [w" et iflivy], [g "igansk" et] , [h " ustv], [coeur], [soleil] (oral, tardif, heureux, gigantesque, sentiment, coeur, soleil).
7. Réduction des groupes de consonnes identiques. Lorsque trois consonnes identiques convergent à la jonction d'une préposition ou d'un préfixe avec le mot suivant, ainsi qu'à la jonction d'une racine et d'un suffixe, les consonnes sont réduites à deux : [pa sor "it"] (temps + querelle) , [avec ylk] (avec un lien), [kLlo n s] (colonne + n + th) ; [Lde avec ki] (Odessa + sk + y).
8. Réduction des voyelles. Changement (affaiblissement) des voyelles dans une position non accentuée est appelée réduction, et les voyelles non accentuées - voyelles réduites. Distinguer la position des voyelles non accentuées dans la première syllabe préaccentuée (position faible du premier degré) et la position des voyelles non accentuées dans les autres syllabes non accentuées (position faible du deuxième degré). Les voyelles en position faible du second degré subissent plus de réduction que les voyelles en position faible du premier degré.
Voyelles en position faible du premier degré : [vLly] (hampes) ; [arbres] (bœufs); [bieda] (trouble), etc.
Voyelles en position faible du second degré : [par ?Vos] (locomotive) ; [kyargLnda] (Karaganda); [kulkLla] (cloches); [p "l" c'est-à-dire sur] (suaire); [voix] (voix), [exclamation] (exclamation), etc.
Les principaux processus phonétiques se produisant dans un mot comprennent : 1) la réduction ; 2) étourdissant ; 3) voix; 4) ramollissement ; 5) assimilation ; 6) simplifier.
Réduction- ce affaiblissement de la prononciation des voyelles en position non accentuée: [maison] - [d ^ ma] - [d ^ voi].
Étourdir- un processus dans lequel les consonnes vocales avant sourd et à la fin du mot se prononcent comme sourd; livre - livre [w] ka; chêne - du [p].
sonorisation- un processus dans lequel sourd Enceinte avant exprimés sont prononcés comme exprimés: do - [z "] do; sélection - o [d] bore.
Atténuation- un processus dans lequel les consonnes dures sont douces sous l'influence des consonnes douces suivantes: dépendent [s "] t, ka [s"] n, le [s"] t.
assimilation est un processus dans lequel la combinaison plusieurs consonnes dissemblables se prononcent comme une longue(par exemple, les combinaisons de sch, zch, shch, zdch, stch sont prononcées avec un son long [w "], et les combinaisons de ts (i), ts (i) sont prononcées comme un son long [c]): volume [sh] ik, printemps [ sh]aty, mu[sh"]ina, [t"]astye, ichi[c]a.
Simplification groupes de consonnes - un processus dans lequel dans les combinaisons de consonnes stn, zdn, mange, dts, personnes et autres, le son disparaît, bien que la lettre utilise une lettre désignant ce son : coeur - [s "e" rts], soleil - [sonts].
Orthoépie(du grec orthos - correct et epos - discours) - un département de linguistique qui étudie les règles de la prononciation exemplaire ( Dictionnaire explicatif de la langue russe D.N. Ouchakov). Orthoépie- ce sont les normes historiquement établies de la prononciation littéraire russe des sons individuels et des combinaisons de sons dans le flux de la parole orale.
1 . Prononciation des voyelles est déterminé par la position dans les syllabes préaccentuées et est basé sur une loi phonétique appelée réduction. En raison de la réduction, les voyelles non accentuées sont conservées dans la durée (quantité) et perdent leur son distinct (qualité). Toutes les voyelles subissent une réduction, mais le degré de cette réduction n'est pas le même. Ainsi, les voyelles [y], [s], [et] dans une position non accentuée conservent leur son principal, tandis que [a], [o], [e] changent qualitativement. Le degré de réduction [a], [o], [e] dépend principalement de la place de la syllabe dans le mot, ainsi que de la nature de la consonne qui la précède.
mais) Dans la première syllabe préaccentuée le son [Ù] se prononce : [vÙdy / sÙdy / nÙzhy]. Après avoir sifflé, [Ù] se prononce : [zhÙra / shÙry].
A la place de [e] après le sifflement [w], [w], [c], le son [s e] se prononce : [tsy e pnoï], [zhy e ltok].
Après des consonnes douces à la place [a], [e], le son [et e] se prononce :
[ch٬ e sy / sn٬ e la].
b ) Dans d'autres syllabes non accentuéesà la place des sons [o], [a], [e], après les consonnes pleines, le son [b] se prononce :
par٨vos] Après des consonnes douces à la place des sons [a], [e], on prononce [b] : [n" tÙch" ok / h" umÙdan].
2. Prononciation des consonnes :
a) les normes de la prononciation littéraire imposent un échange de position entre sourds et exprimés appariés dans une position devant les sourds (seulement sourds) - voisés (seulement exprimés) et en fin de mot (seulement sourds) : [chl "epʹ ] / trʹpkʹ / proʹ b]] ;
b) l'adoucissement par assimilation n'est pas nécessaire, on a tendance à le perdre : [s"t"inaʹ] et [st"inaʹ], [z"d"es"] et [zd"es"].
3. Prononciation de quelques combinaisons de consonnes :
a) dans les formations pronominales Quel, pour– jeu prononcé comme [pcs] ; dans des formations pronominales comme quelque chose, courrier, presque la prononciation [h "t] est conservée ;
b) dans un certain nombre de mots d'origine principalement familière, [shn] se prononce à la place ch: [kÙn "eshn / nÙroshn].
Dans les mots d'origine livre, la prononciation [h "n] a été conservée : [ml "ech" nyį / vÙstoch "nyį] ;
c) dans la prononciation des combinaisons soleil, zdn, stn(bonjour, vacances, commerçant privé) généralement il y a une réduction ou une perte d'une des consonnes : [vacances "ik], [h "asn" ik], [hello]
4. Prononciation des sons dans certains formes grammaticales:
a) prononciation de la forme I.p. unité adjectifs sans accent: [rouge / avec "in" et į] - sous l'influence de l'orthographe est apparu - euh, - euh; après g, k, x ® uy : [t "iх" iį], [m "ahk" iį] ;
b) prononciation - sya, - sya. Sous l'influence de l'orthographe, la prononciation douce est devenue la norme : [n'ch "et e las" / n'ch "et e ls" a] ;
c) prononciation des verbes en - je suis après g, k, x, la prononciation [g "], [k"], [x"] est devenue la norme (sous l'influence de l'orthographe): [vyt "ag" ivt "].