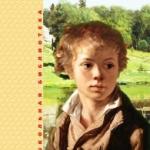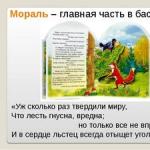L'éthique et la morale comme valeur fondamentale. Éthique, morale, moralité : corrélation des concepts
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, les étudiants diplômés, les jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous en seront très reconnaissants.
1. Notions"éthique", "moralité", "moralité"
Éthique(Ethika grec, de ethos - coutume, disposition, caractère), une discipline philosophique qui étudie la moralité, la moralité ; son développement, ses principes, ses normes et son rôle dans la société.
En tant que désignation d'un domaine d'études particulier, le terme a été utilisé pour la première fois par Aristote. Des stoïciens vient la division traditionnelle de la philosophie en logique, physique et éthique, qui était souvent comprise comme la science de la nature humaine, c'est-à-dire qu'elle coïncidait avec l'anthropologie : l'« éthique » de B. Spinoza est la doctrine de la substance et de ses modes.
L'éthique est la science du dû dans le système de I. Kant, qui a développé les idées du soi-disant. l'éthique morale autonome comme fondée sur des principes moraux internes évidents, l'opposant à l'éthique hétéronome, procédant de toutes conditions, intérêts et buts extérieurs à la morale.
Au 20ème siècle M. Scheler et N. Hartmann, contrairement à l'éthique « formelle » du devoir de Kant, ont développé une éthique « matérielle » (substantive) des valeurs. Le problème du bien et du mal continue d'être au centre de l'éthique.
Moralité(du lat. moralis - moral) - normes morales de comportement, relations avec les gens:
1) la morale, une forme particulière de conscience sociale et le type de relations sociales (relations morales) ; l'un des principaux moyens de réglementer les actions humaines dans la société à l'aide de normes. Contrairement à la simple coutume ou tradition, les normes morales reçoivent une justification idéologique sous la forme d'idéaux de bien et de mal, de dû, de justice, etc. Contrairement à la loi, l'accomplissement des exigences morales n'est sanctionné que par des formes d'influence spirituelle (évaluation publique, condamnation). Outre les éléments humains universels, la moralité comprend des normes, des principes et des idéaux historiquement transitoires. La morale est étudiée par une discipline philosophique particulière - l'éthique.
2) Une instruction morale pratique séparée, moralisante (la morale de la fable, etc.).
Moral- qualités intérieures et spirituelles qui guident une personne (voir moralité).
La "règle d'or de la moralité" est la plus ancienne norme éthique du comportement humain. Sa formulation la plus courante est : « (Ne) traitez pas les autres comme vous ne voudriez (pas) qu'ils vous fassent. La "Règle d'or" se trouve déjà dans les premiers monuments écrits de nombreuses cultures (dans les enseignements de Confucius, dans l'ancien Mahabrat indien, dans la Bible, dans l'Odyssée d'Homère, etc.) et est fermement ancrée dans la conscience des époques suivantes. . En russe, il apparaît sous la forme d'un proverbe "Ce que vous n'aimez pas chez un autre, ne le faites pas vous-même".
Dans l'histoire de l'éthique, un système de catégories s'est développé qui reflète les valeurs morales de la société dans leur contenu. Les principales catégories comprennent : "bien" et "mal", "devoir", "conscience", "honneur", "dignité", "bonheur", "amour", "amitié", "sens de la vie".
Ces catégories ne sont pas seulement des concepts théoriques de l'éthique, mais aussi les concepts de base de la conscience morale qu'une personne utilise lors de l'évaluation de certaines actions de personnes et à travers lesquelles la société procède à la régulation morale du comportement des personnes.
1. "Bien" et "mal"
"Bien" et "mal" sont les concepts centraux de la conscience morale. C'est à travers le prisme de ces concepts que s'effectue l'évaluation des actions d'une personne, de toutes ses activités. Ces concepts ont été élaborés par la conscience morale depuis très longtemps, et déjà les premiers systèmes éthiques les utilisent dans leurs constructions. La gentillesse est le plus concept général la morale, qui réunit l'ensemble des normes positives et des exigences de la morale et agit comme un idéal. De plus, le bien peut être considéré comme un but moral du comportement, et dans ce cas il agit comme un motif pour un acte. En même temps, le bien est la qualité d'une personne (vertu). Une telle définition ambiguë du bien découle de la nature même de la moralité, qui imprègne tous les aspects de la vie humaine.
Le mal est le contraire du bien. La catégorie du mal est une expression généralisée d'idées sur tout ce qui est immoral et qui mérite d'être condamné et doit être surmonté. Par exemple, dans les relations entre les personnes, le mal, c'est quand une personne est traitée non pas comme un individu en tant que tel, mais dans le but d'en tirer profit, de l'utiliser à ses propres fins égoïstes.
Le mal est un concept générique en relation avec tous les phénomènes moralement négatifs - tromperie, méchanceté, cruauté, etc. Le mal se manifeste à la fois dans les petits et dans les grands. Le mal est enraciné dans les habitudes, dans les mœurs, dans la psychologie quotidienne. Lorsque, après avoir commis un acte inconvenant, nous essayons de rejeter le blâme sur un autre, alors, ce faisant, nous agissons de manière déshonorante, nous perdons notre dignité. Lorsque pour un bénéfice quelconque, nous sacrifions nos principes moraux - dans tous ces cas nous commettons des actes qui peuvent être qualifiés de mal - comme mal moral.
Agir dans la morale signifie choisir entre le bien et le mal. Une personne ne peut faire un choix libre et conscient que lorsqu'elle sait ce que sont le bien et le mal, lorsqu'elle a une attitude positive envers le bien et négative envers le mal et que, s'efforçant d'agir dans le sens du bien, elle dispose de conditions et d'opportunités objectives pour ce. En même temps, on ne peut pas prétendre que le bien est quelque chose d'absolu, car le bien et le mal sont interconnectés. La vie morale d'une personne, en règle générale, est contradictoire, déchirée par des aspirations contradictoires. D'une part, une personne vise à satisfaire ses désirs, ses inclinations égoïstes, ses intérêts privés, d'autre part, elle est inhérente à la conscience du devoir, de la responsabilité envers les autres.
Quelles théories de la relation entre le bien et le mal existaient ?
L'éthique religieuse a soutenu que le bien est une expression de la volonté ou de l'esprit de Dieu, tandis que le mal est fatalement inhérent à l'homme - le péché qu'Adam et Eve ont commis est la source de l'existence du mal sur terre.
Les théories naturalistes voyaient l'origine du bien dans la "nature abstraite de l'homme", dans son désir de plaisir, de bonheur.
Ainsi l'éthique de l'hédonisme affirme que le bien est ce qui donne du plaisir ou y conduit. Bon est ce qui est agréable. Seuls le plaisir, le plaisir, la joie sont bons ; souffrance, chagrin, mécontentement - mal. Cependant, on peut immédiatement objecter que le contenu du plaisir dépend non seulement de l'époque, mais aussi de l'environnement, de l'âge, de l'éducation, donc, les émotions positives et négatives en elles-mêmes ne portent pas objectivement les définitions du bien et du mal.
L'éthique de l'utilitarisme affirme que le bien est ce qui est bénéfique pour l'individu et le mal est ce qui est nuisible. Cependant, une personne ne fait pas toujours ce qui lui est utile, car souvent elle suit une telle règle de vie : « Connaissant le meilleur, je suis le pire ». De plus, nous savons que dans l'histoire, il y a eu des cas de service désintéressé d'une personne au nom de n'importe quelle idée - ce comportement est difficile à expliquer par l'éthique utilitaire.
L'éthique relativiste affirme que la différence entre le bien et le mal n'est pas inhérente à la nature, mais n'existe que dans les opinions des gens. Il résulte de ce point de vue qu'il y a autant de jugements moraux équivalents qu'il y a de peuples et d'individus.
Le principal inconvénient de la théorie éthique relativiste est qu'il est impossible d'isoler le contenu universel de la morale, c'est-à-dire ce commencement en lui, qui est conservé dans différents époques historiques chez différents peuples. De plus, une telle vision conduit souvent à l'immoralité (le rejet de la moralité en général).
Les théories éthiques modernes croient que la définition du bien est pratiquement impossible (intuitionnisme), ou bien dépend entièrement du plan personnel de l'individu (existentialisme).
2. Conscience
Apparemment, historiquement, la première formation de la conscience morale était la conscience, qui agissait comme la capacité d'une personne à ressentir et à comprendre la signification morale de son comportement. La conscience est la voix de Dieu en nous, le juge intérieur qui guide et juge nos actions. Indépendamment des opinions sur la nature de la moralité, de nombreux moralistes (Abélard, Kant, Kierkegaard, Tolstoï, Moore, Fromm) ont défini la conscience comme la plus haute capacité à comprendre la vérité morale.
Kant a dit que la conscience est une peur qui est entrée à l'intérieur et dirigée contre elle-même. Il a défini la conscience comme "culte solitaire" et "génie moral", soulignant, d'une part, sa nature sombre, "la capacité étonnante en nous", et, d'autre part, son caractère unique. Feuerbach a noté plus tard, parlant de l'origine de la conscience : « La conscience provient de la connaissance et est associée à la connaissance, mais cela ne signifie pas la connaissance en général, mais un département spécial ou un type de connaissance - cette connaissance qui se rapporte à notre comportement moral et à notre bonnes ou mauvaises humeurs et actions. L'étymologie même du mot « conscience » dans de nombreuses langues montre qu'il renvoie à la connaissance : « nouvelles », « savoir », mais pas seulement savoir, mais savoir avec les autres, savoir ce que l'autre sait. .
La conscience peut se manifester non seulement dans le fait qu'une personne est consciente de la signification morale de son acte, mais aussi sous la forme d'expériences émotionnelles. Ces expériences sont similaires à un sentiment de honte - un sentiment moral de honte et de culpabilité devant les autres et devant soi-même, qui recouvre une personne qui a commis un acte.
En ce sens, la conscience est directement liée au sentiment de culpabilité, à la responsabilité personnelle de l'individu pour ses actes, à la capacité d'une personne à évaluer de manière adéquate la moralité de son propre acte. La conscience est l'expression de la moralité à l'intérieur d'une personne, c'est-à-dire pas ce que je suis chargé de faire de l'extérieur, mais ce que j'ai de l'intérieur.
Le tourment d'une "conscience impure" est l'un des plus grands malheurs qu'une personne prenne sur ses épaules. Trahison, trahison, méchanceté, tromperie, mensonges, biens malhonnêtement acquis - tous ces actes sont un lourd fardeau pour la conscience. La propre conscience devient le juge et l'accusateur le plus strict. Elle rappelle constamment au criminel ce qu'il a fait, le conduisant parfois à la folie.
Kant écrit : « Une personne peut utiliser autant de ruse qu'elle le souhaite pour imaginer son comportement enfreignant la loi, dont elle se souvient, comme un oubli involontaire, simplement une indiscrétion qui ne peut jamais être évitée, complètement, donc, comme quelque chose dans laquelle elle était. impliqué dans un courant de nécessité naturelle de plaider non coupable ; et pourtant il voit que l'avocat qui parle en sa faveur ne peut en aucune façon faire taire l'accusateur en lui, s'il sait qu'au moment où l'injustice a été commise, il était sain d'esprit, c'est-à-dire qu'il pouvait user de sa liberté. Ainsi, selon Kant, on ne peut pas jouer à cache-cache avec la conscience, on ne peut pas tout comprendre correctement, mais agir injustement - aucun accord avec la conscience n'est possible, car tôt ou tard elle se réveillera et vous obligera à répondre.
3. Dette
Le concept de devoir révèle d'abord le rapport entre l'individu et la société. La personnalité agit en tant que porteur actif de certaines obligations morales envers la société, qu'elle réalise et met en œuvre dans ses activités. La catégorie du devoir est très étroitement liée à des concepts tels que la responsabilité, la conscience de soi.
L'interprétation de la nature et de l'origine de la dette a été l'un des problèmes les plus difficiles de l'histoire de l'éthique. Le fondement et la source du devoir se trouvaient soit dans les commandements divins, soit dans la loi morale a priori (Kant), soit dans la nature humaine elle-même, dans le désir « naturel » de l'homme pour le plaisir. Ils ont essayé de dire de différentes manières qui, en dernière analyse, a le droit de déterminer le contenu de la dette : société - théories socialement approbatives, Dieu - théories religieuses, conscience - Fichte, sentiment moral - théories du sentiment moral. Par conséquent, l'autorité d'une sorte ou d'une autre était déclarée base du devoir, mais de ce fait la question du contenu du devoir moral était privée de sens. Le devoir implique la responsabilité des personnes, la capacité d'enjamber un « je veux » personnel au profit d'un « devoir » hautement responsable.
L'apologiste du devoir était Kant, qui devenait pathétique en parlant de devoir : « Dette ! Vous êtes un grand mot exalté, il n'y a rien d'agréable en vous qui flatte les gens, vous exigez l'obéissance, bien que pour stimuler la volonté, vous ne menacez pas de ce qui inspirerait le dégoût naturel dans l'âme et effrayerait; vous ne faites qu'établir une loi qui, d'elle-même, pénètre l'âme et même contre la volonté peut se faire respecter (mais pas toujours exécuter) ; tous les penchants se taisent devant toi, même s'ils s'opposent secrètement à toi - où est ta source digne de toi et où sont les racines de ta noble origine, rejetant fièrement toute parenté avec les penchants, et d'où surgissent les conditions nécessaires à cette dignité que seul les gens peuvent vous donner? Ce ne peut être que ce qui élève une personne au-dessus de lui-même (en tant que partie du monde sensible), qui la relie à l'ordre des choses, que seul l'esprit peut penser et auquel, en même temps, tout le monde sensible est subordonné. , et avec elle - une existence empiriquement déterminée, une personne dans le temps et la totalité de tous les objectifs ... Ce n'est rien de plus qu'une personne.
F. Nietzsche s'est rebellé contre le rigorisme de Kant, dans lequel la "loi" dominait à la fois les phénomènes du monde extérieur et l'âme humaine. Selon l'auteur de La Généalogie de la morale, le concept de dette est historiquement né de la relation du créancier et du débiteur. En cas de non-paiement de la dette, le créancier acquiert un pouvoir sur le débiteur, qui s'avère être plus que le pouvoir d'une simple demande de paiement de la dette. La supériorité morale sert en quelque sorte de compensation que le créancier reçoit si la dette ne lui est pas restituée. En remettant une dette, en faisant preuve de miséricorde, le créancier bénéficie de l'humiliation du débiteur.
4. Honneur
Pour déterminer le contenu spécifique du devoir, il est nécessaire de considérer sa relation avec deux autres catégories : l'honneur et la dignité. La valeur morale d'une personne, exprimée dans le concept d '«honneur», est associée à une position sociale spécifique d'une personne, au type de son activité et aux rôles sociaux qu'elle exerce. Le contenu de la notion d'« honneur » se révèle dans les exigences de comportement, de mode de vie et d'actions d'une personne que la moralité publique impose à une personne en tant que membre d'un certain groupe, en tant que titulaire de fonctions sociales. D'où l'ensemble des exigences spécifiques pour le comportement d'un homme, d'une femme, d'un médecin - l'honneur d'un homme, d'une femme, d'un professionnel.
Selon A. Schopenhauer, l'honneur est une conscience externe, et la conscience est un honneur interne. L'honneur est l'opinion publique de notre valeur, notre peur de cette opinion. Ainsi, par exemple, le concept d'honneur officiel ou professionnel est directement lié à l'opinion selon laquelle une personne occupant un poste dispose réellement de toutes les données nécessaires pour cela et remplit toujours avec précision ses fonctions officielles. Historiquement, le concept d'honneur est apparu dans la conscience morale de la société sous la forme d'idées sur l'honneur tribal et immobilier, sous la forme d'exigences globales prescrivant un certain mode de vie, une ligne de conduite. La violation, l'écart par rapport au mode de vie prescrit par la moralité publique était fortement évalué négativement, provoquait un sentiment de honte et de disgrâce et était donc interprété comme un comportement indigne, la conscience de l'honneur se manifestait particulièrement clairement dans la moralité de la société féodale, qui se distinguait par une structure foncière rigide et une réglementation détaillée du mode de vie de chaque groupe social. La dignité d'une personne dans cette moralité, y compris l'estime de soi, était déterminée par la rigueur avec laquelle une personne observait ces normes de classe de la moralité.
5. Bonheur, sens, but
Bonheur, sens, but et idéal vie humaine. Il est difficile de trouver d'autres catégories d'éthique qui, de l'Antiquité à nos jours, ne suscitent pas un aussi vif intérêt. Pourquoi une personne vit-elle ? Quel est son but dans le monde ? Y a-t-il un sens à sa vie s'il est un être fini, c'est-à-dire mortel?
Ces questions et d'autres similaires, que G. Heine appelait autrefois maudites, ne peuvent qu'exciter toute personne réfléchie, car la question de la mort et de l'immortalité est une question profondément morale - il est naturel pour une personne de penser à la finitude de son existence. C'est à de tels moments qu'il ressent et réalise avec une force particulière le besoin de déterminer quel est le sens de la vie pour lui, s'il est heureux. C'est le moment de l'estime de soi morale d'une personne.
Dans l'histoire de l'éthique, il existe de nombreuses réponses aux questions sur le sens de la vie humaine.
Tous peuvent être divisés en trois domaines principaux:
1) certains voyaient le sens de la vie dans le bien-être individuel ;
2) d'autres l'ont vu dans la mise en œuvre de certaines tâches extraterrestres ;
3) a proclamé le non-sens et l'absurdité de l'existence humaine.
On retrouve des conceptions individualistes du bonheur et du sens de la vie dans l'hédonisme et l'eudémonisme. De plus, sous une forme ou une autre, la compréhension du bonheur comme maximum de plaisir se retrouve dans l'éthique de l'utilitarisme.
La deuxième direction dans la compréhension du sens de la vie se manifeste le plus clairement dans l'éthique religieuse. La valeur la plus élevée est comprise, l'autre monde est proclamé et l'existence terrestre est comprise comme une sorte d'épreuve envoyée par Dieu à l'homme. Par conséquent, le sens de la vie terrestre est le transfert de toutes sortes d'épreuves et de difficultés, mais au nom de l'expiation du péché originel, au nom du salut d'une âme immortelle. Contrairement au concept hédoniste, l'éthique religieuse fait du principe de la vie terrestre le rejet du plaisir, l'ascèse, son idéal est un homme ascétique.
La troisième direction dans la compréhension du sens de la vie peut être qualifiée de pessimiste. C'est un déni de tout sens de l'existence humaine, une conviction profonde dans l'absurdité, le non-sens total de l'existence humaine. De ce point de vue, la vie humaine est dépourvue de toute certitude objective, et donc toujours dénuée de sens et absurde. Une personne seule, livrée à elle-même, éprouve un sentiment constant d'anxiété et de peur. Comme l'a dit Byron : "Qui que vous soyez, il vaudrait mieux ne pas l'être."
On trouvera des humeurs pessimistes dans le livre le plus poétique de la Bible, dans l'Ecclésiaste : « Et je haïssais la vie, car tout est vanité et vexation de l'esprit », « Tout est sorti de la poussière et retournera à la poussière ».
Le livre de Job dit : « L'homme est né pour souffrir. A. Schopenhauer est reconnu comme le père du pessimisme dans la philosophie européenne, selon laquelle les désirs d'une personne ne peuvent jamais être satisfaits et donc "la vie de tous les côtés dans son essence est souffrance".
Le sens de la vie et le but de la vie ne sont pas des concepts équivalents, bien qu'ils soient étroitement liés. Le sens de la vie est l'objectif, indépendant du désir d'une personne, le sens de sa vie, il a lieu, qu'une personne le veuille ou non. Le but de la vie est fixé par la personne elle-même, il s'agit d'une prise de conscience interne et personnelle du sens et du contenu de la vie par une personne, de sa concrétisation dans toute entreprise ou phénomène.
Réfléchissant au problème du sens de la vie, L.N. Tolstoï est arrivé à la conclusion que la question du sens de la vie est une question de foi et non de connaissance rationnellement raisonnée. Le concept de foi dans la philosophie de Tolstoï ne coïncide pas avec le concept traditionnel de foi: «La foi est la connaissance du sens de la vie humaine, à la suite de quoi une personne ne se détruit pas, mais vit. La foi est le pouvoir de la vie." Ainsi, pour Tolstoï, une vie qui a du sens et une vie fondée sur la foi ne font qu'un.
Le concept de bonheur dans tous les systèmes éthiques est directement lié à la compréhension du sens de la vie, puisque dans sa forme la plus générale, le bonheur est défini comme un état de satisfaction morale, la satisfaction de sa vie. Les manifestes philosophiques du bonheur ont eu toutes les époques. Dans de nombreux systèmes éthiques, le bonheur était proclamé un droit humain inaliénable, la poursuite du bonheur était considérée comme une propriété innée de l'individu et, dans ces enseignements, le bonheur et sa poursuite étaient considérés comme la base et la source de l'activité morale. La Mettrie, éducateur français du XVIIIe siècle. a écrit : "Celui qui a trouvé le bonheur, il a tout trouvé." en France au XVIIIe siècle. même "l'Ordre du Bonheur" a été fondé.
Selon Voltaire, "la grande œuvre de la vie et la seule chose dont il faut s'occuper, c'est de vivre heureux". C'est la formule de l'eudémonisme. Cependant, l'eudémonisme diffère de l'hédonisme, car la source du bonheur peut être non seulement le plaisir, mais aussi un destin prospère, la perfection humaine, la satisfaction de la vie.
Le bonheur est l'état de la plus grande satisfaction d'une personne avec les conditions de sa vie, un sentiment de plénitude et de sens de la vie - c'est le bien-être, la santé et le degré de liberté et de confiance d'une personne dans l'utilité de son existence sur Terre.
Le bonheur ne peut pas être un état permanent, ce n'est pas un état de joie continue, mais plutôt un moment de poussée émotionnelle particulière. Un ancien penseur a dit que le bonheur alternait avec le malheur comme une rose avec des épines. Heinrich Heine confirme une idée reçue lorsqu'il compare le bonheur à une fille frivole qui caresse, embrasse et s'enfuit ; le malheur, au contraire, est comme une femme qui s'attache fortement, n'est pas pressée de partir et s'assied tranquillement autour de vous. Par conséquent, en règle générale, le bonheur est éphémère, il est difficile de le garder, tandis que le malheur, au contraire, se distingue par la constance.
6. Amour
En lien avec l'exemple ci-dessus, on peut dire que beaucoup associent le concept de bonheur à la capacité d'aimer et d'être aimé. L'amour est une autre catégorie d'éthique : de nombreux traités théoriques ont été écrits sur l'amour. Dans l'ancien traité indien "Peach Branches", il est noté que "Trois sources ont des inclinations humaines : l'âme, l'esprit et le corps. Les attractions des âmes engendrent l'amitié. Les inclinations de l'esprit engendrent le respect. Les désirs du corps engendrent le désir. L'union des trois pulsions produit l'amour."
Si nous parlons des signes caractéristiques de l'amour, le plus important est la sélectivité, c'est-à-dire c'est un sentiment qui s'adresse à une certaine personne en particulier. L'objet de l'amour individuel est perçu par l'amant comme un ensemble unique de vertus personnelles. L'un des plus secrets de l'amour réside dans l'inexplicabilité de cette sélectivité, dans la capacité de l'amant à voir dans l'aimé ce que les autres ne remarquent pas. Le célèbre écrivain français Stendhal a comparé ce processus à la cristallisation, lorsqu'une simple branche, recouverte de mines de sel avec des cristaux de sel ordinaires, se transforme en un miracle brillant. Un miracle similaire se produit, selon Stendhal, avec les amoureux - pour eux, la bien-aimée ressemble au même miracle. Et le point ici, probablement, est qu'une sorte d'idéalisation est en train de se produire, mais comme l'a écrit M. Nordau : « Plus l'idéal est bas et simple, plus l'individu trouve facilement son incarnation. C'est pourquoi les gens vulgaires et ordinaires peuvent facilement tomber amoureux et remplacer un objet d'amour par un autre, alors qu'il est difficile pour les natures raffinées et complexes d'atteindre leur idéal ou de le remplacer par un autre en cas de perte.
Des signes importants de l'amour sont notés par Engels, parlant de la nature socio-historique de l'amour : « L'amour sexuel moderne diffère sensiblement du simple désir sexuel, de l'eros des anciens. D'abord, elle suppose l'amour mutuel chez l'être aimé ; à cet égard, la femme est sur un pied d'égalité avec l'homme, alors que pour l'ancien eros son consentement n'était nullement requis. Deuxièmement, la force et la durée de l'amour sexuel sont telles que l'impossibilité de la possession et de la séparation apparaît aux deux parties comme un grand, sinon le plus grand malheur ; ils prennent de grands risques, voire mettent leur vie en jeu, juste pour s'appartenir, ce qui dans les temps anciens n'arrivait que sauf en cas de violation fidélité conjugale. Et, enfin, un nouveau critère moral apparaît pour condamner et justifier les rapports sexuels ; ils demandent non seulement s'il s'agit d'un mariage ou d'une relation extraconjugale, mais aussi s'il est né d'un amour mutuel ou non.
Le raisonnement d'Engels est fondamentalement correct, il est basé sur l'affirmation que les idées sur l'amour sont en effet historiquement changeantes. Cependant, on ne peut pas affirmer catégoriquement, par exemple, que dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'amour, mais un seul éros corporel, juste une attirance sexuelle. On peut rappeler le mythe d'Orphée et d'Eurydice, qui suivirent sa bien-aimée aux Enfers, puis, l'ayant perdue, ne purent regarder d'autres femmes, pour lesquelles, selon la légende, il fut mis en pièces par les Bacchantes. Et dans le cycle épique troyen, l'amour est presque la principale source de guerre.
Dans les tragédies grecques classiques, l'amour est un moteur terrible des actions humaines, il apporte la mort, l'horreur. Ici, Eros est un dieu terrible, dont même les dieux eux-mêmes ont peur. (Euripide "Electre", "Médée", "Hippolyte"). Ainsi, sous une forme mythologique, l'idée a été exprimée que l'amour apporte à une personne non seulement de la joie, des sentiments brillants, mais aussi du malheur, du malheur, de la souffrance.
7. Amitié
La Grèce antique a longtemps été considérée comme le royaume de la véritable amitié. Les noms de Castor et Polydeuces, Oreste et Pylade, Achille et Patrocle sont devenus des noms familiers. Les principales caractéristiques de l'amitié étaient considérées comme son indissolubilité. Le symbole d'une telle amitié était l'histoire de Castor et Polydeuces, énoncée dans les mythes des Dioscures. Selon le mythe, Polydeuces (ou Pollux), le fils de Zeus, ne pouvant supporter la mort de son frère et ami Castor, mort au combat, demanda à son père de lui envoyer la mort. Zeus a permis à Polydeuces de donner la moitié de son immortalité à son frère. Depuis lors, les Dioscures ont passé une journée dans le monde souterrain des morts et une journée sur l'Olympe. Dans ce beau mythe poétique, l'idée de la grande valeur de l'amitié est exprimée à l'extrême : l'amitié est plus forte que la mort.
L'ancien canon grec de l'amitié était conçu comme une institution exclusivement masculine. La position dépendante d'une femme et le sous-développement intellectuel qui en résulte rendaient impossible d'avoir une amitié profonde avec elle, car, comme le disait Platon, l'égalité crée l'amitié.
Un résultat particulier de la philosophie grecque antique de l'amitié a été résumé par Aristote, qui a donné dans l'Éthique à Nicomaque le premier essai intégral sur la théorie de l'amitié en tant que relation morale indépendante.
L'amitié selon Aristote, la plus grande valeur sociale et personnelle, la plus nécessaire à la vie. En effet, personne ne choisira une vie sans amis, même en échange d'autres avantages.
Aristote aborde la définition de l'amitié sous plusieurs angles à la fois. D'abord, selon le partenariat, il distingue les relations paternelles, fraternelles, de parenté, conjugales, de voisinage, politiques, de camaraderie, érotiques et d'hospitalité.
Deuxièmement, le philosophe distingue les relations d'égalité des relations fondées sur la supériorité sociale ou morale d'un partenaire sur l'autre.
Troisièmement, il différencie la nature des sentiments ressentis par une personne, en distinguant l'amitié calme, la disposition et l'affection en général, les sentiments amicaux individualisés et l'amour passionné, l'attirance.
Quatrièmement, Aristote classe les motifs de nouer et d'entretenir des relations amicales: amitié utilitaire - pour le bénéfice, le bénéfice, l'amitié hédoniste - pour le plaisir, l'agrément, l'amitié parfaite, dans laquelle ces motifs sont subordonnés à l'amour désintéressé pour un ami en tant que tel.
La véritable amitié est une amitié désintéressée, c'est un moyen nécessaire de connaissance de soi : « Tout comme si nous voulons voir notre visage, nous regardons dans le miroir et le voyons, donc si nous voulons nous connaître, nous pouvons nous connaître en nous regardant. chez un ami. Un ami est notre deuxième "je". Il n'y a personne de plus proche qu'un ami. Par conséquent, selon Aristote, le nombre d'amis a des limites, car une amitié étroite est une amitié avec quelques-uns.
En fait, Aristote a formulé toutes les questions les plus importantes de la psychologie et de l'éthique de l'amitié.
3. Éthique professionnelle
Découvrir l'origine de l'éthique professionnelle, c'est retracer le rapport des exigences morales avec la division du travail social et l'émergence d'une profession. Aristote, puis Comte, Durkheim se sont penchés sur ces questions il y a de nombreuses années. Ils ont parlé de la relation entre la division du travail social et les principes moraux de la société. Pour la première fois, la justification matérialiste de ces problèmes a été donnée par K. Marx et F. Engels.
L'émergence des premiers codes professionnels et déontologiques renvoie à la période de la division du travail dans les conditions de formation des ateliers médiévaux aux XIe-XIIe siècles. C'est alors que, pour la première fois, ils mentionnent la présence dans les chartes d'atelier d'un certain nombre d'exigences morales relatives à la profession, à la nature du travail et aux partenaires de travail.
Cependant, un certain nombre de professions d'une importance vitale pour tous les membres de la société sont apparues dans l'Antiquité et, par conséquent, des codes professionnels et éthiques tels que le serment d'Hippocrate, les règles morales des prêtres exerçant des fonctions judiciaires, sont connus beaucoup plus tôt.
L'apparition de l'éthique professionnelle dans le temps a précédé la création d'enseignements éthiques scientifiques, de théories à ce sujet. L'expérience quotidienne, la nécessité de réglementer les relations des personnes d'une profession particulière a conduit à la réalisation et à la formalisation de certaines exigences de déontologie professionnelle. L'éthique professionnelle, apparue comme une manifestation de la conscience morale quotidienne, s'est ensuite développée sur la base d'une pratique généralisée du comportement des représentants de chaque groupe professionnel. Ces généralisations étaient contenues à la fois dans des codes de conduite écrits et non écrits et sous la forme de conclusions théoriques.
Ainsi, cela indique une transition de la conscience ordinaire à la conscience théorique dans le domaine de la morale professionnelle. L'opinion publique joue un rôle important dans la formation et l'assimilation des normes d'éthique professionnelle.
Les normes de la morale professionnelle ne deviennent pas immédiatement universellement reconnues, cela est parfois associé à une lutte d'opinions. La relation entre l'éthique professionnelle et la conscience publique existe également sous la forme de la tradition. Différents types d'éthique professionnelle ont leurs propres traditions, ce qui indique la continuité des normes éthiques de base développées par les représentants d'une profession particulière au cours des siècles.
Le professionnalisme comme trait de personnalité morale.
L'éthique professionnelle est un ensemble de normes morales qui déterminent l'attitude d'une personne face à son devoir professionnel. Les relations morales des personnes dans la sphère du travail sont régies par l'éthique professionnelle. La société ne peut fonctionner normalement et se développer qu'à la suite d'un processus continu de production de matériaux et d'objets de valeur.
Etudes d'éthique professionnelle :
Relations entre les collectifs de travail et chaque spécialiste individuellement ;
Qualités morales de la personnalité d'un spécialiste, qui assurent la meilleure exécution du devoir professionnel ;
Les relations au sein des équipes professionnelles et les normes morales spécifiques inhérentes à une profession donnée ;
Caractéristiques de la formation professionnelle.
Le professionnalisme et l'attitude au travail sont des caractéristiques importantes du caractère moral d'une personne. Ils sont d'une importance primordiale dans les caractéristiques personnelles de l'individu, mais à divers stades du développement historique, leur contenu et leur évaluation ont considérablement varié. Dans une société de classes, ils étaient déterminés par l'inégalité sociale des types de travail, à l'opposé du travail mental et physique, la présence de professions privilégiées et non privilégiées. Le caractère de classe de la morale dans le domaine du travail est attesté par un ouvrage écrit dans le premier tiers du IIe siècle av. le livre biblique chrétien "La Sagesse de Jésus, le fils de Sirach", dans lequel il y a une leçon sur la façon de traiter un esclave: "nourrir, coller et charger - pour l'âne; pain, punition et travail - pour l'esclave. Gardez l'esclave occupé et vous aurez la paix desserrez ses mains et il cherchera la liberté. Dans la Grèce antique, le travail physique en termes de valeur et d'importance était au plus bas. Et dans une société féodale, la religion considérait le travail comme une punition du péché originel, et le paradis était présenté comme la vie éternelle sans travail. Sous le capitalisme, l'aliénation des travailleurs aux moyens de production et aux résultats du travail a donné naissance à deux types de morale : le capitaliste prédateur-prédateur et la classe ouvrière collectiviste-émancipatrice, qui s'étendait également à la sphère du travail. F. Engels écrit à ce sujet "... chaque classe et même profession a sa propre moralité".
Les situations dans lesquelles les personnes se trouvent dans le processus d'exécution de leurs tâches professionnelles ont une forte influence sur la formation de l'éthique professionnelle. Dans le processus de travail, certaines relations morales se développent entre les personnes. Ils comportent un certain nombre d'éléments inhérents à tous les types d'éthique professionnelle.
Premièrement, c'est l'attitude envers le travail social, envers les participants au processus de travail,
Deuxièmement, ce sont les relations morales qui naissent dans le domaine du contact direct entre les intérêts des groupes professionnels entre eux et avec la société.
L'éthique professionnelle n'est pas une conséquence de l'inégalité du degré de moralité des divers groupes professionnels. C'est juste que la société montre des exigences morales accrues pour certains types d'activités professionnelles. En gros ce sont domaines professionnels dans lequel le processus de travail lui-même nécessite la coordination des actions de tous ses participants. Une attention particulière est portée aux qualités morales des travailleurs de terrain qui sont associées au droit de disposer de la vie des gens, ici nous parlons non seulement sur le niveau de moralité, mais aussi, tout d'abord, sur la bonne exécution de ses devoirs professionnels (il s'agit des professions du secteur des services, des transports, de la gestion, de la santé, de l'éducation). L'activité de travail des personnes exerçant ces professions, plus que toute autre, ne se prête pas à une réglementation préalable, ne s'inscrit pas dans le cadre de instructions de bureau. Il est intrinsèquement créatif. Les particularités du travail de ces groupes professionnels compliquent les relations morales et un nouvel élément leur est ajouté: l'interaction avec les personnes - objets d'activité. C'est là que la responsabilité morale devient cruciale.
La société considère les qualités morales d'un salarié comme l'un des principaux éléments de son aptitude professionnelle.
Les normes morales générales doivent être spécifiées dans l'activité de travail d'une personne, en tenant compte des spécificités de sa profession. Ainsi, la moralité professionnelle doit être considérée dans l'unité avec le système de moralité généralement accepté. Violation éthique de travail accompagnée de la destruction des principes moraux communs, et vice versa. L'attitude irresponsable de l'employé envers devoirs professionnels représente un danger pour les autres, nuit à la société et peut finalement conduire à la dégradation de l'individu lui-même.
Maintenant, en Russie, il est nécessaire de développer un nouveau type de moralité professionnelle, qui reflète l'idéologie de l'activité de travail basée sur le développement des relations de marché. Il s'agit principalement de l'idéologie morale de la nouvelle classe moyenne, qui constitue la grande majorité de la main-d'œuvre dans une société économiquement développée.
Dans la société moderne, les qualités personnelles d'un individu commencent par son caractéristiques de l'entreprise l'attitude au travail, le niveau d'aptitude professionnelle. Tout cela détermine l'exceptionnelle pertinence des enjeux qui composent le contenu de l'éthique professionnelle. Le véritable professionnalisme repose sur des normes morales telles que le devoir, l'honnêteté, l'exigence envers soi-même et ses collègues, la responsabilité des résultats de son travail.
A chaque type d'activité humaine (scientifique, pédagogique, artistique, etc.) correspond un certain type d'éthique professionnelle.
Les types d'éthique professionnelle sont les caractéristiques spécifiques de l'activité professionnelle qui s'adressent directement à une personne dans certaines conditions de sa vie et de son activité dans la société. L'étude des types d'éthique professionnelle montre la diversité, la versatilité des relations morales. Pour chaque profession, certaines normes morales professionnelles acquièrent une signification particulière. Les normes morales professionnelles sont des règles, des échantillons, l'ordre d'autorégulation interne d'une personne basée sur des idéaux éthiques.
Les principaux types d'éthique professionnelle sont: éthique médicale, éthique pédagogique, éthique du scientifique, acteur, artiste, entrepreneur, ingénieur etc.
Chaque type d'éthique professionnelle est déterminé par l'originalité de l'activité professionnelle, a ses propres exigences spécifiques dans le domaine de la moralité. Ainsi, par exemple, l'éthique d'un scientifique présuppose avant tout des qualités morales telles que la conscience scientifique, l'honnêteté personnelle et, bien sûr, le patriotisme. La déontologie judiciaire exige l'honnêteté, l'équité, la franchise, l'humanisme (même envers le prévenu lorsqu'il est coupable), la fidélité à la loi. L'éthique professionnelle dans les conditions service militaire exige une exécution claire du devoir, du courage, de la discipline, du dévouement à la Patrie.
Documents similaires
Éthique, morale et moralité. La dimension morale de l'individu et de la société. Caractéristiques du fonctionnement de la morale. La non-violence comme interdit moral catégorique. L'unité de la morale et la diversité des mœurs. Le paradoxe de l'évaluation morale et du comportement moral.
dissertation, ajouté le 20/05/2008
L'éthique comme doctrine de la morale, de l'assimilation morale de la réalité par une personne. La moralité en tant que moyen spirituel-pratique spécial et précieux de maîtriser le monde. Ses principales fonctions et propriétés. Le système des catégories de l'éthique, reflétant les éléments de la morale.
travaux de contrôle, ajouté le 19/02/2009
Caractéristiques de l'origine et de la corrélation des concepts d'éthique, de moralité, de moralité. Le sujet et les caractéristiques de l'éthique en tant que science. Essence et structure de la morale, son origine. Types historiques de morale. Fonctions fondamentales de la morale. Le concept de subconscient moral.
présentation, ajouté le 03/07/2014
L'éthique est une science qui étudie la moralité et la moralité - des concepts qui ont un sens proche, mais qui ne sont pas synonymes et qui ont des significations, des fonctions et des tâches différentes. Corrélation des concepts "éthique", "moralité", "moralité".
résumé, ajouté le 20/05/2008
L'essence de concepts fondamentaux tels que "éthique", "moralité", "moralité". La norme est une cellule élémentaire de la morale. Principes moraux et leur rôle dans l'orientation du comportement moral d'une personne. Idéaux et valeurs : le niveau supérieur de la conscience morale.
travaux de contrôle, ajouté le 20/12/2007
L'origine des termes "éthique", "moralité", "moralité". Caractéristiques des enseignements éthiques de l'ère antique. La morale comme domaine de la vie publique. Développement de normes de comportement humain dans le processus de développement de la société. Aspects spirituels et pratiques de la morale.
résumé, ajouté le 12/07/2009
Le sujet de l'étude de l'éthique. L'origine et le contenu des concepts d'"éthique", de "moralité", de "moralité". La structure de la connaissance éthique. La relation de l'éthique avec les autres sciences qui étudient la morale. Idées éthiques ancien monde. Histoire de la pensée éthique en Ukraine.
aide-mémoire, ajouté le 12/06/2009
Le sujet de l'éthique. fonctionnement de la morale. L'éthique est la science de la morale et de l'éthique. La structure de la morale et ses éléments. Enseignements éthiques dans l'histoire des religions. Les idées éthiques en philosophie. Développement de l'éthique au XXe siècle. Les problèmes éthiques du présent.
livre, ajouté le 10/10/2008
Essence et structure de la morale. Principes moraux et leur rôle dans l'orientation du comportement moral d'une personne. A propos d'une seule morale et moralité. Aspects moraux du comportement social et de l'activité de la personnalité. Unité de pensée, de morale et d'éthique.
dissertation, ajouté le 01/08/2009
Programmes normatifs d'éthique et de choix moral de l'individu. Systématisation du contenu objectif, généralement significatif de l'éthique, de son sens moralement contraignant. Éthique du devoir et de la vertu. Le concept de moralité dans diverses écoles et directions philosophiques.
1. Les notions d'"éthique", de "moralité", de "moralité".
2. Le sujet de l'éthique et ses principaux problèmes.
3. Ethique - philosophie pratique, sa signification socio-culturelle.
Le terme « éthique » vient du mot grec ancien "éthos"("avec"). Initialement, ethos était compris comme un lieu habituel de vie commune, une maison, une habitation humaine. Par la suite, il a commencé à désigner la nature stable d'un phénomène, d'un tempérament, d'un caractère. A partir du mot "ethos", ancien philosophe grec Aristote au IVe siècle AVANT JC. forma l'adjectif "éthique" pour désigner une classe particulière de qualités humaines - la justice, le courage, l'honnêteté, la modération, la sagesse, etc., qu'il appela les vertus éthiques. Doctrine philosophique, science des vertus éthiques, Aristote appelait l'éthique.
Pour une traduction fidèle du concept aristotélicien d'« éthique »
du grec au latin, l'ancien philosophe romain Cicéron (106-43 av. J.-C.) a construit le terme "morale"(morale) Il l'a formé à partir du mot mois (mœurs- pluriel. nombre) - l'analogue latin du grec "ethos". Cicéron, en particulier, parlait de philosophie morale, entendant par là le même champ de connaissance qu'Aristote appelait l'éthique. Au IVe siècle apr. le terme apparaît en latin "moralité"(morale), qui est un analogue direct du terme grec "éthique".
Ces deux mots sont inclus dans les nouvelles langues européennes. Avec eux
dans un certain nombre de langues il y a propres mots désignant la même réalité, qui se généralise en termes d'"éthique" et de "morale". Dans la langue russe, le concept de "moralité" apparaît. Du mot "disposition" l'adjectif " moral"et de lui - un nouveau nom - "moral".
Au sens originel, différents mots : « éthique », « moralité »,
"morale" - avait le même contenu. Au fil du temps, la situation évolue. Dans le processus de développement culturel, alors que se révèle le caractère unique de l'éthique en tant que domaine de connaissance, au-delà mots différents différentes significations commencent à se fixer : l'éthique est comprise comme la branche correspondante du savoir, la doctrine, et la morale (la morale) est le sujet qu'elle étudie. Dans l'usage courant, cette différence de sens n'est pas toujours prise en compte. En particulier, lorsqu'ils parlent de l'éthique d'un enseignant, d'un médecin, d'un ingénieur, d'un économiste, etc., ils entendent les spécificités de leur moralité. L'une des raisons en est la tendance psychologique des gens à identifier ce qui est présenté dans leur esprit avec le réel, et non présenté avec l'inexistant. Mais la philosophie affirme que le connaissable (dans ce cas, la morale) est fondamentalement différent de la connaissance à son sujet (l'éthique) en termes de manière d'être. Le connaissable existe objectivement, et la connaissance à son sujet est subjective, c'est-à-dire dans la conscience. De plus, le connaissable a un nombre infini de propriétés, et son modèle théorique ne reflète que certaines d'entre elles, en meilleur cas- général et essentiel. En même temps, la connaissance la plus parfaite de la morale, c'est-à-dire la théorie éthique la plus profonde, ne peut remplacer la morale elle-même pour une personne.
L'illusion de l'identité de la morale et de l'éthique découle également du fait que l'éthique utilise les mêmes concepts que la morale. Mais si dans les jugements de moralité les concepts, par exemple, le « bien », le « mal » jouent le rôle de prédicats logiques, c'est-à-dire le connu, alors en éthique ce sont des sujets logiques, c'est-à-dire l'inconnu. Un exemple de jugements moraux : « La vérité est bonne », « La tromperie est mauvaise ». Un exemple de jugements éthiques : « Le bien est une catégorie d'éthique qui… », « Le mal est une catégorie d'éthique qui… ». Ainsi, les jugements d'éthique sont souvent des jugements-définitions. Ce qui est considéré comme connu dans le système de la morale et grâce auquel tout acte d'une personne acquiert une certitude, dans le système de l'éthique est considéré comme inconnu, ce qui nécessite une recherche appropriée.
La morale et la moralité déterminent les significations de l'éthique au singulier et au particulier. C'est le domaine de la perception psychologique, sensuelle-émotionnelle des normes éthiques, le domaine du libre choix moral, les actions pratiques des personnes.
Éthique–un domaine de connaissances philosophiques qui étudie les conditions préalables universelles et les formes de relations morales des personnes dans le système de leurs activités spirituelles et pratiques.
Le sujet de l'éthique est la morale. Moralité - c'est un ensemble de normes, d'idées, de règles de comportement des personnes définies historiquement, réalisées dans leurs actions et actes moraux.
Tous les enseignements éthiques du passé et du présent ont pour but la justification rationnelle de la morale, l'identification de son sens général, essentiel, exprimé dans un système de normes, de lois, de valeurs, de principes, de catégories. En ce sens, l'éthique sous sa forme théorique agit comme une expression de valeurs morales supérieures. Il forme des idées idéales sur le moralement convenable. La morale ne parle pas de ce qui est, mais, basée sur la généralisation de la pratique du comportement humain, elle parle de ce qui devrait être.
La morale est fermée à la personne. C'est un attribut de son existence, un indicateur de sa socialité. Il lie les gens entre eux dans toutes leurs autres relations. C'est la seule condition possible de l'existence mutuelle des personnes, l'espace dans lequel l'existence humaine se déroule précisément en tant qu'humaine. Déjà les premiers enseignements éthiques considèrent l'homme comme le seul et le plus haut critère de la moralité. C'est la moralité qui sert de voie universelle et de moyen de connaissance de soi et d'amélioration de soi de l'individu. Il fournit la plus haute opportunité sociale et personnelle, en maintenant l'harmonie de l'homme et de la société, la stabilité de tous les liens de la vie sociale.
La morale est un mode particulier de régulation normative des relations sociales. Dans ces sens, la moralité est représentée dans le système des codes moraux, des préceptes moraux, des œuvres scientifiques et littéraires, dans les coutumes et les traditions des gens. Il est tissé dans le tissu vivant de l'existence spirituelle de l'humanité et de chaque individu. Avec la science, la politique, le droit, la religion, l'art, la philosophie, la morale détermine l'intégrité des processus historiques, leur continuité, le développement de la culture spirituelle de l'humanité et sert de condition nécessaire à la reproduction de la vie sociale. La prédestination spirituelle de la morale n'est pas réductible aux formes de conscience sociale traditionnellement comprises. Cela est dû au fait que :
Premièrement, toutes les formes connues de vie spirituelle apparaissent dans le temps à la suite d'un développement historique. Les relations politiques, juridiques, religieuses, esthétiques se forment nécessairement sur la base de facteurs objectifs - la complexité de la structure des besoins, la division du travail, la nécessité de rationaliser les liens sociaux, la réflexion créative de la réalité et l'expression de soi de l'individu. La morale, dans son essence, est, pour ainsi dire, destinée à une personne comme la seule voie universelle possible d'auto-organisation et de développement personnel et social.
Deuxièmement, tous les types d'activité spirituelle sont interconnectés, mais chacun d'eux a des paramètres clairement définis de sa signification sociale. Il existe des États, des institutions scientifiques, des organisations religieuses qui personnifient certains domaines d'activité spirituelle et pratique des personnes. La moralité n'a pas de telles frontières et institutions. Il entre organiquement dans le système de la culture spirituelle de l'humanité, constituant son noyau, caractérisant le plus essentiel de l'être idéal. Les motifs les plus élevés du développement social contiennent toujours une signification morale, puisque leur but est de réaliser le bien social, collectif ou individuel. En vertu de ses orientations universelles, la morale détermine les perspectives du processus historique.
Troisièmement, tout le monde a une certaine compréhension de la politique. On peut en dire autant du droit, de l'art, de la religion, de la science. La morale dans cette série est une exception. Personne n'a jamais été capable de donner une définition significativement complète de l'amour, du bonheur, de la justice et des autres valeurs morales. Ces significations sont définies différemment dans différentes théories éthiques. Les allées de la vérité morale ne sont en aucun cas limitées dans les significations des valeurs morales elles-mêmes.
La moralité est un phénomène socioculturel et historique unique qui n'a d'analogue dans aucune des sphères de l'activité spirituelle humaine. Tout élément de la vie spirituelle du point de vue de ses formes idéales, incarnation sujet-activité, porteurs sociaux, est médiatisé par la morale et lui est subordonné. Dans le système d'interaction de la morale avec d'autres formes de vie spirituelle et pratique, les valeurs morales dominent. C'est dans le domaine des relations politiques, juridiques et religieuses que cette tendance se manifeste le plus. Ils, y compris la moralité, jouent le rôle des régulateurs sociaux les plus importants de la vie des gens, servent de facteur nécessaire à l'organisation et à la rationalisation des relations sociales.
L'éthique surgit au sein de la philosophie, elle est donc organiquement liée à toutes ses sections principales : l'ontologie (la doctrine de l'être), l'épistémologie (la théorie de la connaissance), l'axiologie (la doctrine des valeurs), la praxéologie (la doctrine de l'être humain). pratique d'être). Pour découvrir le sens de la vie, l'éthique doit aborder les problèmes fondamentaux d'être une personne en tant que personne. L'éthique, en tant que science normative qui détermine le comportement humain dans certaines situations, s'intéresse avant tout à l'être potentiel, au monde du dû. Cependant, il prend également en compte les relations morales réelles des personnes, c'est-à-dire leur moralité.
Le lien entre l'éthique et l'épistémologie est dû à la nécessité de comprendre la nature, l'essence, la structure et les fonctions de la moralité, d'élever les idées morales de la conscience quotidienne au niveau de leur compréhension rationnelle-théorique. L'éthique est liée à l'axiologie par l'analyse de la nature et de l'essence des valeurs absolues, inconditionnelles, auxquelles appartient d'abord le bien. Il considère les problèmes éthiques et praxéologiques, en particulier, crée des modèles pratiques exemplaires de relations humaines et les moyens de les mettre en œuvre, donne certaines recommandations basées sur une solution philosophique aux problèmes des possibilités, des méthodes et des limites des activités pratiques des personnes dans le contexte de la relation dialectique entre liberté et nécessité. L'éthique s'intéresse principalement à la réalisation par une personne de la liberté de sa volonté, c'est-à-dire des activités dans lesquelles une personne est guidée non par des motifs pratiques-utilitaires, politiques et autres locaux, mais par des motifs axés sur des valeurs humaines universelles inconditionnelles et absolues. qui sont compris et vécus comme "bons".
C'est cette activité et le processus d'intériorisation par une personne d'une exigence morale en exigence de soi (devoir moral), qui précède cette activité, qui constitue l'épicentre des enseignements éthiques. Ce processus complexe, contradictoire, long et souvent douloureux ne peut être décrit qu'à l'aide d'un système de catégories éthiques.
La structure du sujet de l'éthique comprend deux parties principales. L'un d'eux est lié à l'étude et à la justification théorique de l'origine et du développement historique de la moralité, ainsi qu'à la compréhension des diverses formes et orientations des enseignements éthiques. L'autre couvre l'éventail des problèmes qui constituent le contenu de l'éthique en tant que théorie générale de la morale. Il s'agit d'un concept systématisé de la morale, des lois de son fonctionnement et de son développement, de son rôle dans la vie d'une personne et d'une société.
Représentant une certaine position morale et justifiant les valeurs et les exigences qui lui correspondent, l'éthique doit répondre à un certain nombre de questions qui forment le cercle de sa problématique. Tels que : questions sur l'origine et la nature de la morale ; sur la source et le contenu de l'obligation morale ; sur le contenu et les critères du bien et du mal, du devoir et des autres valeurs morales ; sur la nature et l'essence des vertus humaines; sur la liberté morale dans un monde de déterminisme universel et la prédominance des relations et relations de cause à effet ; sur le choix moral, son efficacité et son opportunité, la corrélation des objectifs, des moyens et des résultats en lui; sur les critères et facteurs d'évaluation morale des phénomènes de la vie humaine ; sur l'essence des conflits moraux et les moyens de les résoudre et de les prévenir.
Les premiers enseignements éthiques historiquement connus se forment dans le cadre des anciennes traditions philosophiques orientales et à l'époque de l'Antiquité. Ils sont de la nature de discussions philosophiques moralisatrices pratiques sur le bien et la vertu, sur la valeur comparée des paroles et des actes, des intentions et des actes, sur la nature du bien et du mal. La finalité de l'éthique, selon Aristote, n'est pas la connaissance en général, mais le contenu et l'évaluation des actions.
L'éthique en tant que doctrine philosophique est appelée à résoudre une triple tâche : décrire la morale, expliquer la morale, enseigner la morale. Les phénomènes moraux sont quelque peu vagues, insaisissables, pas toujours faciles à régler. Par conséquent, la tâche de l'éthique est d'isoler la composante morale de la diversité de l'activité humaine, de déterminer et de décrire les habitudes, les mœurs et les motivations réelles du comportement des personnes. Description de la moralité - complexe tâche de recherche, puisque la moralité n'est pas le résultat de la volonté humaine, elle est objectivement déterminée et agit comme une condition nécessaire à l'auto-organisation des individus sociaux, dont le comportement moral a sa propre logique claire. La tâche de l'éthique est d'étudier les processus moraux réels, d'introduire dans le processus de recherche des faits qui nécessitent une explication, de leur donner une interprétation théorique. La fonction descriptive de l'éthique se réalise principalement dans la section sur les étapes du développement historique de la morale ou sur la typologie historique de la morale.
Les orientations philosophiques et idéologiques de l'éthique ne sont pas moralement neutres, elles ont une valeur de valeur, se caractérisent par la certitude morale. L'éthique généralise les processus moraux et valorise les perspectives normatives. Elle ne crée pas de nouvelles formes de morale, mais leur donne des formulations complètes, centrées sur ce qui devrait être. C'est un travail d'analyse complexe. Afin de distinguer parmi la variété existante des valeurs morales celles qui expriment le plus fidèlement les intérêts profonds de la société et ont un avenir historique, elles doivent être soumises à une analyse scientifique. Un tel travail de recherche a une valeur d'orientation importante pour la pratique de l'éducation morale.
L'éthique est appelée à produire des connaissances éthiques, principalement liées à l'explication de l'origine et de l'essence de la moralité, à la justification des valeurs morales, des principes, des normes, des idéaux, des évaluations d'un type historique spécifique de société. L'éthique crée des connaissances scientifiques sur la moralité en transformant des faits moraux empiriques en systèmes théoriques rationnels.
L'éthique, expliquant les fondements et la structure du monde moral, traite d'un objet bien connu de tous. Faisant appel à l'évidence de l'expérience de vie, l'éthique "enseigne" une personne, lui offrant certaines lignes directrices normatives. Toute doctrine éthique cherche à exprimer non pas l'abstrait, mais connaissance pratique, dont la spécificité est d'inciter à l'action. La proximité avec la vie, l'appel à la pratique des relations humaines sont si évidents que l'éthique a reçu d'Aristote le nom de « philosophie pratique ».
En utilisant les exemples de Socrate, Confucius, Epicure, on peut voir que leur "philosophie pratique" est une mission dans la vie, où la preuve principale est les actes, pas les schémas théoriques.
La tâche de l'éthique et dans la justification des idéaux moraux, des modèles exemplaires de relations humaines et des moyens de les mettre en œuvre. Les significations formalisées de ces idéaux sous la forme d'un système de normes morales, de principes, de commandements, de traditions, de codes moraux servent de condition et d'outil pour l'éducation morale, de base normative pour la régulation morale des relations des personnes dans la société et pour évaluer leurs actions.
La tâche de l'éthique est également de former une attitude consciente envers la vie, de transmettre les valeurs morales développées par l'humanité aux nouvelles générations. Développer un nouveau type de moralité correspondant à la société post-industrielle, donner une analyse critique des systèmes éthiques existants, étayer la morale moderne comme un idéal du comportement moral des gens.
La connaissance éthique est un facteur important dans la formation de la culture spirituelle de la société et de la vision morale de l'individu. Sans connaissance éthique, la position morale de l'individu est soit imparfaite, soit vulnérable.
La compréhension des principes de l'éthique, la réflexion sur la nature de la loi morale, enracinée dans l'existence humaine en tant que partie de l'univers, est très importante dans le développement de la personnalité humaine. Aucun homme ne cherche à faire le mal pour le mal lui-même. Habituellement, tout le monde cherche à obtenir un bien, qui peut en fait s'avérer être un bien fictif (déformé), et les tentatives pour y parvenir entraînent des conséquences négatives. La tâche de l'éthique n'est pas de justifier la supériorité du bien sur le mal, du bien sur l'absence de bien. Sa tâche est d'aider une personne à comprendre ce qu'est le vrai bien et à trouver sa propre voie pour y parvenir.
L'éthique n'étudie pas ce qui arrive, mais ce qui devrait arriver. Il établit un lien logique entre les évaluations morales, révèle les lois selon lesquelles les jugements sont élaborés, destinés à guider les actions des personnes. Cela ne signifie pas que l'éthique élabore des recommandations précises sur la manière d'agir dans tel ou tel cas. Il formule des principes généraux sur lesquels des évaluations et des recommandations spécifiques peuvent être construites, servant de lignes directrices pour les actions, les évaluations morales, à l'aide desquelles les attitudes et les comportements des personnes sont vérifiés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux valeurs morales les plus élevées, à l'ordre moral et idéal. L'éthique explore en fait la logique des actions humaines dans un monde où existent des valeurs, y compris des valeurs absolues qui ne dépendent pas de circonstances particulières, c'est-à-dire morales.
La moralité peut être définie comme un ensemble de règles et de normes de comportement que les gens suivent dans leur vie. Ces normes expriment la relation des personnes entre elles, à un groupe social, à la société. En même temps, la caractéristique la plus importante de l'attitude morale est l'évaluation des phénomènes sociaux et du comportement humain du point de vue du bien et du mal, de la justice ou de l'injustice. À l'aide d'évaluations morales, ces relations et le comportement des personnes sont, pour ainsi dire, contrôlés quant à leur conformité aux valeurs morales les plus élevées, à l'ordre moral idéal.
La sphère de la moralité comprend les attitudes et les normes du comportement humain qui ont reçu un caractère stable universellement contraignant et forment les mœurs sociales. Non moins importante pour la moralité est la présence chez une personne de qualités et d'inclinations qui la rendent capable d'une vie morale - les «vertus». Ce sont des traits de caractère stables et des attitudes de valeur qui reflètent le besoin d'une personne pour les valeurs spirituelles, son respect intérieur pour l'ordre mondial moral, la capacité de se comporter de manière culturelle et responsable ; capacité de vivre selon sa conscience.
Nous pouvons dire que la sphère de la moralité comprend : les règles et les normes de comportement, les évaluations et les valeurs, les idéaux, les propriétés et les capacités d'un caractère humain, le comportement même des personnes. L'éthique, qui ne se limite pas à décrire et à exposer les règles de conduite et l'ordre moral du monde, mais cherche à le justifier, est confrontée au problème de trouver un fondement commun pour toute la variété des manifestations de la moralité, révélant l'essence du développement moral de réalité.
Qu'est-ce que le "bien", "l'humanité", la "vérité vitale", quel est le but d'une personne et son devoir moral, qu'est-ce qui rend la vie d'une personne significative et heureuse ? Selon la manière dont ces problèmes les plus importants de l'existence humaine sont résolus, les gens construisent leur vie dans d'autres domaines de la vie - en politique, en économie, dans la vie quotidienne.
En restant dans le cadre de sa propre conscience morale, il est impossible de répondre aux questions sur l'origine des idées des gens sur le bien et le mal, l'honneur et la conscience, d'où viennent les normes, les principes, les idéaux, qu'est-ce qui détermine leur contenu ? Pourquoi la compréhension mutuelle dans le domaine des évaluations morales est-elle si difficile ? Qu'est-ce qui détermine la nature différente et même contradictoire des positions morales des gens, et existe-t-il un critère fiable pour leur comparaison et leur évaluation ? Sur quoi les évaluations morales doivent-elles se fonder pour être justes ?
Les réponses à ces questions et à bien d'autres du domaine de la morale pratique découlent d'une compréhension commune de la nature de la morale, de sa spécificité, de sa place et de son rôle dans le processus de développement historique de la société et de l'homme. La connaissance scientifique de la morale, que l'éthique est appelée à fournir, est donc ici nécessaire.
Les phénomènes de crise liés au développement d'une civilisation existante, les problèmes mondiaux qui se sont déclarés haut et fort à l'humanité (environnementaux, démographiques, problèmes de guerre et de paix, de faim, de culture, etc.) peuvent être résolus par des personnes aux orientations humanistes qui s'efforceraient de construire la paix sur des valeurs morales universelles. Dans de telles conditions, le rôle du facteur moral dans toutes les sphères de la vie de la société et de l'homme s'accroît. Dans le passé, et encore aujourd'hui, il y avait et il y a encore de nombreux facteurs qui limitent l'action de la morale, ce sont, en particulier, les sphères de la politique, du droit et de l'économie. Ce phénomène n'a pas contourné l'Ukraine. La société ukrainienne, qui se transforme progressivement, doit renaître moralement. Par conséquent, aujourd'hui, la connaissance éthique devient une condition importante pour le développement de la culture spirituelle de la société et de la vision morale de l'individu, et de nouvelles exigences sont imposées à l'éthique.
Aujourd'hui, les sociologues, les politologues, les juristes s'intéressent à l'étude de la morale, ce qui fait naître la nécessité de développer davantage l'éthique dans les fondements philosophiques et idéologiques de l'étude de la morale. Les théories éthiques, tout en jouant un rôle méthodologique par rapport aux sciences sociales et humaines dans leur étude de la morale moderne, sont en même temps appelées à coordonner ces études. Sur le cette étape la tâche principale de l'éthique est la justification et la compréhension de la moralité en tant que phénomène humain universel, par opposition à la classe, nationale, corporative, en tant que base de base générique pour toutes les formes de vie.
Ainsi, la moralité est une sphère complexe de la vie spirituelle d'une personne et d'une société, la sphère de la culture spirituelle et fait l'objet d'une étude de l'éthique. L'éthique, au contraire, est la doctrine de la morale, de l'assimilation morale de la réalité par l'homme.
Dans la littérature de référence sur ce sujet, voir les articles :
Nouvelle encyclopédie philosophique. En 4 tomes - M., 2001. St. :
Morale, Ethique.
philosophique dictionnaire encyclopédique. - K., 2002. St. :
"Svidomiste moral", "Choix moral", "Etika".
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
UNIVERSITÉ TECHNIQUE D'ÉTAT DE NOVOSSIBIRSK
Faculté des affaires
Département d'économie de service
Résumé sur la discipline "Éthique et étiquette professionnelles"
Corrélation entre les notions d'"éthique", "moralité", "moralité"
Rempli par un étudiant
Golubova A.V.
groupe St-63
Vérifié par le professeur agrégé
Zagorskaïa L.M.
Novossibirsk, 2008
introduction
1. L'émergence de l'éthique.
2. Qu'est-ce que la morale ?
3. Le concept de moralité.
4. Moralité et moralité.
5. Éthique et morale.
6. La relation entre les concepts de "éthique", "moralité", "moralité".
Conclusion
Liste de la littérature utilisée
Sources d'informations supplémentaires
introduction
Les concepts de moralité, moralité, éthique sont l'un des plus courants dans la langue, et en même temps l'un des plus ambigus et indéfinis. Dans le même temps, les problèmes moraux semblent être l'un des plus importants pour une personne.
La question de l'essence de l'éthique, de la morale et de la moralité, ainsi que de leurs différences et interrelations, a été posée par de nombreux philosophes et penseurs, à commencer par Aristote.
Cette question demeure pertinent et à notre époque, du fait qu'actuellement en Société russe il y a une certaine « revalorisation des valeurs ».
objectif mon essai est d'établir la relation entre les concepts d'"éthique", de "moralité" et de "moralité".
je me suis fixé ce qui suit Tâches :
1. déterminer l'explication exacte de ces termes séparément ;
2. corréler ces concepts et révéler leur essence en interaction les uns avec les autres.
1. L'émergence de l'éthique
L'émergence de l'éthique en tant que système de normes morales ne peut être évoquée dans le même sens que l'on parle de l'émergence des sciences ou de la philosophie en général. L'éthique n'est pas créée par un intérêt théorique pour un domaine particulier de la réalité, comme la plupart des sciences, elle est conditionnée par le fait même de la vie sociale. La morale ne surgit pas dans la société humaine à un moment donné, mais lui est inhérente, sous une forme ou une autre, à tous les stades de son développement. Partout et à tout moment, la volonté d'une personne vivant dans une société de son espèce était liée par des normes morales au contenu le plus divers, ayant la forme de coutumes, d'institutions religieuses ou étatiques. En ce sens, la morale précède la connaissance et est même souvent un puissant stimulant pour son développement : c'est principalement dans le domaine de la morale que naît la pensée philosophique. La morale, reconnue d'abord comme un dû inexplicable, exige sa justification dans le temps, comme nécessaire pour atteindre les objectifs qui se révèlent à l'esprit. En même temps, la téléologie morale débouche inévitablement sur une ontologie philosophique : le « propre » s'éclaire à l'aide de la connaissance philosophique de l'« existant ». Malgré cette priorité de la morale dans le développement de la conscience humaine sociale et individuelle, les premières tentatives historiquement connues d'éthique scientifique surviennent relativement tard, déjà sur la base d'une cosmologie philosophique assez clairement définie. Si la morale, en tant que sagesse mondaine des législateurs sociaux, doit être reconnue comme ayant existé dans la plus haute antiquité, alors la morale, en tant que théorie philosophique, ne peut être établie qu'après Socrate.
2. Qu'est-ce que la morale ?
La morale (latin moralis - relatif à la morale) est l'un des principaux moyens de régulation normative des actions humaines. La moralité couvre les opinions et les sentiments moraux, les orientations et les principes de vie, les objectifs et les motifs des actions et des relations, tracer une ligne entre le bien et le mal, la conscience et l'impudeur, l'honneur et le déshonneur, la justice et l'injustice, la norme et l'anormalité, la miséricorde et la cruauté, etc.
Il y a un point de vue sur les fondements physiques de la moralité, la moralité est objective, c'est un ensemble de lois immuables de la Nature, dont le respect contribue au développement d'une conscience supérieure, et leur violation provoque une baisse de l'énergie vitale et une dégradation d'une personne. Cependant, cette opinion est loin d'être indiscutable et pratiquement infondée.
La morale vise l'uniformité de la régulation des relations et la réduction des conflits dans la société.
La soi-disant "moralité publique" - la moralité adoptée par une société particulière, en règle générale, est endémique à une culture ou à une période historique, parfois même à un groupe social ou religieux, bien que différents systèmes moraux puissent être similaires dans une certaine mesure .
Il est nécessaire de séparer les systèmes moraux idéaux (propagés) et réels.
La moralité se forme principalement à la suite de l'éducation, dans une moindre mesure - à la suite de l'action du mécanisme de l'empathie ou du processus d'adaptation. La moralité d'un individu, en tant que mécanisme subconscient impératif, ne se prête pas bien à une analyse critique et à une correction conscientes.
La morale est le sujet de l'éthique. Un concept plus large qui va au-delà de la moralité est l'éthos.
3. Le concept de morale.
L'approche critériologique de la catégorie de la moralité nécessite, tout d'abord, la réalisation d'une compréhension et d'une orientation dans l'espace de la vie et en général des critères naturels afin de construire un système d'évaluations des connaissances du plus haut niveau. Un tel désir est très difficile à réaliser, car la moralité elle-même est déjà un système d'évaluation de si haut niveau qui permet à l'humanité et à chaque individu de corréler pratiquement toutes les actions et pensées les unes avec les autres.
Lorsque nous essayons de comprendre ce concept, nous remarquons tout d'abord que dans le concept de moralité d'une manière particulière, sinon avec succès, la connaissance de la civilisation humaine sur l'idéal et la réalité est combinée : l'idéal attire la réalité à lui-même, la forçant changer selon des principes moraux.
En outre, cette catégorie, en tant que concept élargi, combine la cause profonde sociale essentielle des actions réelles des personnes : elles assument volontairement des responsabilités personnelles pour conformer leurs actions à certaines idées générales (mœurs générales) et pour corréler ces actions et leurs pensées avec les buts, objectifs, critères de société. . D'une manière différente, la vie se transforme en un jeu gagnant pour tous et pour tous.
Par conséquent, on ne peut parler de moralité que du point de vue des devoirs volontairement assumés par une personne envers la société ou envers cette Puissance Supérieure depuis l'espace de la Conscience de la Nature, qui correspond à l'idée générale, l'image de l'égrégore, Dieu, se tenant au-dessus de cette société et de cette personne. et qui conduit cette société et cette personne sur le chemin de la vie.
Il ne peut y avoir de moralité égoïste. Par conséquent, il est possible de supprimer le reproche du sens libéral (égoïste) selon lequel Jésus-Christ a apporté l'idéologie communiste à l'humanité : tout enseignement spirituel et moral, y compris ceux qui ont surgi avant Jésus-Christ, fait, avant tout, placer des évaluations de le sommet de la société. Et l'URSS s'est effondrée non pas du tout parce que l'idéologie communiste n'était pas viable, au contraire, elle n'avait pas assez de hauteur spirituelle, comme cela existe, par exemple, dans le confucianisme et le taoïsme.
Cependant, les égrégores, ainsi que les individus et les sociétés qu'ils dirigent, peuvent être de différentes hauteurs en termes de niveau de potentiel spirituel, et donc différents en termes de qualité, de force, de charge (positive-négative), d'étendue de couverture, etc. . Et donc, l'idée de Dieu d'une personne ne coïncide pas avec l'idée de Lui d'une autre, le Dieu personnel d'une personne ne coïncidera jamais avec le Dieu personnel d'une autre. Et bien que la hauteur spirituelle de l'égrégore de chaque personne soit évaluée, "mesurée", à partir de la hauteur de la morale générale par la morale, néanmoins, la compréhension de la morale dans personnes différentes différent. La morale est aussi relative que toute autre vérité.
Les problèmes de morale sont étudiés par l'éthique. Cependant, en parlant de différents types d'éthique d'entreprise, tout d'abord, il faut parler de moralité et non de moralité. Parce que la moralité est soit un ensemble de règles et de normes de comportement historiquement modifiables ou professionnelles, formulées par eux sur la base de leur expérience, de leur expérience spirituelle et relationnelle. La morale, d'autre part, agit comme une loi absolue (impérative) de l'attraction de l'esprit humain (I. Kant), et la simple éthique devient déjà une éthique spirituelle.
4. Morale et éthique.
En russe, il existe deux concepts liés - la moralité et la moralité. Quelle est la relation entre eux? En éthique, il y a des tentatives pour « dissoudre » ces concepts. L'idée la plus célèbre est celle de Hegel, qui rattachait la morale à la sphère du propre, de l'idéal, et la morale à la sphère du réel, du réel. Il y a une grande différence entre ce que les gens tiennent pour acquis et ce qu'ils font réellement.
Donner une définition de la "morale" ("moralité") est beaucoup plus difficile que de donner une définition de "l'éthique", qui tient à la complexité, à la multidimensionnalité du sujet lui-même. Nous pouvons distinguer les définitions suivantes, les plus généralement significatives de la "morale".
1) La moralité est « des qualités spirituelles internes qui guident une personne ; des normes éthiques, des règles de conduite déterminées par ces qualités. Dans cette définition, la moralité est réduite à certaines qualités spirituelles d'une personne, ainsi qu'à certaines normes et principes de comportement, c'est-à-dire à une certaine forme de conscience. Cependant, la dimension morale de la société, ainsi que l'activité morale pratique, ne sont pas correctement prises en compte ici. Par conséquent, dans l'éthique soviétique russophone des années 70 du XXe siècle, un autre concept plus large de moralité a été proposé.
2) La morale est une manière spéciale, impérative-évaluative, de maîtriser la réalité à travers la dichotomie (opposée) du bien et du mal. Le lien de ce concept de moralité avec une personne qui ne peut qu'évaluer et commander est évident. La morale est donc comprise comme une forme d'être subjective, bien qu'universelle pour une personne. Mais qu'en est-il de l'attitude envers la nature, peut-elle être morale ? Les êtres vivants autres que les humains ont-ils une valeur morale ? L'intuition morale répond positivement à ces questions, mais elles s'avèrent insolubles pour l'approche subjectiviste de la morale, qui ne rattache la morale qu'à la personne, aux relations interpersonnelles et sociales. Par conséquent, une définition encore plus large de la morale est légitime.
Envoyer votre bon travail dans la base de connaissances est simple. Utilisez le formulaire ci-dessous
Les étudiants, les étudiants diplômés, les jeunes scientifiques qui utilisent la base de connaissances dans leurs études et leur travail vous en seront très reconnaissants.
Hébergé sur http://www.allbest.ru/
introduction
Au sens originel, "éthique", "moralité", "moralité" sont des mots différents, mais un seul terme. Au fil du temps, la situation évolue. Dans le processus de développement culturel, en particulier, à mesure que l'identité de l'éthique en tant que domaine de connaissance se révèle, différentes significations commencent à être attribuées à différents mots : l'éthique désigne principalement la branche correspondante de la connaissance, de la science et de la moralité (moralité) - le sujet qu'il étudie. Il existe également diverses tentatives pour élever les concepts de moralité et d'éthique.
La science éthique étudie l'origine de la morale et de l'éthique, définit et justifie leur rôle dans la vie de la société, fournit une analyse critique des mœurs existantes et des régulateurs moraux des relations interpersonnelles.
L'éthique décrit non seulement les relations réellement existantes entre les personnes, mais cherche également à créer un idéal de ces relations, c'est-à-dire analyse non seulement ce qui existe, mais trace également les contours de ce qui devrait être. L'éthique s'efforce de justifier rationnellement les valeurs morales, bien que leur rationalisation rencontre inévitablement des difficultés, car ces valeurs sont associées non seulement à l'esprit d'une personne, mais également à ses sentiments, ses croyances et sa foi morale.
La moralité est la composante la plus importante de la culture, l'un des principaux moyens de réguler le comportement humain. Elle considère ces problèmes moraux qui se posent inévitablement devant chaque personne : quel est le sens de la vie et de la mort ; quelle est l'essence du bien et du mal et quels sont les critères de leur différenciation ; comment gérer la souffrance; comment évaluer les actions des personnes - par intentions ou par résultats ; quels sont les critères d'équité; quelle est la place de l'amour dans la vie humaine ; pourquoi l'altruisme est préférable à l'égoïsme ; si bon et utile sont compatibles, etc.
1. L'étude des notions d'"éthique" et de "morale"
1.1 Éthique
Le terme « éthique » vient du mot grec ancien « ethos » (« ethos »). Initialement, ethos était compris comme un lieu habituel de vie commune, une maison, une habitation humaine, un repaire d'animaux, un nid d'oiseau. Par la suite, il a commencé à désigner principalement la nature stable d'un phénomène, d'une coutume, d'une disposition, d'un caractère; ainsi, dans un des fragments d'Héraclite, il est dit que l'éthos de l'homme est sa divinité. Un tel changement de sens est instructif : il exprime le lien entre l'entourage d'une personne et son caractère. Partant du mot « ethos » au sens de caractère, Aristote a formé l'adjectif « éthique » pour désigner une classe particulière de qualités humaines, qu'il a appelées vertus éthiques. Les vertus éthiques sont des propriétés du caractère, du tempérament d'une personne, elles sont aussi appelées qualités spirituelles. Elles diffèrent, d'une part, des affects comme propriétés du corps et, d'autre part, des vertus dianoétiques comme propriétés de l'esprit. Par exemple, la peur est un affect naturel, la mémoire est une propriété de l'esprit, et la modération, le courage, la générosité sont des propriétés du caractère. Pour désigner la totalité des vertus éthiques comme un domaine particulier de la connaissance et pour mettre en évidence cette connaissance elle-même comme une science particulière, Aristote a introduit le terme « éthique ».
Le rôle de l'éthique en tant que science est actuellement très grand : elle doit analyser l'état moral de la société, montrer les raisons qui ont provoqué cet état, proposer des solutions qui contribueraient à mettre à jour les orientations morales de la société moderne.
L'éthique est l'une des plus anciennes disciplines théoriques dont l'objet d'étude est la morale. L'éthique surgit lors de la formation du système esclavagiste, se démarquant de la conscience morale spontanément ordinaire de la société comme l'une des principales composantes de la philosophie, comme une science « pratique » de la manière dont il faut agir, par opposition aux connaissances purement théoriques sur des choses.
Moralité, la moralité est l'une des formes les plus importantes de régulation du comportement humain, des relations interpersonnelles. Autrement dit, c'est une des formes de la volonté publique.
éthique moralité moralité tempérament
1.2 Morale
Il est intéressant de noter que le concept de « moralité » est un calque du concept d'« éthique ». Le mot latin "mos" (mos) est l'analogue sémantique du mot "ethos". Au pluriel, "mos" sonne comme "more" (mores).
Pour une traduction précise du concept aristotélicien d'éthique du grec au latin, Cicéron a construit le terme "moralis" (moral).
La morale est la forme la plus ancienne de la conscience humaine, ses rudiments sont déjà visibles dans le système primitif. La morale s'est formée dans le procès du travail, qui a toujours été un phénomène collectif. Toute la vie humaine dans la société primitive se déroulait au vu et au su du collectif. Et chaque type d'activité était justifié ou condamné par le collectif, dont la réaction au comportement de chacun avait un caractère réel, car le pouvoir de la majorité sur l'individu était illimité.
La moralité de la société primitive, bien sûr, était à un faible niveau de développement, elle justifiait le cannibalisme (cannibalisme) et le meurtre de personnes âgées, les vendettas et les châtiments cruels.
Avec le développement de la société et le changement de sa culture économique et sociale, la morale change aussi. Les relations morales ont subi une rupture radicale avec le passage à une société de classes. Si, sous le système primitif, les normes morales étaient les mêmes pour tous les membres de la société, alors avec l'émergence des classes, elles ont commencé à exprimer les intérêts de l'une ou l'autre classe. On sait que les classes vivent dans conditions différentes, occupent une place différente dans le système de production et de distribution des biens matériels, ce qui donne lieu à des intérêts et des points de vue différents sur la réalité environnante, sur le comportement humain. Chaque classe crée son propre système de morale, et dans une société il peut y avoir autant de systèmes moraux en même temps qu'il y a de classes en elle.
La moralité a également des éléments universels - des exigences nécessaires à toute classe. Ce sont les normes et règles dites « élémentaires » de la société humaine (politesse, respect des anciens, hospitalité, etc.). En améliorant ces normes et ces règles, l'humanité les transmet de génération en génération ; d'époque en époque.
Les principales spécificités de la morale sont :
1) impératif (ou obligation) (du lat. imperativ - à commander) - la propriété de la moralité d'exiger un certain comportement, c'est une indication de la façon dont cela devrait être.
2) l'universalité de l'exigence morale : la morale ne donne pas à une personne des recommandations spécifiques sur la façon d'agir dans chaque cas spécifique, mais formule ses exigences de manière universelle ("faites le bien", "aimez votre prochain comme vous-même", etc.), c'est-à-dire. ., conservant son fondement (la forme), les exigences morales se manifestent chaque fois de manière différente (le contenu change) selon les circonstances.
3) le désintérêt du motif moral (le non-pragmatisme du but moral) : seul un tel acte peut être considéré comme moral s'il est fait de manière désintéressée, sans exiger aucune récompense matérielle (lorsque le bien n'est pas fait pour le bénéfice, mais pour lui-même). Cette propriété de la moralité crée une perspective pour une personne développement spirituel l'élevant à leurs propres yeux.
4) causalité libre (déterminisme) : agissant comme cause des actions humaines et limitant ainsi sa liberté, la morale exige un comportement libre de la part d'une personne (si un acte n'est pas commis librement, il ne peut être reconnu comme moral). Ainsi, en morale, une personne n'est soumise qu'à une loi librement choisie (en dernière analyse, elle est sa propre loi). Bien librement choisi, qui est raison principale acte, libère une personne de l'intérêt personnel, de la peur, des conventions, des dogmes.
2. La relation entre les concepts d'"éthique" et de "morale"
Il est bien connu que les mots « éthique » et « moralité » ont un sens proche, interchangeables et souvent complémentaires. Une autre chose est un contexte philosophique et scientifique spécialisé: la nécessité d'une distinction claire entre éthique et morale n'est pas seulement due ici à l'orientation générale de la conscience théorique pour donner aux termes clés le sens le plus précis et individuel (sans recoupement avec d'autres termes) , mais aussi au fait que le brouillage des frontières sémantiques entre ces termes cache un certain nombre de problèmes méthodologiques non résolus (et parfois simplement non identifiés) qui finissent par plomber toute la problématique spécifique du champ de recherche concerné. Par conséquent, dans ce cas, la clarification des termes, c'est-à-dire une certaine rationalisation des outils de recherche est également associée à la formulation et à la justification d'une certaine approche de résolution de problèmes de plan plus général (savoir - valeur, structure de l'éthique, spécificités de la morale, etc.).
Le terme « éthique » vient du grec. etos (caractère, tempérament, disposition), qu'Aristote utilisait pour désigner une classe spéciale de qualités humaines (vertus éthiques), qui sont étudiées par une science spéciale - l'éthique.
Le terme « moralité » en termes d'histoire et de contenu est l'analogue latin du terme « éthique » : il vient du latin. moralis (caractère, disposition) et servait à désigner caractère moral une personne dont l'étude, selon le penseur romain Cicéron (IVe siècle après JC), devrait être étudiée par la science appelée "philosophie morale".
L'étymologie des concepts « éthique » et « morale » est du même type, ce qui explique leur interchangeabilité dans le langage courant. Au cours du développement de la culture, ils ont acquis des significations sémantiques différentes : l'éthique est une science dont l'objet est la morale.
Ces termes ont des racines gréco-latines communes ou, plutôt, étroitement entrelacées : le mot latin moralis est un calque de l'adjectif grec « éthique ». Néanmoins, derrière l'identité formelle des termes considérés, on peut remarquer dès le début des différences - très significatives - dans le contenu et la manière d'utiliser les termes considérés. Cette différence s'exprimait dans le fait que «l'éthique» et la «morale» étaient en fait utilisées pour refléter différents aspects de ce domaine vaste et multiforme de l'existence humaine, que les Grecs et les Latins appelaient respectivement «ethos» et «mos». (« mœurs ») et qui, en russe, est le plus étroitement véhiculé par les mots « mœurs », « coutumes », « caractères », etc. Dès son apparition (si nous prenons l'Éthique d'Aristote comme point de départ), l'« éthique » a été comprise comme une activité mentale spéciale, rationnelle-réflexive, spécialisée dans (et autour de) l'« éthos » existant, et l'activité est non seulement cognitif (c'est-à-dire décrivant et expliquant les coutumes réelles), mais aussi instructif de manière critique - ou axé sur les valeurs, pour utiliser une terminologie ultérieure ; dans le même temps, des dichotomies évaluatives telles que « bon - mauvais », « vertueux - vicieux », « juste - injuste », etc.. En fait, la « moralité » était initialement associée à des normes, des appréciations, des principes, des maximes exprimées dans ces notions ; cependant, si pour la « morale » ces normes spécifiques, idéaux, etc., formés dans la structure de l'éthos et réglant dans une certaine mesure le comportement humain, constituaient son corps même, alors « l'éthique » s'est développée précisément comme une discipline philosophique spéciale, comme discipline pratique. philosophie, elle fonctionnait avec des normes et des idéaux, construisait à partir d'eux des systèmes ou des codes basés sur quelques principes généraux ou sources, et proclamait ces systèmes comme des programmes de vie différents et concurrents.
Ainsi, la première démarcation (dans le temps et dans l'essence) des concepts d'éthique et de morale a été associée à la distinction, d'une part, des formes doctrinalement et (ou) disciplinaires d'enseignements de vie (qui ont reçu le nom d'éthique), et d'autre part, un ensemble de normes et de principes régulateurs particuliers, constituant le contenu d'enseignements éthiques et (ou) spontanément formés et fonctionnant dans les sociétés réelles (c'est-à-dire tout ce qui est le plus souvent désigné par le mot « moralité »).
Considérant la relation entre l'éthique et la morale, il est nécessaire de clarifier d'abord le concept d'éthique, car une partie du conglomérat que l'on appelle communément ce mot fait partie de la morale elle-même, tandis que l'autre composante est la connaissance (ou la science) du phénomène. de la morale. Le fait que l'éthique formée historiquement comprenne ces deux parties trouve son expression dans les définitions modernes de l'éthique, fixant son double statut de « philosophie pratique » et de « science morale ».
Il existe d'autres perspectives théoriques dans lesquelles l'éthique et la morale peuvent être comparées. Ainsi, dans l'encyclopédie anglo-américaine en un volume sur l'éthique, dans un article spécial consacré à la question à l'étude, la différence entre l'éthique et la morale se voit dans le fait que la première comprend des principes universels, fondamentaux, immuables, qui expriment le plus important valeurs et croyances de l'individu et de la société, tandis que la seconde contient des règles plus spécifiques et variables à travers lesquelles ces principes généraux sont mis en œuvre.
Une interprétation plus approfondie de la relation entre l'éthique et la moralité est donnée dans une autre encyclopédie de langue anglaise, qui contient également un article sur ce sujet. L'article soutient que "l'éthique est un concept plus large" que la moralité et "comprend beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la moralité". En ce sens, "l'éthique (surtout ancienne) constitue une alternative à la morale : elle n'a pas les traits étroits caractéristiques de la morale, bien qu'elle touche toujours à des questions morales, à savoir comment nous devons vivre et ce que nous devons faire".
Le sens de cette affirmation est que les chemins historiques de l'éthique et de la morale ont divergé au fil du temps : « l'éthique » (si l'on laisse de côté ses fonctions supplémentaires de description et d'explication du phénomène moral évoqué ci-dessus) est encore comprise comme philosophie pratique, enseignement de la vie, c'est-à-dire prêcher et protéger certaines valeurs positives, dénotées par les mots « bien », « devoir », « bonheur », « amour », etc. ; le concept de moralité a été rétréci et précisé, de sorte que tout ce qui est « bon » et « convenable » n'a en aucun cas le statut de moralement bon et convenable.
En d'autres termes, l'une ou l'autre doctrine éthique peut ne pas être morale dans son orientation sur les valeurs, elle peut déclarer certaines valeurs extramorales, y compris celles qui contredisent les normes morales généralement acceptées.
La trop grande proximité substantielle des concepts d'« éthique » et de « morale » qui a été conservée dans le langage moderne de la philosophie et de la science, qui se manifeste notamment dans le fait que « l'éthique » est presque toujours définie par la « morale » , conduit, d'une part, à un rétrécissement injustifié du sujet de l'éthique. , et d'autre part, à une interprétation large tout aussi injustifiée de la morale, à l'estompement de sa spécificité.
Conclusion
En conclusion de l'épreuve, on peut noter que l'éthique est l'une des plus anciennes disciplines théoriques dont l'objet d'étude est la morale.
L'éthique est née lors de la formation du système esclavagiste, se démarquant de la conscience morale spontanément ordinaire de la société comme l'une des principales composantes de la philosophie, comme une science "pratique" de la façon dont il faut agir, par opposition à la connaissance purement théorique des choses.
La moralité est un ensemble de normes, de valeurs, d'idéaux, d'attitudes qui régissent le comportement humain et sont les composantes les plus importantes de la culture.
Avec le développement de la société et le changement de sa culture économique et sociale, la morale change aussi. Les relations morales ont subi une rupture radicale avec le passage à une société de classes. Si, sous le système primitif, les normes morales étaient les mêmes pour tous les membres de la société, alors avec l'émergence des classes, elles ont commencé à exprimer les intérêts de l'une ou l'autre classe.
Dans la question de la relation entre les concepts d'« éthique » et de « morale », on peut noter ce qui suit : éthique et morale ont un sens proche, interchangeables et souvent complémentaires ; ont des racines gréco-latines étroitement entrelacées.
Mais derrière l'identité formelle de ces termes, on peut remarquer une différence très significative, exprimée dans le fait que "l'éthique" et la "morale" étaient en fait utilisées pour afficher différents aspects du domaine de l'existence humaine.
Les chemins historiques de l'éthique et de la morale ont divergé au fil du temps : « éthique » signifie la prédication et la protection de certaines valeurs positives, dénotées par les mots « bien », « devoir », « bonheur », « amour », etc., et le concept de la moralité rétrécie, de sorte que tout ce qui est "bon" et "dû" n'a pas le statut de moralement bon et convenable.
Bibliographie
1) Apresyan R.G., Huseynov A.A. Ethique: Manuel. - M. : Gardarika, 1998. - 472 p.
2) Huseynov A.A., Dubko E.L. Ethique: Manuel. - M. : Gardariki, 1999. - 496 p.
3) Kruglyanitso T.F. Éthique. Tutoriel expérimental. - M. : AZ Publishing Center, 1997. - 96 p.
4) Kuzmenko G.N. Ethique: Manuel. - M. : INFRA-M, Maison d'édition "Ves Mir", 2002. - 144 p.
5) Maksimov L.V. Éthique et morale : corrélation des concepts // Pensée éthique. Publier. 4. M. : IFRAN, 2003.
6) Strezhneva T.V. Support pédagogique pour le cours "Ethique". - Minsk : MITSO, 2003. - 80 p.
7) Frolov I. T. Dictionnaire philosophique. - 5e éd. - M. : Politizdat, 1987. - 590 p.
Documents similaires
L'éthique est une science qui étudie la moralité et la moralité - des concepts qui ont un sens proche, mais qui ne sont pas synonymes et qui ont des significations, des fonctions et des tâches différentes. Corrélation des concepts "éthique", "moralité", "moralité".
résumé, ajouté le 20/05/2008
Le sujet de l'étude de l'éthique. L'origine et le contenu des concepts d'"éthique", de "moralité", de "moralité". La structure de la connaissance éthique. La relation de l'éthique avec les autres sciences qui étudient la morale. Idées éthiques du monde antique. Histoire de la pensée éthique en Ukraine.
aide-mémoire, ajouté le 12/06/2009
Caractéristiques de l'origine et de la corrélation des concepts d'éthique, de moralité, de moralité. Le sujet et les caractéristiques de l'éthique en tant que science. Essence et structure de la morale, son origine. Types historiques de morale. Fonctions fondamentales de la morale. Le concept de subconscient moral.
présentation, ajouté le 03/07/2014
Éthique, morale et moralité. La dimension morale de l'individu et de la société. Caractéristiques du fonctionnement de la morale. La non-violence comme interdit moral catégorique. L'unité de la morale et la diversité des mœurs. Le paradoxe de l'évaluation morale et du comportement moral.
dissertation, ajouté le 20/05/2008
Éthique et morale dans le monde. L'opinion publique et au niveau de la conscience. L'éthique classique et la preuve de la conscience morale. Le passage d'une apologie prédominante de la morale à sa critique prédominante. Absolutisme et antinormativité dans leurs versions modernes.
résumé, ajouté le 05/06/2009
L'essence de concepts fondamentaux tels que "éthique", "moralité", "moralité". La norme est une cellule élémentaire de la morale. Principes moraux et leur rôle dans l'orientation du comportement moral d'une personne. Idéaux et valeurs : le niveau supérieur de la conscience morale.
travaux de contrôle, ajouté le 20/12/2007
L'éthique comme science philosophique dont l'objet d'étude est la morale. Trois catégories de sciences selon Aristote. Approfondir et changer les idées sur l'idéal moral d'une personne. La morale comme état subjectif.
travaux de contrôle, ajouté le 13/06/2007
L'origine des termes "éthique", "moralité", "moralité". Caractéristiques des enseignements éthiques de l'ère antique. La morale comme domaine de la vie publique. Développement de normes de comportement humain dans le processus de développement de la société. Aspects spirituels et pratiques de la morale.
résumé, ajouté le 12/07/2009
L'éthique professionnelle en tant que partie appliquée et spécialisée de l'éthique. Corrélation entre les notions d'"éthique", "moralité", "moralité". Le rôle et la place de l'éthique professionnelle dans la formation de la vision du monde et des valeurs des forces de l'ordre.
test, ajouté le 28/08/2009
L'éthique comme doctrine de la morale, de l'assimilation morale de la réalité par une personne. La moralité en tant que moyen spirituel-pratique spécial et précieux de maîtriser le monde. Ses principales fonctions et propriétés. Le système des catégories de l'éthique, reflétant les éléments de la morale.
ISBN 978-5-89428-391-3
Cette édition (livre un) traite des thèmes principaux du cours d'éthique : le sujet, les caractéristiques de la régulation morale, la structure de la conscience morale, l'histoire de la morale, les catégories éthiques du bien, du mal, de l'amour, de la conscience, etc. La connaissance des questions éthiques contribue au développement d'une vision du monde et d'une attitude moralement orientées, visant à l'amélioration de soi et au développement de la capacité à faire de bonnes actions, à aimer et à se contrôler consciencieusement. Le manuel présente un large éventail de points de vue et d'évaluations de penseurs de la culture mondiale et nationale. Pour chaque sujet, un atelier éthique a été développé, dont les tâches sont conçues principalement pour le travail individuel du lecteur.
L'auteur remercie le personnel du Département de philosophie et sciences sociales pour une discussion attentive et critique de l'ouvrage. Des remerciements particuliers sont dus à N.S. Barkovskaïa et A.G. Shamakhanov pour la morale et aide financière dans la préparation de cette publication.
Le manuel "Éthique" est destiné aux étudiants, étudiants diplômés, jeunes enseignants, enseignants.
Éditeur : Dr. philosophie, sciences, professeur N.N. Chevtchenko
Réviseurs :
Docteur en Philosophie, Sciences, Professeur N.N. Karpitsky
Docteur en Philosophie, Sciences, Professeur N.A. Lyurya
Professeur S.I. Anoufriev
Candidat, Philosophie, Sciences, Assoc. L.V. Kotlikova
Partie 1.
1. Éthique. Moralité. Moral
2. Caractéristiques de la régulation morale
3. Individu, personnalité, individualité
4. Niveaux de conscience morale
4.1. conscience égocentrique
4.2. conscience centrée sur le groupe
4.3. En fait, le niveau moral de conscience
4.4. Le plus haut niveau (spirituel-religieux) de conscience morale
Partie 2. L'histoire de la morale
1. Le tabou est le plus ancien impératif moral
1.2. Reconstruction mythologique du tabou
1.3. L'état actuel du phénomène tabou
1.4. Tabou comme interdiction de tuer
2. La pitié, la compassion comme source de moralité
3. Rituel. Sacrifice
4. Don.
6. La règle d'or de la morale
7. Codes moraux anciens. Commandements de Moïse
8. Commandement chrétien de l'amour
9. Éthique de la non-violence.
Partie 3. Catégories éthiques
1. Le bien et le mal
2. Réflexion éthique et philosophique du mal. La dialectique du bien et du mal
3. Généalogie du mal. Approches non philosophiques
3.1 Théorie du "gène égoïste"
3.2. Le mal comme souffrance infligée
3.3. La source du mal est les superanimaux et les suggesteurs
3.4. Le mal engendre l'agressivité
3.5. La nature du mal dans le contexte du phénomène de pouvoir
3.6. Complexe altruiste congénital comme capacité à faire de bonnes actions
5. Conscience
5.1. Le concept de honte, tourment et remords, remords
5.2. Origine de la conscience
Littérature
Plan-perspective du deuxième livre
PARTIE 1
Objet et concepts de base de l'éthique
Éthique. Moralité. Moral
S'il y a une science vraiment nécessaire à une personne, alors c'est celle que j'enseigne - à savoir, comment occuper correctement la place indiquée dans le monde - et à partir de laquelle on peut apprendre ce qu'il faut être pour être une personne.
I.Kant
Que suis-je et quelle est mon attitude envers le monde infini ? ... comment puis-je vivre, que dois-je considérer toujours, dans toutes les conditions possibles, comme bon et qu'est-ce qui devrait toujours et dans toutes les conditions possibles être mauvais ?
LN Tolstoï
Toutes les pensées intelligentes ont déjà été repensées.
Le point, cependant, est qu'ils sont toujours nécessaires
repenser à nouveau.
I. Goethe.
L'éthique est la science philosophique de la morale. Donnons d'abord quelques définitions de l'éthique, et considérons ensuite sa nature philosophique. Le philosophe des Lumières Holbach appelait l'éthique la science des relations entre les personnes, des devoirs découlant de ces relations. Le philosophe russe N. Lossky définit l'éthique comme la science du bien et du mal moral et leur réalisation dans le comportement humain. Il explore le but ultime de la vie d'une personne et son comportement, dans la mesure où il conduit à l'atteinte de ce but ou à une déviation de celui-ci. Ces définitions seront remplies d'une signification et d'une compréhension plus profondes après s'être familiarisées avec les concepts éthiques les plus élémentaires. Arrêtons-nous donc sur le contenu des principaux concepts : éthique, moralité, moralité.
Le terme « éthique », qu'Aristote introduit dans l'usage scientifique, remonte au mot grec « ethos », qui signifie une manière d'être, un code unique, l'ordre comme expression de l'ordre cosmique et l'ordre dans l'existence d'une personne, sa vie, dans sa maison, enfin. C'est la loi d'être des anciens grecs aussi bien dans la famille que dans l'agora, lieu de la vie sociale. Des racines étymologiques conduisent à désigner par ce concept une habitation en général, un repaire, un lieu de vie, etc. DANS science moderne avec(coutume, tempérament, caractère) - une caractéristique généralisée de la culture d'un grand groupe social ou d'un individu, exprimée dans le système de valeurs dominantes et de normes de comportement. À tout moment, chaque nation a sa propre éthique. A titre d'exemple, prêtons attention aux commandements de Moïse, aux paraboles, au folklore, ils contiennent toujours les règles selon lesquelles les gens vivent. « Ethos est la reconnaissance, dans les formes historiquement changeantes de l'existence humaine, d'un certain permanente, immuable, quelle que soit l'époque contenu ce qui rend une personne reconnaissable en tant que personne. Ethos est un besoin humain incontournable de communication, le besoin de pouvoir communiquer avec d'autres personnes, la capacité d'organiser et de maintenir des liens, c'est-à-dire réglementer la communication. Le monde humain en ce sens est doté d'un certain ordre, qui se retrouve dans l'ethos sous la forme de normes morales, de traditions. Nous devrons nous référer plus d'une fois à ce sens profond - « ethos », notons que de nombreux termes de la science moderne lui sont associés : éthique, étiquette, éthologie (la science du comportement animal), ethnos, ethos (nous obtiendrons familiariser avec ce concept plus tard).
Chaque science a un objet de connaissance - c'est le champ des phénomènes que cette science explore, et le sujet, qui comprend un ensemble de questions et de problèmes liés à la nature des phénomènes étudiés, aux caractéristiques de leur fonctionnement, etc. processus de recherche de réponses à ces questions, leur analyse, il est nécessaire notions scientifiques, à l'aide desquels les idées principales de cette science sont exprimées. L'éthique étudie toute la sphère des relations humaines, qui sont soumises à une évaluation morale. Le sujet de l'éthique porte sur les questions de l'émergence, du développement, du fonctionnement de la morale ou de la morale - c'est à la fois le domaine des phénomènes dans le monde des relations humaines et les concepts de base de la science de l'éthique.
Nous définissons la morale comme un ensemble de principes, de normes, d'habitudes qui régissent la relation des personnes dans la société en termes de bien et de mal. L.N. Tolstoï dans une de ses lettres à N.N. Miklouho-Maclay a écrit que "la moralité est la science de la façon dont les gens vivent, faisant le plus de bien possible et le moins de mal possible". La moralité peut être considérée comme un synonyme de moralité. mot russe moralité et mos latin - tempérament, mœurs - morale - concepts qui coïncident dans le contenu. Évidemment, les concepts de moralité et de moralité sont étymologiquement liés, mais il existe une tradition de distinction quant à leur contenu dans l'éthique comme science philosophique. Hegel dans son ouvrage "Philosophie du droit", conformément à la logique de sa philosophie, distingue la morale et la moralité comme des étapes de développement et d'expression de l'idée absolue. En science éthique domestique, certains chercheurs pensent que la morale est un ensemble de principes et de normes contenus dans la conscience publique d'une ère culturelle, une entité sociale majeure, ses principes et exigences dépendent de l'état des groupes sociaux dans la société, et la morale est un domaine de pratique, la sphère des actions humaines individuelles , le domaine du monde personnel d'une personne. C'est dans cet espace que s'effectuent l'installation, le motif (conducteur, du latin motif - pousser), l'évaluation de l'activité qui, en fait, sont des éléments de la structure de l'acte. La morale elle-même est la vie, plus précisément la sphère de la vie liée aux affaires humaines. Une personne fait quelque chose - et crée la moralité. Il le crée même lorsqu'il influence les actions d'autres personnes ; où la pratique précède la théorie.
Il y a la position du culturologue moderne S. Averintsev, qui s'est abstenu, selon ses propres termes, d'essayer d'opposer profondément « éthique », « morale » et « moralité », estimant qu'étymologiquement il s'agit absolument du même concept, seulement exprimée d'abord en grec, puis en latin et enfin en racine slave. "Dans le mot latin pour l'oreille russe, il y a un arrière-goût de" mentalité ", explique S. Averintsev. Il relie la moralité à la conscience et poursuit : « Je dirais ceci : la conscience ne vient pas de l'esprit, elle est plus profonde que l'esprit, plus profonde que tout ce qui est dans une personne, mais afin de tirer des conclusions pratiques correctes de la grêle de la conscience. , l'esprit est nécessaire. La morale devrait être le médiateur entre la conscience et l'esprit. La conscience est profondeur, l'esprit est lumière ; il faut de la moralité pour que la lumière éclaire la profondeur.
Il nous semble que la différence entre les concepts de morale et de moralité est la suivante : dans le cadre de la société, dans les liens et les relations sociales, les normes et les exigences de la morale fonctionnent, par exemple, des codes, et là où une personne est pensée en toutes les "profondeurs existentielles", dans l'univers cosmique, dans les relations futures avec l'Absolu (Dieu), le concept de moralité est applicable (comme l'a noté Hegel : dans le langage de la morale, une personne communique avec Dieu).
Ainsi, l'éthique est une science, un domaine de connaissance, une tradition philosophique, une expérience philosophique dans l'étude de la moralité, de ses formes changeantes et du comportement moral des personnes. L'éthique forme des modèles de moralité qui devraient contribuer à un bon objectif dans les motifs des actions humaines, explore la nature des exigences morales, la raison de l'écart constant entre ce qu'une personne fait (existant) et ce qu'elle devrait faire (dû). Vl. Solovyov dans la préface de son ouvrage "Justification du bien" signifie l'objectif de l'éthique comme savoir pour l'action. Il compare la philosophie morale à un guide qui décrit des lieux remarquables, mais ne dit pas à une personne où aller, car l'être humain a déjà les fondements primaires (conscience, pitié, révérence) pour déterminer le but moral de ses actions. En ce sens, l'éthique est une science au plus haut degré. pratique, il est nécessaire précisément pour la pratique de la vie, en premier lieu.
L'éthique cherche des réponses aux questions : à quoi sert la morale ? comment et quand est-ce arrivé ? Les idées morales des gens changent-elles dans le processus de développement historique et dans quelle direction ? Autrement dit, y a-t-il progrès moral, est-il possible que le bien triomphe du mal ou, au contraire, le mal est-il si profondément enraciné dans l'homme qu'il n'y a pas lieu d'être optimiste ?
La philosophie morale a toujours été la partie la plus tortueuse de tout type de philosophie, parce que les questions « maudites » du sens, de la valeur de l'existence de chaque personne et de l'humanité dans son ensemble ne sont pas pleinement comprises ; chaque époque, chaque philosophe, chaque personne qui pense à elle-même a le droit de choisir son propre point de vue, de suivre ceux qu'elle comprend et partage. Le philosophe russe S. Frank dans son ouvrage "Le sens de la vie" écrit que "cette question n'est pas une" question théorique ", pas le sujet d'un jeu mental oisif, cette question est une question de la vie elle-même, c'est tout aussi terrible et, en fait, bien plus terrible que dans le besoin sévère la question d'un morceau de pain pour satisfaire la faim. Une place particulière dans le système de connaissances éthiques est occupée par le monde intérieur d'une personne inextricablement lié à son contenu mental et spirituel, et donc par l'étude des «conditions d'émergence des actions morales dans l'âme» (note un autre philosophe russe KD Kavelin) est inclus dans le contenu du sujet de l'éthique.
L'éthique se pose en ligne avec la philosophie ancienne et est son début de contenu spécial. Cette grande et significative philosophie jusqu'à aujourd'hui est née précisément en relation avec la formulation des problèmes éthiques du sens et de la valeur de la vie humaine. « La philosophie est ce qui appelle à conduire inlassablement la science à la sagesse, les concepts aux idées, la raison à la raison. Mais pour cela, l'amour est nécessaire, et le plus désintéressé, le plus pur, le plus doux et le plus saint est l'amour de la vérité. Et un tel amour est quelque chose de moral. Cela veut dire que la philosophie est aussi une matière morale, et tout ce qui s'appelle philosophie, mais n'est pas possédé par une idée morale, est soit une pseudo-philosophie, soit seulement un instrument de la philosophie, et non la philosophie elle-même. Et encore: "La philosophie est née en Grèce en réponse au besoin moral d'évaluer de manière critique la véritable dignité de l'homme dans le monde."
Presque tous les grands penseurs de l'histoire de l'humanité ont été impliqués dans l'éthique. Si nous suivons la position ci-dessus, alors il faut reconnaître que ce sont les questions éthiques du sens de la vie, un mode de vie digne qui ont été la source de philosopher et toujours coprésenter dans tout système philosophique quelque peu intégral comme une connaissance orientant les valeurs et donnant du sens. Prenons par exemple les fameuses questions kantiennes : « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire? Que puis-je espérer ? Une personne répond à ces questions toute sa vie et toute sa vie, il est clair qu'avec divers degrés profondeurs, mais le besoin d'être responsable de soi inséparable de l'homme. Le philosophe est "chargé" de ces questions dans leur intégralité - son enseignement et sa vie deviennent une variante de la réponse à celles-ci.
Notre philosophie domestique en tant que forme de conscience de soi russe, apparue bien plus tard que l'ancienne et l'européenne, se caractérise le plus clairement par la présence d'un contenu moral profond tout au long de son existence. Philosophe N.O. Lossky a déclaré que la morale dominante du peuple russe était la "recherche du bien absolu", qui déterminait non seulement l'originalité de la créativité morale et éthique de la pensée russe, mais aussi une vision générale du sens socio-historique de la vie en général . "Le peuple russe", souligne Lossky N.O., "possède une distinction particulièrement sensible entre le bien et le mal, il remarque avec vigilance l'imperfection de nos actions, de nos mœurs et de nos institutions, ne s'en contentant jamais et ne cessant de rechercher la bonté parfaite".
Plus loin (livre 2, partie 1) nous nous attarderons sur les caractéristiques de l'éthique en tant que science, dont nous voyons la tâche principale dans désignation d'un mode de vie moral, dans la réflexion de ce point de vue de la pratique de la vie, et maintenant nous allons considérer sous la forme la plus générale les significations significatives de la morale (ou de la morale).
Quand il sera clair ce qu'est la vraie moralité, alors tout le reste sera clair.
Confucius
Déjà dans l'Antiquité, la compréhension de la morale (qui est l'essence de la morale et de l'éthique) commence comme mesures de la domination de l'homme sur lui-même, mesures de sa responsabilité pour ses actes. La question de la domination de l'homme sur lui-même est d'abord la question de la domination de la raison sur les passions. La moralité, comme le montre l'étymologie du mot (tempérament, tempérament), est associée au caractère, au tempérament. Si dans la nature humaine, nous distinguons le corps, l'âme et l'esprit (esprit), alors la moralité devient une caractéristique qualitative de l'âme, qui a été étayée par Aristote. En même temps, sous l'âme, il a compris un tel principe actif actif-volontaire chez une personne, qui contient des parties raisonnables et déraisonnables et représente leur interaction, leur interpénétration, leur synthèse.
L'expérience des jugements éthiques est née bien avant l'avènement de la science éthique, puisque les hommes ont toujours eu la nécessité d'harmoniser les intérêts et les actions, de définir les responsabilités envers les autres membres de la société ; dans le respect de certaines normes de conduite. En d'autres termes, on peut dire que les gens ont toujours ressenti le besoin de tels comportements, de telles règles qui réglementer la vie de la communauté humaine du point de vue de sa préservation et d'assurer la possibilité de développement, tant de la vie d'un individu que de la société tout entière.
Désignons ce besoin comme une caractéristique fondamentale et systémique d'un être humain en développement. Si nous imaginons la société humaine comme un système dynamique qui se développe lui-même, nous devons trouver en elle de tels mécanismes de régulation qui soutiennent, d'une part, son intégrité, et d'autre part, la mobilité, la capacité de changer, et si les changements sont dirigés, ordonnés, alors le système sera capable de développement. Les mécanismes de régulation s'avèrent donc être le contenu interne et nécessaire des processus sociaux, et chaque élément de l'organisation sociale (système) est aussi nécessairement inclus dans les processus de régulation, les inclut dans sa nature interne. Dans la science moderne de l'auto-organisation (synergie), il existe un concept - l'entropie. Dans les processus sociaux, l'entropie signifie une mesure de l'ordre et du désordre du comportement des éléments dans le système (de l'ordre absolu au chaos). Les deux se révèlent être des états polaires extrêmes du système. Les états absolus de chaos ou d'ordre rendent le système non viable. Le chaos absolu, le désordre, l'arbitraire des éléments du système le ruinent tout simplement, tout comme des éléments rigidement ordonnés entravent son développement, son auto-mouvement - par conséquent, le système a besoin d'une certaine liberté de mouvement éléments individuels. Par conséquent, les mécanismes qui régulent les processus d'entropie sont appelés anti-entropie et s'avèrent nécessaires; de plus, ce sont ces mécanismes qui fournissent une mesure d'ordre et de liberté, l'arbitraire du comportement des éléments du système.
Dans la société, ce sont des lois réglementaires qui assurent son existence, son intégrité et son développement, grâce à la présence de la liberté de comportement d'un individu et son respect de l'ordre, des règles, des lois généralement établis, finalement. Les composantes régulatrices de la société comprennent : les lois morales, religieuses, esthétiques, juridiques, économiques, politiques, elles sont constructions d'établissement d'objectifs et de formation de sens activités d'une personne, des groupes sociaux, de la société tout entière. L'intelligence humaine, les connaissances, l'équipement technique sont les principaux installations lutter contre l'entropie.
Tout d'abord, la morale et le droit appartiennent aux mécanismes régulateurs propres. Ce sont des formes profondément interconnectées de régulation du comportement et des attitudes des gens. Si la morale est un régulateur « interne » du comportement humain, fondé sur la conscience, la responsabilité personnelle, alors la loi est un régulateur exclusivement externe par rapport à une personne (l'ignorance de la loi n'exonère pas une personne de sa responsabilité juridique). L'ordre moral, la loi, est créé par les efforts internes subjectifs des personnes, car une personne n'est pas un instrument, mais a la liberté de choix (cela sera discuté plus en détail ci-dessous). La liberté est la condition principale pour qu'une personne acquière l'individualité, l'estime de soi, l'estime de soi, le droit de créer l'être. Nous soulignons une fois de plus que c'est la présence de la liberté interne qui rend le système mobile et capable de développement.
La régulation juridique se fonde sur un besoin objectivé et institutionnellement structuré de ordre publique dans le respect par tous les membres de la communauté des normes de l'être. Contrairement au respect exclusivement volontaire des exigences morales, le respect des normes juridiques est contrôlé par l'autorité publique (par exemple, l'État) et repose sur la coercition. Le droit, en tant que produit du développement culturel et civilisationnel, "émane" de la "common law" - l'étape historique de la moralité (par exemple, le talion, qui fera l'objet d'une description détaillée dans la deuxième partie). Notons que la morale est « plus ancienne » que la loi dans sa primogéniture historique. La régulation morale a toujours existé dans la société (tabou, talion, règle d'or morale, etc.), puisqu'elle est « une ligne qui sépare la communauté animale de la communauté humaine » (Ch. Darwin), et en ce sens est une caractéristique générique et essentielle de l'homme et de l'humanité.
Les exigences éthiques pour une personne sont beaucoup plus élevées que les exigences juridiques, car elles sont axées sur un idéal moral, sur ce qu'il devrait être du point de vue de la justice supérieure.. Les normes juridiques fixent le niveau concret et historique de réalisation de l'idéal. La morale condamne toute manifestation de malhonnêteté, de malhonnêteté, de cupidité, etc., et la loi n'en supprime que les manifestations les plus malveillantes et socialement dangereuses. « L'autorité des lois morales est infiniment supérieure », dit Hegel. Désignons la position de Hegel sur ce point.
Dans L'Esprit du christianisme et son destin, Hegel critique les pratiques sociales et juridiques de la société juive et romaine : reconnaissant l'influence civilisatrice des lois sociales et juridiques et des institutions du pouvoir, il constate en même temps l'absence formelle de législation, qui consiste à dans la mondialisation de l'intérêt privé et dans la subordination individuelle générale. L'imperfection morale de la loi se manifeste dans le mécanisme du crime et du châtiment. L'exécution de la loi non seulement ne rétablit pas la justice, mais conduit également à sa double violation: d'abord, le contrevenant franchit la ligne de la loi, puis le bourreau rejette le commandement suprême "Tu ne tueras pas", empiétant sur la vie humaine . Seuls l'amour, le pardon et la réconciliation peuvent rétablir la justice morale.
Hegel a écrit : « Une personne dont l'âme s'est élevée au-dessus des relations légales et n'est soumise à rien d'objectif n'a rien à pardonner à l'offenseur, car il n'a en aucune façon affecté ses droits ; dès que quelqu'un empiète sur l'objet du droit, il renonce immédiatement à ce droit. L'âme d'une telle personne est ouverte à la réconciliation, car elle peut immédiatement rétablir tout lien vivant, entrer à nouveau dans une relation d'amitié et d'amour. Un délit amène un châtiment, un crime un bourreau. Tel est le jeu de la "justice" sociale, qui ne laisse aucune place à la restauration des relations humaines dans la société.
Plus les lois seront scrupuleuses et plus les structures de pouvoir seront fortes, plus le volume des doléances et des revendications mutuelles augmentera, plus le niveau de tension sociale devrait s'élever. Il est important pour nous d'insister sur cette idée car toute discussion sur une société juridique, sur le renforcement de la régulation juridique ne doit pas occulter le fondement éthique dans le système de régulation des relations humaines.
Dans la philosophie russe, deux points de vue sur la relation entre le droit et la morale sont connus. D'un certain point de vue, on pense que la loi est une «morale légalement formalisée»: bien que toutes les normes morales, mais socialement significatives, ne soient pas exprimées dans les normes de la loi, la loi est donc la «limite inférieure» ou le «minimum de moralité» ( Vl. Soloviev). On suppose qu'il ne devrait pas y avoir de contradictions entre les normes du droit et les normes de la morale, bien que l'espace moral soit plus large que l'espace juridique, loin de tout ce qui est condamné par l'opinion publique comme un acte immoral est un acte qui viole les normes juridiques et est punissable en conséquence.
S'opposer à Vl. Soloviev, E.N. Trubetskoï écrit : « Il existe de nombreuses normes juridiques qui non seulement ne représentent pas un minimum de moralité, mais, au contraire, sont hautement immorales. Ce sont, par exemple, servage, lois établissant la torture, exécutions, lois restreignant la liberté religieuse. En outre, il existe de nombreuses normes juridiques qui ne contiennent ni contenu moral ni immoral, sont moralement indifférentes: telles sont les réglementations militaires, les règles sur le port des ordres, les lois établissant la coupe des uniformes pour divers départements. Enfin, l'exercice même du droit n'est nullement toujours conforme à la morale : un même acte peut être irréprochablement légal, correct d'un point de vue juridique, et en même temps totalement immoral... Tout ce qui vient d'être dit suffit amplement à montrer que la loi ne peut en aucun cas être définie comme un minimum de moralité. Tout ce que l'on peut dire, c'est seulement que la loi dans son ensemble doit servir des objectifs moraux. Mais c'est l'exigence d'un idéal, auquel la réalité ne correspond pas toujours, et contredit souvent directement.
A notre avis, on ne peut ignorer la position de Vl. Solovyov et E. Trubetskoy, réalisant que la loi elle-même apparaît comme une forme de protection de la propriété privée (Rome antique), elle est à tout moment grevée de violence légitime (légitime), elle est plus efficace que la « belle » morale. L'état de droit est un produit culturel et civilisationnel, animé par le besoin social de freiner les processus destructeurs dans la société. Comme le montre l'histoire réelle de l'État, ses fonction principale- réglementer et protéger les intérêts de chacun de ses citoyens, ce qui se transforme assez souvent en la protection du désir inéluctable d'une personne pour le pouvoir et la propriété privée, qui peut être et est souvent de nature déviante (déviante) du point de vue de l'idéal de la communauté humaine. Et donc la régulation morale, encore moins efficace et sans défense que la loi, est toujours nécessaire dans toute société, dans tout système étatique en tant qu'expression de l'humanité, de la véritable humanité.
La relation entre le droit et la morale peut être représentée par deux cercles qui se croisent (comme les cercles d'Euler en logique) : ils ont une partie commune où les normes du droit et de la morale coïncident, mais, en plus, il y a un domaine des normes morales qui ne se reflète pas dans les lois juridiques, et un domaine des normes juridiques qui n'ont aucun contenu moral ou même immoral, mais des normes "juridiques", légitimes, qui se reflètent dans l'adage bien connu : dura lex, sed lex (la loi est sévère, mais telle est la loi).
Nous soulignons une fois de plus que dans la relation entre les deux systèmes de réglementation les plus importants (la morale et le droit), on ne peut sous-estimer (dans le développement et la pratique de la réglementation juridique) que « toute loi est fondée sur une exigence éthique fondamentale, sur une réalité vraiment visible. évaluer. Toute loi est l'expression d'aspirations éthiques », ajoutons-nous : nous parlons de loi idéale, en pratique elle n'existe pas. Le philosophe et homme politique russe P.A. Kropotkine, qui disait qu'« il vaut mieux ne pas confondre les tâches de l'éthique avec les tâches de la législation. La doctrine de la morale ne décide même pas si la législation est nécessaire ou non. ... L'éthique n'indique pas une ligne de conduite stricte, car une personne doit elle-même peser le prix des différents arguments qui lui sont présentés. Le but de l'éthique est de fixer devant les gens le but le plus élevé - un idéal qui, mieux que tout conseil, conduirait leurs actions dans la bonne direction.
Parlant de la différence entre la régulation morale et les autres sphères d'organisation et de contrôle (droit, politique), il convient de noter que la morale « n'a pas de formes matérielles, ne se matérialise pas dans des appareils de gestion, des institutions de pouvoir, est dépourvue de centres de contrôle et de moyens de la communication et s'objective dans le langage et la parole, mais surtout dans la réflexion, dans les signes et les propriétés d'autres phénomènes. Autrement dit, la morale virtuel, existe en tant que forme de conscience. Étant une forme particulière de conscience sociale et individuelle, la moralité fait partie de tous les domaines de l'activité spirituelle des gens et affecte la vie d'une personne qui pense comment agir, projette, assume le résultat et l'appréciation morale d'une action qui n'est pas encore achevée. Le philosophe moderne A.A. Huseynov, qui a consacré toute sa vie scientifique à l'étude de l'éthique, définit les caractéristiques de la morale comme suit :
a) il caractérise la capacité d'une personne à vivre ensemble et est une forme de relations entre les personnes ;
b) il n'est pas soumis à la loi de causalité et au principe d'utilité (notez que seul ce qui est moral peut être utile - cette thèse sera développée dans le thème de la critique des principes de la théorie et de la pratique marxistes-léninistes - TT );
c) la loi morale ne permet pas la séparation du sujet et de l'objet de l'action, c'est-à-dire que proclamer la morale et la pratiquer soi-même est un processus unique et inséparable ;
d) la moralité est un lourd fardeau qu'une personne assume volontairement. La morale est un jeu dans lequel une personne se met en jeu (le sens et le contenu, la qualité de sa vie - T.T.). Socrate est contraint de boire du poison pour rester fidèle à ses convictions morales. Jésus-Christ a été crucifié. Giordano Bruno a été brûlé. Ghandi a été tué. Ce sont les enjeux les plus élevés de ce jeu.
Rappelons que la morale régule le comportement des personnes à travers l'appréciation de leurs actions, leurs actions par rapport aux autres du point de vue du bien et du mal. Avant de parler des spécificités de la régulation morale, donnons la définition la plus générale des concepts éthiques les plus importants du « bien » et du « mal ».
Le bien en et pour soi est le but absolu du monde et le devoir de chaque sujet, qui doit comprendre le bien, en faire son intention (motif) et le mettre en œuvre dans son activité.
Hegel
Les notions de bien et de mal sous-tendent la motivation morale d'un acte et l'appréciation du comportement des personnes. Donnons la définition la plus générale du bien, et sa caractérisation plus profonde sera présentée dans la troisième partie de cette édition. Le bien est un acte dont le résultat est un bien non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, par exemple un bien public.. Ce qui est bon? En éthique et en philosophie, le bien est défini comme quelque chose qui a une certaine signification positive.
Dans l'éthique ancienne, le bien était interprété différemment selon l'école philosophique ou les opinions des philosophes individuels : comme plaisir (l'école cyrénien, l'épicurisme) ou l'abstinence des passions (cyniques), comme une vertu au sens de la domination d'un supérieur , nature rationnelle sur l'inférieur (Aristote, stoïcisme). Aristote distingue les bienfaits de trois sortes : corporels (santé, force, etc.), externes (richesse, honneur, renommée, etc.) et spirituels (vivacité d'esprit, vertu morale, etc.). Chez Platon et dans le platonisme antique, le bien est identifié au plus haut niveau de la hiérarchie de l'être. Platon définit le bien comme l'unité du vrai, du bien et du beau.
Dans la scolastique médiévale, Dieu agit comme le plus grand bien, étant la source de toutes les bénédictions et le but ultime des aspirations humaines. La nouvelle philosophie européenne met l'accent sur le rôle du sujet dans la définition de quelque chose comme bon (Hobbes, Spinoza : le bien est ce à quoi une personne aspire, ce dont elle a besoin). Un trait caractéristique de la nouvelle éthique européenne est l'interprétation utilitaire du bien, le réduisant à l'utilité. À l'avenir, le concept de bien perd sa signification en tant que principale catégorie éthique et, au milieu du XIXe siècle, il est remplacé par le concept de valeur.
Le bien est la propriété des choses, des relations, des idées pour satisfaire les besoins humains. Ce qui est nécessaire pour une personne, ce qui lui est utile, peut être appelé bien. Toutes choses et relations, toutes actions, idées, etc. qui satisfont des besoins humains raisonnables, contribuent à une vie pleine et harmonieuse d'une personne, sont des bénédictions. Il est clair que non seulement la nourriture, une maison, un travail créatif, mais aussi l'existence des autres sont bonnes pour un individu ; une personne par origine, par sa manière d'être, est sociale, liée à d'autres personnes, dépend de l'état de la communauté dans laquelle elle vit, ses actions, à leur tour, affectent d'autres personnes, la société dans son ensemble. Au sens éthique propre du terme, le concept bien synonyme de de bien.
Bien peut être compris comme une bénédiction, c'est-à-dire un contenu et un résultat moralement positifs de l'activité humaine qui sont nécessaires à l'existence d'une personne, d'une société. Le bien est un bien qui fournit la vie elle-même, et le mal est ce qui détruit les biens, un certain ordre de leur distribution, qui ne correspond pas aux lois de l'existence, en d'autres termes, elle ne contribue pas en fin de compte à la fourniture et à la préservation de la vie. Le bien peut être défini comme une telle activité humaine, à la suite de laquelle le bien est accompli. Dans l'approximation la plus générale, bon peut être considéré comme bon, utile aux personnes activités en général le bien est une manière de conserver et de multiplier les richesses de la vie et la vie elle-même. Il y a du mal destruction du bien, le résultat du mal est le manque, le mal, la souffrance, etc.
Ainsi, nous avons identifié trois concepts principaux : moral, ou attitudes comportementales individuelles de la personnalité (bien, mal); moralité, ou les attitudes socio-comportementales des communautés humaines, les prescriptions orientées vers le bien ou le mal, et éthique- une science dont le sujet est la morale, la moralité, qui régit la relation des personnes en termes de bien et de mal. L'éthique, la morale, la morale ont leur propre langage, leurs propres concepts et catégories. Le contenu des catégories éthiques sera divulgué dans la troisième partie de cette publication, et nous donnerons ici un bref résumé des concepts éthiques les plus importants à l'aide desquels la communication morale entre les personnes est réalisée, les règles morales de la communauté sont formulé. Notez qu'ils sont le résultat de la sélection, de la fixation de l'expérience humaine et de sa réflexion en tant que fonction la plus importante de la culture.
Exigence(moral) - l'élément le plus simple des relations morales (du point de vue du bien et du mal), dans lequel les gens sont liés par une multitude de liens sociaux et sociaux. L'exigence a un sens impératif (impératif) en morale. Tout le monde connaît ces exigences : être gentil, ne pas faire de mal, faire son devoir envers la famille, le collectif de travail, l'État, etc.
Norme(lat. - règle, modèle) l'un des plus formes simples moral conditions. C'est un élément des relations morales qui doit correspondre à la nécessité morale, et en même temps, c'est une forme de conscience morale sous forme de règles, de commandements. Une norme morale est l'expression d'une forme historique concrète du besoin de régulation de la société. Nous évaluons nos actions et les actions des autres, tout d'abord, comme répondant à la norme morale ou comme la violant.
Des principes - la forme la plus générale des exigences morales, qui révèle le contenu d'un système moral particulier. Les principes moraux sont à la base du développement et de l'analyse des normes morales.
Idéaux - le concept de conscience morale, contenant les plus hautes exigences morales absolues, est une projection sur la perfection morale des relations individuelles et sociales. Sans la reconnaissance des absolus moraux, aucun impératif (commande) n'est valide, car le relativisme moral est inévitable - les principes moraux commencent à s'adapter à des circonstances en constante évolution, ce qui contribue à une diminution des évaluations morales, rend la réglementation morale inefficace et, finalement, met en danger la vie et la société dignes d'une personne.
Atelier éthique
1. Donnez une analyse du jugement suivant de K. Wojtyla : "La vérité sur le bien est basée sur une compréhension de la nature de l'homme et de ses buts, car le bien est ce qui correspond à cette nature et au but d'être lui-même ."
2. Le philosophe russe K.D. Kavelin croyait que le contenu principal du sujet de l'éthique est l'étude des «conditions d'émergence des actions morales dans l'âme». Êtes-vous d'accord avec cette compréhension du sujet de l'éthique? Comparez cette définition avec d'autres que vous connaissez.
3. Donnez une analyse du jugement suivant sur la moralité par A.A. Huseynov du livre «Grands moralistes»: «La morale illumine le chemin de la vie humaine ... Elle est de ce monde ... Sa mission ... est de donner une certaine direction à l'être historique lui-même. La morale est la vérité de la vie terrestre, et en dehors de l'épanouissement concret, en dehors du lien avec la soif de bonheur, elle n'existe pas. "La moralité est responsable du sens de la vie humaine."
4. Donnez des exemples pour confirmer l'affirmation suivante : « L'essentiel dans la morale, l'essentiel n'est pas de penser, de raisonner, mais d'agir, d'agir. La moralité est la capacité d'agir en connaissance de cause.
5. En quel sens peut-on être d'accord avec l'affirmation de l'éthicien soviétique Milner-Irinin selon laquelle "la loi est une morale sclérosée" ?