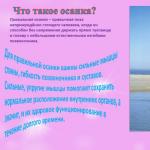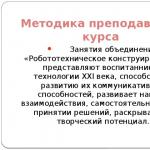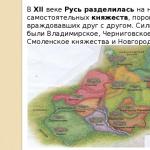Développement des pays d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Situations en Europe centrale et orientale après la Seconde Guerre mondiale
La situation politique interne en Pologne après la fin de la Seconde Guerre mondiale était très difficile. Dans la lutte pour le pouvoir, deux forces politiques se sont opposées, qui ont pris part au mouvement de résistance antifasciste - le Comité polonais de libération nationale, soutenu par l'URSS, et la Rada régionale des peuples, orientée pour soutenir le gouvernement polonais en exil , créé par les partis socialistes. Chacun des partis avait un soutien important parmi la population, par conséquent, après la libération de la Pologne par l'armée soviétique, un gouvernement provisoire d'unité nationale de coalition a été formé. Cependant, pour un temps limité des personnalités bourgeoises dirigées par l'ancien premier ministre du gouvernement des émigrés, le leader du "Soutien du peuple polonais" (PSL) S. Mikolajczyk, en ont été évincées. En 1947, les élections au premier parlement polonais d'après-guerre - le Sejm législatif - ont été remportées par le Bloc démocrate, composé de partis politiques d'orientation socialiste (en 1948, ils ont fusionné avec le Parti ouvrier unifié polonais (PUWP)). Le nouveau régime socialiste, avec le soutien de l'URSS, a commencé à se transformer selon le modèle soviétique.
Pendant un certain temps, le PSL a tenté d'opposer une résistance armée au nouveau gouvernement, mais les forces étaient inégales. Dans le sud-est de la Pologne, en 1947, des détachements de l'AP opéraient. Le massacre polono-ukrainien s'est poursuivi jusqu'à ce que l'action dite "Vistule" soit menée par le gouvernement. Sous prétexte de combattre l'AP, les autorités ont expulsé et dispersé sur le territoire de la Pologne 140 000 Ukrainiens qui vivaient ici depuis des siècles.
Formellement, la Pologne avait un système multipartite, mais dans sa vie politique Le PUWP dominé, qui a copié l'expérience du PCUS, a notamment introduit un système de répression. En 1952, la Constitution de la République populaire de Pologne (PNR) a été adoptée, l'institut de la présidence a été aboli et un organe directeur collectif, le Conseil d'État, a été créé. En juin 1956, en raison de la détérioration de la situation économique à Poznan, des émeutes anti-gouvernementales ont commencé, qui ont été brutalement réprimées par les autorités (75 personnes ont été tuées, environ 1000 ont été blessées). Cependant, la nouvelle direction du PUWP, dirigée par V. Gomulka, a été contrainte de faire des concessions : dissoudre les fermes collectives, réhabiliter les condamnés innocents, améliorer les relations avec église catholique.
Après des protestations massives contre le gouvernement des travailleurs et des étudiants en 1970, E. Gierek a été élu premier secrétaire du Comité central du PUWP. Les hausses de prix ont été annulées, le processus de renouveau économique a commencé, principalement grâce à d'importants prêts des pays occidentaux développés, à la suite desquels la situation dans le pays est temporairement revenue à la normale. Cependant, au début des années 1980, l'économie recommence à stagner, la dette extérieure de la Pologne atteint 27 milliards de dollars.En 1980, le PNS est saisi par une nouvelle crise politique, la plus longue et la plus aiguë. A l'été, une vague de grèves déferle sur tout le pays, les travailleurs des villes portuaires passent à la création de syndicats "libres" non contrôlés par l'Etat. Le plus massif était le syndicat indépendant "Solidarité", dirigé par un électricien du chantier naval de Gdansk, L. Walensa. Des poches de "Solidarité" ont commencé à se former dans tout le pays. Déjà à l'automne 1980, le nombre de ses membres dépassait les 9 millions de personnes. Le syndicat indépendant, soutenu par l'influente Église catholique dans la société polonaise, s'est transformé en un puissant mouvement socio-politique démocratique, s'est activement opposé au régime PUWP. Un autre changement à la direction du parti n'a pas stabilisé la situation dans le pays. Direction soviétique, effrayé par la perspective de l'arrivée au pouvoir des forces démocratiques en Pologne, menace d'intervenir militairement dans les affaires polonaises selon le scénario tchécoslovaque de 1968 et exige l'instauration immédiate de l'état d'urgence dans le pays. En 1981, le ministre de la Défense, le général V. Jaruzelsky, est élu président du Conseil des ministres et premier secrétaire du Comité central du PUWP. C'est lui qui a déclaré la loi martiale en Pologne le 13 décembre 1981: les activités de toutes les organisations d'opposition ont été interdites, leurs dirigeants et personnalités actives (près de 6,5 mille personnes) ont été internés, des patrouilles militaires des villes et des villages ont été introduites et un contrôle militaire sur le travail des entreprises. Ainsi, l'occupation soviétique du pays a été évitée, mais c'était déjà l'agonie du régime communiste en Pologne.
Au cours des années 80, la crise économique et sociopolitique en Pologne s'est aggravée et le gouvernement a été contraint de négocier avec l'opposition (février - avril 1989), qui s'est soldée par un accord sur des réformes démocratiques, à savoir la légalisation de toutes les associations politiques du pays. , en particulier "Solidarité", la tenue d'élections libres, le rétablissement de la présidence et du parlement bicaméral. Lors des élections de juin 1989, presque tous les sièges de la chambre haute - le Sénat - ont été attribués à des représentants de Solidarité et d'autres partis démocratiques. W. Jaruzelski a été élu président du pays et T. Mazowiecki, l'un des dirigeants de Solidarité, est devenu Premier ministre. Le démantèlement du modèle d'État totalitaire a commencé. Au début de 1990, ayant finalement perdu le soutien du peuple, le PZPR se dissout et Jaruzelski démissionne de ses pouvoirs de président. En décembre 1990, le leader de Solidarité, L. Walesa, remporte la première élection présidentielle directe. Le régime communiste en Pologne a subi un effondrement complet.
Les réformes économiques élaborées par le ministre des Finances L. Balcerowicz, connues sous le nom de "thérapie de choc", ont commencé. En peu de temps, les contrôles des prix ont été abolis, libre échange, privatisé la majeure partie du secteur public. Au prix d'une baisse importante du niveau de vie de la population (de 40 %), d'une augmentation du nombre de chômeurs (jusqu'à 2 millions de personnes), le marché intérieur de la Pologne s'est stabilisé. Mais le mécontentement de la population s'est manifesté lors de l'élection au parlement en 1993 d'anciens communistes principalement - des représentants de l'Union des forces de gauche démocratique (SLDS) et en 1995, le chef du SLDS A. Kwasniewski est devenu président de la Pologne, qui, avec le nouveau gouvernement de centre-gauche, a poursuivi la politique de réformes, renforçant l'accent mis sur la protection sociale de la population. En avril 1997, le Parlement a adopté la Constitution polonaise, selon laquelle une forme de gouvernement parlementaire-présidentiel a été établie avec une répartition claire des pouvoirs entre les branches législative, exécutive et judiciaire.
Les principales priorités de la politique étrangère de la Pologne dans les années 90 du XXe siècle. ont été déterminés: le développement d'une coopération globale avec les États-Unis, les pays européens développés, l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. À la suite de l'activité délibérée des autorités, la Pologne est devenue membre de l'OTAN en mars 1999 et, en mai 2004, de l'UE.
Le 25 septembre 2005, le parti Droit et Justice de Jaroslaw Kaczynski remporte les élections législatives en Pologne avec un score de 26,99% (155 sièges sur 460), en deuxième position revient la Plate-forme civique de Donald Tusk (24,14%), puis - "Self- défense" par Andrzej Lepper - 11,41%.
9 octobre 2005 Lech Kaczynski (frère jumeau de Jaroslav Kaczynski) et Donald Tusk accèdent au second tour élections présidentielles. Le 23 octobre 2005, Lech Kaczynski remporte les élections et devient président de la Pologne. 54,04% des électeurs ont voté pour lui. Le parti conservateur Droit et Justice entretient des liens étroits avec l'Église catholique. Lech Kaczynski lui-même pendant son mandat de maire de Varsovie a interdit les défilés minorités sexuelles, qui a suscité des critiques de la part des partenaires de la Pologne au sein de l'Union européenne, et a également exigé que l'Allemagne indemnise les dommages causés à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le nouveau président a mené une ligne nationaliste à l'égard non seulement de l'Allemagne, mais de l'ensemble de l'Europe unie. Il a notamment annoncé que la question de l'introduction d'une monnaie commune européenne en Pologne serait soumise à référendum. Depuis le 3 juillet 2006, son frère, Yaroslav Kaczynski, est à la tête du gouvernement.
Les élections législatives anticipées d'octobre 2007 ont apporté la victoire à la Plate-forme civique libérale-conservatrice, tandis que le parti conservateur au pouvoir Droit et Justice a été battu. Donald Tusk, leader de la Plateforme civique, est devenu Premier ministre.
Les relations de la Pologne avec l'Ukraine ont une tradition historique riche et plutôt complexe et une base contractuelle moderne et fiable. La Pologne a été la première au monde à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. En mai 1992, le traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre la Pologne et l'Ukraine a été signé. Les deux grands États voisins coopèrent activement dans des structures paneuropéennes. La Pologne soutient traditionnellement les aspirations de l'Ukraine à l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN.
PAYS D'EUROPE DE L'EST EN 1945-2000
§ 7. Pays d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale
Les résultats de la Seconde Guerre mondiale ont entraîné d'énormes pertes économiques et démographiques dans les pays de l'Est et en Europe. Destruction des infrastructures industrielles et de transport, hausse de l'inflation, perturbation des relations commerciales traditionnelles et grave pénurie d'acier pour les biens de consommation problèmes communs pour tous les pays de la région. Il est caractéristique que les plus grandes pertes subies pendant les années de guerre aient été les États qui, dans la période d'avant-guerre, étaient à un niveau de développement socio-économique plus élevé - la Pologne, complètement dévastée pendant les années Occupation nazie, la Hongrie, la plus touchée parmi les anciens alliés de l'Allemagne au stade final de la guerre et dans les premières années de l'occupation soviétique, la Tchécoslovaquie, qui a connu plusieurs divisions territoriales. Les pertes totales de la Pologne et de la Hongrie ont atteint 40% de la richesse nationale. La part de l'ensemble de la région d'Europe de l'Est dans la production industrielle mondiale a été multipliée par 2. Ainsi, la guerre a non seulement repoussé les pays d'Europe de l'Est dans la modernisation économique, mais a également considérablement nivelé leur niveau de développement.
Les changements territoriaux qui ont eu lieu en Europe de l'Est à la suite de la Seconde Guerre mondiale se sont avérés moins importants qu'en 1918-1920, mais ont néanmoins modifié de manière significative la carte politique régionale. Leur base juridique était les décisions des conférences de Crimée (Yalta) et de Potsdam, traités de paix avec des pays qui ont fait des études dans le bloc allemand, ainsi qu'une série d'accords bilatéraux ° P (? / Depuis les années des pays européens exacts avec l'URSS, conclus en 1944-19, des traités de paix avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie sont préparés par les pays lauréats du Conseil des ministres des affaires étrangères (FMD)
créé en 1945 pour répondre aux problèmes d'ure-ioovanie d'après-guerre. Ce travail fut achevé en décembre 1946 et le texte définitif des traités de paix fut signé le 10 février 1947. Le territoire de la Bulgarie est resté à l'intérieur des frontières du 1er janvier 3/aA/ La Hongrie est revenue aux frontières du 1er janvier 1938, à l'exception du transfert à la Tchécoslovaquie d'une petite zone aux environs de Bratislava. Ainsi, la Hongrie a perdu les territoires acquis dans le cadre des arbitrages de Vienne de 1938 et 1940. (Les pions du sud de la Slovaquie ont été rendus à l'État tchécoslovaque, l'Ukraine transcarpathique est devenue une partie de l'URSS, le nord-ouest de la Transylvanie est revenu à la Roumanie). Les frontières de la Roumanie ont été rétablies à partir du 1er janvier 1941, c'est-à-dire La Bessarabie et le nord de la Bucovine font toujours partie de l'URSS. Les traités ont également établi le montant et la procédure de paiement des réparations par la Roumanie en faveur de l'URSS, la Bulgarie en faveur de la Yougoslavie et de la Grèce, la Hongrie en faveur de l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Sur proposition de l'URSS, le principe d'une indemnisation partielle des dommages causés (66 %) est adopté. Par la suite, le gouvernement soviétique a réduit les paiements de réparation aux pays d'Europe de l'Est de 50 % supplémentaires.
Dans une position plus avantageuse se trouvaient les pays d'Europe de l'Est qui ont participé à la lutte contre le bloc nazi - Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Les nouvelles frontières de la Pologne ont été établies par la conférence de Crimée et le traité soviéto-polonais de 1945. La Pologne a acquis les anciens territoires allemands à l'est de la ligne le long de l'Oder et de la Neisse occidentale, y compris le retour du corridor de Danzing. L'ouest de l'Ukraine et l'ouest de la Biélorussie font toujours partie de l'URSS. Dans le même temps, le gouvernement soviétique a renoncé en faveur de la Pologne à toute revendication sur les biens et avoirs allemands situés sur le territoire polonais, ainsi qu'à une partie des réparations allemandes. Le traité spécial soviéto-tchécoslovaque de 1945 a confirmé la renonciation de la Tchécoslovaquie à ses revendications sur l'Ukraine transcarpathique. Le reste du territoire de la Tchécoslovaquie a été arrêté à l'intérieur des frontières du début de 1938. La tentative des Soviétiques et de la diplomatie yougoslave de garantir les droits de la Yougoslavie sur le territoire NC°?NUYU de la péninsule d'Istrie a échoué. Par décision de Paris et de la conférence de 1947, le «Territoire libre de Trieste» a été créé ici, divisé par l'Italie et la Yougoslavie déjà en 1954, et dans les plus brefs délais, l'un des problèmes d'après-guerre les plus difficiles de la région a été résolu. - déménagement à -mu h Iya "Selon la décision de la conférence de Potsdam, confirmée par Mannck> accords HH1MI> la population allemande a été déportée vers l'Allemagne depuis le territoire des Sudètes de Tchécoslovaquie, de nouvelles terres et> ainsi que de Hongrie et ancienne Prusse orientale, y compris -
""""" 8b74 d. m "
Ch-Rodr, ges Ou
soupe aux choux à l'URSS. L'accord soviéto-polonais de 1945 réglementait « l'échange de population » entre les deux pays. Un participant à la lutte contre le nazisme et les membres de leur famille, de nationalité polonaise et juive ", qui vivaient sur le territoire de l'URSS, ont reçu un PP en option - le choix de la citoyenneté polonaise ou soviétique. Cependant, en même temps , conformément aux accords antérieurs, il y a eu une évacuation mutuelle forcée de la population dans les régions frontalières de l'ouest de l'Ukraine et de l'ouest de la Biélorussie. En option, un échange de population a été effectué entre l'URSS et la Tchécoslovaquie dans les régions frontalières.
La situation politique interne qui s'est développée dans les pays d'Europe de l'Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale était également très difficile. L'effondrement des régimes autoritaires pro-fascistes, la large participation de la population au mouvement de résistance ont créé les conditions préalables à de profonds changements dans l'ensemble du système politique de l'État. Cependant, en réalité, la politisation des masses et leur préparation aux transformations démocratiques étaient superficielles. La psychologie politique autoritaire a non seulement été préservée, mais aussi renforcée pendant les années de guerre. Le désir de voir l'État comme un garant de la stabilité sociale et une force capable de résoudre les tâches auxquelles la société est confrontée dans les plus brefs délais était encore caractéristique de la conscience de masse.
Au sein d'une culture politique autoritaire, s'est également formée une grande partie de la nouvelle élite étatique arrivée au pouvoir dans les pays d'Europe de l'Est. Beaucoup de ces personnes ont consacré toute leur vie à la lutte contre les anciens régimes, sont passées par les prisons, les travaux forcés et l'émigration. L'esprit de lutte, le maintien irréconciliable et intransigeant de ses propres idéaux sont devenus la loi de la vie politique d'après-guerre en Europe de l'Est. Cela a également été facilité par l'héritage de la guerre elle-même, qui était un choc de modèles sociaux incompatibles, de systèmes idéologiques. La défaite du national-socialisme a laissé face à face d'autres adversaires implacables : le communisme et la démocratie libérale. Les partisans de ces idées victorieuses ont acquis une prédominance dans la nouvelle élite politique des pays d'Europe de l'Est, mais cela promettait un nouveau cycle de confrontation idéologique à l'avenir. La situation était également compliquée par l'influence accrue de l'idée nationale, l'existence de tendances à tendance nationaliste même dans les camps démocrate et communiste. L'idée de l'agrarisme, ravivée au cours de ces années, et les activités des partis paysans encore influents et nombreux reçurent également une coloration nationale.
n formation Un spectre de parti hétérogène formé
période dans les pays d'Europe de l'Est après la guerre, et de haute
L'ardeur de la lutte idéologique devant la démocratie pourrait devenir une raison suffisante pour que la première étape de la transformation sociale s'accompagne d'une confrontation aiguë de toutes les forces politiques. Cependant, la situation a évolué tout à fait différemment. Au dernier stade de la guerre dans la grande majorité des pays d'Europe de l'Est, le processus de consolidation de tous les anciens partis et mouvements d'opposition, la formation de larges coalitions multipartites, qui ont reçu le nom de Fronts nationaux ou de la patrie, commence. Alors que l'armée soviétique et les forces armées de la Résistance se déplaçaient vers l'ouest jusqu'aux frontières de l'Allemagne, ces associations politiques assumaient le plein pouvoir du pouvoir d'État.
Le Front de la patrie bulgare, qui réunissait le Parti des travailleurs bulgares pro-communiste, le Parti social-démocrate des travailleurs bulgares, le BZNS agraire et l'influent groupe politique Zveno, a été formé en 1942. Après la victoire du soulèvement populaire à Sofia en Septembre 1944, un gouvernement de coalition du Front est formé sous la direction de K. Georgiev du «Link». Le Front national démocratique roumain existe depuis septembre 1944. Initialement, il était basé sur des communistes et des sociaux-démocrates. Mais déjà en mars 1945, le gouvernement de coalition était dirigé par le chef autoritaire du Front roumain des agriculteurs P. Groz, et après le début d'une coopération constructive entre ce cabinet et la monarchie, des représentants des partis «historiques», les tséranistes et Les nationaux-libéraux, sont entrés au gouvernement. En décembre 1944, le Parti communiste hongrois, les sociaux-démocrates, le Parti national paysan et le Parti des petits agriculteurs forment le Front national hongrois et un gouvernement de transition. Après les premières élections libres en Hongrie en novembre 1945, le cabinet de coalition est dirigé par le chef de l'IMSH, Z. Tildy. La prédominance évidente des forces de gauche n'a d'abord été reçue que par le Front national des Tchèques et des Slovaques, créé en mars 1945. Malgré la participation active à celui-ci de politiciens influents du Parti national-socialiste, du Parti démocratique slovaque, du Parti populaire, du Parti communiste K Gottwald, et le premier gouvernement de coalition était dirigé par le social-démocrate Z. Fierlinger. Cependant, dans le même temps, la direction de la NFES a mené un dialogue très constructif avec le gouvernement en exil sous la direction de E. Benes et J. Massaryk. La situation politique intérieure en Pologne était plus compliquée, la confrontation s'est construite en juillet 1944 à Lublin
du Comité communiste de libération nationale et du gouvernement émissaire de S. Mikolajczyk, la confrontation ouverte "entre les détachements armés de l'armée populaire et de l'armée de l'intérieur a conduit la Pologne au bord de la guerre civile. L'activité des services spéciaux soviétiques a également joué un rôle rôle négatif - le personnel du NKVD et du SMERSH a été utilisé non seulement pour conseiller la création du service de sécurité polonais UB, mais également pour la persécution directe des combattants de l'armée de l'intérieur.Cependant, conformément aux décisions de la conférence de Crimée en Pologne, le processus de formation d'un gouvernement d'union nationale a également commencé. Il comprenait des représentants du Parti ouvrier polonais (PPR), du Parti socialiste polonais (PPS), du Parti paysan polonais (PSL), ainsi que du Parti des Ludoviens et Parti social-démocrate.E. forces de résistance et forces antifascistes de l'émigration en Yougoslavie. Le Comité de libération nationale, créé sur la base du Front de libération nationale pro-communiste, est parvenu en mars 1945 à un accord avec le gouvernement Šubašić en exil pour organiser des élections générales libres à l'Assemblée constituante (Assemblée constituante). La prédominance sans partage des forces pro-communistes n'a été préservée pendant cette période qu'en Albanie.
La raison d'une coopération aussi inattendue à première vue de forces politiques complètement hétérogènes était l'unité de leurs tâches au premier stade des transformations d'après-guerre. Il était tout à fait évident pour les communistes et les agrariens, les nationalistes et les démocrates que le problème le plus urgent était la formation des fondements mêmes d'un nouvel ordre constitutionnel, l'élimination des structures de gouvernance autoritaires associées aux anciens régimes et la tenue d'élections libres. Dans tous les pays, le système monarchique a été liquidé (ce n'est qu'en Roumanie que cela s'est produit plus tard, après l'établissement du pouvoir monopolistique des communistes). En Yougoslavie et en Tchécoslovaquie, la première vague de réformes concernait également la solution de la question nationale, la formation d'un État fédéral. La tâche principale était la restauration de l'économie détruite, la mise en place d'un soutien matériel pour la population et la solution des problèmes sociaux pressants. La priorité de ces tâches a permis de caractériser toute l'étape de 1945-1946. comme une période de "démocratie populaire". Cependant, la consolidation des forces politiques a été temporaire.
Si la nécessité même des réformes économiques était remise en question, alors les méthodes de leur mise en œuvre et le but ultime devenaient
marque la première scission des coalitions au pouvoir. Alors que la situation économique se stabilisait, il était nécessaire de déterminer la stratégie à long terme des réformes. Les partis paysans, les plus nombreux et les plus influents à cette époque (leurs représentants, on l'a dit plus haut, dirigeaient les premiers gouvernements en Roumanie, Bulgarie, Hongrie), n'estimaient pas nécessaire d'accélérer la modernisation, développement prioritaire de l'industrie. Ils s'opposent également à l'expansion de la régulation étatique de l'économie.La tâche principale de ces partis, généralement achevée dès la première étape des réformes, est la destruction des latifundia et la mise en œuvre de la réforme agraire dans l'intérêt de la paysannerie moyenne. Partis libéraux-démocrates, communistes et sociaux-démocrates, malgré les divergences politiques, se sont unis pour privilégier le modèle du « développement de rattrapage », s'efforçant d'assurer une percée de leur pays dans le développement industriel, de se rapprocher du niveau des pays leaders de la monde. N'ayant pas un grand avantage isolément, ils constituaient tous ensemble une force puissante capable d'opérer un changement dans la stratégie politique des coalitions au pouvoir.
Un tournant dans l'alignement des forces politiques se produit en 1946, lorsque les partis paysans sont écartés du pouvoir. Les changements dans les échelons supérieurs du gouvernement ont conduit à un ajustement du cours réformiste. La mise en œuvre des programmes de nationalisation de la grande industrie et du système bancaire, du commerce de gros, contrôle d'état sur les éléments de production et de planification. Mais si les communistes considéraient ces réformes comme le premier pas vers des transformations socialistes, alors les forces démocratiques y voyaient un processus de renforcement de l'élément étatique de l'économie de marché, naturel pour le système MMC d'après-guerre. La définition d'une nouvelle stratégie s'est avérée impossible sans « l'autodétermination » idéologique finale. Un facteur important était la logique objective des transformations économiques d'après-guerre. Le "rattrapage du développement", qui a déjà dépassé la période de reprise économique, la poursuite des réformes forcées dans le domaine de la production industrielle à grande échelle, la restructuration structurelle et sectorielle de l'économie, ont exigé des coûts d'investissement énormes. Il n'y avait pas de ressources internes suffisantes dans les pays d'Europe de l'Est. Cette situation a prédéterminé le caractère inévitable de la dépendance économique croissante de la région vis-à-vis de l'aide étrangère. Le choix de Delan était de n'être qu'entre l'Ouest et l'Est, et son issue ne dépendait déjà pas tant de l'alignement des forces politiques internes, mais de la scène mondiale.
Est Le destin politique de l'Europe de l'Est était l'Europe et a commencé le sujet de discussions actives lors des conférences alliées de Crimée et de Potsdam froides. CONTRAT
GUERRES "n g ^ tch Rs" ~
Les accords conclus à Yalta entre Staline, Roosevelt et Churchill reflétaient la division effective du continent européen en sphères d'influence. La Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie et l'Albanie constituaient la « zone de responsabilité » de l'URSS À l'avenir, la diplomatie soviétique conserva invariablement l'initiative lors des négociations avec d'anciens alliés sur divers aspects d'un règlement pacifique en Europe de l'Est. La signature par l'Union soviétique de traités bilatéraux d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (avec la Tchécoslovaquie en 1943, avec la Pologne et la Yougoslavie en 1945, avec la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie en 1948) a définitivement façonné les contours de ces relations paternalistes. La conférence de Francisco en avril 1945 a adopté la « Déclaration sur une Europe libérée », dans laquelle l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont également engagés à soutenir les réformes démocratiques dans tous les pays libérés des nazis, garantissant la liberté de choisir leur développement ultérieur. deux ans, l'URSS a cherché à Je suis catégoriquement le cap proclamé et je ne force pas la scission géopolitique du continent. Une réelle influence dans la région de l'Europe de l'Est, basée sur la présence militaire et l'autorité de la puissance libératrice, a permis au gouvernement soviétique d'effectuer plus d'une fois des démarches afin de manifester son respect pour la souveraineté de ces pays.
La flexibilité inhabituelle de Staline s'étendait même au saint des saints, le domaine idéologique. Avec le plein soutien de la haute direction du parti, l'académicien E. Varga a formulé en 1946 le concept de "démocratie d'un nouveau type". Il était basé sur le concept de socialisme démocratique, qui se construit en tenant compte des spécificités nationales dans les pays libérés du fascisme. L'idée de "démocratie populaire" - un système social qui combine les principes de justice sociale, de démocratie parlementaire et de liberté individuelle - était en effet extrêmement populaire alors dans les pays d'Europe de l'Est. Il était considéré par de nombreuses forces politiques comme une « troisième voie », une alternative au capitalisme individualiste américanisé et au socialisme totalitaire à la soviétique.
La situation internationale autour des pays d'Europe de l'Est a commencé à changer à partir du milieu de 1946. Lors de la Conférence de paix de Paris en août 1946, les délégations américaine et britannique
Yade tente activement d'intervenir dans le processus de formation de nouveaux organes gouvernementaux en Bulgarie et en Roumanie, ainsi que dans la construction de structures judiciaires spéciales pour le contrôle international du respect des droits de l'homme dans les pays de l'ancien bloc nazi. L'URSS s'oppose résolument à de telles propositions, justifiant sa position par le respect du principe de souveraineté des puissances d'Europe de l'Est. L'aggravation des relations entre les pays vainqueurs est devenue particulièrement évidente lors des IIIe et IVe sessions du Conseil ministériel des ministres des Affaires étrangères, tenues fin 1946 - début 1947 et consacrées au règlement des problèmes frontaliers dans l'Europe d'après-guerre et au sort de l'Allemagne. . En mars 1947, le message présidentiel de M. Truman proclamait une nouvelle doctrine de la politique étrangère américaine. La direction américaine a annoncé qu'elle était prête à soutenir tous les "peuples libres" dans leur résistance à la pression extérieure et, plus important encore, à la menace communiste sous toutes ses formes. Truman a également déclaré que les États-Unis sont obligés de diriger l'ensemble du "monde libre" dans la lutte contre les régimes totalitaires déjà établis qui sapent les fondements de l'ordre juridique international.
La proclamation de la « Doctrine Truman », qui annonçait le début d'une croisade contre le communisme, marqua le début d'une lutte ouverte des superpuissances pour l'influence géopolitique partout dans le monde. Les pays d'Europe de l'Est ont ressenti le changement de la situation internationale dès l'été 1947. Au cours de cette période, des négociations ont eu lieu sur les conditions de l'assistance économique des États-Unis aux pays européens dans le cadre du plan Marshall. Les dirigeants soviétiques ont non seulement rejeté résolument la possibilité d'une telle coopération, mais aussi un ultimatum a exigé que la Pologne et la Tchécoslovaquie, qui avaient manifesté un intérêt manifeste, refusent de participer au projet. Les autres pays de la région de l'Europe de l'Est ont prudemment tenu des consultations préliminaires avec Moscou et ont répondu aux propositions américaines par un "refus volontaire et décisif". L'URSS a offert une compensation généreuse sous la forme d'approvisionnements préférentiels en matières premières et en nourriture. Mais il fallait éradiquer la possibilité même d'une réorientation géopolitique de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire assurer le monopole du pouvoir dans ces pays aux partis communistes.
Formation de régimes pro-soviétiques en Europe de l'Est
l'Europe socialiste a suivi un scénario similaire
qui campe. Ryu. La première étape de cette voie a été de consolider
la trajectoire soviétique des partis communistes vers la « paix
Yougoslave "
si l'excroissance du national-démocratique révolutionnaire
Lucius dans le socialiste". Tout d'abord, la décision correspondante a été prise par le Parti communiste roumain - en octobre 1945, le RCP était le plus faible du
politiquement des partis communistes d'Europe de l'Est, n'était pas associée au mouvement de résistance de masse. La direction du parti, dominée par des représentants des minorités nationales, a été désorganisée par le conflit de son chef G. Georgiou-Deja avec les représentants de l'Union moscovite des communistes roumains A. Pauker et V. Luca. En outre, Geop-giu-Dej a accusé S. Foris, secrétaire du Comité central du parti, de complicité avec les envahisseurs, qui a été arrêté après l'arrivée des troupes soviétiques et pendu sans décision de justice. L'adoption du programme radical était associée à une tentative d'obtenir un soutien supplémentaire de la part des dirigeants soviétiques et ne correspondait pas à la situation politique du pays.
Dans la plupart des pays de la région de l'Europe de l'Est, la décision de passer au stade socialiste de la transformation sociale a été prise par la direction des partis communistes dès 1946 et n'a pas été associée à une restructuration radicale des plus hauts échelons du pouvoir de l'État. En avril, la décision correspondante a été adoptée par le Plénum du Parti communiste de Tchécoslovaquie, en septembre - par le III Congrès du PCUS. En octobre 1946, après les élections en Bulgarie, le gouvernement Dimitrov est arrivé au pouvoir, déclarant le même objectif ; en novembre, le bloc nouvellement formé des partis polonais PPR et PPS ("Bloc démocratique") a annoncé une orientation socialiste. Dans tous ces cas, la consolidation du cours vers la construction socialiste n'a pas conduit à une escalade de la violence politique et à l'implantation de l'idéologie communiste. Au contraire, l'idée de construction socialiste était soutenue par un large éventail de forces de centre-gauche et suscitait la confiance des segments les plus divers de la population. Pour eux, le socialisme n'était pas encore associé à l'expérience soviétique. Les partis communistes eux-mêmes ont utilisé avec succès la tactique des blocs au cours de ces mois. Les coalitions avec la participation des communistes, des sociaux-démocrates et de leurs alliés, en règle générale, ont reçu un avantage évident lors des premières élections démocratiques - en mai 1946 en Tchécoslovaquie, en octobre 1946 - en Bulgarie, en janvier 1947 - en Pologne, en août 1947 - en Hongrie. Les seules exceptions étaient la Yougoslavie et l'Albanie, où, sur la crête du mouvement de libération, les forces pro-communistes sont arrivées au pouvoir dans les premiers mois d'après-guerre.
En 1947, les nouveaux gouvernements de centre-gauche, utilisant le soutien déjà ouvert de l'administration militaire soviétique et s'appuyant sur les agences de sécurité de l'État créées sous le contrôle des services spéciaux soviétiques sur la base de cadres communistes, provoquèrent une série de conflits politiques qui conduit à la défaite de la paysannerie et de la démocratie libérale
ans. Des procès politiques ont eu lieu contre les dirigeants de l'IMSH hongrois 3. Tildy, le Parti populaire polonais g] ulkolaichik, l'Union populaire agricole bulgare N. Petkov, le Parti tsariste roumain A. Alexandres-y, le président slovaque Tiso et la direction de le Parti démocrate slovaque qui l'a soutenu. En Roumanie, ce processus a coïncidé avec la liquidation définitive du système monarchique. Malgré la loyauté démonstrative du roi Mihai envers l'URSS, il a été accusé de "rechercher le soutien des cercles impérialistes occidentaux" et expulsé du pays.
La suite logique de la défaite de l'opposition démocratique a été la fusion organisationnelle des partis communistes et sociaux-démocrates avec le discrédit ultérieur et, par la suite, la destruction des dirigeants de la social-démocratie. En février 1948, le Parti des travailleurs roumains est formé sur la base du RCP et du SDPR. En mai 1948, après une purge politique de la direction du Parti social-démocrate bulgare, elle rejoint le BKP. Un mois plus tard, en Hongrie, le PCUS et le SDPV étaient réunis au sein du Parti des travailleurs hongrois. Dans le même temps, les communistes et sociaux-démocrates tchécoslovaques s'unissent en un seul parti, le Parti communiste de Tchécoslovaquie. En décembre 1948, l'unification progressive du PPS et du PPR aboutit à la formation du Parti ouvrier uni polonais (PUWP). Dans le même temps, dans la plupart des pays de la région, le multipartisme n'a pas été formellement éliminé.
Donc, vers 1948-1949. dans presque tous les pays d'Europe de l'Est, l'hégémonie politique des forces communistes est devenue évidente. Le système socialiste a également reçu une consolidation juridique. En avril 1948, la constitution de la République populaire roumaine a été adoptée, proclamant une voie vers l'édification des fondements du socialisme. Le 9 mai de la même année, une constitution de ce genre fut adoptée en Tchécoslovaquie. En 1948, le cap vers l'édification socialiste fut fixé par le Ve Congrès du Parti communiste bulgare au pouvoir, et en Hongrie le début des transformations socialistes fut proclamé dans la constitution adoptée en août 1949. Ce n'est qu'en Pologne que la constitution socialiste fut adoptée un peu plus tard. - en 1952, mais déjà la "Petite Constitution" de 1947 fixait la Dictature du prolétariat comme une forme de l'Etat polonais et la base du système social.
Tous les actes constitutionnels de la fin des années 40 - début des années 50. sur la base d'une doctrine juridique similaire. Ils ont consolidé le principe du pouvoir populaire et la base de classe de « l'état des ouvriers et des paysans travailleurs ». La doctrine constitutionnelle et juridique socialiste niait le principe de la séparation des pouvoirs. Dans le système d'État
les autorités proclament « la toute-puissance des Soviets ». Les soviets locaux sont devenus des "organes du pouvoir d'État unifié", responsables de l'exécution des actes des autorités centrales sur leur territoire. Les organes exécutifs du pouvoir ont été formés à partir de la composition des soviets à tous les niveaux. Les comités exécutifs, en règle générale, agissaient selon le principe de la double subordination : à un organe directeur supérieur et au Conseil correspondant. En conséquence, une hiérarchie de pouvoir rigide a pris forme, patronnée par les organes du parti.
Tout en maintenant le principe de la souveraineté populaire (démocratie) dans la doctrine constitutionnelle et juridique socialiste, le concept de "peuple" a été réduit à une notion distincte groupe social- "les travailleurs". Ce groupe a été déclaré le sujet le plus élevé des relations juridiques, le véritable porteur de la souveraineté impérieuse. La personnalité juridique individuelle d'une personne était en fait niée. La personnalité était considérée comme une partie organique et intégrale de la société, et son statut juridique - comme un dérivé du statut d'une entité sociale et juridique collective («travailleurs» ou «classes exploiteuses»). Le critère le plus important pour maintenir le statut juridique d'un individu était la loyauté politique, qui était considérée comme la reconnaissance de la priorité des intérêts du peuple sur les intérêts individuels et égoïstes. Une telle approche a ouvert la voie au déploiement de répressions politiques à grande échelle. On pourrait également déclarer « ennemis du peuple » les personnes qui non seulement mènent des « actions anti-peuple », mais qui ne partagent tout simplement pas les postulats idéologiques dominants. Le bouleversement politique qui s'est produit dans les pays d'Europe de l'Est en 1947-1948 a renforcé l'influence de l'URSS dans la région, mais ne l'a pas encore rendue écrasante. Dans les partis communistes victorieux, en plus de l'aile "Moscou" - cette partie des communistes qui est passée par l'école du Komintern "et possédait précisément la vision soviétique du socialisme, une aile "nationale" influente subsistait, centrée sur les idées de la souveraineté nationale et de l'égalité dans les relations avec le "grand frère" (ce qui n'a cependant pas empêché de nombreux représentants de l'idée de "national-socialisme" d'être des partisans plus que constants et tenaces d'un État totalitaire.) Pour soutenir le " cours politique correct" des jeunes régimes communistes d'Europe de l'Est, la direction soviétique a pris un certain nombre de mesures vigoureuses. La plus importante d'entre elles a été la formation d'une nouvelle organisation communiste internationale - le successeur du Komintern.
L'idée de créer un centre de coordination du mouvement communiste et ouvrier international est née à Moscou avant le début de la confrontation active avec l'Occident. Par conséquent, l'initiale
les dirigeants soviétiques ont adopté une position très prudente, essayant de maintenir l'image d'un partenaire égal des pays d'Europe de l'Est. Au printemps 1947, Staline propose au dirigeant polonais W. Gomulka de prendre l'initiative de créer un périodique d'information commun à plusieurs partis communistes. Mais déjà à l'été de cette année-là, lors des travaux préparatoires, le Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union a adopté une position beaucoup plus dure. L'idée d'un dialogue constructif entre les différents courants du mouvement ouvrier international a été remplacée par une volonté de créer une tribune pour critiquer les "théories non marxistes d'une transition pacifique vers le socialisme", la lutte contre le "dangereux engouement pour parlementarisme » et d'autres manifestations de « révisionnisme ».
Dans le même ordre d'idées, en septembre 1947, dans la ville polonaise de Szklarska Poreba, une réunion des délégations des partis communistes d'URSS, de France, d'Italie et de l'Est États européens. La délégation soviétique dirigée par A. Zhdanov et G. Malenkov a activement soutenu les discours les plus durs sur "l'aggravation de la lutte des classes" et la nécessité d'un ajustement correspondant dans le cours des partis communistes. V. Gomulka, les chefs des délégations bulgare et hongroise V. Chervenkov et J. Revai, ainsi que le secrétaire du Parti communiste de Tchécoslovaquie R. Slansky ont pris la parole à partir de ces postes. Les discours du dirigeant roumain G. Georgeu-Deja et des représentants yougoslaves M. Djilas et E. Kardelya se sont avérés plus sobres. Les politiciens de Moscou étaient encore moins intéressés par la position des communistes français et italiens, qui préconisaient de maintenir le cap de la consolidation de toutes les forces de gauche dans la lutte contre « l'impérialisme américain ». Dans le même temps, aucun des orateurs n'a proposé de renforcer la coordination politique et organisationnelle du mouvement communiste international - il s'agissait de l'échange "d'informations internes" et d'opinions. Une surprise pour les participants à la réunion a été le rapport final de Jdanov, où, contrairement à l'ordre du jour initial, l'accent a été mis sur les tâches politiques communes à tous les partis communistes et une conclusion a été tirée sur l'opportunité de créer un centre de coordination permanent-Ra. En conséquence, la réunion de Szklarska Poreba a décidé de créer le Bureau d'information communiste. Certes, conscient de tous les hauts et les bas qui ont accompagné la lutte contre la direction trotskyste-zinoviéviste et boukharine de l'ancien Komintern, et ne voulant pas recevoir une nouvelle opposition en la personne du Kominform dans la lutte pour l'autocratie dans le mouvement communiste, Staline a réduit au maximum le champ d'activité de la nouvelle organisation. Le Kominform ne devait devenir qu'une tribune politique de la direction du FI(b) pour présenter « une vision juste des voies de construction du socialisme ».
Selon les recettes politiques éprouvées des années 20. Le Kremlin a d'abord tenté de trouver un adversaire potentiel parmi ses nouveaux alliés et de punir brutalement les "désobéissants". À en juger par les documents du département de politique étrangère du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l'Union, V. Gomulka a d'abord été considéré dans ce rôle, s'exprimant imprudemment lors d'une réunion à Szklarska Poreba contre la création d'un centre de coordination politique à la place de la publication conjointe prévue. Cependant, le "problème polonais" fut bientôt obscurci par un conflit plus aigu avec les dirigeants yougoslaves. Gomulka, en revanche, est démis en 1948 du poste de secrétaire général du PPR sans bruit supplémentaire et remplacé par B. Bierut, plus fidèle au Kremlin.
La Yougoslavie, à première vue, de tous les pays d'Europe de l'Est, a donné le moins de terrain aux révélations idéologiques et à la confrontation politique. Depuis la guerre, le Parti communiste de Yougoslavie est devenu la force la plus influente du pays et son chef Josef Broz Tito est devenu un héros national. Depuis janvier 1946, un système de parti unique a été légalement fixé en Yougoslavie, la mise en œuvre de vastes programmes de nationalisation de l'industrie et de collectivisation de l'agriculture a commencé. L'industrialisation forcée, menée selon le modèle soviétique, était considérée comme un axe stratégique pour le développement de l'économie nationale et structure sociale société. L'autorité de l'URSS en Yougoslavie pendant ces années était indiscutable.
La première raison de l'émergence de désaccords entre les dirigeants soviétiques et yougoslaves a été les négociations sur le territoire contesté de Trieste en 1946. Staline, ne voulant pas aggraver les relations avec les puissances occidentales à l'époque, a soutenu les plans d'un règlement de compromis de ce problème. . En Yougoslavie, cela était considéré comme une trahison des intérêts d'un allié. Des désaccords ont également surgi sur la question de la participation de l'URSS à la restauration et au développement de l'industrie minière yougoslave. Le gouvernement soviétique était prêt à financer la moitié des coûts, mais la partie yougoslave a insisté sur le financement intégral de l'URSS, ne contribuant que le coût des minerais comme sa part. En conséquence, l'assistance économique de l'URSS n'a été réduite qu'aux fournitures, à l'équipement et à l'envoi de spécialistes. Mais la véritable cause du conflit était précisément politique. De plus en plus d'irritation à Moscou a provoqué le désir des dirigeants de la Yougoslavie de présenter leur pays comme un allié "spécial" de l'URSS, plus important et influent que tous les autres membres du bloc soviétique. La Yougoslavie considérait toute la région des Balkans comme une zone d'influence directe et l'Albanie comme un potentiel
membre de la fédération yougoslave. Le style paternaliste et pas toujours respectueux des relations des politiciens soviétiques et des spécialistes économiques, à son tour, a provoqué le mécontentement à Belgrade. Dans une mesure particulière, elle s'est intensifiée après le début en 1947 d'une opération à grande échelle des services spéciaux soviétiques pour recruter des agents en Yougoslavie et y créer un réseau de renseignement.
A partir du milieu de 1947, les relations entre l'URSS et la Yougoslavie commencèrent à se détériorer rapidement. Le Moscou officiel a vivement réagi à la déclaration conjointe des gouvernements yougoslave et bulgare du 1er août 1947 sur le paraphe (coordination) du traité d'amitié et de coopération. Cette décision non seulement n'a pas été convenue avec le gouvernement soviétique, mais a également devancé la ratification du traité de paix entre la Bulgarie et les principaux pays de la coalition anti-hitlérienne. Sous la pression de Moscou, les dirigeants yougoslaves et bulgares ont alors reconnu leur « erreur ». Mais dès l'automne 1947, la question albanaise est devenue une pierre d'achoppement dans les relations soviéto-yougoslaves. Profitant des divergences au sein du gouvernement albanais, en novembre, la Yougoslavie a porté des accusations d'actions hostiles aux dirigeants de ce pays. Les critiques concernaient principalement le ministre de l'Économie N. Spiru, qui dirigeait l'aile pro-soviétique du gouvernement albanais. Spiru s'est rapidement suicidé et les dirigeants yougoslaves, anticipant la possible réaction du Kremlin, ont eux-mêmes lancé une discussion sur le sort de l'Albanie à Moscou. Les négociations qui ont eu lieu en décembre-janvier n'ont fait que temporairement réduire l'intensité de l'affrontement. Staline a laissé entendre sans équivoque qu'à l'avenir, l'adhésion de l'Albanie à la fédération yougoslave pourrait devenir tout à fait réelle. Mais les demandes de Tito pour l'entrée des troupes yougoslaves sur le territoire de l'Albanie ont été durement rejetées. Le dénouement est survenu en janvier 1948 après l'annonce par les dirigeants yougoslaves et bulgares de plans d'approfondissement de l'intégration balkanique. Ce projet a reçu l'évaluation la plus sévère de la presse officielle soviétique. Début février, les "rebelles" sont convoqués à Moscou. Le dirigeant bulgare G. Dimitrov s'est empressé d'abandonner ses anciennes intentions, mais la réaction des officiels de Belgrade a été plus modérée. Tito a refusé de se rendre personnellement à la «flagellation publique», et le Comité central du PCY, après le rapport de Djilas et Kardelj, qui étaient revenus de Moscou, a décidé d'abandonner> t les projets d'intégration balkanique, mais d'augmenter la pression diplomatique sur Albanie. Le 1er mars, une autre réunion du Comité central de la Yougoslavie du Sud a eu lieu, au cours de laquelle une critique très sévère de la position de la direction soviétique a été exprimée. La réponse de Moscou fut la décision du 18 mars "sur le retrait de tous les spécialistes soviétiques de Yougoslavie.
Le 27 mars 1948, Staline a envoyé une lettre personnelle à I. Tito, résumant les accusations portées contre la partie yougoslave (cependant, il est significatif que le chef des partis communistes d'autres pays participant au Kominform en ait également reçu des copies) Le contenu de la lettre montre la véritable raison de la rupture avec la Yougoslavie - le désir des dirigeants soviétiques de démontrer comment "le socialisme ne doit pas être construit". Tito et ses compagnons d'armes se sont vu reprocher de critiquer l'universalité de l'expérience historique de l'URSS, de dissoudre le parti communiste dans le Front populaire, de renoncer à la lutte des classes, de patronner les éléments capitalistes de l'économie. En fait, ces reproches n'avaient rien à voir avec les problèmes internes de la Yougoslavie - elle n'a été choisie comme cible qu'en raison d'une volonté personnelle excessive. Mais les dirigeants des autres partis communistes, invités à participer à la « dénonciation » publique de la « clique criminelle de Tito », ont été contraints de reconnaître officiellement la criminalité de la tentative même de trouver d'autres moyens de construire le socialisme.
Le 4 mai 1948, Staline envoya à Tito une nouvelle lettre avec une invitation à la deuxième réunion du Kominform et un long exposé de sa vision des principes de la construction "correcte" des fondements du socialisme. Il s'agissait de l'universalité du modèle soviétique de transformations sociales, de l'inévitable exacerbation de la lutte des classes au stade de la construction des fondements du socialisme et, par conséquent, de la dictature incontestée du prolétariat, du monopole politique des partis communistes, la lutte sans compromis contre les autres forces politiques et les "éléments non ouvriers", les programmes prioritaires d'industrialisation accélérée et de collectivisation de l'agriculture. Tito, bien sûr, n'a pas répondu à cette invitation et les relations soviéto-yougoslaves ont été effectivement rompues.
Lors de la deuxième réunion du Kominform en juin 1948, formellement consacrée à la question yougoslave, les fondements idéologiques et politiques du camp socialiste sont définitivement consolidés, y compris le droit de l'URSS de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays socialistes et la reconnaissance de l'universalité du modèle soviétique de socialisme. Désormais, le développement interne des pays d'Europe de l'Est s'effectue sous le strict contrôle de l'URSS. La création en 1949 du Conseil d'assistance économique mutuelle, qui a assumé les fonctions de coordination de l'intégration économique des pays socialistes, et plus tard (en 1955) du bloc militaro-politique de l'Organisation du Traité de Varsovie, a achevé la formation du camp socialiste .
Histoire générale en questions et réponses Tkachenko Irina Valerievna
20. Quelles ont été les principales tendances du développement des pays d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale ?
Les pays d'Europe centrale et du Sud-Est (Pologne, Allemagne de l'Est, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Albanie), qui en période d'après-guerre a commencé à s'appeler simplement l'Europe de l'Est, a traversé des épreuves dramatiques.
Pendant la guerre, certains d'entre eux étaient occupés par les troupes allemandes et italiennes (Pologne, République tchèque, Yougoslavie, Albanie), d'autres étaient des alliés de l'Allemagne et de l'Italie. Des traités de paix ont été conclus avec ces pays (Bulgarie, Hongrie, Roumanie).
La libération de l'Europe du fascisme a ouvert la voie à l'établissement d'un système démocratique et de réformes antifascistes. La défaite des troupes nazies par l'armée soviétique sur le territoire de ces pays a eu une influence décisive sur les processus internes des États d'Europe de l'Est. Ils étaient dans l'orbite d'influence Union soviétique.
Mise en œuvre dans les pays d'Europe de l'Est en 1945-1948 les transformations démocratiques (rétablissement des régimes parlementaires, multipartisme, suffrage universel, adoption de constitutions, réformes agraires, châtiment des criminels de guerre, nationalisation des biens des criminels nazis actifs et de leurs alliés) ont également été caractéristiques des pays de l'Occident européen . Cependant, dans les conditions de la rivalité soviéto-américaine d'après-guerre et à la suite de la pression directe et de l'aide de l'URSS en 1947-1948. dans les pays d'Europe de l'Est, les partis communistes se sont installés au pouvoir, ce qui a repoussé et liquidé leur opposants politiques- les partis démocrates libéraux. Après avoir achevé le processus d'affirmation de l'autocratie, qui s'appelait alors la période des révolutions démocratiques populaires, les partis communistes des pays de l'Est ont proclamé le début de la construction du socialisme.
Dans le même temps, le système socio-économique et politique qui s'est imposé en URSS devient le modèle initial. Un degré plus ou moins grand de copie de l'expérience de l'URSS était typique de tous les pays d'Europe centrale et du Sud-Est. Bien que la Yougoslavie ait choisi une variante légèrement différente de la politique socio-économique, dans ses principaux paramètres, elle représentait une variante du socialisme totalitaire, mais avec une plus grande orientation vers l'Occident.
Dans les pays d'Europe de l'Est, en règle générale, un système politique à parti unique a été établi. Les fronts populaires créés comprenaient parfois des représentants politiques de partis qui n'avaient pas d'influence politique.
Dans la période d'après-guerre, dans tous les pays de la région, l'attention principale a été accordée aux problèmes d'industrialisation, au développement de l'industrie lourde, tout d'abord, car, à l'exception de la Tchécoslovaquie et de la RDA, tous les autres pays étaient agraires. L'industrialisation s'est accélérée. Elle reposait sur la nationalisation de l'industrie, de la finance et du commerce. Les réformes agraires se sont terminées par la collectivisation, mais sans la nationalisation de la terre. Le système de gestion de toutes les branches de l'économie était concentré entre les mains de l'État. Les relations marchandes ont été réduites au minimum et le système de distribution administrative a triomphé.
La surpression des finances et du budget réduit les opportunités de développement sphère sociale et toute la sphère non productive - éducation, santé, science. Tôt ou tard, cela devait avoir un impact à la fois sur le ralentissement du rythme de développement et sur la détérioration des conditions de vie. Le modèle d'une production de type extensif, exigeant une implication toujours plus importante des coûts de matière, d'énergie et de main-d'œuvre, s'est épuisé. Le monde entrait dans une réalité différente - l'ère de la révolution scientifique et technologique, qui implique un type de production différent et intensif. Les pays d'Europe de l'Est se sont révélés insensibles aux nouvelles exigences économiques.
Plus loin développement socialiste de plus en plus éloigné du processus naturel et historique du développement de la civilisation européenne. Les soulèvements en Pologne et les grèves dans d'autres pays, le soulèvement en RDA en 1953, le soulèvement hongrois de 1956 et le "Printemps de Prague" de 1968, réprimés par les troupes des pays socialistes voisins - tout cela est une preuve suffisante de l'implantation de l'idéal socialiste sous la forme qu'il était compris par les partis communistes de cette époque.
Extrait du livre Histoire. Histoire générale. 11e année. Niveaux basique et avancé auteur Volobouev Oleg Vladimirovitch§ 15. Pays socialistes et caractéristiques de leur développement après la Seconde Guerre mondiale Etablissement de régimes pro-soviétiques. Libération Troupes soviétiques pays d'Europe de l'Est des nazis ont conduit à la formation de nouvelles autorités ici.
Extrait du livre Histoire. Histoire générale. 11e année. Niveaux basique et avancé auteur Volobouev Oleg Vladimirovitch§ 24. Les grandes tendances du développement de la culture artistique mondiale Avant-gardisme. La culture d'avant-garde est un ensemble de diverses tendances esthétiques unies par l'innovation dans la forme, le style et le langage. Cette innovation est révolutionnaire et destructrice dans
Extrait du livre Questions et réponses. Première partie : Seconde Guerre mondiale. Pays participants. Armée, armes. auteur Lisitsyn Fedor ViktorovitchArmements des pays participant à la Seconde Guerre mondiale
Extrait du livre Au-delà du seuil de la victoire auteur Martirosyan Arsen BenikovichMythe n° 21. À la fin de la guerre et immédiatement après, Staline a commencé à imposer le régime communiste dans les pays du centre, de l'est et du sud-est.
auteur Tkachenko Irina Valerievna10. Quelles ont été les principales étapes du développement d'après-guerre des principaux pays d'Europe occidentale (années 20-50 du XIXe siècle) ? Après la fin des guerres napoléoniennes, une situation contradictoire s'est développée en Europe. Un côté, élites politiques Les États européens ont cherché à
Extrait du livre Histoire générale en questions et réponses auteur Tkachenko Irina Valerievna12. Quelles ont été les voies de développement économique et politique de la France dans la seconde moitié du XIXe siècle ? Le jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier le 2 décembre 1852, Louis Napoléon se proclame empereur sous le nom de Napoléon III.Le régime politique du Second Empire est instauré dans le pays. Nouveau
Extrait du livre Histoire générale en questions et réponses auteur Tkachenko Irina Valerievna4. Quels ont été les résultats de la Première Guerre mondiale ? La révolution de février qui a eu lieu en Russie a excité les politiciens de tous les principaux États. Tout le monde comprenait que les événements qui se déroulaient en Russie affecteraient directement le cours de la guerre mondiale. Il était clair que cela
Extrait du livre Histoire générale en questions et réponses auteur Tkachenko Irina Valerievna7. Quels ont été les résultats de la Première Guerre mondiale pour les pays d'Amérique latine ? La Première Guerre mondiale a accéléré la poursuite du développement capitaliste des pays d'Amérique latine. L'afflux de biens et de capitaux européens a temporairement diminué. Les cours mondiaux des matières premières et
Extrait du livre Histoire générale en questions et réponses auteur Tkachenko Irina Valerievna16. Quels ont été les résultats de la Seconde Guerre mondiale ? Quels changements ont eu lieu en Europe et dans le monde après la Seconde Guerre mondiale ? La Seconde Guerre mondiale a marqué de son sceau toute l'histoire du monde dans la seconde moitié du XXe siècle. Pendant la guerre, 60 millions de vies ont été perdues en Europe, il faut en ajouter beaucoup.
Extrait du livre Histoire générale en questions et réponses auteur Tkachenko Irina Valerievna22. Quelles sont les caractéristiques du développement de la Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale ? La Grande-Bretagne est sortie victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, en tant que l'un des participants à la coalition anti-hitlérienne. Ses pertes humaines sont moindres que pendant la Première Guerre mondiale, mais le matériel
Du livre Histoire nationale: Aide-mémoire auteur auteur inconnu99. FORMATION DU SYSTÈME SOCIALISTE MONDIAL APRÈS LA SECONDE GUERRE MONDIALE. CONSÉQUENCES DE LA GUERRE FROIDE POUR L'URSS Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rapports de force entre les principales puissances ont fondamentalement changé. Les États-Unis ont considérablement renforcé leurs positions, tandis que
auteur Volobouev Oleg Vladimirovitch§ 15. Pays socialistes et caractéristiques de leur développement après la Seconde Guerre mondiale Établissement de régimes pro-soviétiquesLa libération des pays d'Europe de l'Est par les troupes soviétiques des nazis a conduit à la formation de nouvelles autorités ici. Gouvernements
Extrait du livre Histoire générale. XX - le début du XXIe siècle. 11e année. Un niveau de base de auteur Volobouev Oleg Vladimirovitch§ 24. Principales tendances du développement de la culture artistique mondiale Cette innovation est révolutionnaire et destructrice dans
auteurLes principaux pays d'Europe occidentale et Amérique du Nord au début du siècle : grandes tendances d'évolution Le déclin de la Pax Britanica Si le XIXe siècle fut souvent et non sans raison appelé « anglais », alors le nouveau siècle qui s'annonçait fut loin d'être aussi favorable à la Grande-Bretagne que le siècle
Extrait du livre Histoire générale [Civilisation. Conceptions modernes. Faits, événements] auteur Dmitrieva Olga VladimirovnaLes grandes tendances du développement socio-économique et politique de l'Amérique latine au début du siècle Depuis les indépendances, les pays d'Amérique latine ont fait des progrès significatifs dans leur développement socio-économique. Au début du 20e siècle
Extrait du livre Histoire générale [Civilisation. Conceptions modernes. Faits, événements] auteur Dmitrieva Olga VladimirovnaLes principaux pays d'Europe occidentale et les États-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle: les principales tendances de la socio-politique
La défaite de l'Allemagne fasciste et de ses alliés a conduit à la libération des peuples d'Europe de la domination nazie. La victoire des alliés dans la coalition antihitlérienne a conduit à la restauration de l'indépendance de ces pays, ou à un changement de régime politique dans les pays alliés de l'Allemagne. Néanmoins, les pays d'Europe de l'Est se sont trouvés, d'une part, avant de choisir une autre voie pour leur développement, et d'autre part, ils étaient complètement dépendants de la volonté des puissances alliées victorieuses, qui, lors des conférences de Yalta et de Potsdam, ont convenu de diviser l'Europe en sphères d'influence. Le fait que l'Europe de l'Est ait été libérée par l'armée soviétique était d'une importance capitale.
Avec le déclenchement de la guerre froide (fin 1946), les forces gouvernementales des États d'Europe de l'Est qui ne soutenaient pas l'URSS ont été facilement écartées du pouvoir. En conséquence, en 1949 les communistes ont pris le pouvoir dans les pays de la région. Les satellites soviétiques sont devenus :
Tchécoslovaquie,
Hongrie,
Roumanie,
Bulgarie,
Yougoslavie,
Albanie.
L'URSS a été prise comme modèle en termes de construction de l'État - la dictature du prolétariat a été proclamée l'objectif des transformations. Le multipartisme a été soit éliminé (Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Albanie), soit les partis ont perdu leur indépendance politique et ont rejoint des coalitions dirigées par les communistes (RDA, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie). Les programmes des pays de la région de l'Est ont déterminé la nationalisation de l'économie, la transition vers un système à parti unique et l'établissement du contrôle de l'État sur la société. Une importance particulière a été attachée à l'établissement de l'idéologie communiste en tant qu'idéologie nationale. En conséquence, le socialisme totalitaire a englouti toute l'Europe de l'Est. L'inclusion de la région dans le CAEM en 1949. et ATS 1955. signifiait que dans leur politique étrangère, les satellites suivaient le cap de l'URSS.
Néanmoins, les pays du socialisme totalitaire ont constamment secoué crises politiques . La première de ces crises a été l'écart entre le chef de la Yougoslavie soviétique, le maréchal I.-B. Tito avec le chef de l'URSS I.V. Staline en 1948. Les contacts entre l'URSS et la Yougoslavie n'ont été interrompus qu'à l'initiative de N. S. Khrouchtchev après la mort de Staline. Cependant, la Yougoslavie a choisi sa propre voie pour le développement du socialisme. La répression de l'insurrection en Hongrie (1956) et en Tchécoslovaquie (1968) fait de la dépendance des pays d'Europe de l'Est vis-à-vis de l'URSS par la force le facteur principal de leur vie politique.
2. "Révolutions de velours".
Décennie de conservation régimes politiques soutenu par la menace d'une invasion soviétique. Venir en URSS au pouvoir de l'équipe MS Gorbacheva(1985-1991) renverse la situation : la direction soviétique se met à soutenir les partisans du changement et du renouveau du socialisme dans les pays d'Europe de l'Est. La politisation de la société, l'effondrement du système de pouvoir et le discrédit des valeurs établies ont exacerbé la crise économique croissante, rendant l'effondrement du socialisme inévitable. En 1989 dans les pays d'Europe de l'Est, des révolutions démocratiques antisoviétiques ont eu lieu, qui ont reçu le nom "velours", car dans presque tous les pays (à l'exception de la Roumanie), le régime a été remplacé par des moyens pacifiques non violents.
Le scénario des révolutions était à peu près le même, et était largement calqué sur l'URSS :
1. l'impossibilité pour les autorités de réprimer les manifestations de masse.
2.Annulation des articles constitutionnels sur le rôle dirigeant des partis communistes.
3. la désintégration des partis communistes et leur transformation en partis sociaux-démocrates.
4. La renaissance des partis libéraux et conservateurs, ainsi que des mouvements démocratiques généraux.
5.formation de gouvernements de coalition de transition.
Tout organisations internationales créé par les pays de la région avec la participation de l'URSS, incl. Le CMEA et l'ATS ont été dissous. L'effondrement du rideau de fer prédéterminé l'effondrement du socialisme en Europe de l'Est.
Lors des élections libres de 1990. de nouveaux gouvernements sont arrivés au pouvoir dans tous les pays d'Europe de l'Est et le totalitarisme en Europe a cessé d'exister.
Chapitre 12
Selon de nombreux géopoliticiens, en raison de la population, de l'abondance des ressources, assez haut niveau développement économique, le territoire du Rhin à l'Oural est le "cœur de la Terre", dont le contrôle assure l'hégémonie sur l'Eurasie et, par conséquent, sur le monde. L'Europe de l'Est est le centre du "cœur de la Terre", qui détermine sa signification particulière. En effet, historiquement, l'Europe de l'Est a été un champ de bataille de puissances et une arène d'interaction. différentes cultures. Au cours des siècles passés, la domination sur elle a été revendiquée Empire ottoman, Empire des Habsbourg, Allemagne, Russie. Il y a eu aussi des tentatives de créer des États slaves occidentaux forts, le plus grand éducation publique l'une d'entre elles était la Pologne qui, aux XVIIIe et XIXe siècles, était divisée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse.
La plupart des États d'Europe de l'Est - Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie - sont apparus sur carte politique monde après la Première Guerre mondiale. Étant principalement agraires et agro-industriels, ayant des revendications territoriales les uns sur les autres, ils sont devenus dans l'entre-deux-guerres les otages des relations entre les grandes puissances, une monnaie d'échange dans leur affrontement. En fin de compte, dans le rôle de satellites, de partenaires juniors, de protectorats occupés, ils étaient subordonnés à l'Allemagne nazie.
La nature subordonnée et dépendante de la situation en Europe de l'Est n'a pas changé même après la Seconde Guerre mondiale.
§ 38. L'EUROPE DE L'EST DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XX SIÈCLE
Avec la défaite du fascisme, des gouvernements de coalition sont arrivés au pouvoir dans les pays d'Europe de l'Est, dans lesquels les partis antifascistes étaient représentés (communistes, sociaux-démocrates, libéraux, etc.). Les premières transformations étaient de nature démocratique générale, visaient à éradiquer les vestiges du fascisme, à restaurer l'économie détruite par la guerre. Avec l'aggravation des contradictions entre l'URSS et ses alliés de la coalition antihitlérienne, les USA et la Grande-Bretagne, le début de la guerre froide dans les pays d'Europe de l'Est, les forces politiques se sont polarisées en partisans d'une politique pro-occidentale et pro - Orientation soviétique. Dans les années 1947-1948. dans ces pays, dont la plupart avaient des troupes soviétiques, tous ceux qui ne partageaient pas les vues communistes ont été expulsés des gouvernements.
Europe de l'Est : caractéristiques du modèle de développement. Les vestiges d'un système multipartite ont été préservés dans les pays qui ont reçu le nom de démocraties populaires. Les partis politiques en Pologne, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, qui reconnaissaient le rôle dirigeant des communistes, n'ont pas été dissous, leurs représentants se sont vu attribuer un quota dans les parlements et les gouvernements. Sinon, en Europe de l'Est, le modèle soviétique du régime totalitaire a été reproduit avec ses caractéristiques inhérentes : culte du chef, répressions de masse. Selon le modèle soviétique, la collectivisation de l'agriculture (la Pologne était une exception partielle) et l'industrialisation ont été réalisées.
Formellement, les pays d'Europe de l'Est étaient considérés comme des États indépendants. Dans le même temps, avec la création du Bureau d'information des partis communistes et ouvriers (Informburo) en 1947, la direction effective des «pays frères» commence à s'exercer depuis Moscou. Le fait qu'en URSS ils ne toléreront aucune performance amateur a été démontré par la réaction extrêmement négative d'I.V. Staline sur la politique des dirigeants de la Bulgarie et de la Yougoslavie - G. Dimitrov et I. Tito. Le traité d'amitié et d'assistance mutuelle entre la Bulgarie et la Yougoslavie comprenait une clause sur la lutte contre "toute agression, de quelque côté qu'elle vienne". Les dirigeants de ces États ont eu l'idée de créer une confédération des pays d'Europe de l'Est, ce qui leur permettrait de choisir indépendamment un modèle de développement.
La tâche de modernisation était sans aucun doute pertinente pour les pays d'Europe de l'Est. Les partis communistes au pouvoir en leur sein ont cherché à résoudre ces problèmes par des méthodes socialistes, copiant l'expérience de la modernisation en URSS au cours des premiers plans quinquennaux. Dans le même temps, il n'a pas été tenu compte du fait que dans les petits pays, la création de géants industriels n'est rationnelle que s'ils s'intègrent à leurs voisins. Une confédération en Europe de l'Est, mettant en commun les ressources des pays d'Europe de l'Est serait économiquement justifiée. Cependant, la direction soviétique voyait dans cette idée une menace pour son influence sur les pays libérés du fascisme.
La réponse de l'URSS aux tentatives de manifester son indépendance a été la rupture des relations avec la Yougoslavie. Le Bureau d'information appelle les communistes yougoslaves à renverser le régime de Tito, accusé de basculer sur les positions du nationalisme bourgeois. Les transformations en Yougoslavie se sont déroulées de la même manière que dans les pays voisins. Des coopératives ont été créées dans l'agriculture, l'économie est devenue la propriété de l'État, le monopole du pouvoir appartenait au Parti communiste. Néanmoins, le régime de I. Tito jusqu'à la mort de Staline a été défini comme fasciste. Pour tous les pays d'Europe de l'Est en 1948-1949. une vague de représailles déferla sur ceux qui étaient soupçonnés de sympathiser avec les idées du chef de la Yougoslavie. En Bulgarie, après la mort de G. Dimitrov, une ligne d'hostilité envers Tito s'est également établie.
Les régimes totalitaires de la plupart des pays d'Europe de l'Est sont restés instables. L'histoire d'après-guerre de l'Europe de l'Est est remplie de tentatives pour se libérer des régimes soutenus par l'URSS et pour réviser les fondements idéologiques du socialisme. Pour la population des pays d'Europe de l'Est, malgré le mur du blocus de l'information entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, il est vite devenu évident que la politique économique des régimes communistes au pouvoir était un échec complet. Ainsi, avant la Seconde Guerre mondiale, les niveaux de vie en Allemagne de l'Ouest et de l'Est, en Autriche et en Hongrie étaient à peu près les mêmes. Au fil du temps, dans les années 1980, dans les pays construisant le socialisme selon les recettes soviétiques, le niveau de vie était trois fois inférieur à celui des États voisins où une économie de marché à vocation sociale s'était développée.
La crise du modèle soviétique de socialisme en Europe de l'Est a commencé à se développer presque immédiatement après son établissement. Mort d'I.V. Staline en 1953, qui a fait naître des espoirs de changement dans le "camp socialiste", a provoqué un soulèvement en RDA.
L'exposition du culte de la personnalité de Staline par le 20e Congrès du PCUS en 1956 a conduit à un changement dans les dirigeants des partis au pouvoir, nommés et soutenus par lui, dans la plupart des pays d'Europe de l'Est. La liquidation du Bureau d'information et le rétablissement des relations entre l'URSS et la Yougoslavie, la reconnaissance du conflit comme un malentendu ont fait naître l'espoir que les dirigeants soviétiques renonceraient à un contrôle étroit sur Politiques intérieures Pays d'Europe de l'Est. Dans ces conditions, de nouveaux dirigeants, théoriciens des partis communistes, y compris au pouvoir (M. Djilas en Yougoslavie, L. Kolakovsky en Pologne, E. Bloch en RDA, I. Nagy en Hongrie), tentent d'appréhender des phénomènes nouveaux et tendances de la vie socio-économique des pays développés, intérêts du mouvement ouvrier. Ces tentatives ont provoqué une vive condamnation de la part du PCUS, qui a agi comme le principal défenseur de l'intégrité de l'ordre établi en Europe de l'Est.
Politique de l'URSS envers les pays d'Europe de l'Est. Les tentatives de démantèlement des structures totalitaires du pouvoir en Hongrie en 1956, la transition vers un système multipartite, entreprise par la direction du parti au pouvoir, se sont transformées en une révolution antitotalitaire et démocratique. Ces aspirations ont été réprimées par les troupes soviétiques. Une tentative de réforme, une transition vers un « socialisme à visage humain », entreprise en Tchécoslovaquie en 1968, a également été contrecarrée par la force armée.
Il n'y avait aucune justification légale pour le déploiement de troupes dans les deux cas. La raison en était la demande du "groupe de dirigeants" d'assistance dans la lutte contre la "contre-révolution", prétendument dirigée de l'extérieur et menaçant les fondements du socialisme. La fidélité au principe de sa défense collective a été déclarée à plusieurs reprises par les partis au pouvoir de l'URSS et des pays d'Europe de l'Est. Cependant, en Tchécoslovaquie en 1968, les dirigeants du parti au pouvoir et de l'État ont soulevé la question non pas de l'abandon du socialisme, mais de son amélioration. Les personnes qui ont invité des troupes étrangères dans le pays n'ont été autorisées par personne à le faire. La direction du PCUS et de l'État soviétique s'est arrogé le droit de décider ce qui est dans l'intérêt du socialisme non seulement en URSS, mais dans le monde entier. Sous L. I. Brejnev, le concept de socialisme réel a été formulé, selon lequel seule la compréhension du socialisme acceptée en URSS avait le droit d'exister. Tout écart par rapport à celui-ci était considéré comme une transition vers des positions hostiles au progrès, à l'Union soviétique.
La théorie du socialisme réel, qui justifie le droit de l'URSS de mener des interventions militaires dans les affaires intérieures de ses alliés dans le cadre du Pacte de Varsovie, était appelée la "doctrine Brejnev" dans les pays occidentaux. Le contexte de cette doctrine a été déterminé par deux facteurs.
Il y avait d'abord des considérations idéologiques. La reconnaissance de la faillite du socialisme en Europe de l'Est pourrait faire douter de la justesse de l'orientation du PCUS également parmi les peuples de l'URSS.
Deuxièmement, dans les conditions de la guerre froide, la scission de l'Europe en deux blocs militaro-politiques, l'affaiblissement de l'un d'eux s'est objectivement avéré être un gain pour l'autre. Écart par la Hongrie ou la Tchécoslovaquie relations alliées avec l'URSS (c'était l'une des exigences des réformateurs) était perçue comme violant l'équilibre des forces en Europe. Bien qu'à l'ère des missiles nucléaires, la question de savoir où se situe la ligne d'affrontement ait perdu son ancienne signification, la mémoire historique des invasions occidentales a été préservée. Cela a incité les dirigeants soviétiques à s'efforcer de faire en sorte que les troupes d'un ennemi potentiel, considéré comme le bloc de l'OTAN, soient déployées le plus loin possible des frontières de l'URSS. Dans le même temps, le fait que de nombreux Européens de l'Est se sentent otages de la confrontation soviéto-américaine a été sous-estimé, sachant qu'en cas de conflit grave entre l'URSS et les États-Unis, le territoire de l'Europe de l'Est deviendrait le principal champ de bataille pour intérêts qui leur sont étrangers.
Approfondissement de la crise du « socialisme réel ». Dans les années 1970 dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, des réformes ont été progressivement menées, opportunités limitées le développement des relations de marché libre, les liens commerciaux et économiques avec les États d'Europe occidentale se sont intensifiés, les répressions contre les dissidents ont été limitées. En particulier, un mouvement pacifiste indépendant et non partisan a émergé en Hongrie. Les changements, cependant, étaient limités, effectués en tenant compte de la position des dirigeants de l'URSS, qui les désapprouvaient.
Les dirigeants les plus clairvoyants des partis au pouvoir dans les pays d'Europe de l'Est se sont efforcés de maintenir au moins un soutien interne minimal et la nécessité de tenir compte de la position rigide des idéologues du PCUS intolérants à toute réforme dans les pays alliés.
Les événements de Pologne en 1980-1981 sont devenus une sorte de tournant, où le syndicat indépendant "Solidarité" a été formé, qui a immédiatement pris une position anticommuniste. Ses membres comprenaient des millions de membres de la classe ouvrière polonaise qui rejetaient le droit de la bureaucratie communiste de gouverner en son nom. Dans cette situation, l'URSS et ses alliés n'ont pas osé utiliser des troupes pour réprimer la dissidence. La loi martiale a été introduite en Pologne et le régime autoritaire du général W. Jaruzelski a été établi. Cela a marqué l'effondrement complet de l'idée du "socialisme réel", qui a été contraint d'être remplacé, avec l'approbation de l'URSS, par une dictature militaire.
DOCUMENTS ET MATERIELS
DepuissouvenirsM. Djilas, membreComité centralUGS, dansle recueil: "Russie, quinousne pasconnaissait, 1939 - 1993 » . M., 1995. Avec. 222-223:
« Staline poursuivait deux objectifs. Le premier est d'assujettir la Yougoslavie et, à travers elle, toute l'Europe de l'Est. Il y avait une autre option. Si cela ne marche pas avec la Yougoslavie, alors soumettez l'Europe de l'Est sans elle. Il a obtenu le deuxième<...>
Ce n'était écrit nulle part, mais je me souviens de conversations confidentielles que dans les pays d'Europe de l'Est - Pologne, Roumanie, Hongrie - il y avait une tendance au développement indépendant<...>En 1946, j'étais au congrès du parti tchécoslovaque à Prague. Là, Gottwald a déclaré que le niveau de culture de la Tchécoslovaquie et de l'Union soviétique était différent. Il a souligné que la Tchécoslovaquie est un pays industrialisé et que le socialisme s'y développera différemment, sous des formes plus civilisées, sans les bouleversements qui ont eu lieu en Union soviétique, où l'industrialisation a franchi des étapes très difficiles. Gottwald s'opposait à la collectivisation en Tchécoslovaquie. Au fond, ses vues n'étaient pas très différentes des nôtres. Gottwald n'avait pas le caractère pour combattre Staline. Et Tito était homme fort <...>Gomułka n'a pas non plus réussi à défendre sa position. Lors d'une réunion du Bureau d'information, Gomułka a parlé de la voie polonaise vers le socialisme. Dimitrov a également pensé au développement indépendant.
DepuisdéclarationsH. Avec. Khrouchtchev 26 Mai 1955 g. dansle recueil: "Russie, quinousne pasconnaissait, 1939 - 1993 » . M., 1995. Avec. 221:
"Nous regrettons sincèrement ce qui s'est passé et écartons résolument toutes les accrétions de cette période<...>Nous avons soigneusement étudié les documents sur lesquels se fondaient les graves accusations et insultes portées à l'époque contre les dirigeants de la Yougoslavie. Les faits montrent que ces matériaux ont été fabriqués par les ennemis du peuple, les agents méprisables de l'impérialisme qui se sont frayé un chemin dans les rangs de notre parti.
Nous sommes profondément convaincus que la période où nos relations étaient assombries est révolue.
Depuissouvenirs 3. Mlynarzha, membreComité centralCRH, "GelésuccèsdepuisKremlin". M., 1992. Avec. 130:
« Les années de stalinisme en Tchécoslovaquie n'ont fait que renforcer dans la conscience nationale ces idéaux que les autorités ont essayé par tous les moyens d'éradiquer. La dictature a clairement montré à quoi mène leur oubli, ce qui a poussé même les staliniens « idéologiquement convaincus » à emprunter la voie des réformes. Dans l'esprit des peuples, les valeurs de démocratie et d'humanisme ont été réhabilitées bien avant 1968<...>Vivre dans la peur, agir sur ordre, et non de la manière que vous considérez au fond comme juste, digne, est un lourd fardeau pour un individu, et pour un groupe social, et pour tout le peuple. Par conséquent, se débarrasser d'une telle peur est accueilli comme une résurrection.
QUESTIONS ET TÂCHES
1. Quels facteurs ont déterminé le choix du modèle de développement des États d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale ? Qu'est-ce qui était commun et qu'est-ce qui distinguait le développement d'après-guerre de ces pays ?
2. Quels événements des années 1940-1980 montré l'instabilité des régimes politiques des États d'Europe de l'Est ?
3. Quelle était la doctrine Brejnev, quelle était sa principale signification idéologique et politique?
§ 39. CAUSES DE LA CRISE DU SOCIALISME TOTALITAIRE EN URSS
Le XXe siècle a été témoin non seulement de la montée, mais aussi du déclin du totalitarisme, de l'effondrement des régimes politiques totalitaires dans de nombreux pays. Ce n'est pas un caprice de l'histoire, mais plutôt un produit naturel du développement social.
L'Union soviétique a démontré une capacité à résoudre des problèmes à grande échelle qui a étonné l'imagination des contemporains. En un temps record, l'URSS est devenue une puissante puissance industrielle, a réussi à vaincre les principales forces terrestres de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, à surmonter son retard par rapport aux États-Unis dans la création d'armes atomiques et à être la première à commencer exploration de l'espace.
Dans le même temps, au cours de son développement, l'URSS a pleinement démontré côtés faibles organiquement inhérent à tout régime totalitaire, qui a déterminé l'inévitabilité de son effondrement.
L'effondrement du système de commandement administratif. Dans un système de prise de décision sans discussion approfondie, un dirigeant ou un groupe de dirigeants déterminait souvent à tort les priorités dans l'allocation des ressources. Les ressources ont été dépensées pour des projets qui n'ont pas donné de retours et se sont même transformées en dommages.
Tant en URSS que dans les pays d'Europe de l'Est, de nombreuses "constructions du siècle" ont été réalisées, opportunité économique ce qui était douteux, et l'infériorité environnementale est indiscutable. Dans le même temps, aucune attention n'a été accordée au développement de technologies économes en énergie et en ressources. attention particulière. Pour des raisons idéologiques, une interdiction a été imposée à la recherche dans le domaine de la création intelligence artificielle, la génétique, ce qui a entraîné un sérieux retard dans ces domaines importants du progrès scientifique et technologique. Fondée sur des considérations idéologiques, solidarité avec les régimes « anti-impérialistes » en 1957-1964. L'URSS a fourni une assistance économique à plus de 20 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il a couvert jusqu'à 50% des dépenses de l'Egypte pour le développement économique, jusqu'à 15% - de l'Inde. Préparation N.S. Khrouchtchev pour aider tout régime qui exprimait un intérêt pour les idéaux du socialisme, a conduit à un gaspillage des ressources de l'URSS, sans apporter d'avantages économiques ou militaro-politiques significatifs. Par la suite, la plupart des régimes aidés sont entrés dans l'orbite d'influence des pays développés de l'Occident. En raison d'une décision purement volontaire, prise même sans discussion par les organes dirigeants du parti au pouvoir et de l'État, l'URSS en 1979 a soutenu par la force des armes un groupe pro-soviétique dans l'élite dirigeante de l'Afghanistan. Cette action a été considérée par le peuple afghan et la plupart des pays en développement comme un acte d'agression. L'URSS a été entraînée dans une guerre insensée et sans espoir qui a coûté beaucoup de pertes humaines et matérielles et a sapé son prestige international.
La gestion centralisée et administrative de l'économie, à mesure que son ampleur grandissait, exigeait la croissance de l'appareil administratif, travaillant avec des rendements décroissants. Un "centre de pouvoir" n'est en principe pas en mesure de surveiller, de contrôler et de planifier, surtout plusieurs années à l'avance, toutes les communications entre des dizaines de milliers de grandes, petites et moyennes entreprises, les changements des conditions du marché mondial. Cela a créé l'anarchie dans l'économie, qui n'est restée planifiée au niveau central que de nom. Pendant toute l'existence de l'URSS, ils n'ont jamais été en en entier les tâches des plans quinquennaux ont été remplies (sans parler du "plan de sept ans" de N.S. Khrouchtchev, dont les résultats n'ont pas du tout été résumés). Dans les années 1980 le taux de croissance de la production est devenu nul. Les tâches formulées par le parti au pouvoir pour transférer l'économie sur une voie de développement intensif, en utilisant les technologies de l'ère de l'information, n'ont pas été remplies. L'une des raisons en était que les dirigeants des industries, des régions et des entreprises craignaient l'émergence d'un chômage de masse et n'étaient pas prêts à résoudre les problèmes sociaux de la modernisation.
Crise d'idéologie. S'assurant un soutien de masse à l'aide de l'idéologie, le régime totalitaire devait constamment démontrer le succès, confirmer le réalisme des super-tâches formulées, sinon l'enthousiasme cède la place à la déception et à l'irritation.
Les dirigeants de l'URSS et d'autres pays qui se proclamaient avoir atteint la phase inférieure du communisme étaient liés par l'obligation de construire la société la plus progressiste et la plus juste du monde, où les besoins des gens (bien sûr, raisonnables) seraient Totalement satisfait. Ainsi, le chef du Parti communiste chinois, Mao Zedong, a lancé le slogan - "Cinq ans de travail acharné, dix mille ans d'une vie heureuse." Dans le Programme du PCUS, adopté sous N.S. Khrouchtchev, contenait l'obligation de réaliser le communisme du vivant de sa génération contemporaine Peuple soviétique, d'ici 1980 pour dépasser le pays le plus développé du monde - les États-Unis dans les principaux indicateurs de développement.
Les idéologues du PCUS et d'autres partis apparentés au pouvoir ont proposé diverses explications sur les raisons pour lesquelles les objectifs fixés étaient irréalisables. Cependant, ces explications, même prises au sérieux, fragilisent objectivement les fondements de l'État totalitaire. Les références aux intrigues d'ennemis externes et internes ont intensifié l'atmosphère de suspicion générale dans la société, qui a été utilisée à des fins de carrière par des factions intéressées de l'élite bureaucratique, réprimant la partie la plus talentueuse et la plus créative de l'intelligentsia. La révélation des erreurs de calcul, des erreurs et des crimes des dirigeants précédents, souvent justes, a discrédité le régime totalitaire en général.
La critique des dirigeants est une chose courante et habituelle dans une démocratie. En URSS, après la doxologie aux dirigeants sages et infaillibles I.V. Staline, N.S. Khrouchtchev, L.I. Brejnev, l'un s'est avéré coupable de génocide, l'extermination de millions de ses propres concitoyens, l'autre de volontarisme, de refus de tenir compte des réalités objectives, le troisième - de stagnation, d'inertie. Le régime totalitaire étant bâti sur la déification des dirigeants, leur démystification ou infirmité physique évidente (Yu.V. Andropov, K.U. Chernenko) ont été à l'origine de la perte de confiance en lui. Les mensonges sur le prétendu succès ont joué un grand rôle pour assurer la stabilité du régime, mais avec le développement des médias et sa mondialisation, grâce à la radiodiffusion internationale, la télévision par satellite, il est devenu de plus en plus difficile de cacher la vérité.
Au fil du temps, l'enthousiasme des masses a été inévitablement remplacé par l'apathie, l'ironie, le désir de trouver des voies alternatives de développement, dans les années 1980. englouti la direction du PCUS, du PCC et d'autres partis au pouvoir.
La déception idéologique a frappé non seulement les gouvernés, mais aussi de nombreuses parties de l'appareil administratif. Ce n'est qu'aux origines du mouvement communiste que se trouvaient des dirigeants sincèrement convaincus de la justesse de leur idée, capables de transmettre leur conviction aux autres. Pour de nombreux représentants du mécanisme de gestion hiérarchique et bureaucratique, l'idéologie est devenue moins un symbole de foi qu'un hommage au rituel, un moyen de dissimuler leurs intérêts personnels, y compris dans le domaine de l'enrichissement.
Selon un certain nombre de théoriciens - d'un ancien associé de V.I. Lénine L.D. Trotsky à M. Djilas, un marxiste yougoslave qualifié de renégat en URSS, le régime totalitaire, même s'il est initialement construit sur les idées de l'égalitarisme social, donne inévitablement naissance à une nouvelle classe dirigeante - l'élite bureaucratique, la nomenklatura. Au fil du temps, sa volonté de légaliser la richesse accumulée crée une couche dans la direction du régime totalitaire, pour qui l'idée socialiste devient un fardeau. Dans les régions, dans les localités, se constitue leur propre couche de l'oligarchie, pour laquelle le contrôle de ses activités par le centre du pouvoir s'avère être un obstacle à l'enrichissement, qui devient une source de tendances séparatistes.
Isolement sur la scène internationale. Le régime totalitaire soviétique, en raison de sa méfiance inhérente à l'égard des politiques des pays dominés par une idéologie différente, des aspirations à un contrôle complet sur toutes les sphères de la société, était très inquiet à l'égard de la coopération internationale. Les possibilités d'utiliser les avantages de la division internationale du travail, de la coopération scientifique, technique et humanitaire ont été volontairement limitées. Le désir d'auto-isolement a été alimenté par la politique de restriction des échanges menée par les pays occidentaux pendant la guerre froide, qui a également été un facteur d'essoufflement.
Initialement, avec l'arrivée au pouvoir dans les pays d'Europe de l'Est, les communistes, chacun d'eux, suivant le modèle soviétique, ont commencé à procéder à l'industrialisation, s'efforçant d'aller vers l'autosuffisance totale. Avec la création en 1949 du Conseil d'assistance économique mutuelle entre l'URSS et les pays d'Europe de l'Est, un système de division internationale du travail s'est formé, mais le rythme de son développement était inférieur à celui de l'Europe occidentale.
L'établissement de liens directs entre entreprises, la formation de firmes internationales dans des conditions où l'intégration se faisait dans le cadre et sur la base d'accords interétatiques, nécessitaient d'innombrables approbations et ne connaissaient pratiquement aucun développement. La planification du développement des relations commerciales extérieures avec l'établissement de prix fixes pour une période de cinq ans a conduit à la séparation des prix au sein du CAEM des prix mondiaux. Ainsi, avec une hausse des prix mondiaux de l'énergie après 1973, l'URSS a continué à les fournir à ses partenaires aux mêmes prix bas, au détriment de ses intérêts. Mais dans les années 1980. les prix du pétrole et du gaz soviétiques étaient supérieurs à la moyenne mondiale. Cela est déjà devenu une source de difficultés économiques dans les pays d'Europe de l'Est.
La faible efficacité de l'intégration dans le cadre du CMEA a intensifié l'insatisfaction cachée de ses participants à l'égard du modèle de relations établi. Les aspirations grandissaient, y compris parmi le plus grand pays du CAEM - l'URSS, à développer des liens commerciaux et économiques avec les pays très développés de l'Ouest, à acquérir les produits qu'ils produisent haute technologie, biens de consommation. La part des pays occidentaux dans le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'URSS en seulement 20 ans, de 1960 à 1980, a doublé - passant de 15% à 33,6%. Dans le même temps, il a été principalement acheté produits finis, au lieu d'établir sa coproduction, beaucoup plus rentable économiquement. (L'une des rares exceptions a été la création de l'usine automobile soviéto-italienne dans la ville de Togliatti, qui a commencé à produire des voitures Zhiguli.)
Si l'URSS en avait l'opportunité grâce à la vente de ressources naturelles, pétrole, gaz, qui dans les années 1970. devenu le principal dans ses exportations, pour mener un commerce équilibré avec les pays de l'Ouest, puis ses partenaires du CAEM ont très tôt fait face à une augmentation de la dette, de l'inflation, fragilisant les perspectives de développement.
Les difficultés des relations avec des pays qui étaient auparavant classés parmi les alliés fiables de l'URSS, dans le monde du socialisme, sapaient la confiance dans l'idéologie professée par le PCUS. Les affirmations selon lesquelles des relations d'un type nouveau se développaient entre les pays édifiant le socialisme semblaient peu convaincantes. Les frictions entre l'URSS et la Yougoslavie, le conflit entre l'URSS et la Chine, qui a dégénéré en affrontements à la frontière soviéto-chinoise, la guerre entre la Chine et le Vietnam en 1979, le mécontentement à l'égard du CAEM ont clairement montré que le socialisme totalitaire est très loin de la paix.
ANNEXE BIOGRAPHIQUE
N.S. Khrouchtchev(1894-1971) - successeur de I.V. Staline comme premier secrétaire du CE £ PCUS (1953-1964), en même temps président du Conseil des ministres de l'URSS (1958-1964).
N.S. Khrouchtchev est né dans le village de Kalinovka, province de Koursk, a travaillé comme berger, mécanicien dans les usines et les mines du Donbass. En 1918, il rejoint le parti bolchevique, participe à guerre civile. Diplômé de la faculté de travail de Donetsk institut industriel et a commencé à gravir rapidement les échelons de la hiérarchie du parti: du secrétaire de la cellule du parti de la faculté ouvrière au secrétaire du comité du parti de l'Académie industrielle (1929), puis - secrétaire du comité de district de Moscou, depuis 1934 - membre du Comité central du parti, chef de la ville de Moscou et des organisations régionales du parti. De 1938 à 1949, il a été le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d'Ukraine, en 1949-1953. - Secrétaire du Comité central du PCUS.
10Programme
... « Monderécit . Récit La Russie et le monde en XX- début XXI siècle", tutoriel pour 11 classe, M, " mot russe", 2009 NV Zagladin" MonderécitXXsiècle" ...