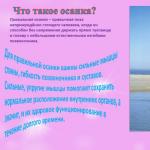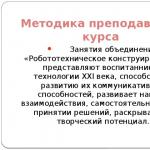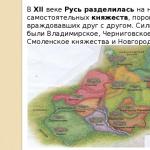Les États européens se sont formés à la fin du 20e début du 21e siècle. Les pays d'Europe occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle - début du XXIe siècle
La perestroïka en URSS a provoqué des processus similaires dans les pays d'Europe de l'Est. Pendant ce temps, la direction soviétique à la fin des années 80. a refusé de préserver les régimes qui existaient dans ces pays, au contraire, les appelant à la démocratisation. La direction a changé dans la plupart des partis au pouvoir. Mais les tentatives de la nouvelle direction pour mener à bien des réformes, comme en Union soviétique, ont échoué. La situation économique s'est aggravée, la fuite de la population vers l'Ouest s'est généralisée. Des forces d'opposition se sont formées, il y a eu des manifestations et des grèves partout. À la suite des manifestations d'octobre-novembre 1989 en RDA, le gouvernement a démissionné et le 9 novembre, la destruction du mur de Berlin a commencé. En 1990, la RDA et la RFA s'unifient.
Dans la plupart des pays, les communistes ont été chassés du pouvoir. Les partis au pouvoir se sont dissous ou transformés en partis sociaux-démocrates. Des élections ont eu lieu, au cours desquelles les anciens opposants ont gagné. Ces événements ont été appelés "révolutions de velours". Cependant, les révolutions n'étaient pas partout "de velours". En Roumanie, les opposants au chef de l'État, Nicolae Ceausescu, ont organisé un soulèvement en décembre 1989, à la suite duquel de nombreuses personnes sont mortes. Ceausescu et sa femme ont été tués. Des événements dramatiques ont eu lieu en Yougoslavie, où les élections dans toutes les républiques à l'exception de la Serbie et du Monténégro ont été remportées par des partis opposés aux communistes. En 1991, la Slovénie, la Croatie et la Macédoine ont déclaré leur indépendance. En Croatie, une guerre a immédiatement commencé entre Serbes et Croates, car les Serbes craignaient la persécution qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale par les fascistes croates Ustaše. Initialement, les Serbes ont créé leurs propres républiques, mais en 1995, ils ont été capturés par les Croates avec le soutien des pays occidentaux, et la plupart des Serbes ont été exterminés ou expulsés.
En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance. La Serbie et le Monténégro ont formé la République fédérale de Yougoslavie (RFY).
En Bosnie-Herzégovine, une guerre interethnique a éclaté entre Serbes, Croates et Musulmans. Aux côtés des Musulmans de Bosnie et des Croates, les forces armées des pays de l'OTAN sont intervenues. La guerre s'est poursuivie jusqu'à la fin de 1995, lorsque les Serbes ont été contraints de succomber à la pression des forces supérieures de l'OTAN.
L'Etat de Bosnie-Herzégovine est désormais divisé en deux parties : la Republika Srpska et la fédération croato-musulmane. Les Serbes ont perdu une partie de leurs terres.
En 1998, un conflit ouvert a éclaté entre Albanais et Serbes au Kosovo, qui faisait partie de la Serbie. L'extermination et l'expulsion des Serbes par les extrémistes albanais ont forcé les autorités yougoslaves à entrer dans une lutte armée contre eux. Cependant, en 1999, l'OTAN a commencé à bombarder la Yougoslavie. L'armée yougoslave a été contrainte de quitter le Kosovo, dont le territoire était occupé par les troupes de l'OTAN. La majeure partie de la population serbe a été détruite et expulsée de la région. Le 17 février 2008, le Kosovo, avec le soutien de l'Occident, a déclaré unilatéralement et illégalement son indépendance.
Après le renversement du président Slobodan Milosevic en 2000 lors de la « révolution de couleur », la désintégration de la RFY s'est poursuivie. En 2003, l'État confédéral de Serbie-et-Monténégro a été formé. En 2006, le Monténégro a fait sécession et deux États indépendants ont émergé : la Serbie et le Monténégro.
L'effondrement de la Tchécoslovaquie s'est déroulé pacifiquement. Après un référendum, il a été divisé en 1993 entre la République tchèque et la Slovaquie.
Après des changements politiques dans tous les pays d'Europe de l'Est, des transformations ont commencé dans l'économie et d'autres sphères de la société. Partout ils ont abandonné l'économie planifiée, passant à la restauration des relations de marché. La privatisation a été réalisée, le capital étranger a reçu des positions fortes dans l'économie. Les premières transformations sont entrées dans l'histoire sous le nom de « thérapie de choc », car elles étaient associées à une baisse de la production, un chômage de masse, une inflation, etc. Des changements particulièrement radicaux à cet égard ont eu lieu en Pologne. La stratification sociale s'est intensifiée partout, la criminalité et la corruption ont augmenté.
Vers la fin des années 90. la situation dans la plupart des pays s'est quelque peu stabilisée. L'inflation a été surmontée, la croissance économique a commencé. La République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont obtenu un certain succès. Les investissements étrangers y ont joué un grand rôle. Peu à peu, les liens traditionnels mutuellement bénéfiques avec la Russie et d'autres États post-soviétiques ont également été rétablis. Mais la crise économique mondiale qui a débuté en 2008 a eu des conséquences dévastatrices pour les économies des pays d'Europe de l'Est.
En politique étrangère, tous les pays d'Europe de l'Est sont guidés par l'Occident, la plupart d'entre eux au début du XXIe siècle. rejoint l'OTAN et l'UE. La situation politique interne de ces pays est caractérisée par un changement de pouvoir entre les partis de droite et de gauche. Cependant, leurs politiques tant à l'intérieur du pays que sur la scène internationale coïncident largement.
La période considérée a été paisible et stable pour les pays d'Europe occidentale et les États-Unis par rapport à la première moitié du siècle, qui a connu plusieurs guerres européennes et deux guerres mondiales, deux séries d'événements révolutionnaires. Le développement dominant de ce groupe d'États dans la seconde moitié du XXe siècle. considéré comme un progrès significatif sur la voie du progrès scientifique et technologique, la transition de la société industrielle à la société post-industrielle. Cependant, même au cours de ces décennies, les pays du monde occidental ont été confrontés à un certain nombre de problèmes complexes, de crises, de bouleversements - tout cela s'appelle "les défis du temps". Il s'agissait d'événements et de processus à grande échelle dans divers domaines, tels que la révolution technologique et de l'information, l'effondrement des empires coloniaux, les crises économiques mondiales de 1974-1975. et 1980-1982, les performances sociales des années 60-70. XXe siècle, mouvements séparatistes, etc. Tous ont exigé une sorte de restructuration des relations économiques et sociales, le choix des voies de développement ultérieur, des compromis ou un durcissement des cours politiques. À cet égard, diverses forces politiques ont été remplacées au pouvoir, principalement des conservateurs et des libéraux, qui ont tenté de renforcer leurs positions dans un monde en mutation.
Les premières années d'après-guerre dans les pays européens sont devenues une période de lutte acharnée, principalement autour de questions de structure sociale, les fondements politiques des États. Dans un certain nombre de pays, par exemple en France, il a fallu surmonter les conséquences de l'occupation et des activités des gouvernements collaborationnistes. Et pour l'Allemagne, l'Italie, il s'agissait de l'élimination complète des vestiges du nazisme et du fascisme, de la création de nouveaux États démocratiques. D'importantes batailles politiques se sont déroulées autour des élections aux assemblées constituantes, de l'élaboration et de l'adoption de nouvelles constitutions. En Italie, par exemple, les événements liés au choix d'une forme d'État monarchique ou républicaine sont entrés dans l'histoire comme une « bataille pour la république » (le pays a été proclamé république à la suite d'un référendum le 18 juin 1946 ).
C'est alors que se sont déclarées les forces qui ont participé le plus activement à la lutte pour le pouvoir et l'influence dans la société au cours des décennies suivantes. Sur le flanc gauche se trouvaient les sociaux-démocrates et les communistes. Au stade final de la guerre (surtout après 1943, lorsque le Komintern a été dissous), les membres de ces partis ont collaboré au mouvement de résistance, plus tard - dans les premiers gouvernements d'après-guerre (en France en 1944, un comité de conciliation des communistes et des socialistes a été créé, en Italie en 1946. un accord sur l'unité d'action a été signé). Des représentants des deux partis de gauche faisaient partie des gouvernements de coalition en France en 1944-1947, en Italie en 1945-1947. Mais les différences fondamentales entre les partis communistes et socialistes ont persisté, de plus, dans les années d'après-guerre, de nombreux partis sociaux-démocrates ont exclu de leurs programmes la tâche d'établir la dictature du prolétariat, ont adopté le concept de société sociale, en substance, sont passés au libéral postes.
Dans le camp conservateur depuis le milieu des années 40. les partis qui combinaient la représentation des intérêts des grands industriels et financiers avec la promotion des valeurs chrétiennes comme durables et unissant différentes couches sociales de fondements idéologiques sont devenus les plus influents. Il s'agit notamment du Parti chrétien-démocrate (CDP) en Italie (fondé en 1943), du Mouvement républicain du peuple (MPM) en France (fondé en 1945), de l'Union chrétienne-démocrate (depuis 1945 - CDU, avec 1950 - bloc CDU/CSU) en Allemagne. Ces partis cherchaient à gagner un large soutien dans la société et mettaient l'accent sur l'adhésion aux principes de la démocratie. Ainsi, le premier programme de la CDU (1947) comportait les mots d'ordre de « socialisation » d'un certain nombre de branches de l'économie, de « complicité » des ouvriers dans la gestion des entreprises, reflétant l'esprit de l'époque. Et en Italie, lors d'un référendum en 1946, la majorité des membres du CDA ont voté pour une république, pas pour une monarchie. L'affrontement entre les partis de droite, conservateurs et de gauche, socialistes, a constitué la ligne principale de l'histoire politique des pays d'Europe occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle. En même temps, on peut remarquer comment l'évolution de la situation économique et sociale de certaines années a déplacé le pendule politique soit vers la gauche, soit vers la droite.
De la reprise à la stabilité (1945-1950)
Après la fin de la guerre, des gouvernements de coalition ont été établis dans la plupart des pays d'Europe occidentale, dans lesquels des représentants des forces de gauche - socialistes et, dans certains cas, communistes - ont joué un rôle décisif. Les principales activités de ces gouvernements étaient la restauration des libertés démocratiques, le nettoyage de l'appareil d'État des membres du mouvement fasciste, des personnes qui ont collaboré avec les envahisseurs. L'étape la plus importante dans le domaine économique a été la nationalisation d'un certain nombre de secteurs de l'économie et d'entreprises. En France, les 5 plus grandes banques, l'industrie charbonnière, les usines automobiles Renault (dont le propriétaire a collaboré avec le régime d'occupation) et plusieurs entreprises aéronautiques ont été nationalisées. La part du secteur public dans la production industrielle a atteint 20-25 %. Au Royaume-Uni, où il était au pouvoir en 1945-1951. Les travaillistes étaient dans l'électricité, les centrales électriques, les industries du charbon et du gaz, les chemins de fer, les transports, les compagnies aériennes individuelles, les aciéries passées aux mains de l'État. En règle générale, celles-ci étaient importantes, mais loin d'être les entreprises les plus prospères et les plus rentables, au contraire, elles nécessitaient d'importants investissements en capital. En outre, les anciens propriétaires des entreprises nationalisées ont reçu d'importantes compensations. Néanmoins, la nationalisation et la réglementation par l'État étaient considérées par les dirigeants sociaux-démocrates comme la plus haute réalisation sur la voie d'une «économie sociale».
Constitutions adoptées dans les pays d'Europe occidentale dans la seconde moitié des années 40. - en 1946 en France (la constitution de la IVe République), en 1947 en Italie (entrée en vigueur le 1er janvier 1948), en 1949 en Allemagne de l'Ouest, sont devenues les constitutions les plus démocratiques de l'histoire de ces pays. Ainsi, dans la constitution française de 1946, outre les droits démocratiques, les droits au travail, au repos, à la sécurité sociale, à l'instruction, les droits des travailleurs à participer à la gestion des entreprises, aux activités syndicales et politiques, le droit de grève » dans le cadre des lois », etc. ont été proclamées.
Conformément aux dispositions des constitutions, de nombreux pays ont créé des systèmes d'assurance sociale qui comprenaient des pensions, des prestations de maladie et de chômage et une aide aux familles nombreuses. Une semaine de 40 à 42 heures a été établie, des congés payés ont été introduits. Cela a été fait en grande partie sous la pression des travailleurs. Par exemple, en Angleterre en 1945, 50 000 dockers se sont mis en grève pour obtenir une réduction de la semaine de travail à 40 heures et l'introduction de deux semaines de congés payés.
Les années 1950 ont constitué une période particulière dans l'histoire des pays d'Europe occidentale. C'était une époque de développement économique rapide (la croissance de la production industrielle atteignait 5 à 6% par an). L'industrie d'après-guerre a été créée en utilisant de nouvelles machines et technologies. Une révolution scientifique et technologique a commencé, dont l'une des principales manifestations a été l'automatisation de la production. Les qualifications des travailleurs qui exploitaient des lignes et des systèmes automatiques ont augmenté, et leurs salaires ont également augmenté.
Au Royaume-Uni, le niveau des salaires dans les années 50. augmenté en moyenne de 5% par an avec une augmentation des prix de 3% par an. en Allemagne dans les années 1950. les salaires réels ont doublé. Certes, dans certains pays, par exemple en Italie, en Autriche, les chiffres n'étaient pas si significatifs. De plus, les gouvernements « gelaient » périodiquement les salaires (interdisaient leur augmentation). Cela a provoqué des protestations et des grèves des travailleurs.
La reprise économique a été particulièrement notable en République fédérale d'Allemagne et en Italie. Dans les années d'après-guerre, l'économie ici s'est ajustée plus difficilement et plus lentement que dans d'autres pays. Dans ce contexte, la situation dans les années 1950 considéré comme un "miracle économique". Elle est devenue possible grâce à la restructuration de l'industrie sur de nouvelles bases technologiques, la création de nouvelles industries (pétrochimie, électronique, production de fibres synthétiques, etc.) et l'industrialisation des régions agraires. L'aide américaine dans le cadre du plan Marshall a été une aide importante. Une condition favorable à l'augmentation de la production était que, dans les années d'après-guerre, il y avait une forte demande pour divers produits manufacturés. En revanche, il existait une importante réserve de main-d'œuvre bon marché (aux dépens des immigrés, des gens du village).
La reprise économique s'est accompagnée d'une stabilité sociale. Dans des conditions de chômage réduit, de stabilité relative des prix et d'augmentation des salaires, les protestations ouvrières ont été réduites au minimum. Leur croissance a commencé à la fin des années 1950, lorsque certaines des conséquences négatives de l'automatisation sont apparues - suppressions d'emplois, etc.
La période de développement stable a coïncidé avec l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Ainsi, en Allemagne, le nom de K. Adenauer, qui a occupé le poste de chancelier en 1949-1963, était associé à la renaissance de l'État allemand, et L. Erhard était appelé le "père du miracle économique". Les chrétiens-démocrates gardaient en partie la façade de la « politique sociale », ils parlaient de société de bien-être, de garanties sociales pour les travailleurs. Mais l'intervention de l'État dans l'économie a été réduite. En Allemagne, la théorie de «l'économie sociale de marché» a été établie, axée sur le soutien de la propriété privée et de la libre concurrence. En Angleterre, les gouvernements conservateurs de W. Churchill puis d'A. Eden ont procédé à la reprivatisation de certaines industries et entreprises auparavant nationalisées (transports automobiles, aciéries, etc.). Dans de nombreux pays, avec l'arrivée au pouvoir des conservateurs, une offensive a commencé sur les droits et libertés politiques proclamés après la guerre, des lois ont été adoptées conformément auxquelles les citoyens ont été persécutés pour des raisons politiques et le Parti communiste a été interdit en Allemagne.
Changements dans les années 60
Après une décennie de stabilité dans la vie des États d'Europe occidentale, une période de bouleversements et de changements s'est ouverte, liée à la fois aux problèmes de développement interne et à l'effondrement des empires coloniaux.
Donc, en France à la fin des années 50. il y avait une situation de crise provoquée par les changements fréquents de gouvernements des socialistes et des radicaux, l'effondrement de l'empire colonial (la perte de l'Indochine, de la Tunisie et du Maroc, la guerre d'Algérie) et la détérioration de la situation des travailleurs. Dans une telle situation, l'idée de "puissance forte", dont un partisan actif était le général Charles de Gaulle, a reçu de plus en plus de soutien. En mai 1958, le commandement des troupes françaises à Alger refuse d'obéir au gouvernement jusqu'au retour de Charles de Gaulle. Le général s'est déclaré « prêt à prendre le pouvoir de la République » à condition que la constitution de 1946 soit abrogée et que des pouvoirs d'urgence lui soient accordés. À l'automne 1958, la constitution de la Ve République est adoptée, qui accorde au chef de l'État les droits les plus étendus et, en décembre, de Gaulle est élu président de la France. Ayant établi un "régime de pouvoir personnel", il a cherché à résister aux tentatives d'affaiblir l'État de l'intérieur et de l'extérieur. Mais sur la question des colonies, étant un homme politique réaliste, il a vite décidé qu'il valait mieux procéder à la décolonisation "d'en haut", tout en maintenant l'influence dans les anciennes possessions, que d'attendre une expulsion honteuse, par exemple, d'Algérie, qui luttait pour l'indépendance. La volonté de De Gaulle de reconnaître le droit des Algériens de décider de leur propre sort a provoqué une mutinerie militaire anti-gouvernementale en 1960. Tous en 1962, l'Algérie accède à l'indépendance.
Dans les années 60. dans les pays européens, les discours de différents segments de la population sous différents slogans sont devenus plus fréquents. en France en 1961-1962. des manifestations et des grèves sont organisées pour réclamer la fin de la rébellion des forces ultra-colonialistes opposées à l'octroi de l'indépendance à l'Algérie. En Italie, il y a eu des manifestations de masse contre l'activation des néo-fascistes. Les travailleurs ont présenté des revendications à la fois économiques et politiques. La lutte pour des salaires plus élevés comprenait des "cols blancs" - des travailleurs hautement qualifiés, des employés.
Le point culminant de l'action sociale durant cette période fut les événements de mai-juin 1968 en France. Commençant comme une protestation des étudiants parisiens réclamant la démocratisation du système d'enseignement supérieur, ils se sont rapidement transformés en manifestations de masse et en grève générale (le nombre de grévistes dans le pays dépassait les 10 millions de personnes). Les ouvriers d'un certain nombre d'usines automobiles "Renault" occupaient leurs entreprises. Le gouvernement a été contraint de faire des concessions. Les grévistes ont obtenu une augmentation de 10 à 19% des salaires, une augmentation des vacances et l'expansion des droits syndicaux. Ces événements se sont avérés être un test sérieux pour les autorités. En avril 1969, le président de Gaulle soumet à référendum un projet de loi sur la réorganisation de l'autonomie locale, mais la majorité des votants rejette le projet de loi. Après cela, Charles de Gaulle a démissionné. En juin 1969, un représentant du parti gaulliste, J. Pompidou, est élu nouveau président du pays.
L'année 1968 est marquée par une aggravation de la situation en Irlande du Nord, où le mouvement des droits civiques devient plus actif. Les affrontements entre les représentants de la population catholique et la police ont dégénéré en un conflit armé, qui a impliqué à la fois des groupes extrémistes protestants et catholiques. Le gouvernement a amené des troupes en Ulster. La crise, tantôt aggravante, tantôt fragilisante, s'éternise pendant trois décennies.
Une vague d'action sociale a conduit à des changements politiques dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Beaucoup d'entre eux dans les années 60. Les partis sociaux-démocrates et socialistes sont arrivés au pouvoir. En Allemagne, fin 1966, des représentants du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) rejoignent le gouvernement de coalition avec la CDU/CSU, et à partir de 1969 ils forment eux-mêmes le gouvernement en bloc avec le Parti libéral-démocrate (FDP). En Autriche en 1970-1971. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le Parti socialiste arrive au pouvoir. En Italie, la base des gouvernements d'après-guerre était le Parti chrétien-démocrate (CDA), qui entra en coalition avec les partis de gauche, puis avec la droite. Dans les années 60. ses partenaires étaient la gauche - les sociaux-démocrates et les socialistes. Le leader des sociaux-démocrates, D. Saragat, a été élu président du pays.
Malgré les différences de situation dans les différents pays, la politique des sociaux-démocrates avait des caractéristiques communes. Leur principale "tâche sans fin", ils considéraient la création d'une "société sociale", dont les principales valeurs étaient proclamées liberté, justice, solidarité. Ils se considéraient comme des représentants des intérêts non seulement des travailleurs, mais aussi d'autres couches de la population (à partir des années 70-80, ces partis ont commencé à s'appuyer sur les soi-disant "nouvelles couches moyennes" - l'intelligentsia scientifique et technique, employés). Dans le domaine économique, les sociaux-démocrates prônaient une combinaison de différentes formes de propriété - privée, étatique, etc. La principale disposition de leurs programmes était la thèse de la régulation étatique de l'économie. L'attitude envers le marché était exprimée par la devise: "Concurrence - autant que possible, planification - autant que nécessaire". Une importance particulière était attachée à la "participation démocratique" des travailleurs à la solution des questions d'organisation de la production, des prix et des salaires.
En Suède, où les sociaux-démocrates étaient au pouvoir depuis plusieurs décennies, le concept de « socialisme fonctionnel » a été formulé. Il était supposé que le propriétaire privé ne devait pas être privé de sa propriété, mais devait être progressivement impliqué dans l'exercice des fonctions publiques par la redistribution des bénéfices. L'État en Suède possédait environ 6% de la capacité de production, mais la part de la consommation publique dans le produit national brut (PNB) au début des années 70. était d'environ 30 %.
Les gouvernements sociaux-démocrates et socialistes ont alloué des fonds importants à l'éducation, aux soins de santé et à la sécurité sociale. Pour réduire le taux de chômage, des programmes spéciaux de formation et de recyclage de la main-d'œuvre ont été adoptés. Les progrès dans la résolution des problèmes sociaux ont été l'une des réalisations les plus importantes des gouvernements sociaux-démocrates. Cependant, les conséquences négatives de leur politique sont rapidement apparues - "surréglementation" excessive, bureaucratisation de la gestion publique et économique, surpression du budget de l'État. Une partie de la population a commencé à affirmer la psychologie de la dépendance sociale, lorsque les personnes, ne travaillant pas, s'attendaient à recevoir sous forme d'aide sociale autant que celles qui travaillaient dur. Ces "coûts" ont attiré les critiques des forces conservatrices.
Un aspect important des activités des gouvernements sociaux-démocrates des États d'Europe occidentale a été le changement de politique étrangère. Des mesures particulièrement importantes dans ce sens ont été prises en République fédérale d'Allemagne. Le gouvernement arrivé au pouvoir en 1969, dirigé par le chancelier W. Brandt (SPD) et le vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères W. Scheel (FDP), a opéré un tournant fondamental dans l'"Ostpolitik", concluant en 1970-1973. traités bilatéraux avec l'URSS, la Pologne, la Tchécoslovaquie, confirmant l'inviolabilité des frontières entre la RFA et la Pologne, la RFA et la RDA. Ces traités, ainsi que les accords quadripartites sur Berlin-Ouest, signés par des représentants de l'URSS, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France en septembre 1971, ont créé une véritable base pour développer les contacts internationaux et la compréhension mutuelle en Europe. 4. La chute des régimes autoritaires au Portugal, en Grèce, en Espagne. Au milieu des années 70. Des changements politiques importants ont eu lieu dans les États du sud-ouest et du sud de l'Europe.
Au Portugal, à la suite de la révolution d'avril 1974, le régime autoritaire a été renversé. Le bouleversement politique mené par le Mouvement des forces armées dans la capitale a entraîné un changement de pouvoir sur le terrain. Les premiers gouvernements post-révolutionnaires (1974-1975), qui se composaient des dirigeants du Mouvement des forces armées et des communistes, se sont concentrés sur les tâches de défashisation et d'établissement d'ordres démocratiques, la décolonisation des possessions africaines du Portugal, la réforme agraire, l'adoption d'une nouvelle constitution du pays, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. La nationalisation des plus grandes entreprises et banques a été réalisée, le contrôle ouvrier a été introduit. Plus tard, le bloc de droite Alliance démocratique (1979-1983) est arrivé au pouvoir, qui a tenté de freiner les transformations qui avaient commencé plus tôt, puis le gouvernement de coalition des partis socialistes et sociaux-démocrates, dirigé par le chef des socialistes M. Soares (1983-1985).
En Grèce, en 1974, le régime des "colonels noirs" a été remplacé par un gouvernement civil, composé de représentants de la bourgeoisie conservatrice. Il n'a pas apporté de changements majeurs. En 1981 -1989. et depuis 1993, le parti du Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) était au pouvoir, un cours de démocratisation du système politique et de réformes sociales a été poursuivi.
En Espagne, après la mort de F. Franco en 1975, le roi Juan Carlos I est devenu le chef de l'État.Avec son approbation, la transition d'un régime autoritaire à un régime démocratique a commencé. Le gouvernement dirigé par A. Suarez rétablit les libertés démocratiques et lève l'interdiction des activités des partis politiques. En décembre 1978, une constitution est adoptée proclamant l'Espagne État social et de droit. Depuis 1982, le Parti socialiste ouvrier espagnol est au pouvoir, son leader F. Gonzalez a dirigé le gouvernement du pays. Une attention particulière a été accordée aux mesures visant à accroître la production et à créer des emplois. Dans la première moitié des années 1980. le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sociales importantes (réduction de la semaine de travail, augmentation des congés, adoption de lois élargissant les droits des travailleurs dans les entreprises, etc.). Le parti aspirait à la stabilité sociale, à la réalisation du consentement entre les différentes couches de la société espagnole. Le résultat de la politique des socialistes, qui étaient au pouvoir sans interruption jusqu'en 1996, a été l'achèvement de la transition pacifique de la dictature à une société démocratique.
Néoconservateurs et libéraux dans les dernières décennies du XXe - début du XXIe siècle.
Crise de 1974-1975 a sérieusement compliqué la situation économique et sociale dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Des changements étaient nécessaires, une restructuration de l'économie. Il n'y avait pas de ressources pour cela dans le cadre de la politique économique et sociale existante, la régulation étatique de l'économie n'a pas fonctionné. Les conservateurs ont essayé de donner une réponse au défi du temps. Leur focalisation sur une économie de marché libre, l'entreprise privée et l'initiative était bien alignée avec le besoin objectif d'investissements massifs dans la production.
Fin des années 70 - début des années 80. les conservateurs sont arrivés au pouvoir dans de nombreux pays occidentaux. En 1979, le Parti conservateur remporte les élections législatives en Grande-Bretagne, le gouvernement est dirigé par M. Thatcher (le parti reste au pouvoir jusqu'en 1997) En Allemagne, une coalition de la CDU/CSU et du FDP arrive au pouvoir, G. Kohl a pris le poste de chancelier. Le règne à long terme des sociaux-démocrates dans les pays d'Europe du Nord a été interrompu. Ils ont été défaits aux élections de 1976 en Suède et au Danemark, en 1981 en Norvège.
Les personnalités arrivées au pouvoir durant cette période n'ont pas été en vain appelées les nouveaux conservateurs. Ils ont montré qu'ils pouvaient aller de l'avant et qu'ils étaient capables de changer. Ils se distinguaient par leur flexibilité politique et leur affirmation de soi, leur attrait pour la population en général. Ainsi, les conservateurs britanniques, menés par M. Thatcher, se sont prononcés pour la défense des "vraies valeurs de la société britannique", qui incluaient la diligence et l'économie ; négligence des paresseux; l'indépendance, l'autonomie et la recherche de la réussite individuelle ; le respect des lois, de la religion, des fondements de la famille et de la société ; contribuer à la préservation et à l'amélioration de la grandeur nationale de la Grande-Bretagne. Les slogans de la création d'une "démocratie des propriétaires" ont également été utilisés.
Les principales composantes de la politique des néoconservateurs étaient la privatisation du secteur public et la réduction de la régulation étatique de l'économie ; cours vers une économie de marché libre; coupes dans les dépenses sociales; réduction des impôts sur le revenu (ce qui a contribué à la revitalisation de l'activité entrepreneuriale). La péréquation et le principe de redistribution des profits ont été rejetés dans la politique sociale. Les premiers pas des néoconservateurs dans le domaine de la politique étrangère ont conduit à un nouveau cycle de course aux armements, à une aggravation de la situation internationale (une manifestation éclatante en a été la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Argentine au sujet des îles Falkland en 1983).
L'encouragement de l'entrepreneuriat privé, le cap vers la modernisation de la production ont contribué au développement dynamique de l'économie, sa restructuration en fonction des besoins de la révolution de l'information en cours. Ainsi, les conservateurs ont prouvé qu'ils étaient capables de transformer la société. En Allemagne, l'événement historique le plus important a été ajouté aux réalisations de cette période - l'unification de l'Allemagne en 1990, à laquelle la participation a placé G. Kohl parmi les personnages les plus importants de l'histoire allemande. Parallèlement, pendant les années de régime conservateur, les protestations de divers groupes de la population pour les droits sociaux et civiques ne se sont pas arrêtées (dont la grève des mineurs britanniques en 1984-1985, les protestations en RFA contre le déploiement de missiles américains, etc.).
À la fin des années 90. Dans de nombreux pays européens, les conservateurs ont été remplacés par des libéraux. En 1997, le gouvernement travailliste dirigé par E. Blair est arrivé au pouvoir en Grande-Bretagne, et en France, suite aux résultats des élections législatives, un gouvernement a été formé de représentants des partis de gauche. En 1998, le leader du Parti social-démocrate, G. Schroeder, est devenu chancelier d'Allemagne. En 2005, il est remplacé comme chancelier par la représentante du bloc CDU/CSU A. Merkel, qui dirige le gouvernement de « grande coalition », composé de représentants des chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates. Encore plus tôt en France, le gouvernement de gauche a été remplacé par un gouvernement de droite. Cependant, au milieu des années 10. 21e siècle en Espagne et en Italie, les gouvernements de droite, à la suite d'élections parlementaires, ont été contraints de céder le pouvoir à des gouvernements dirigés par des socialistes.
À l'été 1980, les travailleurs ont commencé à manifester en Pologne, dont la raison était une nouvelle augmentation des prix. Peu à peu, ils ont couvert les villes de la côte nord du pays. A Gdansk, sur la base d'un comité de grève interusine, l'association syndicale "Solidarité" a été constituée.
Sous la bannière de la Solidarité
Ses participants ont présenté "21 demandes" aux autorités. Ce document contenait des revendications à la fois économiques et politiques, notamment : reconnaître des syndicats libres indépendants de l'État et le droit de grève des travailleurs, mettre fin à la persécution pour leurs convictions, élargir l'accès des organisations publiques et religieuses aux médias, etc. Le chef de la commission panpolonaise de l'association syndicale "Solidarité", un électricien L. Walesa a été élu.
L'influence croissante de l'association syndicale et son début de développement en un mouvement politique ont incité le gouvernement à introduire la loi martiale dans le pays en décembre 1981. Les activités de Solidarité sont interdites, ses dirigeants sont internés (assignés à résidence). Mais les autorités n'ont pas pu éliminer la crise imminente.
En juin 1989, des élections parlementaires se sont tenues en Pologne sur une base multipartite. Ils ont gagné "Solidarité". Le nouveau gouvernement de coalition était dirigé par le représentant de "Solidarité" T. Mazowiecki. En décembre 1990, L. Walesa est élu président du pays.
Lech Walesa est né en 1943 dans une famille paysanne. Il est diplômé de l'école de mécanisation agricole, a commencé à travailler comme électricien. En 1967, il entre au chantier naval comme électricien. Lénine à Gdansk. En 1970 et 1979-1980. - membre du comité de grève du chantier naval. Un des organisateurs et dirigeants du syndicat Solidarité. En décembre 1981 il est interné, en 1983 il retourne au chantier naval comme électricien. En 1990-1995 - Président de la République de Pologne. Le destin politique extraordinaire de L. Walesa a été généré à la fois par le temps et par les qualités personnelles de cette personne. Les publicistes ont noté qu'il était un " Polonais typique ", un catholique profondément croyant, un père de famille. En même temps, ce n'est pas un hasard s'il a été appelé "l'homme de fer flexible". Il se distinguait non seulement par ses capacités prononcées de combattant politique et d'orateur, mais aussi par sa capacité à choisir sa propre voie, à accomplir des actions que ni ses adversaires ni ses compagnons d'armes n'attendaient de lui.
1989-1990 : grands changements
Panorama des événements
- Août 1989- Le premier gouvernement de solidarité en Pologne est formé.
- Novembre - Décembre 1989- manifestations massives de la population et déplacement de la direction communiste en RDA, Tchécoslovaquie, Roumanie, Bulgarie.
- En juin 1990à la suite d'élections multipartites dans tous les pays d'Europe de l'Est (à l'exception de l'Albanie), de nouveaux gouvernements et dirigeants sont arrivés au pouvoir.
- mars - avril 1991- Les premières élections législatives multipartites en Albanie, depuis juin un gouvernement de coalition est au pouvoir.
En moins de deux ans, le pouvoir a changé dans huit pays d'Europe de l'Est. Pourquoi est-ce arrivé ainsi ? Cette question peut être posée pour chaque pays séparément. On pourrait aussi se demander : pourquoi cela s'est-il produit dans tous les pays presque en même temps ?
Considérons des situations spécifiques.
République démocratique allemande
Dates et événements
1989
- Octobre- des manifestations anti-gouvernementales de masse dans différentes villes, leur dispersion, les arrestations de participants, la montée d'un mouvement social pour le renouvellement du système existant.
- 9 novembre- Le mur de Berlin est tombé.
- Fin novembre plus de 100 partis politiques et mouvements sociaux ont émergé dans le pays.
- le 1er décembre- L'article 1 de la Constitution de la RDA (sur le rôle dirigeant du Parti socialiste unifié d'Allemagne) a été aboli.
- Décembre- la sortie massive des membres du SED du parti, en janvier 1990, sur les 2,3 millions précédents, 1,1 million de personnes restaient dans le parti.
- 10-11 et 16-17 décembre- Congrès extraordinaire du SED, sa transformation en Parti du socialisme démocratique.

Chute du Mur de Berlin
1990
- Mars- élections législatives, victoire du bloc conservateur "Alliance pour l'Allemagne" dirigé par l'Union chrétienne-démocrate.
- Avril- Un gouvernement de « grande coalition » est formé, dont la moitié des postes sont occupés par des représentants de la CDU.
- 1er juillet- l'accord entre la RDA et la RFA sur l'union économique, monétaire et sociale est entré en vigueur.
- 3 octobre Le traité d'unification allemande est entré en vigueur.
Tchécoslovaquie
Événements nommés d'après "révolution de velours", a commencé le 17 novembre 1989. Ce jour-là, des étudiants ont organisé une manifestation à Prague à l'occasion du 50e anniversaire du discours anti-nazi des étudiants tchèques pendant les années d'occupation allemande. Au cours de la manifestation, des revendications ont été faites pour la démocratisation de la société et la démission du gouvernement. Les forces de l'ordre ont dispersé la manifestation, arrêté certains des participants et plusieurs personnes ont été blessées.

19 novembre une manifestation de protestation a eu lieu à Prague avec des slogans antigouvernementaux, des appels à la grève. Le même jour, le Forum civil a été créé - un mouvement public qui a présenté des demandes pour retirer un certain nombre de dirigeants de pays de leurs postes, et le Parti socialiste (dissous en 1948) a également été rétabli. Soutenant le tollé général, les théâtres de Prague, dont le Théâtre national, ont annulé des représentations.
20 novembreà Prague, une manifestation de 150 000 personnes a eu lieu sous le slogan "Fin du règne d'un parti !", des manifestations ont commencé dans différentes villes de la République tchèque et de la Slovaquie.
Le gouvernement a dû entamer des négociations avec des représentants du Forum civil. Le Parlement a abrogé des articles de la Constitution sur le rôle dirigeant du Parti communiste dans la société et le rôle déterminant du marxisme-léninisme dans l'éducation et l'éducation. Le 10 décembre, un gouvernement de coalition a été créé, qui comprenait les communistes, des représentants du Forum civil, des partis socialiste et populaire. Quelque temps plus tard, A. Dubcek est devenu le président de l'Assemblée fédérale (parlement). V. Havel a été élu président du pays.

Václav Havel né en 1936. A reçu une formation économique. Dans les années 1960, il commence à travailler au théâtre et se fait connaître comme dramaturge et écrivain. Membre du "Printemps de Prague" en 1968. Après 1969, il est privé de la possibilité d'exercer son métier, travaille comme ouvrier. Entre 1970 et 1989, il a été emprisonné trois fois pour des raisons politiques. Depuis novembre 1989 - l'un des dirigeants du Forum civil. En 1989-1992 - Président de la République tchécoslovaque. Depuis 1993 - le premier président de la République tchèque nouvellement formée (il a occupé ce poste en 1993-2003).
Roumanie
Alors que de sérieux changements avaient déjà eu lieu dans les pays voisins, en Roumanie, du 20 au 24 novembre 1989, se tenait le XIVe Congrès du Parti communiste. Le rapport de cinq heures du secrétaire général du Parti, Nicolae Ceausescu, sur les succès obtenus, a été accueilli par des applaudissements sans fin. Les slogans "Ceaucescu et le peuple !", "Ceausescu - le communisme !" résonnent dans la salle. Avec une joie orageuse, le congrès a accueilli l'annonce de l'élection de Ceausescu à son poste pour un nouveau mandat.
D'après des publications dans des journaux roumains de l'époque :
« Aux forces impérialistes, qui multiplient les efforts pour saper et déstabiliser le socialisme, en parlant de sa « crise », nous répondons par des actes : le pays tout entier s'est transformé en un immense chantier et un jardin fleuri. Et c'est parce que le socialisme roumain est le socialisme du travail libre, et non du "marché", qu'il ne laisse pas au hasard les problèmes cardinaux du développement et ne comprend pas l'amélioration, le renouveau, la perestroïka comme la restauration des formes capitalistes.
"L'engagement unanime à la décision de réélire le camarade N. Ceausescu au poste de secrétaire général du PCR est un vote politique pour la poursuite de la voie constructive éprouvée, ainsi que la reconnaissance de l'exemple héroïque d'un révolutionnaire et patriote, le chef de notre parti et de notre État. Avec tout le peuple roumain, les écrivains, avec un sens de pleine responsabilité, se joignent à la proposition de réélire le camarade N. Ceausescu au poste de chef de notre parti.
Un mois plus tard, le 21 décembre, lors d'un rassemblement officiel dans le centre de Bucarest, au lieu de toasts, des cris de "A bas Ceausescu!" ont été entendus de la foule. Les actions des unités de l'armée dirigées contre les manifestants ont rapidement cessé. Réalisant que la situation était hors de contrôle, N. Ceausescu et son épouse E. Ceausescu (un chef de parti bien connu) ont fui Bucarest. Le lendemain, ils ont été arrêtés et jugés par un tribunal tenu au secret le plus strict. Le 26 décembre 1989, les médias roumains ont rendu compte du tribunal qui a condamné à mort le couple Ceausescu (ils ont été abattus 15 minutes après l'annonce du verdict).
Déjà le 23 décembre, la télévision roumaine annonçait la création du Conseil du Front de salut national, qui assumait les pleins pouvoirs. Ion Iliescu , autrefois membre du Parti communiste , qui a été démis de ses fonctions à plusieurs reprises dans les années 1970 pour des sentiments d'opposition, est devenu président du Conseil du Service fédéral des impôts. En mai 1990, I. Iliescu a été élu président du pays.
Le résultat global des événements de 1989-1990. fut la chute des régimes communistes dans tous les pays d'Europe de l'Est. Les partis communistes se sont effondrés, certains d'entre eux se sont transformés en partis de type social-démocrate. De nouvelles forces politiques et de nouveaux dirigeants sont arrivés au pouvoir.
A une nouvelle étape
Les « nouveaux » au pouvoir sont le plus souvent des politiciens libéraux (en Pologne, Hongrie, Bulgarie, République tchèque). Dans certains cas, par exemple en Roumanie, il s'agissait d'anciens membres des partis communistes passés à des positions social-démocrates. Les principales activités des nouveaux gouvernements dans le domaine économique prévoyaient la transition vers une économie de marché. La privatisation (transfert à des mains privées) de la propriété de l'État a commencé, le contrôle des prix a été aboli. Dépenses sociales considérablement réduites, salaires "gelés". La rupture du système existant précédemment a été réalisée dans un certain nombre de cas par les méthodes les plus sévères dans les plus brefs délais, pour lesquelles on l'appelait «thérapie de choc» (cette option a été réalisée en Pologne).
Au milieu des années 1990, les coûts économiques et sociaux des réformes sont devenus apparents : baisse de la production et ruine de centaines d'entreprises, chômage de masse, hausse des prix, stratification de la société en quelques riches et milliers de personnes vivant en dessous du seuil seuil de pauvreté, etc. Les gouvernements responsables des réformes et de leurs conséquences ont commencé à perdre le soutien de la population. Aux élections de 1995-1996. en Pologne, en Hongrie, en Bulgarie, les représentants des socialistes ont gagné. Renforcé la position des sociaux-démocrates en République tchèque. En Pologne, à la suite d'un changement dans l'opinion publique, L. Walesa, l'homme politique le plus populaire au début des années 1990, a perdu l'élection présidentielle. En 1995, le social-démocrate A. Kwasniewski est devenu président du pays.
Les changements dans les fondements du système social ne pouvaient qu'affecter les relations nationales. Auparavant, des systèmes centralisés rigides liaient chaque État à un tout unique. Avec leur chute, la voie a été ouverte non seulement à l'autodétermination nationale, mais aussi aux actions des forces nationalistes et séparatistes. En 1991 -1992 l'État yougoslave s'est effondré. La République fédérale de Yougoslavie a conservé deux des six anciennes républiques yougoslaves - la Serbie et le Monténégro. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine sont devenues des États indépendants. Cependant, la démarcation étatique s'est accompagnée d'une aggravation des contradictions ethno-nationales dans chacune des républiques.
crise bosniaque. Une situation insoluble s'est développée en Bosnie-Herzégovine. Serbes, Croates et Musulmans y ont historiquement coexisté (le concept de « Musulmans » en Bosnie est considéré comme une définition de la nationalité, bien qu'il s'agisse de la population slave qui s'est convertie à l'islam après la conquête turque au XIVe siècle). Aux différences ethniques s'ajoutaient des différences religieuses : outre la division entre chrétiens et musulmans, les Serbes appartenaient à l'Église orthodoxe et les Croates à l'Église catholique. Dans une seule langue serbo-croate, il y avait deux alphabets - cyrillique (chez les Serbes) et latin (chez les Croates).
Tout au long du 20ème siècle une autorité centrale forte dans le royaume yougoslave, puis dans l'État socialiste fédéral, a tenu en échec les contradictions nationales. En République de Bosnie-Herzégovine, qui s'est séparée de la Yougoslavie, elles se sont manifestées avec une sévérité particulière. Les Serbes, qui constituaient la moitié de la population de Bosnie, ont refusé de reconnaître la sécession de la fédération yougoslave, puis ont proclamé la République serbe en Bosnie. En 1992-1994 un conflit armé éclate entre Serbes, Musulmans et Croates. Elle a fait de nombreuses victimes non seulement parmi les combattants, mais aussi parmi la population civile. Dans les camps de prisonniers, dans les colonies, des gens ont été tués. Des milliers d'habitants ont quitté leurs villages et leurs villes et sont devenus des réfugiés. Pour contenir la lutte intestine, des troupes de maintien de la paix de l'ONU ont été envoyées en Bosnie. Au milieu des années 1990, les opérations militaires en Bosnie ont été stoppées par les efforts de la diplomatie internationale.
En 2006, le Monténégro a fait sécession de la Serbie à la suite d'un plébiscite. La République de Yougoslavie a cessé d'exister.
À Serbie après 1990, une crise est survenue associée à la province autonome du Kosovo, dont 90% de la population était des Albanais (musulmans de religion). La limitation de l'autonomie de la province a conduit à l'auto-proclamation de la « République du Kosovo ». Un conflit armé éclate. À la fin des années 1990, grâce à la médiation internationale, un processus de négociation s'est engagé entre les dirigeants de la Serbie et les dirigeants des Albanais du Kosovo. Dans un effort pour faire pression sur le président serbe S. Milosevic, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord - OTAN est intervenue dans le conflit. En mars 1999, les troupes de l'OTAN ont commencé à bombarder le territoire de la Yougoslavie. La crise s'est étendue à l'échelle européenne.
Les peuples ont choisi une manière différente de régler les problèmes nationaux Tchécoslovaquie. En 1992, à la suite d'un référendum, il a été décidé de diviser le pays. La procédure de division a été minutieusement discutée et préparée, pour laquelle les publicistes ont qualifié cet événement de "divorce à visage humain". Le 1er janvier 1993, deux nouveaux États sont apparus sur la carte du monde - la République tchèque et la République slovaque.

Les changements intervenus dans les pays d'Europe de l'Est ont eu des conséquences importantes sur la politique étrangère. Au début des années 1990, le Conseil d'assistance économique mutuelle et le Pacte de Varsovie ont cessé d'exister. En 1991, les troupes soviétiques ont été retirées de la Hongrie, de l'Allemagne de l'Est, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Les organisations économiques et militaro-politiques des pays d'Europe occidentale, principalement l'Union européenne et l'OTAN, sont devenues le centre de gravité des pays de la région. En 1999, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont rejoint l'OTAN, et en 2004, 7 autres États (Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Estonie) ont rejoint l'OTAN. Dans le même 2004, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque sont devenues membres de l'UE, et en 2007 - la Roumanie et la Bulgarie.
Au début du XXIème siècle. dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale (comme on a commencé à appeler la région), les gouvernements de gauche et de droite et les chefs d'État ont été remplacés au pouvoir. Ainsi, en République tchèque, le gouvernement de centre gauche était censé coopérer avec le président W. Klaus, qui occupe les postes de droite (élu en 2003), en Pologne, le politicien de gauche A. Kwasniewski a été remplacé à la présidence du pays par le représentant des forces de droite L. Kaczynski (2005-2010). Il convient de noter que les gouvernements de "gauche" et de "droite", d'une manière ou d'une autre, ont résolu les tâches communes consistant à accélérer le développement économique des pays, à aligner leurs systèmes politiques et économiques sur les normes européennes et à résoudre les problèmes sociaux.
Références:
Aleksashkina L. N. / Histoire générale. XX - le début du XXIe siècle.
Selon les décisions des conférences de Yalta et de Potsdam des chefs des grandes puissances (1945) sur la structure de l'Europe d'après-guerre, les pays d'Europe de l'Est et du Sud-Est ont été inclus dans la sphère d'intérêts de l'URSS. Dans la plupart d'entre eux, les partis communistes étaient populaires, puisqu'ils étaient les organisateurs de la résistance antifasciste. Jusqu'en 1948, les dirigeants soviétiques évitèrent de s'ingérer grossièrement dans les affaires des pays de « démocratie populaire ». Cependant, avec le déroulement de la guerre froide, en particulier après la création du bloc de l'OTAN, une telle ingérence est devenue évidente. Cela a conduit à un conflit avec la Yougoslavie, dont le leadership était axé sur la construction du socialisme, mais a fait preuve d'une plus grande indépendance. Après la mort de Staline, le "chauvinisme idéologique" de la direction soviétique n'a pas disparu, mais s'est plutôt intensifié. Bien qu'il y ait eu une relative réconciliation avec la Yougoslavie, les dirigeants soviétiques (N.S. Khrouchtchev, L.I. Brejnev) se sont constamment heurtés aux dirigeants de l'Albanie, de la Chine, de la Corée du Nord, de Cuba, de la Roumanie, qui ont suivi une voie indépendante. Particulièrement aigu, jusqu'aux affrontements armés de 1969, fut le conflit avec la Chine.
En Europe, au début de la période que nous étudions, il existait un bloc de pays socialistes dont les structures organisationnelles étaient l'Organisation du Pacte de Varsovie (OMC) et le Conseil d'assistance économique mutuelle (CAEM). Le poids du système socialiste dans l'économie mondiale était assez lourd : en 1980, l'URSS représentait 25 % de la production industrielle mondiale, la Tchécoslovaquie, la RDA et la Roumanie figuraient parmi les dix premières puissances industrielles du monde.
Cependant, le degré d'enracinement du socialisme d'État de type soviétique n'était pas très élevé, il l'était d'autant moins que les dirigeants des pays suivaient docilement les recettes soviétiques. Régimes politiques des pays socialistes européens dans les années 1980 ressemblait au régime libéral-bureaucratique soviétique (1953-1991), avec le monopole politique et idéologique du parti au pouvoir, mis en œuvre par des méthodes relativement douces. Tout au long de la période d'après-guerre, le bloc occidental a cherché à séparer les pays socialistes de l'URSS, ce qui était la tâche la plus importante des services spéciaux.
En République Populaire de Pologne (PNR) au tournant des années 1970-80. le véritable socialisme de style soviétique est entré en crise. Puis un syndicat indépendant "Solidarité" est né, dirigé par L. Walesa, un électricien du chantier naval local. est devenu une force d'opposition. Bientôt, Solidarité s'est transformé en un mouvement sociopolitique organisé en masse (jusqu'à 10 millions de membres) et a commencé à tenter de prendre le pouvoir du Parti ouvrier unifié polonais (PUWP). En décembre 1981, le nouveau président de la Pologne, le général W. Jaruzelski, qui était populaire dans le pays, a introduit la loi martiale et arrêté environ 5 000 syndicalistes, la loi martiale a été introduite dans le pays, Solidarité a été interdite, mais son influence est restée.
Dans la seconde moitié des années 1980. dans la partie de l'Europe contrôlée par les Soviétiques, ils ont remarqué que la perestroïka de Gorbatchev avait une orientation antisocialiste et pro-occidentale. Cela a inspiré l'opposition politique qui a existé et a parfois été active pendant toute la période socialiste. Les mouvements antisocialistes et antisoviétiques des pays d'Europe de l'Est ont traditionnellement été qualifiés de "démocratiques" en Occident.
Ainsi, les manifestations de grève organisées par Solidarité à l'été 1988 obligent les communistes à négocier avec la direction de Solidarité. Dans le cadre du début de la «perestroïka» en URSS, V. Jaruzelsky et son entourage ont été contraints d'accepter la légalisation des activités de Solidarité, des élections législatives compétitives, la réforme de l'institution du président du pays et la création d'une deuxième chambre en le Sejm - le Sénat.
Les élections de juin 1989 se sont soldées par la victoire de Solidarité et sa faction au Sejm a formé un gouvernement dirigé par T. Mazowiecki. En 1990, le leader de Solidarité, L. Walesa, est élu président du pays. Il a soutenu le plan de L. Balcerowicz pour des réformes radicales du marché, qui a été en fait développé par le FMI et la Banque mondiale. Avec la participation active du nouveau président, la Pologne a commencé à se rapprocher de l'OTAN et de la communauté européenne. Les difficultés économiques liées à la privatisation de masse, ainsi que la révélation de liens secrets dans le passé avec les services secrets de certaines personnalités de l'entourage de Walesa et de lui-même ont conduit au fait qu'A. Kwasniewski, ancien communiste actif, a remporté l'élection présidentielle en 1995.
Déjà au début des années 1990. Les troupes russes ont été retirées du pays. À cette époque, le Pacte de Varsovie et le Conseil d'assistance économique mutuelle avaient déjà cessé d'exister. En 1994, la Pologne annonce sa volonté d'entrer dans les structures occidentales, ce qu'elle réussit : en 1999, malgré la condamnation diplomatique de la Russie, elle devient membre de l'OTAN, et en 2004, membre de l'Union européenne. Ces dernières années (sous le règne des frères Kaczynski), les difficultés se sont accrues dans les relations russo-polonaises liées à des revendications économiques et politiques mutuelles. La Pologne a même bloqué la signature en 2006 d'un nouvel accord de coopération entre l'UE et la Russie. À l'heure actuelle, les dirigeants polonais acceptent le déploiement d'installations américaines de défense antimissile dans le pays, ce qui complique encore la situation.
Il convient de noter que la Pologne est le plus grand État de la région PECO en termes de territoire et de population (36 millions d'habitants) et, en principe, les relations avec elle sont importantes.
À l'automne 1989 en Tchécoslovaquie (Tchécoslovaquie), il y avait un soi-disant. "révolution de velours". Cet État est né en 1919. À la suite de l'accord de Munich (septembre 1938) entre les puissances occidentales et l'Allemagne nazie, en mars 1939, la Tchécoslovaquie a cessé d'exister. La République tchèque a été annexée au Reich avec le statut de protectorat de Bohême et de Moravie. Son puissant complexe militaro-industriel a travaillé pour l'Allemagne jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu de résistance notable ni de sabotage. Jusqu'au 22 juin 1941, l'URSS entretenait des relations diplomatiques formelles avec la Slovaquie, formellement indépendante, mais en réalité contrôlée par le Reich.
Déjà pendant la guerre, des relations étroites s'étaient établies entre le gouvernement tchécoslovaque en exil et Moscou. En 1945, le traité d'amitié entre la Tchécoslovaquie et l'URSS est signé. Dans le même temps, la Tchécoslovaquie a renoncé à ses droits sur l'Ukraine transcarpathique, qui en faisait partie auparavant. Dans les premières années d'après-guerre, tout en entretenant des relations étroites avec l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie a conservé ses institutions démocratiques de base. La popularité de l'URSS à l'époque a contribué au fait que l'influence des communistes tchécoslovaques était très grande. En février 1948, avec le soutien de l'URSS, ils chassent d'autres forces politiques du pouvoir et établissent dans le pays un régime qui ne diffère pas de ceux qui se forment à l'époque dans toute la région de l'Europe de l'Est.
Jusqu'à la fin des années 1960. il n'y avait pas de sentiments antisoviétiques forts en Tchécoslovaquie. La situation a été modifiée par les événements de 1968, lorsqu'une tentative a été faite en Tchécoslovaquie pour libéraliser le régime communiste existant, ce qui a suscité des craintes et des soupçons de la part des dirigeants soviétiques. L'URSS et d'autres pays participant au Pacte de Varsovie ont envoyé leurs troupes sur le territoire de la Tchécoslovaquie, ce qui a finalement conduit à l'arrêt des réformes et à des changements radicaux dans la direction du pays et du Parti communiste. Après cela, au niveau de la conscience de masse, une réaction d'aliénation du «grand frère» est apparue.
En Tchécoslovaquie, après le début de la «perestroïka» en URSS, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie, G. Husak, a refusé de changer de cap politique et d'engager un dialogue avec l'opposition. En 1988, il a été contraint de démissionner de son poste de chef. En novembre 1989, la révolution de velours a eu lieu en Tchécoslovaquie, au cours de laquelle, sous la pression de manifestations pacifiques de masse, les communistes ont été contraints d'accepter la formation d'un gouvernement avec la participation de représentants de l'opposition démocratique. A. Dubcek est devenu président du parlement et V. Havel, un écrivain démocrate, est devenu président.
Prague s'oriente vers l'établissement de relations étroites avec les pays occidentaux. En 1992, les troupes russes ont été retirées du pays et, en 1993, cet État lui-même s'est désintégré (sans conflits graves) en République tchèque et en Slovaquie. V. Havel a été élu président de la République tchèque. Le désir des deux États de s'intégrer dans les structures occidentales est resté, cependant, la République tchèque, en tant que pays économiquement plus développé, s'est déplacée vers cela plus rapidement et déjà en 1999 est devenue membre de l'OTAN. La Slovaquie n'a rejoint cette organisation qu'en 2004. La même année, les deux États sont devenus membres de l'UE. La Slovaquie dans les années 1990 montré plus d'intérêt pour la coopération avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, mais les choses ne sont jamais allées au-delà des déclarations et des déclarations.
Contrairement à la Tchécoslovaquie, la Hongrie était un allié de l'Allemagne nazie et a été vaincue avec elle. Le territoire du pays était occupé par les troupes soviétiques et l'URSS a activement influencé le développement des processus politiques hongrois. En 1949, le régime stalinien était établi en Hongrie, dirigé par le chef du Parti communiste local, F. Rakosi. Contrairement aux traditions nationales existantes, le pays a commencé à copier en détail le modèle soviétique de socialisme, ce qui a conduit à une aggravation des contradictions socio-économiques et politiques. L'influence des éléments profascistes, qui ont mené une propagande anticommuniste et antisémite, est restée forte. La conséquence de ces contradictions fut une profonde crise politique interne en Hongrie, qui éclata à l'automne 1956 sous la forme d'affrontements armés et conduisit presque à l'effondrement du socialisme hongrois. Après les événements de 1956, l'Union soviétique autorisa la mise en place d'une politique économique assez raisonnable et indépendante en Hongrie, ce qui rendit le pays relativement prospère dans le cadre du camp socialiste. Mais, d'un autre côté, les changements qui ont eu lieu ont dans une certaine mesure brouillé les fondements idéologiques du régime existant, de sorte que la Hongrie, comme la Pologne, a commencé à démanteler le système socialiste plus tôt que les autres pays d'Europe de l'Est.
En octobre 1989, en Hongrie, les communistes (Parti socialiste ouvrier hongrois) sont contraints d'accepter l'adoption d'une loi sur le multipartisme et les activités des partis. Et puis la constitution du pays a été amendée. Ils envisageaient "une transition politique pacifique vers un État de droit dans lequel un système multipartite, une démocratie parlementaire et une économie de marché à vocation sociale sont mis en œuvre". Lors des élections de mars 1990 à l'Assemblée d'État hongroise, les communistes ont été défaits et le Forum démocratique hongrois a remporté la majorité des sièges au parlement. Après cela, toute mention du socialisme a été exclue de la constitution. Contrairement à d'autres pays de la région, la transition de la Hongrie vers les «valeurs occidentales» s'est déroulée de manière évolutive, mais le vecteur général de son mouvement vers l'intégration dans les structures européennes a coïncidé avec le vecteur de mouvement d'autres États post-communistes de l'Europe centrale et orientale. La Hongrie est membre de l'UE et de l'OTAN.
La démocratisation de la vie publique et étatique a également eu lieu en RDA, où l'opposition démocratique a remporté les premières élections libres en mars 1990. Puis il y a eu l'unification de l'Allemagne par l'absorption de l'Allemagne de l'Est (RDA) par l'Allemagne de l'Ouest (RFA).
Lorsque l'on considère les événements de la fin de 1989, il faut tenir compte du fait qu'au début de décembre 1989, lors de la rencontre de M. Gorbatchev et George W. Bush (ancien) à Malte, Gorbatchev a en fait abandonné la sphère d'influence soviétique à l'Est. L'Europe à l'Ouest, plus précisément aux USA.
Les événements dans les pays d'Europe du Sud-Est se sont développés de manière exceptionnellement spectaculaire. Il convient de noter que les États les plus importants de cette région ont acquis leur souveraineté avec le soutien actif de la Russie. C'est le cas de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Serbie-et-Monténégro, qui faisaient partie de l'ex-Yougoslavie. De plus, la Russie a souvent fourni cette aide au détriment de ses propres intérêts de politique étrangère, fondés sur le romantisme panslave, qui ont commencé à dominer l'opinion publique à partir de la 2e moitié du XIXe siècle. et conserve une certaine influence à ce jour.
Pendant la Première Guerre mondiale, la Bulgarie est devenue l'alliée des pays du bloc allemand. En avril 1941, la Bulgarie a participé à l'agression allemande contre la Yougoslavie et la Grèce, mais le gouvernement bulgare a refusé de participer aux hostilités contre l'URSS, invoquant de forts sentiments russophiles au sein de la population. Après que l'Armée rouge ait atteint les frontières de la Bulgarie le 5 septembre 1944, l'URSS lui a déclaré la guerre, mais il n'y a en fait pas eu d'hostilités, car l'armée bulgare a refusé de se battre et un changement de pouvoir a eu lieu dans le pays. Le gouvernement du Front de la patrie a déclaré la guerre à l'Allemagne et à ses alliés, et les troupes bulgares au stade final de la guerre se sont battues aux côtés de la coalition anti-hitlérienne. En fait, déjà en 1944, l'établissement du régime communiste a commencé, qui s'est terminé en 1948, lorsque la République populaire de Bulgarie a été proclamée.
Jusqu'à la fin des années 1980. les relations entre l'URSS et la Bulgarie se sont développées régulièrement, il n'y avait pas de forces anticommunistes importantes à l'intérieur de l'État. Comme dans d'autres pays d'Europe de l'Est, les changements démocratiques en Bulgarie ont commencé à la fin de 1989. En même temps, comme dans d'autres États de la région, la tâche de l'intégration dans les structures occidentales a été fixée presque immédiatement. Plus tard, il y a eu une forte distanciation de la Russie, avec laquelle un régime de visa a été établi. Actuellement, la Bulgarie est membre de l'OTAN, en 2004, elle a été admise dans l'UE. Les relations russo-bulgares sont dans un état de stagnation depuis longtemps, le chiffre d'affaires commercial mutuel reste insignifiant.
La Roumanie, voisine de la Bulgarie, a également participé activement à la guerre contre l'URSS dès le début, dans la période 1941-1944. il comprenait comme provinces non seulement la Bessarabie, mais aussi la région nord de la mer Noire, y compris Odessa. Dans le même temps, l'État tente de maintenir des contacts avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le 23 août 1944, un coup d'État a eu lieu en Roumanie, il a rompu le bloc avec l'Allemagne et a rejoint la coalition anti-hitlérienne.Il est à noter que le roi roumain Mihai a reçu la plus haute distinction de l'URSS - l'Ordre de La victoire. Cependant, déjà en 1946, la monarchie en Roumanie a été abolie et un régime communiste a été établi dans le pays. Relations soviéto-roumaines depuis la fin des années 1950. développé quelque peu différemment des relations de l'URSS avec les autres pays d'Europe de l'Est. Après l'arrivée au pouvoir de Nicolae Ceausescu en 1965, la République socialiste de Roumanie (SRR) a pris ses distances avec l'Union soviétique. Les dirigeants roumains ont ouvertement exprimé leur attitude négative à l'égard de l'entrée des troupes du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en 1968. La Roumanie était le seul pays socialiste à entretenir des relations diplomatiques avec Israël après la guerre arabo-israélienne de 1967. En outre, la Roumanie a fait preuve d'un certain niveau de indépendance dans le cadre du Pacte de Varsovie et du CAEM . En 1980, le puissant développement économique du pays l'a conduit au rang des dix premiers pays industrialisés du monde. En décembre 1989, à la suite d'un putsch armé avec une imitation d'un "soulèvement populaire de masse", le régime de N. Ceausescu (plutôt libéral, mais avec un fort culte de la personnalité du président) est renversé. Le président lui-même, ainsi que son épouse E. Ceausescu, ont été tués. Cela a été présenté par la propagande occidentale et soviétique (de Gorbatchev) comme le renversement du «régime communiste détesté».
Après la chute du socialisme, la Roumanie, comme d'autres pays d'Europe de l'Est, s'est dirigée vers l'intégration à l'Ouest.Cependant, la baisse rapide du niveau de vie a fait de la Roumanie l'un des pays les plus pauvres d'Europe, ce qui ne lui a pas permis d'atteindre rapidement l'objectif de sa politique - l'adhésion à l'UE. Cela ne s'est produit qu'en 2007. Les relations avec la Russie sont dans un état de stagnation, tandis que les sentiments unitaristes concernant l'unification avec la Moldavie sont populaires en Roumanie même.
Les pires événements depuis le début des années 1990 déployé en Yougoslavie. La Russie tout au long du XIXe siècle. a activement contribué aux aspirations de la Serbie à l'indépendance de l'Empire ottoman. En 1878, à la suite de la guerre russo-turque, l'indépendance de la Serbie est reconnue par Istanbul. Le pays est proclamé royaume. Au premier plan de la politique étrangère du pays se trouvait la tâche d'unir les Slaves du Sud en un seul État. Cet objectif a été atteint après la Première Guerre mondiale, lorsque le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a été formé (depuis 1929 - Yougoslavie).
En politique étrangère, le pays a conservé son orientation vers l'Entente. Dès le début, des contradictions ethniques ont émergé au sein de l'État, principalement entre Serbes et Croates. Le 6 avril 1941, l'Allemagne et ses alliés entament la guerre contre la Yougoslavie et la Grèce. Le 10 avril, la Croatie déclare son indépendance et le 17, la Yougoslavie capitule. Un mouvement partisan très fort s'est formé dans le pays, mais l'Armée rouge, qui en octobre 1944 est entrée sur son territoire, a joué un rôle décisif dans la libération de la Yougoslavie. Le 11 avril 1945, un traité d'amitié est conclu entre les pays. Cependant, en raison du désir des communistes yougoslaves de maintenir leur indépendance dans la prise de décision, à l'été 1948, le traité a été dénoncé et les relations entre les pays ont cessé. Ils ne revinrent à la normale qu'en 1955, lorsqu'un accord sur les relations amicales fut à nouveau signé. Néanmoins, la Yougoslavie n'est jamais devenue membre du Pacte de Varsovie et a eu un statut d'observateur au sein du CAEM. A la fin des années 1980 dans le pays, d'une part, le monopole des communistes sur le pouvoir prend fin, d'autre part, des processus de désintégration sont en cours, activement soutenus par l'Occident.
La « perestroïka » en URSS et l'affaiblissement de la position communiste en Europe de l'Est ont entraîné des changements importants dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui était dominée par la Serbie et ses dirigeants communistes. Dans le même temps, la Serbie a cherché à préserver la fédération existante, tandis que la Slovénie et la Croatie ont insisté pour en faire une confédération (1991). En juin 1991, l'Assemblée slovène a déclaré son indépendance et le Conseil croate a adopté une déclaration déclarant l'indépendance de la Croatie. Puis une armée régulière fut envoyée de Belgrade contre eux, mais les Croates et les Slovènes commencèrent à résister par les armes.
Les tentatives de Belgrade avec l'aide de troupes pour empêcher l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie se sont soldées par un échec en raison du soutien des séparatistes de l'Union européenne et de l'OTAN. Puis une partie de la population serbe de Croatie, soutenue par Belgrade, entama une lutte armée contre l'indépendance de la Croatie. Les troupes serbes ont pris part au conflit, beaucoup de sang a été versé, le conflit entre la Croatie et la Serbie s'est estompé après l'entrée des troupes de maintien de la paix de l'ONU en Croatie en février 1992. Des événements encore plus sanglants ont accompagné l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Cette dernière a conduit à l'effondrement du pays en 1991 : la Croatie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine ont déclaré leur indépendance ; et seuls ces derniers ont réussi à le faire pacifiquement. Dans d'autres cas, il y avait un conflit armé avec le gouvernement central. La Russie a reconnu leur indépendance, mais a soutenu les Serbes dans tous les conflits. Un tel soutien était dû, avant tout, à des facteurs civilisationnels et a entraîné des complications dans les relations de la Russie tant avec les autres pays de la région qu'avec les principales puissances occidentales. Surtout, cela s'est manifesté en 1999 lors de la crise du Kosovo et de l'agression directe de l'OTAN contre la Yougoslavie, qui ne comprenait déjà que la Serbie et le Monténégro. La Russie, soutenant Belgrade, s'est en fait retrouvée au bord d'un conflit diplomatique avec les pays occidentaux. Dans le même temps, la Serbie, où les forces pro-occidentales sont arrivées au pouvoir, n'a pas démontré tout au long de cette période sa volonté d'une large coopération économique, et en 2000, presque immédiatement après la fin de la crise du Kosovo, un régime de visas a été introduit entre le gouvernement fédéral République de Yougoslavie et la Fédération de Russie.
En 2008, la Russie a soutenu la volonté de la Serbie de maintenir l'intégrité territoriale et a condamné les pays occidentaux pour avoir reconnu l'indépendance du Kosovo.
En Albanie, le régime communiste a été démantelé en 1992.
Au début des années 1990 dans un certain nombre d'États d'Europe de l'Est, de nouvelles constitutions ont été adoptées ou des modifications importantes ont été apportées à celles qui existaient déjà. Ils ont changé non seulement les noms des États, mais aussi l'essence du système social et politique, perçu comme "les valeurs démocratiques occidentales". Les constitutions ont également fixé les changements dans les fonctions du chef de l'État, dans le rôle desquelles le corps collectif a cessé d'agir. Le poste de président de l'État est rétabli partout.
2. Renouveau de la civilisation de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle.
1. La crise globale de l'Occident dans la première moitié du XXe siècle.
Toute la période de l'entre-deux-guerres en Europe occidentale dans la première moitié du XXe siècle a été marquée par une crise systémique de l'économie capitaliste. Ce n'était pas inhabituel, se produisant en moyenne tous les 10 ans. Mais la crise qui débute en 1929 se révèle unique à bien des égards et surtout dans sa profondeur. La production industrielle n'a pas seulement décliné, elle a été ramenée au niveau du début du siècle. Une réduction aussi importante de la production a entraîné une forte augmentation du chômage : le nombre de chômeurs dans les seuls pays occidentaux avoisinait les 30 millions, soit de 1/5 à 1/3 de la population active. La deuxième caractéristique de la crise est son ampleur. Il est devenu mondial. La troisième caractéristique de la crise est sa durée. Il a commencé en 1929 et le déclin s'est poursuivi jusqu'en 1932. Mais même après la fin du déclin et l'apparition de signes de reprise en 1933, l'économie ne s'est pas complètement rétablie avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Aucune autre crise n'a généré des conséquences économiques aussi importantes. Ce n'est pas un hasard si les années 1930 sont entrées dans l'histoire comme la Grande Dépression.
Dans une large mesure, cette crise était une conséquence du coup porté à l'économie mondiale par la guerre et les actions des puissances victorieuses après celle-ci. Les liens économiques traditionnels ont été rompus, l'économie mondiale a été surchargée de dettes. La guerre a généré une croissance sans précédent pour l'économie américaine et a fait des États-Unis un créancier mondial. Toute l'économie mondiale a commencé à dépendre du bien-être de l'économie américaine, mais elle s'est avérée très fragile. Dans les années 1920, l'industrie américaine, en plein essor, passe à des technologies de production de masse basées sur l'utilisation de procédés en ligne, le convoyeur. Mais la consommation n'est en aucun cas devenue massive. La répartition du revenu national était extrêmement inégale. Les salaires ont à peine augmenté et les bénéfices des entreprises ont triplé. Les riches se sont enrichis, ont acheté des demeures luxueuses, des limousines et des yachts, mais ils ne pouvaient pas remplacer le consommateur de masse. Le système financier américain était également extrêmement instable. Dans les années 1920, la Bourse de New York, la plus importante du monde, connaît une fièvre sans précédent : la hausse du cours des actions attire depuis plusieurs années d'énormes capitaux vers le marché des valeurs mobilières. Tout le monde voulait acheter des actions pour les revendre plus tard. Lorsque ce boom spéculatif a atteint sa limite, les prix ont commencé à chuter précipitamment. Le "mardi noir" du 29 octobre 1929, la chute des cours boursiers se traduit par une perte de 10 milliards de dollars. À partir de ce moment, tout le système financier américain s'est effondré, et avec lui les finances du reste du monde. Les banques américaines ont cessé de prêter aux Européens, l'Allemagne a cessé de payer les réparations, l'Angleterre et la France étaient endettées. Les banques sont devenues insolvables, ont cessé d'accorder des prêts. Il y avait moins d'argent en circulation, et l'activité économique - toujours plus faible.
Les gouvernements occidentaux n'étaient absolument pas préparés à une telle évolution des événements. L'opinion dominante était que l'intervention de l'État dans le cours naturel des événements était inutile et même préjudiciable à l'économie. La crise a également touché les finances publiques - les recettes fiscales du budget ont commencé à baisser et des déficits y sont apparus. Tous les gouvernements ont commencé à réduire les dépenses ensemble, licenciant des employés, économisant sur les coûts sociaux. Toutes ces actions ont exacerbé la crise.
Elle est mondiale et il serait naturel que les gouvernements essaient de coordonner leurs actions. Cependant, c'est tout le contraire qui s'est produit, chacun a tenté de se protéger de cette catastrophe à ses risques et périls, en élevant les barrières douanières. Le commerce mondial a fini par tripler, accentuant la surproduction dans tous les pays.
Une crise d'une telle profondeur et d'une telle durée ne pouvait qu'avoir de graves conséquences sociales. Le chômage est devenu massif et prolongé. Les allocations de chômage n'étaient versées que dans quelques pays. La plupart de ceux qui ont perdu leur emploi, ayant épuisé leurs économies, se sont vite retrouvés sans moyens de subsistance. Les organisations caritatives créées pour aider les plus démunis n'étaient pas en mesure de subvenir aux besoins de tous ceux qui en avaient besoin. Dans le pays le plus riche du monde - les États-Unis - les chômeurs pouvaient tout au plus compter sur un bol de soupe.
La crise a encore aggravé la situation des agriculteurs et des paysans. La demande alimentaire a chuté, les prix des denrées alimentaires et les revenus des agriculteurs ont chuté. De nombreuses fermes sont devenues non rentables et ont fait faillite. Un rôle similaire est arrivé aux petits marchands et artisans, particulièrement nombreux en Europe. L'existence de la classe moyenne - salariés "médecins, avocats, enseignants" était également menacée. Ils pourraient perdre ce dont ils étaient récemment fiers : leur propre maison ou appartement et une voiture. Le résultat de la crise a été la pauvreté de masse. Des millions de personnes erraient d'un endroit à l'autre, faisant des petits boulots, vivant dans des cages assemblées en tôle et en carton, préoccupées uniquement par leur pain quotidien. Les liens sociaux établis se sont effondrés, les familles se sont effondrées, les valeurs de vie traditionnelles se sont effondrées - Changements d'humeur. Les espoirs d'un avenir meilleur qui ont surgi dans les années 1920 ont été remplacés par le pessimisme et le désespoir. L'apathie stupéfiante fit place à des accès de rage aveugle. Il y avait une profonde désillusion avec l'ordre existant. Encore une fois, comme après la Première Guerre mondiale, l'influence des partis et des mouvements qui réclamaient sa rupture radicale a commencé à croître. Les partis communistes, qui se sont prononcés dans les années de crise pour une révolution socialiste immédiate, se sont sensiblement renforcés. Les fascistes, comme seul moyen de renaissance nationale, envisageaient le remplacement de la démocratie par la dictature. Pendant la crise, ils sont devenus une force considérable.
Le fascisme est un mouvement politique à prédominance européenne du XXe siècle et une forme de gouvernement spéciale et spécifique. Il a apporté des désastres indicibles aux peuples du monde. Le mot lui-même est d'origine italienne. Les fascistes allemands se disaient nazis. Le fascisme a un certain nombre de traits caractéristiques. Il se caractérise par le nationalisme, le rejet de la démocratie, le désir de créer un État totalitaire et le culte de la violence. Le fascisme allemand était caractérisé par un nationalisme et un racisme extrêmes. Le désir de conquérir la domination mondiale des Allemands en a fait le plus agressif. Le mouvement nazi en Allemagne a émergé après la Première Guerre mondiale. Presque immédiatement, il a été dirigé par Adolf Hitler. La croissance rapide de l'influence du fascisme tombe sur les années de la crise économique.
L'incapacité de la République de Weimar à atténuer le sort du peuple à cette époque a provoqué sa crise et sa désillusion massive à l'égard de la démocratie en général. Le parti fasciste a commencé à recevoir de nombreux votes lors des élections. En 1933, Hitler a reçu le droit de former le gouvernement de l'Allemagne. Une fois au pouvoir, les nazis ont détruit la démocratie. Tout le pouvoir était entre les mains d'Hitler, les partis politiques, à l'exception des fascistes, ont été liquidés et le rôle des organes punitifs s'est accru. L'économie s'est également transformée. L'État a commencé à le réglementer afin d'accélérer la sortie de crise et de créer une puissante industrie militaire. Il a établi un contrôle sur les prix, les salaires, a subordonné tous les entrepreneurs aux organes de l'État. L'antisémitisme est devenu une politique publique ouverte. Les Juifs ont été privés de leur citoyenneté allemande et ont commencé à être réinstallés dans des quartiers de villes spécialement désignés. Ils étaient tenus de porter une étoile jaune sur leurs vêtements et de ne pas apparaître dans les lieux publics. Les nazis ont cherché à établir un contrôle sur les esprits des gens. La presse, la radio, l'art et la littérature étaient directement subordonnés au ministère de la Propagande et étaient obligés de glorifier Hitler, la supériorité des Allemands en tant que race supérieure et l'ordre nouveau. L'ensemble de la population devait être membre de diverses organisations nazies et participer à toutes les campagnes de masse. L'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne a changé la donne en Europe. Le désir de domination mondiale de l'Allemagne menaçait le monde. En 1939, l'Allemagne s'était déjà préparée au déclenchement de la guerre.
La stabilité politique interne des pays occidentaux dans le deuxième quart du XXe siècle appartient au passé. Dans certains, un changement fréquent de gouvernement a commencé, en Espagne il y a même eu une révolution, la monarchie a été renversée. Les partis politiques, tout en consolidant le pouvoir, ont essayé de créer des coalitions plus larges. Dans d'autres cas, les gouvernements ont commencé à régner sur la tête des parlements, promulguant des décrets d'urgence. Mais toutes ces manœuvres politiques n'ont pas fait disparaître la question de l'ordre du jour : comment sortir de la crise et désamorcer les tensions sociales.
La question centrale des pays occidentaux dans les années 1930 était la recherche de sorties de crise. Plusieurs directions principales de leur développement ont été identifiées. Dans certains pays (comme on l'a montré plus haut avec l'exemple de l'Allemagne), le fascisme s'est imposé. Dans d'autres, ils ont pris le chemin de la poursuite des réformes. Dans la seconde moitié des années 1930, des fronts populaires apparaissent en Europe. Ils ont uni les forces de gauche dans leur lutte contre le fascisme. Sa base a été faite par les communistes et les sociaux-démocrates. Ils ont réalisé que le fascisme était devenu leur principal danger et ont décidé d'abandonner la lutte mutuelle. En France, le Front populaire est formé en 1935. L'année suivante, le Front populaire remporte les élections législatives. Le gouvernement du Front populaire, dirigé par le socialiste Léon Blum, interdit les organisations paramilitaires des nazis. Les salaires des travailleurs ont été augmentés, des congés payés ont été introduits, les pensions et les prestations ont été augmentées. Après la mise en œuvre du programme du Front populaire, des désaccords sont apparus entre ses participants. Cela a conduit à la chute du gouvernement du Front populaire. Beaucoup de ses réformes ont été éliminées. En Espagne, après la révolution de 1931, qui a détruit la monarchie, il y a eu une lutte acharnée. Le fascisme est apparu. Les partis de gauche ont formé le Front populaire. Il remporte les élections aux Cortès (parlement) et forme un gouvernement. Les forces de droite en réponse ont tenté de mener un coup d'État militaire et de renverser le gouvernement légitime. Le général Francisco Franco est devenu le chef du gouvernement militaire. Une guerre civile éclate en Espagne. Franco a reçu l'aide de l'Italie et de l'Allemagne. Gouvernement républicain - uniquement de l'URSS. Le reste des pays a poursuivi une politique de non-intervention dans les affaires de l'Espagne. Le régime de la république a progressivement changé. La démocratie a été restreinte sous prétexte de lutter contre le fascisme. En 1939, Franco a gagné. En Espagne, une dictature fasciste a été établie pendant de nombreuses années.
Néanmoins, avec toutes les différences dans les options de développement des pays occidentaux, ils avaient quelque chose en commun - le rôle de l'État s'est accru partout.
La crise a également affecté les relations internationales. Les pays occidentaux ont préféré se rejeter mutuellement le fardeau de la crise, au lieu de chercher ensemble des moyens d'en sortir. Cela a tendu les relations entre les grandes puissances et paralysé leur capacité à maintenir l'ordre mondial qu'elles avaient elles-mêmes établi. Le Japon a été le premier à en profiter, violant ouvertement les accords conclus lors de la Conférence de Washington sur la Chine. En 1931, elle occupa la Mandchourie (nord-est de la Chine) et en fit une base pour préparer de nouvelles agressions contre la Chine et l'URSS. Les tentatives timides de la Société des Nations pour rappeler le Japon à l'ordre l'ont conduit à se retirer avec défi de cette organisation internationale. Ses actions ont fini par rester impunies. En Allemagne, en 1933, les nazis arrivent au pouvoir avec leur programme de révision du traité de Versailles et de révision des frontières. Les fascistes italiens ont présenté un plan d'expansion en Afrique et en Méditerranée. Tout cela a conduit à une menace évidente pour le système Versailles-Washington.
2. Le renouveau de la civilisation de l'Europe occidentale dans la seconde
moitié du XXe siècle.
Le renouveau de la civilisation de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle a été marqué par l'idée d'un "État-providence" (un État démocratique qui garantit à ses citoyens un certain niveau de sécurité sociale et de bien-être tout en maintenant une économie de marché ). L'idée d'un tel État a longtemps fait son chemin. Au XIXe siècle, l'idée prévalait que chacun devait prendre soin de lui-même et si, dans des cas extrêmes, quelqu'un avait besoin d'aide, celle-ci devrait être fournie non pas par l'État, mais par des organisations caritatives. Mais l'opinion a progressivement commencé à se répandre que la protection sociale des citoyens est leur droit, et si tel est le cas, l'État devrait garantir la mise en œuvre de ce droit. La mise en œuvre de cette idée s'est déroulée lentement, sporadiquement. Le changement le plus profond dans cette direction s'est produit dans les années 1930. Les réformes du « nouveau cap », les transformations opérées par le gouvernement du Front populaire en France, en sont la preuve.
La formation finale de «l'État-providence» tombe dans les années 40 à 50. La nouvelle vague démocratique après la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle important à cet égard. Les réformes sociales ont été l'une des principales revendications des forces démocratiques, tout comme après la Première Guerre mondiale. Contribué à la formation de « l'État-providence » et de la « guerre froide ». Selon la politique de « confinement », l'Occident devait s'efforcer de créer une société juste et prospère afin de se protéger de la pénétration des idées communistes subversives. La condition pour la formation de « l'État-providence » était une situation économique favorable dans les pays de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Après tout, les programmes sociaux nécessitent des dépenses importantes. La croissance économique rapide a permis de les réaliser.
Parmi les caractéristiques frappantes du développement d'après-guerre de l'économie des pays occidentaux figure sa croissance rapide dans les années 50-60. Les taux de croissance annuels moyens de l'économie en Allemagne et en Italie ont été multipliés par 4, au Royaume-Uni - ont presque doublé. Dans le même temps, le point de départ a été pris en 1950, alors que le niveau d'avant-guerre était déjà dépassé. Plusieurs raisons expliquent ce développement dynamique des pays occidentaux. L'impulsion incontestable en fut le plan Marshall. Jusqu'en 1951, les États-Unis ont fourni aux pays d'Europe occidentale 13 milliards de dollars, qui sont allés principalement à l'achat d'équipements industriels. L'expansion du marché était une condition importante de la croissance économique. Le marché intérieur a été affecté par l'apparition de « l'État-providence ». Les revenus de la population ont augmenté et les dépenses de consommation ont augmenté en conséquence. À mesure que les revenus augmentaient, la structure de la consommation commençait à changer. Une part de plus en plus réduite en était occupée par le coût de la nourriture, une part croissante - par les biens durables : maisons, voitures, téléviseurs, machines à laver, stimulant directement la production. L'une des caractéristiques du développement de l'économie occidentale après la guerre a été la croissance rapide du commerce international. Si, après la Première Guerre mondiale, les pays ont cherché à s'isoler de l'économie mondiale avec des droits de douane élevés, alors après la Seconde Guerre mondiale, une voie a été prise pour libéraliser le commerce mondial et l'intégration économique a commencé en Europe occidentale. En conséquence, les exportations ont augmenté à un rythme sans précédent : sa croissance annuelle en 1948-1960, par exemple en Allemagne, était de 16,2 %. Ainsi, le commerce extérieur est devenu un stimulant pour le développement de l'économie. Les années de croissance économique ont coïncidé avec l'ère du pétrole bon marché. Après la guerre, l'exploitation intensive des plus grandes réserves mondiales de pétrole dans le golfe Persique a commencé. Son faible coût, sa haute qualité et son échelle de production colossale ont créé une situation unique dans le domaine de l'approvisionnement énergétique. Le pétrole a commencé à remplacer le charbon, les coûts de production ont été réduits, stimulant davantage la production. Une condition nécessaire à toute croissance économique sont les investissements, les investissements en capital. Leurs taux au cours de ces années dans certains pays ont atteint les valeurs maximales de toute l'histoire des statistiques de ce type. Leur niveau était déterminé par la nature même du développement industriel des années 1950 et 1960. Il y a eu une restructuration qualitative de l'industrie basée sur l'introduction de nombreux développements scientifiques et techniques pendant la guerre; la production de masse de téléviseurs, de récepteurs à transistors, de nouveaux moyens de communication, de plastiques et de fibres artificielles a commencé, les avions à réaction et l'énergie nucléaire sont apparus. La guerre froide a stimulé le développement de l'industrie militaire. Enfin, le maintien de la croissance économique a été la politique des gouvernements occidentaux ; ils l'ont activement promu, encourageant les investissements, stimulant la demande des consommateurs.
Le résultat de ces réformes a été l'émergence de «l'État-providence». Sa formation a eu lieu dans les années 40-50, son apogée - dans les années 60 - début des années 70. En 1975, tous les pays occidentaux avaient créé des systèmes de sécurité sociale qui fournissaient aux citoyens une variété de services - assurance sociale et assistance sociale, leur garantissant le soutien de l'État tout au long de leur vie. L'Etat s'est chargé d'organiser l'aide aux veuves, aux orphelins, aux handicapés, aux familles nombreuses, aux citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté établi dans de nombreux pays. De 52 à 67 % de l'ensemble de la population en âge de travailler des pays occidentaux était couverte par l'assurance chômage, de 48 à 94 % - par l'assurance accident, de 72 à 100 % - en cas de maladie, de 80 à 100 % - par les pensions. Les dépenses sociales sont devenues le poste le plus important des dépenses publiques, représentant 50 à 60 % du budget.
Réglementation des relations de travail. Le système de réglementation étatique des relations de travail est devenu une composante importante de l'État-providence. Le cadre juridique pour l'interaction des syndicats et des entrepreneurs a été établi, ce qui a assuré leur partenariat. La législation du travail a fourni aux salariés un certain nombre de garanties en matière d'emploi, d'embauche et de licenciement. La contradiction entre travail et capital demeure, mais prend des formes légales, réglementées et donc moins destructrices. Les salaires réels (salaires corrigés de la hausse des prix) ont doublé en Europe au cours des années 1950 ; aux États-Unis, ils n'ont augmenté de 20 % que pendant les années de la présidence d'Eisenhower (1953-1961).
Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes sociaux, « l'État-providence » est intervenu dans la vie économique. Dans un premier temps, la tâche principale des pays occidentaux dans ce domaine était d'empêcher des bouleversements économiques à la hauteur de la crise de 1929-1933. Tous ont mené une politique anticrise, essayant de réduire l'ampleur de la baisse de la production. Cette tâche a été largement accomplie ; il y a eu moins de crises, la baisse de la production n'a pas été profonde, il n'y a pas eu de crises globales d'ampleur. Cela a permis de proposer une tâche plus ambitieuse - parvenir à une accélération de la croissance économique.
La formation et le développement de «l'État-providence» ont été l'une des manifestations d'une tendance qui s'est manifestée à partir du début du XXe siècle - une tendance à l'élargissement des fonctions de l'État. Elle s'est manifestée de différentes manières. En URSS et dans les États fascistes, l'élargissement des fonctions de l'État s'est accompagné de la liquidation de la démocratie. La protection sociale de la population en eux n'était pas considérée comme un droit inaliénable des citoyens, mais comme une manifestation du "soin" de l'État. Après l'effondrement du fascisme, l'élargissement des fonctions de l'État s'est accompagné non pas de la réduction, mais du renforcement de la démocratie. La protection sociale, le travail, le bien-être ont commencé à être considérés comme des droits inaliénables des citoyens, comme le droit à la liberté d'expression, de réunion, de presse, etc.
Lorsque « l'État-providence » a atteint son apogée, beaucoup ont commencé à penser qu'il pouvait résoudre tous les problèmes, qu'il rendrait les sociétés occidentales prospères et justes, les sauverait de la pauvreté et du chômage, de l'ivresse et de la toxicomanie, donnerait à chacun un emploi et confiance en l'avenir. Et si l'État-providence atténue certainement ces problèmes, il ne possède pas de remèdes miracles. Et comme il s'est avéré bientôt, ses capacités étaient très limitées.
Au milieu des années 1970, « l'État-providence » traverse une période difficile. A cette époque, la situation économique en Occident a changé. En 1974-1975, la première véritable crise économique mondiale éclate. La croissance économique rapide s'est arrêtée. Il y a eu des interruptions dans l'approvisionnement des pays occidentaux en matières premières et, surtout, en pétrole. En 1973, les pays arabes, afin de forcer l'Occident à refuser son aide à Israël, ont cessé de vendre du pétrole à Israël, puis ont commencé à augmenter son prix : à la fin des années 70, il avait été multiplié par 10. La hausse des prix du pétrole a entraîné une hausse des prix de tous les biens et services. La hausse des prix - l'inflation - est devenue un problème économique majeur. Le ralentissement du développement économique coïncide avec l'entrée sur le marché du travail d'une génération nombreuse née après la guerre. L'économie de l'Occident ne pouvait plus absorber tous les demandeurs d'emploi. Le chômage a commencé à augmenter : à la fin des années 70, il atteignait 16,8 millions de personnes. La croissance des salaires réels s'est arrêtée, ce qui a accru le besoin de services sociaux de l'État et réduit ses possibilités : le système de protection sociale a commencé à fonctionner par intermittence.
L'« État-providence » est devenu un objet de critiques. Jusqu'à récemment, il était considéré comme une clé magique des portes du paradis terrestre, et maintenant il est devenu aux yeux de la population la source de tous les maux. L'opinion a été établie que l'inflation était le résultat de dépenses publiques excessives pour les besoins sociaux. Ce sont eux qui dévalorisent l'argent.
En conséquence, un mouvement politique est apparu prônant l'abolition de «l'État-providence». Ce mouvement s'appelait la "vague conservatrice". Ses représentants, les soi-disant néoconservateurs, sont arrivés au pouvoir dans la plupart des pays occidentaux dans les années 1980 et ont en effet pris des mesures pour affaiblir la régulation étatique de l'économie et créer des conditions plus favorables au développement de l'entrepreneuriat privé. Ils ont, en règle générale, mené une politique de crédit et financière rigoureuse afin de freiner l'inflation et de réduire les dépenses publiques. Dans les pays où il y avait un secteur public important dans l'économie, sa privatisation a été réalisée.
Cependant, il n'y a aucune raison de considérer tous ces phénomènes comme la preuve de l'effondrement de « l'État-providence ». Les systèmes de protection sociale ont bien résisté à la « vague conservatrice », mais ont été adaptés aux réalités économiques. Il est devenu évident que bon nombre des objectifs que l'on croyait possibles étaient irréalisables, comme le plein emploi. Il devenait évident qu'il fallait s'efforcer d'éviter une intervention étatique excessive : la concurrence et le marché devaient avoir la liberté nécessaire.
Au milieu des années 1980, en raison d'économies dans les dépenses budgétaires, une politique de resserrement du crédit et des finances a réussi à stopper l'inflation. Stabiliser les prix du pétrole et des autres énergies. Cela a créé les conditions préalables à la croissance des investissements en capital. De plus, à cette époque, il était nécessaire de mettre à jour le capital fixe dans le cadre de la révolution technologique qui avait commencé. L'ordinateur en est devenu le principal moteur et le symbole. Les ordinateurs électroniques ont été créés pendant les années de guerre. La première génération de ces machines, basée sur l'utilisation de tubes à vide, ressemblait à des monstres géants. Créé en 1951 par la firme américaine IBC (International Business Corporation), le modèle UNIVAC-1 pesait 30 tonnes, il utilisait 18 000 lampes reliées par 200 miles de fils. Enfin, en 1972, le microprocesseur a été inventé, faisant de la technologie informatique une miniature. En 1973, l'Américain Stephen Jobs a créé le premier ordinateur personnel, et en 1977 leur production en série a commencé. L'informatisation a ouvert la voie à l'utilisation de nouvelles technologies dans la production : robots, systèmes de production flexibles, systèmes de conception automatique - Parallèlement, l'introduction généralisée de nouveaux matériaux tels que le silicium, le gallium, l'indium et leurs dérivés a commencé. De nouveaux types de céramiques industrielles et de matériaux composites sont apparus. Pour la première fois, la biotechnologie a commencé à être largement introduite dans la production, l'utilisation des méthodes de génie génétique a commencé. Tout cela pris ensemble a conduit à une reprise régulière de l'économie de 1982 jusqu'au début des années 1990. Son rythme, cependant, était lent. Il n'a pas touché à la métallurgie, à l'industrie charbonnière, à la construction navale. En conséquence, la hausse n'a pas conduit, comme auparavant, au plein emploi, l'armée des chômeurs n'a pas diminué. Cependant, derrière ces indicateurs quantitatifs peu impressionnants, un profond glissement qualitatif s'est amorcé. La révolution technologique a assuré une augmentation rapide de la productivité du travail, elle a rendu l'économie des pays occidentaux moins énergivore, la consommation spécifique de matières premières a diminué et la production est devenue plus respectueuse de l'environnement.
La révolution technologique a créé de nouveaux moyens de communication. La télécopie, le courrier électronique, les radiotéléphones portables et les téléphones satellites sont apparus. Ils ont à leur tour contribué à la croissance rapide du commerce mondial. Le rôle principal dans l'économie de l'Occident a commencé à être joué par les sociétés transnationales, qui produisaient et vendaient leurs produits dans de nombreux pays à la fois. L'interconnexion et l'interdépendance des économies nationales sont devenues encore plus grandes.
Liste de la littérature utilisée.
1. Babin Yu. Europe d'après-guerre // Nord. –1994, n° 12.
2. Histoire mondiale : En 24 volumes / Éd. Badak A.V., L.A. Voinich T. 21. - Minsk. : Littérature, 1998.
3. Zagorsky A. L'Europe après la guerre froide // Courrier de l'UNESCO. - 1993, décembre.
4. Zaritsky B. Secrets du "miracle allemand" // Nouvelle heure. –1995, n° 14.
5. Kostyuk V.N. Histoire de la pensée économique. M. : Centre, 1997.
6. Narinsky M. M. L'URSS et le plan Marshall // Compréhension de l'histoire. - M., 1996.
7. Fedyashin A. De l'union monétaire - à la superpuissance "Europe" // Echo de la planète. - 1997, n° 12.
8. Khachaturyan V. M. Histoire des civilisations du monde. – M. : Outarde, 1996.
© Placement de matériel sur d'autres ressources électroniques uniquement accompagné d'un lien actif
Mémoires d'examen à Magnitogorsk, mémoires d'examen à acheter, dissertations en droit, dissertations en droit, dissertations au RANEPA, dissertations en droit au RANEPA, mémoires de fin d'études en droit à Magnitogorsk, diplômes en droit au MIEP, diplômes et dissertations en VSU, tests en SGA, mémoires de maîtrise en droit à Chelga.