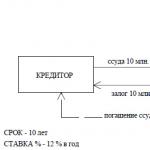Héraldique théorique : éléments obligatoires et facultatifs des armoiries, formes d'écus, pans héraldiques, couleurs héraldiques, leur désignation graphique et règles de combinaison. Composantes des armoiries - Les parties d'une réalisation d'armoiries
Parmi les guerriers slaves, bien avant l'apparition de Kievan Rus, selon les rapports d'auteurs byzantins du 6ème siècle. les boucliers sont les seuls moyens de protection :
Procope de Césarée : "En entrant dans la bataille, la majorité va aux ennemis à pied, ayant de petits boucliers et des lances à la main, mais ils ne mettent jamais d'armure."
Mauritius Strategist : "Chaque homme est armé de deux petites lances, et certains d'entre eux de boucliers, solides mais difficiles à porter."
Malheureusement, il n'est pas possible d'imaginer l'apparence des boucliers slaves mentionnés ci-dessus, car il n'y a aucune preuve picturale ou archéologique pour les sources écrites. De toute évidence, les boucliers slaves de cette époque étaient entièrement constitués de matériaux organiques (planches, tiges) et, faute de pièces métalliques, n'ont pas survécu à ce jour.
Les premiers fragments de boucliers retrouvés sur le territoire Russie antique, appartiennent au Xe siècle. A de rares exceptions près, il ne s'agit que de pièces métalliques. Ainsi, les informations permettant de recréer l'apparence et les caractéristiques de conception des boucliers sont très limitées.
Des fragments d'au moins 20 boucliers ont été archéologiquement enregistrés sur le territoire de l'ancienne Russie. La partie la plus commune et clairement identifiable du bouclier est l'ombon, qui est un hémisphère de fer attaché au centre du bouclier.
A.N.Kirpichnikov distingue deux types d'ombons russes anciens : hémisphérique et sphéroconique. Le premier type comprend 13 spécimens sur 16 trouvés. Tous ont une forme standard - un arc semi-sphérique sur un col bas et une taille - diamètre 13,2-15,5 cm, hauteur 5,5-7 cm. L'épaisseur du métal ne dépasse pas 1,5 mm.
Le deuxième type comprend trois umbons, dont deux proviennent de la région du sud-est de Ladoga et un autre a été trouvé dans l'ancienne couche russe de la colonie de Tsimlyansk. Ce sont des umbos sphéro-coniques, le plus clairement exprimés dans les spécimens de Ladoga. Elles sont un peu plus grandes que les ombons du premier type : diamètre 15,6 cm et 17,5 cm, hauteur 7,8 cm et 8,5 cm Il n'y a pas de col. L'ombon de la colonie de Tsimlyansk se distingue par sa plus petite taille (diamètre 13,4 cm, hauteur 5,5 cm) et la présence d'une petite saillie au sommet de la voûte.
Les ombons des deux types ont des champs de 1,5 à 2,5 cm de large.De 4 à 8 trous ont été percés dans ces champs, à travers lesquels des clous (rarement des rivets) sont passés, fixant l'ombon à boite en bois bouclier. Plusieurs clous de fixation ont été conservés, ce qui permet de calculer grossièrement l'épaisseur du champ de bois sous l'ombon. D'une longueur de 2,5 à 5 cm, les clous sont pliés de manière à ce que l'épaisseur du champ en bois soit reconstruite à moins de 7-8 mm. A la même époque, sur l'un des ombons du deuxième type trouvés dans la région de Ladoga, on fixait un rivet sans coudes, long de 4,5 cm.
En plus des ombons, la partie définie du bouclier est constituée des ferrures métalliques fixées au bord du bouclier. Dans six cas, des fers ont été trouvés avec des umbones, dans trois cas sans umbones. Le nombre de pièces forgées variait de quelques pièces à deux douzaines. Ce sont de fines bandes de fer (0,5 mm) (dans un cas, du bronze) d'environ 6 cm de long et d'environ 2 cm de large, pliées en deux. Sur l'une des ferrures, des traces d'ornementation sous forme de deux lignes parallèles ont été conservées. Avec deux petits rivets, les ferrures étaient fixées au bord du bouclier. La plupart des anciennes garnitures russes des deux côtés avaient une marche qui, comme le montrent les matériaux étrangers, était nécessaire pour l'emplacement de la bande de cuir longeant le bord du bouclier. La distance entre les bords de la reliure était dans tous les cas de 5 à 6 mm, ce qui était égal à l'épaisseur du champ en bois sur le bord du bouclier.
Le sujet de l'héraldique théorique est un ensemble de règles et de techniques de compilation d'armoiries, sans connaissance desquelles leur «lecture» et leur définition correctes sont impossibles. Conformément à ces règles, le blason était composé de diverses parties : un écu, un casque, une couronne, un cimier, un bâtard, des porte-écus, des devises, un manteau et diverses décorations autour de l'écu. Cependant, toutes les armoiries n'exigeaient pas la présence simultanée de toutes ces pièces. Certains d'entre eux étaient les principaux, obligatoires, d'autres non.La partie principale des armoiries est le bouclier. Il existe plusieurs types d'écussons héraldiques : Français- forme quadrangulaire avec un affûtage en bas au milieu. La hauteur d'un tel bouclier doit être égale aux 9/8 de sa largeur ; Espagnol- la même taille que le français, mais avec un fond légèrement arrondi; Varègue- triangulaire, avec des côtés légèrement incurvés ; italien- ovale et Allemand- un bouclier de forme richement sculptée. En plus d'eux, il y avait des boucliers ronds, obliques et carrés. Dans l'héraldique russe, la forme française du bouclier est devenue la plus courante.
côtés héraldiques. Les parties en héraldique sont définies en termes de qui se tient derrière les armoiries et les tient; ainsi, du spectateur, le côté héraldique droit est à gauche, le côté héraldique gauche est à droite. Un bouclier divisé en deux verticalement est dit disséqué ; divisé en deux horizontalement - croisé; divisé en deux parties d'un coin à l'autre - biseauté à droite ou à gauche. Le bouclier, divisé à la fois verticalement et horizontalement, est à la fois disséqué et croisé. D'autres types de divisions ont également été utilisés, par exemple, en forme de fourche, en forme de coin. Les divisions du bouclier pourraient également être formées par des lignes courbes. Dans ce cas, ils avaient les noms correspondants - dentelés croisés, concaves disséqués, épineux disséqués. La division des armoiries avec des lignes dentelées était caractéristique des armoiries allemandes.
Couleurs héraldiques. Les couleurs de tous les détails (formes, champs, etc.) doivent être définies. Il est conseillé de se limiter aux principales couleurs héraldiques: deux "métaux" - or et argent (en héraldique, il n'y a pas de distinction entre l'or et le jaune, entre l'argent et le blanc), cinq "finifts" ("émaux") - azur ( ce concept combine différentes nuances de bleu et de bleu, entre lesquelles il n'y a pas non plus de distinction), écarlate (rouge, écarlate), vert, noir et violet (peut être transmis dans différentes nuances de violet, cramoisi froid, lilas); une image stylisée de certaines fourrures est également autorisée (hermine, écureuil, "anti-hermine" ; chacune des fourrures est considérée comme une couleur distincte en héraldique) et la couleur chair (lorsqu'elle représente des personnes, des anges, des centaures, des sphinx et d'autres monstres humanoïdes) . Lorsque les armoiries sont reproduites en une seule couleur, des hachures conditionnelles sont utilisées pour la cicatrisation. L'argent est représenté comme une surface non ombrée, l'or comme une surface pointillée. La couleur noire est représentée par une surface solide et reproduite en relief - par des traits qui se croisent. La fourrure antiermine a un fond noir avec des "queues" blanches représentées de la même manière que l'hermine. La fourrure de zibeline équivaut au noir. Les figures principales placées sur un fond en métal doivent être en émail, et vice versa - les figures dans le champ en émail doivent être en métal. Métal sur métal, émail sur émail ne se superposent pas. C'est ce qu'on appelle la "règle de base de l'héraldique".
Image graphique. L'argent est un espace vide, l'or est des points, l'azur est des lignes horizontales et l'écarlate est des lignes verticales. Les parties noires des armoiries peuvent être entièrement peintes ou recouvertes de peinture verticale et lignes horizontales comme une grille. Les émaux verts et violets correspondent à des lignes obliques ; il est seulement important de ne pas confondre quelle pente correspond au vert et laquelle correspond au violet. Si le bouclier est représenté comme incliné, l'ombrage est incliné avec lui.
Héraldique théorique: les règles de base des images héraldiques, les noms des parties du bouclier, les manières de diviser le bouclier et la hiérarchie des champs armoriaux, les figures héraldiques et non héraldiques, les noms des différentes formes de leur position relative.
Parmi les figures armoriales, on distingue des figures géométriques abstraites, appelées figures héraldiques ou honorifiques. Les figures héraldiques les plus importantes sont un pilier (bande verticale), une croix (pilier et ceinture reliés), des bandages droit et gauche (bandes diagonales), se terminant (une bande le long du bord inférieur de l'écu), une bordure (une bande le long tous les bords de l'écu), un chevron (deux bandes inclinées reliées par une "maison"). La colonne peut être déplacée vers la droite et la gauche, la ceinture peut être relevée ou abaissée, la tête et l'extrémité peuvent être biseautées vers la droite ou vers la gauche. Le chevron, sauf indication contraire, repose sur les coins inférieurs et n'atteint pas le milieu du bord supérieur du bouclier. S'il atteint le milieu du bouclier, alors il est dit abaissé, s'il ne repose pas sur les coins, mais sur les côtés du bouclier, alors il est dit élevé. Il peut être renversé (inversé), droit (en appui contre les coins gauches et le milieu du côté droit de l'écu), gauche, biseauté vers la droite (en appui contre le milieu de la base et le côté gauche de l'écu et la partie supérieure coin droit) ou biseauté vers la gauche. S'il n'y a qu'une seule figure héraldique, elle a généralement une largeur de ½ à 1/3 de la largeur de l'écu, s'il y en a plusieurs dans les armoiries, alors la largeur devient plus petite.
Les figures restantes sont dites non héraldiques et sont divisées en naturelles (images d'êtres vivants) et artificielles (images d'une grande variété d'objets créés par l'homme).
La composition des armoiries, en plus de l'écu, peut inclure des signes d'état qui composent le cadre. Ceux-ci incluent un casque, une crête, un manteau ou un manteau, une couronne (ou une burlet ou une casquette le remplaçant), des porte-boucliers, une devise, ainsi que des récompenses et des signes officiels. La disposition de deux personnages ou plus l'une au-dessus de l'autre est appelée «en colonne», les unes avec les autres - «en ceinture», la disposition le long de la diagonale du bouclier est «en bandage». Par défaut, les chiffres des armoiries sont disposés comme suit: simple - au milieu du champ de bouclier, deux - côte à côte, trois - deux côte à côte au-dessus d'un, quatre - deux d'affilée. Avec un grand nombre indéfini de chiffres identiques, le champ est dit pointillé avec ces chiffres. Un chiffre plus grand peut être accompagné de chiffres plus petits. L'accompagnement sur les côtés et les coins est possible, et il doit y avoir le même nombre de personnages d'accompagnement de chaque côté. Un chiffre plus grand peut être accablé ou couvert par les plus petits. Dans les deux cas, de petites figures se superposent à une grande, mais lorsqu'elles sont encombrées, elles s'y adaptent entièrement, et lorsqu'elles sont couvertes, les bords des petites figures dépassent des bords de la grande. Même si une autre figure est placée sur le bord supérieur d'une figure, la première figure est appelée seconde perfectionnée. Les créatures vivantes et les armes sont tournées vers la droite par défaut. Les figures tournées vers la droite sont dites renversées. Les figures inversées ne sont pas précisées si elles sont dues à la parade nuptiale dite héraldique, c'est-à-dire tournée vers une autre figure. Une figure inversée est appelée renversée, située au-dessus ou en dessous de la position normale - élevée ou abaissée. La figure d'un animal, partiellement représentée dans le champ des armoiries, est dite croissante lorsqu'environ la moitié de la figure est visible, et survenant lorsque seuls la tête et le cou sont visibles de derrière le bord du bouclier ou d'une autre figure, parfois avec une partie de la patte ou de la queue. Les animaux héraldiques peuvent être représentés dans des poses strictement définies. Les quadrupèdes se lèvent (debout sur leurs pattes arrière), galopent (avec une position horizontale du corps, mais en s'appuyant sur deux pattes arrière), marchent (sur les quatre pattes, sur la première levée), debout (sur les quatre pattes), assis ou mentir.
Héraldique familiale russe. familiale, personnelle et armoiries familiales en Russie. Principes de construction des armoiries familiales. Armoiries accordées et « originales ». Armoiries de diverses catégories de la noblesse russe. Emblèmes d'origine étrangère.
Dans la Russie pré-révolutionnaire, seuls les nobles avaient droit aux armoiries familiales - cette Russie différait des pays européens, où non seulement les armoiries du clergé, mais aussi les bourgeois et même les paysans étaient courants. Les armoiries nobles en Russie étaient génériques, comme les familles nobles, et la plupart des titres. Les armoiries d'un noble sont passées à tous ses descendants légitimes des deux sexes dans la lignée masculine. Le transfert des armoiries à travers la lignée féminine a été officialisé comme une nouvelle récompense. La base pourrait être la suppression du clan. Il n'y avait pas de règles claires pour la disposition de deux armoiries fusionnées en une seule, les plus courantes étaient dans un bouclier disséqué, dans un bouclier avec un bouclier cardiaque ou un bouclier en quatre parties.
Une caractéristique des armoiries accordées est leur immuabilité. Seul le monarque a le droit d'apporter des modifications aux armoiries en accordant à nouveau, les modifications arbitraires sont inacceptables. Ce principe a été introduit par Paul 1.
À la volonté du monarque, des ajouts honorifiques spéciaux pourraient être apportés aux armoiries. Le plus souvent, un aigle à deux têtes ou une partie de celui-ci était introduit, mais il pouvait également y avoir des éléments d'emblèmes locaux, des récompenses, des indications de différences, ainsi que des symboles abstraits d'honneur. C'est ce qu'on appelle l'augmentation. Les armoiries "originales" sont des armoiries adoptées indépendamment, elles sont valables si elles ne sont pas interdites par l'état.
Les armoiries générales des familles nobles de l'Empire russe sont un ensemble d'armoiries des familles nobles russes, établies par décret de l'empereur Paul Ier du 20 janvier 1797. Vingt volumes de l'armorial comprennent 3 066 familles et plusieurs personnels armoiries. L'abréviation courante est OG. Laissez tous les blasons inscrits au blason à jamais indispensables pour que sans nos spéciaux, ou les successeurs de nos commandements, rien en aucun cas n'en soit exclu et rien ne leur soit encore ajouté.
A chaque noble de la famille dont les armoiries sont à l'armorial, délivrer sur parchemin pour agrafe, des copies exactes des armoiries de cette famille et de la description de celle localisée. Il y a trois siècles, comme aujourd'hui, les armoiries tribales ont commencé à être utilisées spontanément en Russie. Au début, à partir de la fin du XVIIe siècle, l'État moscovite ne reconnaissait que les armoiries d'origine étrangère (appartenant à des familles « voyageant en Russie ») et les confirmait par l'Ordre des ambassadeurs. Au cours des réformes de Pierre, avec l'unification de la classe noble et la création du bureau du roi des armes, une tentative a été faite d'utiliser les armoiries familiales comme attribut de la «gentry» en cours d'élaboration, et à ce titre pour les placer sous le contrôle de l'État. Initialement, le bureau du roi des armes était autorisé non seulement à soumettre de nouvelles armoiries et des ajouts honorifiques à l'approbation royale, mais également à confirmer indépendamment les armoiries déjà utilisées, si nécessaire, en les soumettant à l'édition. Au fil du temps, cependant, la procédure d'auto-validation n'a été laissée en place que pour les armoiries précédemment accordées en Russie. La nécessité de toute édition, édition d'armoiries en même temps a disparu. Cet ordre fut fixé successivement par Paul Ier et Alexandre II.
Ville russe et héraldique régionale. Emblèmes de la ville du XVIIe siècle. Principes de construction des armoiries provinciales et municipales. Corrélation des armoiries des comtés avec celles des provinces. Emblèmes de la ville en L'heure soviétique. Armoiries de la ville dans la Russie moderne.
Les premiers emblèmes terrestres ne sont connus que par les sceaux. Le grand sceau d'État d'Ivan le Terrible, datant du dernier quart du XVIe siècle, contenait 24 emblèmes terrestres. Le Grand Livre d'État de 1672 contenait déjà 33 terres, dont les noms étaient à ce moment inclus dans le titre du tsar russe. Sous Catherine II, toutes les villes ont reçu des armoiries. Les emblèmes de la ville accordés par Catherine ne contenaient aucun élément autre que des boucliers. Dans l'héraldique de la ville, il y a aussi des armoiries de voyelles (un aigle dans les armoiries de la ville d'Orel ; un loup dans les armoiries de Volchansk ; des perdrix dans les armoiries de Koursk, etc.). Outre les armoiries vocaliques, une place prépondérante est occupée par les "anciennes" armoiries, dont certaines reflètent des cultes anciens locaux. Mais le plus souvent, les armoiries de la ville accordées par Catherine reflétaient la nature, l'économie ou la vie politique du comté ou de la ville. Parfois, le contenu et l'élément "parlant" fusionnaient en un seul symbole. Par exemple, la cloche dans les armoiries de Zvenigorod peut être perçue à la fois comme un blason de voyelle et comme une inclusion dans les armoiries d'un élément pour lequel Zvenigorod est réellement célèbre. À l'époque soviétique, l'intérêt pour l'héraldique urbaine n'a repris que dans la seconde moitié des années 1960. Et en environ un quart de siècle, environ 250 armoiries des villes de l'URSS ont été développées. Dans le même temps, les compilateurs d'armoiries, ainsi que ceux qui revendiquaient ces armoiries, manquaient généralement de connaissances héraldiques. Le placement du nom de la ville dans les armoiries est devenu très courant, ce qui n'est pas du tout accepté dans l'héraldique traditionnelle. Pendant ce temps, près de la moitié des emblèmes des villes soviétiques contiennent cet élément. L'idée est née que les armoiries devaient certainement refléter le passé de la ville, son présent et son avenir. Cela a conduit à une surcharge des armoiries, rédigées conformément à une telle prémisse. De plus, le symbolisme de la modernité était, en règle générale, monotone - l'industrie était symbolisée par un engrenage ou un marteau-piqueur, Agriculture- une oreille, la science - une fiole, un modèle d'atome. Dans d'autres domaines, un certain nombre de villes (Tula, Pskov, Smolensk, Zubtsov, Novgorod, Riga, Yaroslavl) ont pris les anciens emblèmes comme base. Les armoiries soviétiques originales des villes de la région de Mourmansk, n'ayant qu'une très courte histoire. Les compilateurs des armoiries ont réussi à éviter les solutions "industrielles" standard. Les armoiries de Monchegorsk, célèbre pour son usine de nickel, contiennent les symboles éléments chimiques cuivre, nickel et cobalt. À la fin des années 80, l'intérêt pour l'héraldique historique s'est accru et les anciennes armoiries ont commencé à revenir dans les villes. Dans la Russie moderne, la succession à l'héraldique pré-révolutionnaire a été proclamée. Mais l'herboristerie garde toute sa signification : premièrement, de nombreuses villes qui existent aujourd'hui n'ont jamais eu d'armoiries auparavant ; d'autre part, de nouvelles versions graphiques d'anciennes armoiries sont créées ; troisièmement, malgré la réforme de 1857, de nombreuses armoiries locales jusqu'en 1917 ont été utilisées dans la version de l'époque de Catherine, bien que cela soit contraire à la loi. Depuis 1992, un département héraldique fonctionne dans la Fédération de Russie, en 1996 l'unité de la politique héraldique dans le pays a été proclamée et l'enregistrement fédéral des armoiries a été introduit. Des armoiries personnelles, des armoiries de sociétés, d'associations, d'entreprises sont également créées.
Héraldique d'État. Emblème d'État et ses caractéristiques. Armoiries de l'Empire russe, son histoire et son évolution. Grand, moyen et petit emblème d'État de l'Empire russe. Symboles d'État du gouvernement provisoire. Armoiries de la Russie moderne.
Pour la première fois, un aigle à deux têtes apparaît sur le sceau du grand-duc Ivan 3 vers 1490. Mais le blason lui-même (un aigle à deux têtes dans un bouclier sous un casque avec une couronne royale et un baptême) pour le première fois en Russie apparaît sur le sceau personnel du tsar Fiodor Alekseevitch, bien qu'il s'agisse d'un cas unique au XVIIe siècle. Au seuil du 18 s., l'emblème royal est proclamé (un aigle à deux têtes, généralement avec un cavalier sur la poitrine). Les détails sont fixés (l'aigle tient le sceptre et l'orbe, le cavalier frappe le serpent avec une lance), les couleurs sont déterminées (un aigle noir dans un champ d'or, un cavalier "naturel" dans un bouclier écarlate) et l'orientation des figures (un cavalier en cuirasse est renversé). Les couronnes au-dessus de l'aigle ont été remplacées par des couronnes "impériales" (semblables à la couronne latérale du Saint Empire romain germanique) avant même que Pierre 1 ne prenne le titre impérial. Initialement, sur certaines images, l'aigle du bouclier portait deux couronnes et la troisième, grande couronne, commençait à être située directement au-dessus. Sous Pierre 1, une chaîne de l'Ordre de Saint-André le Premier Appelé a été placée autour du bouclier sur la poitrine de l'aigle, et le cavalier a été interprété comme Saint-André. George. L'héraldisation a également affecté les emblèmes qui désignaient les principautés et les possessions individuelles selon le titre complet du monarque. Mais l'élaboration d'un grand blason impérial, qui comprenait tous les blasons des possessions, ne fut pas réalisée durant ces années. Un tel blason a été développé sous Paul 1, mais n'a pas été approuvé. Mais sous Paul 1, la croix maltaise, placée sur la poitrine d'un aigle derrière un bouclier avec un cavalier, et la couronne maltaise ont été introduites dans l'emblème de l'État. Alexandre 1 a supprimé le symbolisme maltais, mais a beaucoup expérimenté la position des ailes de l'aigle, le nombre de couronnes, les objets que l'aigle tient dans ses pattes. En 1856, Alexandre II a approuvé les grands, moyens et petits emblèmes d'État, les emblèmes des domaines de titre, les grands et petits emblèmes pour tous les membres de la dynastie. Quelques modifications ont été apportées aux armoiries, notamment, le cavalier a été tourné vers la droite, et une fine bordure dorée a été appliquée sur l'écu avec le cavalier (pour éviter d'imposer un écu écarlate sur la poitrine noire d'un aigle). Un auvent a été introduit dans les armoiries des membres supérieurs de la dynastie au lieu du manteau. Les plus jeunes membres de la dynastie couronnaient leurs armoiries de la couronne impériale. Le gouvernement provisoire a aboli les armoiries impériales et a commencé à utiliser l'aigle à deux têtes sur des sceaux sans aucun attribut, sans bouclier héraldique et de couleur fixe. Il était supposé que les nouvelles armoiries seraient rédigées après l'adoption Assemblée constituante décisions gouvernementales. Mais au lieu de cela, l'aigle à deux têtes a complètement disparu des symboles de l'État russe pendant 75 ans. Le 30 novembre 1993, par décret du président de la Fédération de Russie, un blason a été rétabli sous la forme d'un aigle à deux têtes sous trois couronnes, cependant, d'une couleur différente. Sept ans plus tard, ce blason fut ré-approuvé par une loi constitutionnelle. Selon l'art. 1 de la loi constitutionnelle fédérale «Sur l'emblème d'État de la Fédération de Russie», adoptée le 25 décembre 2000, «L'emblème d'État de la Fédération de Russie est un quadrangulaire, avec des coins inférieurs arrondis, pointé à l'extrémité, un bouclier héraldique rouge avec un aigle bicéphale doré, levant ses ailes déployées. L'aigle est surmonté de deux petites couronnes et au-dessus d'elles par une grande couronne reliée par un ruban. Dans la patte droite de l'aigle se trouve un sceptre, dans la gauche se trouve un pouvoir. Sur la poitrine de l'aigle, dans un bouclier rouge, il y a un cavalier d'argent dans un manteau bleu sur un cheval d'argent, frappant avec une lance d'argent un dragon noir renversé et piétiné sur son cheval.
Baron N.A. Tipolt
COMPOSANTS DU BLASON
Le blason se compose d'un bouclier, d'un casque, d'une couronne, d'une crête, d'un bâtard, de porte-boucliers, d'une devise, d'un manteau et de décorations spéciales autour du bouclier.
Les principales formes du bouclier sont les suivantes :
- triangulaire, soi-disant Varègue(Tableau I, Fig. 1.).
- ovale, soi-disant italien(Fig. 2).
- Carré arrondi, soi-disant Espagnol(Fig. 3).
- quadrangulaire, pointé vers le bas, le soi-disant français(Fig. 4).
- coupé, soi-disant allemand(Fig. 5).
MÉTAUX, émail et fourrures
Pour la représentation des armoiries en héraldique, les métaux, couleurs et fourrures suivants sont utilisés, représentés par les couleurs correspondantes ou les signes graphiques conventionnels.
- Or, représenté avec de l'or naturel ou de la peinture jaune (Fig. 6a) et graphiquement avec des points (Fig. 6b).
- Argent, représenté en argent naturel et graphiquement dépourvu de tout signe (Fig. 7a).
Les couleurs appelées émaux sont les suivantes :
- Rouge, ou écarlate, représenté par la peinture correspondante (Fig. 8a) et graphiquement par des lignes verticales (Fig. 86).
- Bleu, ou Azur, représenté par la peinture correspondante (Fig. 9a) et graphiquement par des lignes horizontales (Fig. 9b).
- Vert, représenté par la peinture correspondante (Fig. 10a) et graphiquement par des lignes diagonales à droite (Fig. 10b).
- violet, représenté par la peinture correspondante (Fig. 11a) et graphiquement par des lignes diagonales à gauche (Fig. 116).
- Le noir, représenté par la peinture correspondante (Fig. 12a) et des lignes verticales et horizontales qui se croisent graphiquement (Fig. 126).
- Hermine, représentés au naturel (planche II, fig. 13a) ou en signes noirs conventionnels (fig. 136).
Parfois, la couleur de cette fourrure est représentée à l'envers, c'est-à-dire que le champ est noir et les signes sont blancs, auquel cas la fourrure est dite anti-hermine (Fig. 14a et 146). - Écureuil, représentés de manière particulière par des figures disposées en rang (généralement d'azur, fig. 15). L'emplacement de ces figurines peut être varié: si elles sont tournées vers le bas avec leurs sommets, alors la fourrure sera renversée (Fig. 16); s'ils sont placés l'un sous l'autre, alors on l'appelle placés dans un poteau (Fig. 17), et si leurs sommets sont rabattus, alors on l'appelle renversé dans un poteau (Fig. 18); si ces figures sont directement en contact par paires avec leurs bases, alors la fourrure est appelée anti-écureuil dans une colonne (Fig. 19); et s'ils ne touchent que les bords des bases, alors - anti-écureuil dans la ceinture (Fig. 20).
En héraldique, il est également permis Naturel couleur, mais avec une extrême prudence et, principalement, par rapport à la seule couleur de peau.
Le bouclier armorial ne reste presque jamais recouvert uniquement d'émail sans aucune figure (Fig. 21), mais dans de tels cas, il est rempli d'un motif monotone spécial - damas ou écailles (Fig. 22), qui, cependant, peut également couvrir des parties individuelles du bouclier.
Cela a établi la règle: métal sur métalet ne pas appliquer d'émail sur émail.
DIVISIONS DU BOUCLIER
Pour les locaux Suite chiffres et leur disposition plus pratique dans le bouclier, ce dernier permet des divisions conditionnelles, à savoir, le bouclier peut être :
Disséqué : une fois (fig. 23), deux fois (fig. 24) ou plusieurs fois.
Franchi: une fois (Fig. 25), deux fois (Fig. 26), plusieurs fois (ex. 9 fois - Fig. 27).
biseauté :à droite (Fig. 28), à gauche (Fig. 29), deux biseautés à droite (Fig. 30).
Dans le même temps, il convient de garder à l'esprit que le droit et côté gauche Il est d'usage en héraldique de déterminer le bouclier de la personne qui porte prétendument le bouclier, c'est-à-dire de retour au spectateur.
Ces grandes divisions peuvent être combinées les unes avec les autres de diverses manières, par exemple : le bouclier est disséqué et croisé ou quadruple(Fig. 31), disséqué et croisé deux fois (Fig. 32), disséqué et croisé deux fois (Fig. 33), disséqué et demi-croisé (Fig. 34), semi-croisé et disséqué (Fig. 35), croisé et semi-disséqué (tableau III, fig. 36), semi-disséqué et croisé (fig. 37), oblique à droite et à gauche, ou biseauté en quatre parties(fig. 38), biseauté à droite et demi biseauté à gauche (fig. 39), biseauté à droite et demi biseauté à gauche (fig. 40), à bifurcation(Fig. 41) et renversé-fourchu(Fig. 42), croisé et biseauté à droite (Fig. 43), croisé et biseauté à droite et à gauche (Fig. 44), disséqué et en première partie biseauté à droite (Fig. 45), en forme de coin(Fig. 46).
Les divisions peuvent être formées non seulement par des lignes droites, mais aussi par des lignes brisées et autres. Les divisions les plus courantes sont :
Échelonné : par exemple, l'écu est traversé d'un gradin (fig. 47), biseauté de trois gradins (fig. 48), traversé de deux gradins descendants (fig. 49), traversé de trois gradins ascendants (fig. 50).
concave(Fig. 51) et arqué(Fig. 52).
Cranté: p. , disséqué par des dents arrondies (Fig. 58), traversé par des dents en trèfle (Fig. 59), disséqué par des dents en béquille (Planche IV, Fig. 60).
pointu, par exemple. épineux croisé (Fig. 61).
en dents de scie, par exemple. biseauté en dents de scie (Fig. 62).
squameux, par exemple. renversé-croisé écailleux (Fig. 63).
nuageux, par exemple. nuageux traversé (Fig. 64).
semblable à une flamme, par exemple. biseauté en forme de flamme (Fig. 65).
cochléaire, par exemple. croisé cochléairement (Fig. 66).
PERSONNAGES HÉRALDIQUES
PRIMAIRE.
Les figures héraldiques les plus importantes, formées par la sélection de lignes tracées dans l'écu de la plus petite partie de son champ, sont les suivantes :
- Chapitre(Fig. 67), qui occupe généralement les 2/7 de la hauteur du bouclier, mais si sa hauteur est inférieure à la valeur indiquée, alors ce chiffre s'appelle le sommet; la tête du bouclier peut être biseautée, par exemple la tête biseautée droite (Fig. 69), ou triangulaire (Fig. 70).
- extrémité(Fig. 71), qui a généralement les dimensions adoptées pour la tête du bouclier, mais si elles sont plus petites, la figure s'appelle le pied(fig. 72) ; la pointe peut aussi être biseautée (Fig. 73) et triangulaire (Fig. 74).
Il est également possible de relier ces figures, par exemple : un chapitre avec son haut, qui s'appelle, dans ce cas, un chapitre achevé (Fig. 75), ou un chapitre avec son pied, qui composent la figure d'un chapitre (fig. 76). - Pilier(Fig. 77), occupant 1/3 de la largeur du bouclier ; si sa figure est en contact direct avec le côté droit ou gauche de l'écu, alors le pilier porte également le nom local correspondant, par exemple, le pilier droit (Fig. 78) ; le pilier peut être décalé vers la droite (fig. 79) ou vers la gauche ; si le pilier est un peu plus étroit que sa largeur normale et est seul dans le bouclier, alors il est désigné comme étroit (Fig. 80).
- Ceinture(Fig. 81), occupant 1/3 au milieu de l'écu ; la ceinture peut être relevée (fig. 82), ou abaissée ; ce qui a été dit d'un pilier étroit s'applique également à une ceinture étroite, mais il est clair qu'il peut y avoir plusieurs ceintures dans le bouclier (fig. 83).
- Fronde, délimité par deux lignes biseautées parallèles à droite (Fig. 84) et à gauche (Fig. 85) ; et le baudrier, comme les figures précédentes, peut être étroit (Pl. V, fig. 86), relevé (fig. 87), ou abaissé, et, enfin, répété plusieurs fois dans l'écu (fig. 88).
- Chevron, formé, pour ainsi dire, par deux bandages opposés (Fig. 89); le chevron est dit renversé si son sommet touche le bas de l'écu (fig. 90) ; il peut être rétréci ou répété plusieurs fois (Fig. 91), augmenté (Fig. 92) ou abaissé (Fig. 93).
Toutes les figures indiquées peuvent être répétées par paires dans le bouclier et, dans ce cas, elles sont appelées appariées, par exemple trois bandages appariés à droite (Fig. 94).
Comme les divisions, les figures héraldiques peuvent être limitées par des lignes non seulement droites, mais aussi brisées, courbes et autres, etc., une ceinture dentelée (Fig. 95), une colonne anti-dentée (Fig. 96), un chevron abaissé avec pointu saillies (Fig. 97) , ceinture brisée (Fig. 98), ceinture en dents de scie (Fig. 99), bande ondulée (Fig. 100), chevron concave abaissé (Fig. 101), chevron à pointes (Fig. 102), ceinture ramifiée (Fig. 103), colonne squameuse (Fig. 104), colonne pointée vers le bas (Fig. 105), bandage interrompu (Fig. 106).
Ces figures sont dites raccourcies si elles ne touchent pas les côtés du bouclier, par exemple un chevron abaissé raccourci (Fig. 107); puis, en répétant, les figures peuvent entrelacer, par exemple, trois chevrons abaissés entrelacés (Fig. 108), deux chevrons latéraux opposés entrelacés (Fig. 109).
Enfin, deux figures hétérogènes peuvent être combinées en une seule, par exemple, une tête reliée à un pilier forme une figure appelée béquille(Fig. 110), un pilier relié à une ceinture est le prototype de la figure d'une croix héraldique.
TRAVERSER
Le type de croix le plus simple est la connexion d'un pilier avec une ceinture, la soi-disant. croix héraldique (Planche VI, fig. 111). Il peut aussi être étroit (Fig. 112). Ses variétés sont des croix: en forme de coin (Fig. 113), à extrémités élargies (Fig. 114), béquille (Fig. 115), étagée (Fig. 116), griffée (Fig. 117).
La jonction des deux bandages constitue la croix de Saint-André (Fig. 118), qui peut aussi être étroite (Fig. 119).
Ces croix peuvent être représentées comme raccourcies, dont les variétés sont typiques: les soi-disant. croix héraldique (Fig. 120), croix élargie (Fig. 121), croix latine (Fig. 122), croix traversante (Fig. 123), croix d'Antoine (Fig. 124 - une béquille raccourcie proprement dite), croix de béquille (Tableau VII , Fig. 138) et une croix griffue (Fig. 140).
Une connexion particulière de deux demi-bandes avec un pilier forme une figure appelée à bifurcation une croix (planche VI, fig. 125), qui peut aussi être représentée à l'envers (fig. 126).
Les croix peuvent être et croisées (Fig. 127 - héraldique et Fig. 128 - raccourci).
La croix peut être non seulement à quatre pointes, mais aussi à cinq pointes (Fig. 129), à six pointes (Fig. 130 et 131), russe (Fig. 132); à sept branches (Fig. 133), à huit branches, par exemple: orthodoxe (Fig. 134), patriarcal (Fig. 135), et lui, également trèfle (Planche VII, Fig. 136), et même très complexe, croisé plusieurs fois ( Fig. 137).
Les croix peuvent être accompagnées de croix, par exemple, une croix de béquille raccourcie (Fig. 138), accompagnée de quatre croix dans les coins, s'appelle Jérusalem (or dans un champ d'argent, Fig. 139).
Plusieurs croix peuvent être reliées par des bases en une seule croix, par exemple: quatre croix à griffes raccourcies (Fig. 140) peuvent être reliées en une croix à griffes à quatre composés (Fig. 141).
Les extrémités des croix peuvent être extrêmement diverses et leurs types portent les noms suivants: croix lancette (Fig. 142), ancre (Fig. 143), serpentine à deux têtes (Fig. 144), enroulée (Fig. 145), trèfle (Fig. 146) , lunaire (Fig. 147), en forme de lys (Fig. 148), décoré de boules (Fig. 149), en forme de clou (Fig. 150), en forme de coin (Fig. 151), décoré de fleurs de lys (Fig. 152), en forme de losange (Fig. 155 ), à motifs (Toulouse, Fig. 154), de la croix de Saint-Jacques (Fig. 155), de maltais (Fig. 156), en forme de crochet ( Fig. 157), croix gammée (Fig. 158). Une croix qui touche son extrémité inférieure avec la ligne d'un bouclier ou d'une figure est dite hissée (Fig. 159). Parfois, la croix peut également être représentée à l'envers, la croix dite du martyr ou la croix de Saint-Paul (Fig. 160).
PERSONNAGES HÉRALDIQUES SECONDAIRES
- Frontière(Tableau VIII, fig. 161) ; la frontière peut être interne (Fig. 162).
- Carré(Fig. 163) ; le bouclier peut être divisé en carrés (Fig. 164), et s'il en est recouvert sur plusieurs rangées (généralement six sur sept), on l'appelle alors un échiquier (Fig. 165).
- partie gratuite, placé dans l'un des quatre coins du bouclier, par exemple ; partie libre droite (Fig. 166).
- Coin(Fig. 167) ; ce qui a été dit sur la partie libre s'applique également à cette figure.
- indiquer(Fig. 168) ; il peut être latéral (Fig. 169), renversé et concave (Fig. 170), rétréci (Fig. 171). La figure du point peut être répétée dans le bouclier, par exemple: deux points raccourcis inversés (Fig. 172). Le bouclier peut être divisé par points (Fig. 173); enfin, l'écu peut être recouvert de rangées de pointes (fig. 174).
- Bar- une figure rectangulaire dont la hauteur est inférieure à la largeur ; généralement il y en a plusieurs dans le bouclier (Fig. 175). Si le bouclier est recouvert de barres, il est alors appelé muré de coutures (Fig. 176).
- Galets- une figure rectangulaire dont la hauteur est supérieure à sa largeur, par exemple trois bardeaux : 2 et 1 (Fig. 177). Le bouclier peut être divisé par des bardeaux (Fig. 178).
- Rhombe(Fig. 179) ; l'écu peut être divisé par des losanges (Fig. 180).
- Broche(Fig. 181). Le bouclier peut être divisé par des broches et en ceintures (Fig. 182).
- collier de tournoi(Fig. 183).
- Un cercle(Fig. 184). Si le cercle est métallique, on l'appelle une pièce de monnaie.
- Bouclier ou cœur bouclier (fig. 185).
PERSONNAGES NON HÉRALDIQUES
Il existe des figures non héraldiques : naturelles, artificielles et légendaires.
FIGURES NATURELLES
Aux figures naturelles appartiennent, tout d'abord, Les saints. Dans l'héraldique russe, les images sont acceptées: Saint-Georges le Victorieux, représenté selon l'église du spectateur à droite (tableau IX, 1), et dans l'héraldique officielle, depuis 1856, héraldiquement à droite; Saint Archange Michel (IX, 2) et Archange Gabriel (IX, 3).
Humain. Parfois, il est représenté nu et avec une massue (IX, 4), mais plus souvent en cavalier sur un cheval en armure et armé d'une épée (IX, 5), ou en guerrier, par exemple, avec une lance et un bouclier ( IX, 6). Généralement aussi une image de parties du corps humain : tête, mains, par exemple, une main armée d'une épée, émergeant d'un nuage (IX 7), paumes, jambes, un cœur, par exemple, enflammé (IX, 8) , etc.
Animaux: un lion, représenté le plus souvent debout, la tête tournée vers la droite (IX, 9), bien que séparément sa tête puisse l'être. représenté et directement (IX, 10). Si le lion est représenté marchant la tête droite, alors on l'appelle léopard(IX, 11). Des mélanges de ces espèces sont également possibles, puis, selon la position de la tête de l'animal, on l'appelle ou léopardlion ou lion léopard.
D'autres espèces d'autres animaux prédateurs sont rarement placées dans des armoiries, mais certaines parties d'entre elles, par exemple. patte (IX, 12), sont plus fréquents.
Cheval représentée en marche (IX, 13) ou au galop (IX, 14) ; tête de cheval (IX, 15).
Cerf généralement représenté au galop (IX, 16) : il y a une image de bois de cerf, par exemple, connectés (IX, 17).
Entre autres animaux sont représentés: chien(IX, 18), loup(IX, 19), sanglier(IX, 20), ours se levant (IX, 21) et marchant (IX, 22), taureau(IX, 23), sa tête (IX, 24) et ses cornes (IX, 25), l'éléphant(X, 1) et ses crocs (X, 2), blaireau(X, 3), chèvre(X, 4), RAM, et s'il est avec une bannière, alors on l'appelle un agneau (X, 5).
Des oiseaux: Aigle, représenté avec la tête tournée vers la droite et les ailes déployées (X, 6).
Moins courant dans l'image des armoiries corbeau(X, 7) mais grue, tenir une pierre dans sa patte - la figure dite de "vigilance" (X, 8) - est assez courant ; cygne(X, 9), coq(X, 10) paon(X, 11), chouette(X, 12) Pigeon(X, 13), etc., mais le plus souvent leurs parties et surtout une aile (X, 14), ou deux ailes reliées (X, 15) sont représentées.
Reptiles, poissons, insectes et amphibiens. Parmi eux meya, représenté dans un pilier (X, 16), ou dans un anneau (X, 17 ), dauphin(X, 18), poisson, par exemple, dans la croix de Saint-André (X, 19), écrevisse ( X, 20), scarabée(X, 21), les abeilles(X, 22), fourmis(X, 23), escargot(X, 24), coquilles(X, 25).
Végétaux: lis, représenté héraldiquement (XI, 1), ou naturellement (XI, 2), une rose aussi héraldiquement (XI, 3), moins souvent naturellement (XI, 4), fleurs, par exemple, tournesol(XI, 5), couronne(XI, 6). Des arbres, par exemple. le chêne (XI, 7) et ses glands (XI, 8), épicéa(XI, 9), branches, par exemple. branche de palmier (XI, 10). Trouvé dans les armoiries assez souvent et des céréales, notamment sous forme de gerbe (XI, 11) ou de trèfle (XI, 12).
Luminaires, éléments, etc., qui comprennent : Soleil(XI, 13) et surtout aimé croissant(XI, 14) et étoiles environ cinq rayons ou plus (XI, 15 et 16). Rivières, figurés par des ceintures ondulées raccourcies (XII 17), collines(XI, 18), des nuages(XI, 19), arc en ciel(XI, 20).
FIGURES ARTIFICIELLES
Il est d'usage d'appeler des figures artificielles dans l'héraldique des objets créés par la créativité humaine. Leur diversité, bien sûr, est illimitée, mais seuls les objets de la vie militaire et, de surcroît, dans des formes à prédominance ancienne sont les plus appropriés pour les représenter en blasons, et parmi d'autres objets à usage pacifique, seuls ceux qui servent de symboles de des concepts abstraits ou des emblèmes directs de grades, de postes et de professions spéciaux.
De la vie militaire les plus courantes : casque(XI, 21), épées: droit (XI, 22) et courbe (XI, 23), une lance(XI, 24), hache(XI, 25), flèches(XII, 1), trembler(XI, 2), cotte de mailles(XII, 5), bouclier(XI, 4), klaxon(XII, 5), pistolets(XI, 6), fer à cheval(XI, 7), éperon(XII, 8), étrier(XI, 9), bague(XI, 10), bannière ou bannière(XI, 11), insigne(XI, 12), la tour(XI, 13), forteresse(XII, 14), campement tente(XII, 15), serf clé(XI, 16), un pistolet(XII, 17), la roue(XII, 18), bateau(XII, 19), ancre(XIL 20); exemples de figures pacifiques : pet de licteur(XII, 21), tige mercurielle(XII, 22), bol(XII, 23), lire(XII, 24), klaxon abondance(XII, 25).
PERSONNAGES LÉGENDAIRES
Les images peuvent être attribuées au nombre de personnages légendaires ou fantastiques : centaure, (XIII, 1), oiseaux : Alconost, (XIII, 2) et Sirène(XIII, 3), Sirènes: ailé (XIII, 4) et à deux queues (XIII, 5) - représentant des combinaisons particulières de demi-figures d'une personne et d'animaux ou d'oiseaux, dont les images de Sirin et d'Alkonost, en fait, ne se trouvent pas, mais pourraient convenir comme emblèmes bien-aimés dans l'art russe ancien.
Les figures suivantes sont plus courantes en héraldique : le vautour (XIII, 6), Licorne(XIII, 7), Pégase(XIII, 8), le dragon(XIII, 9), hydre à sept têtes(XIII, 10), oiseau de paradis(XIII, 11), phénix(XIII, 12), Zilant(XIII, 13), Capricorne(XIII, 14), salamandre(XIII, 15) et autres.
Les personnages légendaires comprennent aigle à deux têtes pris comme emblème de l'État russe (ХШ, 16). Cependant, au cours de ses quatre cents ans d'existence, son image a subi diverses modifications, dont les types suivants sont les plus caractéristiques : le début du XVIIe siècle (XIII, 17), le règne de l'empereur Paul (XIII, 18), l'empereur Nicolas Ier (XIII, 19) moderne (XIII, vingt).
TYPES ET CONNEXIONS DES FIGURES
Habituellement, les figures non héraldiques sont implantées dans l'écu de manière à occuper tout le champ, si possible, sans toutefois toucher aux lignes qui le délimitent. Si la figure touche l'un des côtés du bouclier, comme si elle était coupée, alors on l'appelle sortant, par exemple, une main sortante avec une épée (XIII, 21) ; mais si une figure, touchant de la même manière, n'est qu'à moitié visible, alors on l'appelle émergent, par exemple, le lion émergeant (XIII, 22) ; si près d'une figure, prise comme principale, est placée à côté, mais sans la toucher, d'une autre figure, alors cette figure principale est appelée accompagné(haut, bas, droite, gauche) secondaire, par exemple, une lance, accompagnée des côtés par deux étoiles pentagonales (XIII, 23) ; si une autre figure est placée au-dessus d'une, la touchant directement, alors la première est appelée couronné, par exemple, une colonne surmontée d'une couronne (ХШ, 24) ; si l'une des figures est couverte par l'autre, et dans de tels cas, généralement une combinaison d'une figure héraldique et d'une autre figure non héraldique, la première est appelée chargé le second, par exemple, un pilier chargé de trois étoiles octogonales (XIII, 25).
CASQUES
En héraldique russe, deux types de casques en acier sont acceptés :
- européen de l'Ouestà cinq barres, figurées droites (XIV, 1) ou tournées vers la droite (XIV, 2) et
- Vieux russe casque, qui peut aussi être placé droit (XIV, 3) ou tourné vers la droite (XIV, 4).
COURONNES
En héraldique russe, les types de couronnes suivants sont acceptés :
Princier un chapeau de velours cramoisi foncé avec un bord d'hermine, trois arcs d'or apparents constellés de perles, au-dessus desquels se trouve un orbe d'or avec une croix (XIV, 5);
Comte couronne - or avec neuf perles apparentes (XIV, 6) ;
Baronnial couronnes : 1, russe - un cerceau d'or entrelacé trois fois d'un fil de perles (XIV, 7) et 2, adopté pour les barons : baltes et ayant un titre étranger, - or avec sept perles apparentes (XIV, 8) ;
noble couronne - or avec trois dents visibles en forme de feuille et deux perles entre elles (XIV, 9).
Ramper
Une crête est une figure émergeant d'une couronne couronnant un casque.
Les crêtes peuvent être à la fois des figures identiques à celles situées dans le bouclier, et des parties de celles-ci, et même complètement différentes, par exemple, une main avec une épée (XIV, 10), un lion émergeant (XIV, 11), un aigle (XIV , 12); le plus souvent dans les armoiries russes trois plumes d'autruche (XIV, 13) et deux ailes (XIV, 14) sont représentées.
ROBE ET BAS
Le manteau est autorisé dans l'héraldique russe dans les armoiries princières, ainsi que dans les armoiries des familles d'origine princière, mais qui ont perdu leur titre.
Ce manteau est issu de dessous la couronne princière et est représenté en velours cramoisi foncé doublé de fourrure d'hermine (XIV, 15).
Le namet, en tant que décoration ornementale, est représenté descendant d'un casque couronné d'une couronne noble, baronniale ou comtale. La coloration de l'insigne doit être conforme à la coloration du champ du bouclier et des chiffres qui y sont placés, et chacun des côtés de l'insigne (c'est-à-dire droite et gauche) peut avoir une couleur différente, mais c'est généralement accepté que le contour de son côté extérieur soit en émail (coloré) , et de l'intérieur - doublé de métal (or ou argent). (XIV, 16).
SUPPORTS DE BOUCLIER
Les détenteurs de boucliers sont acceptés dans l'héraldique russe en tant que figures décorant les côtés des armoiries des familles nobles, inclus dans la 6ème partie du livre de généalogie noble. Les Shitoholders peuvent être à la fois des personnes, généralement en tenue militaire, ainsi que des animaux et des oiseaux, adoptés en héraldique. Les porte-boucliers sont situés sur des socles sous l'écusson armorié (XV : 1,2,3).
DEVISE
La devise, comme un dicton adopté par la famille noble dans ses armoiries, est placée sur un ruban dont la couleur et la lettre de la devise doivent correspondre aux armoiries et à sa figure principale. Au XVIIIe siècle, les devises étaient généralement écrites en Latin, mais maintenant ils ne sont autorisés qu'en russe. La devise est située en dessous sous les armoiries; aux porte-boucliers, un ruban avec une devise peut servir de socle (XV, 4).
DESCRIPTION DU BLASON
Lors de la description des armoiries, il faut garder à l'esprit que l'ordre parties constitutives lui, ce qui est accepté ci-dessus lors de leur présentation, c'est-à-dire un bouclier, un casque, une couronne, une crête, un namet, des porte-boucliers, une devise, un manteau et, enfin, des décorations spéciales.
Si le blason a deux champs ou plus, sa description doit être donnée dans un ordre établi bien connu, en tenant compte de l'avantage du côté droit et de la partie supérieure dans l'écu. Si l'écu est divisé en deux parties, alors la description est donnée dans l'ordre indiqué au tableau XVI : 1-5 ; si le bouclier est divisé en trois parties, alors sa description est donnée comme indiqué aux figures 6 à 10 ; si le bouclier est divisé en quatre parties, l'ordre de sa description est indiqué aux figures 11-12 ; mais, si deux des quatre parties du bouclier sont identiques, alors la description est donnée par paires, voir fig. 13-15 ; si le bouclier est divisé en cinq parties, alors pour le décrire, il faut être guidé par les figures 16-20, en commençant par le bouclier du milieu si les principaux emblèmes y sont placés; si le bouclier est divisé en six parties ou plus, sa description est faite selon la même méthode, voir figures 21-25.
Exemples:
I. Dans un champ d'argent, un vautour écarlate tenant une épée d'or et un tarque couronné d'un petit aigle ; sur une bordure noire se trouvent huit têtes de lion arrachées : quatre d'or et quatre d'argent. L'écu est enfermé dans un cartouche et surmonté d'une couronne. (XVII).
II. Quadruple bouclier avec un bouclier au milieu. Dans les première et quatrième pièces d'or, l'aigle d'État russe; dans le dôme d'azur se trouve la couronne impériale d'or. Dans les deuxième et troisième parties écarlates, un lion d'hermine face à l'écu, chargé d'écus d'azur avec une croix griffue d'or. Au milieu du bouclier, neuf fois barré d'or et d'azur, se trouve un aigle rouge au bec et aux pattes d'or. Le bouclier est orné de trois casques, dont: celui du milieu est couronné d'une couronne comtale, celui de droite est noble et celui de gauche est un coupe-vent en or écarlate. Crêtes : celle du milieu est l'aigle de l'État russe, celle de droite est composée de deux ailes d'aigle écarlate et celle de gauche est un lion d'hermine émergent avec un bouclier et une croix. Namet : azur à droite et écarlate à gauche, doublé d'or. Porte-épées : deux guerriers en armure, tenant des insignes, dont à droite, croisé neuf fois d'or et d'azur, est un aigle écarlate, et à gauche, écarlate, un lion d'hermine avec un bouclier et une croix. Devise : "Fortitudine et Constantia" en lettres d'or sur un ruban bleu. L'écu est couvert d'un bonnet et d'un manteau princiers. (XVIII).
TYPES D'ARMES
Selon leur signification, les armoiries sont divisées en groupes suivants :
1. Armoiries étatiques et territoriales.
À propos des emblèmes d'État et des décorations spéciales attribuées aux emblèmes locaux Empire russe voir Annexes : I et III et Tableau XIX.
2. Armoiries personnelles.
Les emblèmes des Membres de la MAISON IMPÉRIALE servent d'armoiries personnelles ; pour eux, voir l'annexe II.
3. Armoiries familiales - nobles.
GÉNÉRALITÉS AVEC ARMES
Il existe un type de tableaux généalogiques, la généalogie dite ascendante-mixte, qui consiste généralement en des armoiries disposées dans un certain ordre, à savoir : les armoiries de la personne dont la généalogie est conduite sont placées en dessous, légèrement plus haut , à gauche (du spectateur) les armoiries de son père et à droite - la famille de sa mère, encore plus haut - une série d'armoiries, en partant de la gauche, la première étant les armoiries de le grand-père, le second est le blason de la famille de la grand-mère, c'est-à-dire la mère de son père, le troisième est le blason de la mère de son père et le quatrième est le blason de la famille de son la mère de la mère; au-dessus - une nouvelle rangée de parents ascendants, dont les boucliers des emblèmes familiaux sont situés à gauche - du côté du père et à droite - du côté de la mère. La disposition de huit ou seize armoiries dans la rangée supérieure est considérée comme suffisante, mais, bien sûr, elle peut en avoir séquentiellement trente-deux, soixante-quatre, etc. (XX).
les tables
|
Tableau I |
Tableau II |
|
Tableau III |
Tableau IV |
|
Tableau V |
Tableau VI |
|
Tableau VII |
Tableau VIII |
|
Tableau IX |
Tableau X |
|
Tableau XI |
Tableau XII |
|
Tableau XIII |
Tableau XIV |
|
Tableau XV |
Tableau XVI |
|
Tableau XVII |
Tableau XVIII |
|
Tableau XIX |
Tableau XX |
Dessins
Applications
EMBLÈME D'ÉTAT RUSSE
L'emblème d'État russe moderne a trois types, appelés les grands, moyens et petits emblèmes d'État; parmi ceux-ci, le premier, le plus élevé, a été approuvé le 24 juillet 1882 et le dernier le 23 février 1883.
Leurs dessins sont reproduits dans la Collection complète des lois, tome (1882) sous le n° 1035, et tome III. (1883) sous le n° 1402.
Une description des emblèmes est disponible dans le Code des lois de l'Empire russe, volume I, partie 1, Code des lois fondamentales de l'État. Éd. 1906 Annexe I.
Description détaillée de l'emblème de l'État.
A. Grand emblème d'État.
§ 1. L'emblème de l'État russe est dans un bouclier d'or un aigle noir à deux têtes couronné de deux couronnes impériales, au-dessus de laquelle la troisième est la même, sous une forme plus grande, avec deux extrémités flottantes du ruban de l'Ordre du Saint Apôtre André le premier appelé. L'aigle d'état tient un sceptre et un orbe d'or. Sur la poitrine de l'aigle se trouvent les armoiries de Moscou: dans un bouclier écarlate aux bords dorés, le Saint Grand Martyr et Victorious George en armes d'argent et traînée d'azur (manteau), sur argent, recouvert de tissu cramoisi à franges d'or, un cheval frappant de l'or, avec des ailes vertes, un dragon, de l'or, avec une croix à huit pointes sur le dessus, une lance. Le bouclier principal (avec l'emblème de l'État) est couronné du casque du Saint Grand-Duc Alexandre Nevsky. Le namet est noir avec de l'or. Autour du bouclier se trouve la chaîne de l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé ; sur les côtés de l'image du Saint Archange Michel et de l'Archange Gabriel. Le dais est doré, couronné de la couronne impériale, parsemé d'aigles bicéphales russes et bordé d'hermine. Il y a dessus une inscription écarlate : Dieu est avec nous ! Au-dessus de la canopée, la bannière d'État apparaît, avec une croix octogonale sur le fût. La toile de la bannière d'État est d'or ; dessus se trouve une image de l'emblème d'État du milieu (§ 5 de cette annexe), mais sans les neuf écus qui l'entourent.
§ 2. Autour de l'écu principal, des écus aux armoiries des Royaumes et des Grands-Duchés suivants :
I. Emblème du Royaume Kazanski: dans un bouclier d'argent il y a un dragon couronné noir : la langue, les ailes et la queue sont écarlates, le bec et les griffes sont dorés.
II. Emblème du Royaume Astrakan: dans un écu d'azur, une couronne d'or, semblable à la couronne royale, à cinq arcs et une doublure verte ; en dessous se trouve une épée orientale en argent, avec une poignée en or, avec une extrémité pointue à droite.
III. Emblème du Royaume polonais: dans un bouclier écarlate un aigle couronné d'argent avec un bec et des griffes d'or.
IV. Emblème du Royaume sibérien: dans un écu d'hermine se trouvent deux zibelines noires, debout sur leurs pattes de derrière et soutenant de leurs pattes de devant, l'une une couronne d'or à cinq branches, l'autre un arc couché écarlate et deux flèches placées en croix, la pointe vers le bas.
V. Emblème du Royaume Chersonis Tauride: dans un bouclier d'or, un aigle byzantin noir couronné de deux couronnes d'or, avec des langues écarlates et des becs et griffes d'or ; sur la poitrine, dans un écu d'azur aux bords dorés, une croix dorée à huit pointes.
VI. Emblème du Royaume géorgien: bouclier en quatre parties, avec une pointe et un petit bouclier au milieu. Au milieu petit bouclier est le blason de la Géorgie : dans un champ d'or, le Saint Grand Martyr et le Victorieux George, dans les armes d'azur, avec une croix d'or sur une pile, en enchevêtrement écarlate, assis sur un cheval noir couvert de violet avec une frange d'or, frappant avec une lance vert écarlate, avec des ailes noires et des yeux et une langue écarlates, un dragon. Dans la première partie - armoiries Ivérie: dans un bouclier écarlate un cheval au galop d'argent ; dans les coins, en haut à gauche et en bas à droite, des étoiles d'argent à huit rayons. Dans la deuxième partie - armoiries Cartlines: dans un écu d'or une montagne cracheuse de feu verte transpercée en travers par deux flèches noires, pointe vers le haut. Dans la troisième partie - les armoiries Kabarde se pose : dans un écu d'azur, sur deux flèches d'argent, en croix, pointant vers le haut, un petit écu d'or avec un croissant écarlate tourné vers la droite ; dans les trois premiers quarts des étoiles hexagonales argentées. Dans la quatrième partie - les armoiries Arménie: dans un écu d'or un lion écarlate couronné. Dans la pointe d'or - armoiries Tcherkasski et Princes des montagnes: un Circassien galopant sur un cheval noir, en armes d'argent, vêtements écarlates et traîné de fourrure noire, avec une lance noire sur son épaule droite.
VII. Armoiries unies des Grands-Duchés : Kyiv, Vladimirski et Novgorod: dans un bouclier divisé en trois parties. Dans la première partie d'azur - blason Kyiv: Saint Archange Michel en robes et armes d'argent, avec une épée flamboyante et un bouclier d'argent. Dans la deuxième partie écarlate - armoiries Vladimirski: un lion léopard doré, coiffé d'une couronne de fer ornée d'or et de pierres de couleur, tenant une longue croix d'argent dans sa patte droite. Dans la troisième partie d'argent - armoiries Novgorod: deux ours noirs soutenant des chaises dorées avec un oreiller écarlate, sur lesquelles ils sont placés, en travers, à droite un sceptre, et à gauche une croix ; au-dessus des fauteuils, il y a un trois briquets dorés avec des bougies allumées : dans la périphérie azur de l'écu se trouvent deux poissons d'argent, l'un en face de l'autre.
VIII. Armoiries du Grand-Duché finlandais: dans un bouclier écarlate, un lion couronné d'or tenant une épée droite dans sa patte droite, et une épée courbe dans sa gauche, sur laquelle le lion repose de sa patte arrière droite, accompagné de huit roses d'argent.
Tous ces boucliers sont couronnés de leurs propres couronnes.
Au bas de l'écu principal (avec les armoiries de l'État) les armoiries de la famille de Sa Majesté Impériale. Le bouclier est fendu. À droite - armoiries de la famille Romanov: dans un champ d'argent, un vautour écarlate tenant une épée d'or et un tarque couronné d'un petit aigle : sur un liseré noir, huit têtes de lion arrachées, quatre d'or et quatre d'argent. Gauche - armoiries Schleswig-Golstinski: un bouclier en quatre parties avec une pointe spéciale en bas et un petit bouclier au milieu ; dans la première partie écarlate - armoiries norvégien: lion couronné d'or avec gallebarde d'argent; dans la deuxième partie dorée - armoiries Schleswig: deux lions léopard azur ; dans la troisième partie écarlate - armoiries Holstein: petit écu croisé, argent et écarlate ; autour de lui se trouve un argent coupé en trois parties, une feuille d'ortie et trois clous d'argent avec des extrémités aux coins de l'écu ; dans la quatrième partie écarlate - armoiries Stormarn: un cygne argenté aux pattes noires et une couronne dorée autour du cou ; à la pointe écarlate - armoiries Dithmarsen: or, avec une épée levée, un cavalier sur un cheval d'argent recouvert de drap noir ; le petit bouclier du milieu est également disséqué : dans la moitié droite il y a un blason Oldenbourg, sur un champ doré deux ceintures écarlates ; dans le blason gauche Delmenhorst, dans un champ d'azur d'or, avec une extrémité pointue en bas, une croix. Ce petit écu est surmonté de la couronne grand-ducale, et le principal de la couronne royale.
§ 3. Au-dessus de la verrière du bouclier principal (avec l'emblème de l'État) se trouvent six boucliers :
I. Blason des armoiries unies des Principautés et des Régions Grand russe, doublement disséquée et doublement barrée, avec une pointe. Dans la première partie d'azur - blason Pskov: léopard doré; au-dessus de lui, une main droite émergeant de nuages argentés. Dans la deuxième partie en argent - armoiries Smolenski: canon noir : chariot et roues dans un cadre doré ; un oiseau de paradis au soleil. Dans la troisième partie écarlate - armoiries Tverskoï: un trône d'or : dessus est la couronne royale, sur un oreiller vert. Dans la quatrième partie d'argent - armoiries Iougorski: deux mains vêtues d'écarlates, émergeant de droite et de gauche des nuées d'azur et tenant en croix deux lances écarlates. Dans la cinquième partie d'argent - armoiries Nijni Novgorod: cerf marchant écarlate; cornes à six processus et sabots noirs. Dans la sixième partie dorée - armoiries Riazan: Le prince en robe verte et en chapeau garni de zibeline, avec un manteau écarlate, et dans les mêmes bottes, tient une épée d'argent dans sa main droite, et un fourreau noir dans sa gauche. Dans la septième partie écarlate - armoiries Rostov: un cerf d'argent avec un collier d'or. Dans la huitième partie d'argent - armoiries Iaroslavski: noir, marchant sur ses pattes de derrière, un ours, tête droite, tenant une hache d'or dans la patte gauche sur la même armée. Dans la neuvième partie d'azur - les armoiries Belozerski: deux poissons d'argent posés en croix : au-dessus d'eux se trouve un croissant d'argent ; dans le coin droit se trouve une croix dorée, avec des boules aux extrémités. Dans la pointe noire - armoiries Udorsky: un renard argenté marchant, avec des yeux et une langue écarlates.
P. Blason des armoiries unies des Principautés et des Régions Sud-ouest divisé en trois parties. Dans la première partie écarlate - armoiries Volynski: Croix d'Argent. Dans la seconde partie d'azur - blason Podolski: soleil doré à seize rayons ; au-dessus se trouve une croix dorée. Dans la troisième partie d'argent - armoiries Tchernigov: un aigle noir couronné à la langue écarlate aux griffes d'or, tenant une longue croix d'or dans les serres de sa patte gauche, inclinée vers le coin droit de l'écu.
III. Ecusson des armoiries unies des Principautés et des Régions Belo-russe et lituanien: en quatre parties, avec une pointe et un petit bouclier au milieu. Dans ce petit bouclier écarlate les armoiries du Grand-Duché lituanien: sur un cheval d'argent couvert d'un écarlate à trois pointes, avec une bordure dorée, un tapis, un cavalier (pogon) est d'argent, armé, d'une épée levée, et d'un bouclier, sur lequel est une croix écarlate à huit pointes . Dans la première partie de l'écu - armoiries Bialystok: bouclier croisé ; dans la partie supérieure écarlate - un aigle d'argent, dans la partie inférieure dorée - un cavalier armé d'azur avec une épée levée et un bouclier d'argent, sur lequel se trouve une croix écarlate à huit pointes; le cheval est noir, couvert d'écarlate, à trois pointes, avec une bordure d'or, tapis. Dans la deuxième partie dorée - armoiries Samogitski: un ours noir debout sur ses pattes arrière, avec des yeux écarlates et une langue. Dans la troisième partie d'argent - armoiries Polotski: sur un cheval noir, harnaché d'argent et d'écarlate, un cavalier (pogon) aux armes noires, le sabre levé ; anse dorée, goudron écarlate, avec une croix octogonale en argent. Dans la quatrième partie écarlate - les armoiries Vitebsk: un cavalier d'argent en armes, avec une épée levée et une cible ronde ; la selle d'un cheval d'argent est écarlate, recouverte d'un tapis d'or à trois pointes bordé d'azur. Dans la pointe d'argent - armoiries Mstislavski: loup écarlate; tête à gauche.
IV. Bouclier des armoiries unies des Régions baltique quadruple. Dans la première partie dorée - armoiries estonien: trois lions léopard azur. Dans la deuxième partie écarlate - armoiries Livonien: vautour argenté avec épée d'or ; sur la poitrine, sous la couronne impériale, un monogramme écarlate : PV IV (Pierre II, empereur de toute la Russie). Au troisième dans un champ quadruple - armoiries Courlande et Semigalsky; dans les premier et quatrième quartiers d'argent - armoiries Courlande: lion écarlate ; dans une couronne écarlate; et aux deuxième et troisième quartiers d'azur les armoiries Semigalsky: un cerf argenté émergeant, à six pousses sur les cornes, surmonté de la couronne du Duc. Dans la quatrième partie écarlate - les armoiries coréen: deux mains opposées, dressées, en armure d'argent, avec des épées courbées d'argent ; au-dessus de lui se trouve une couronne d'or.
V. Bouclier des armoiries unies Nord-Est Les régions de l'Empire sont en quatre parties, avec un petit bouclier au milieu. Dans ce petit bouclier écarlate - armoiries permien: un ours d'argent qui marche, sur son dos est un évangile d'or, sur lequel se trouve une croix d'argent à quatre rayons. Dans la première partie dorée du bouclier principal - les armoiries Viatka: une main émergeant à droite de nuages azur vêtus d'habits écarlates, tenant un arc écarlate tendu avec une flèche ; dans le coin droit se trouve une croix écarlate avec des boules. Dans la deuxième partie verte, divisée par une croix d'argent - les armoiries bulgare: un agneau marchant d'argent, avec une bannière écarlate, une hampe d'or. Dans la troisième partie d'argent - armoiries Obdorski: renard ambulant noir aux yeux et à la langue écarlates. Dans la quatrième partie verte - les armoiries Kondia: un homme sauvage avec une couronne de chêne sur la tête et une ceinture de chêne, tenant main droite sur l'épaule une masse d'argent.
VI. Blason Turkestan: dans un bouclier doré, une licorne marcheuse noire aux yeux, à la langue et à la corne écarlates.
§ 4. L'emblème de l'État russe dans sa forme complète est représenté sur le grand sceau de l'État (§15 de cette annexe), également sur les trônes, les auvents, dans les salles désignées pour les réunions solennelles à la cour impériale ou pour les réunions des hauts lieux du gouvernement, mais pas autrement, comme par des ordres spéciaux les plus élevés, annoncés par le ministre de la cour impériale. En même temps, il est déterminé à chaque fois quelles décorations doivent être autour des armoiries principales et entre les écus qui l'entourent des autres armoiries des Royaumes, Principautés et Régions mentionnées dans le titre long de Sa Majesté Impériale (Zak. Osn. Art. 59.
B. Emblème de l'État du Milieu.
§ 5. L'emblème d'État du milieu est le même que le grand, mais sans la bannière d'État et six écus au-dessus du dais avec les emblèmes indiqués au § 3 de cette annexe.
§ 6. L'emblème d'État du milieu est représenté comme au milieu Sceau de l'État(§ 15 du présent adj.), ainsi, selon les instructions spéciales de Sa Majesté Impériale, et en d'autres lieux et cas.
B. Petit emblème d'État.
§ 7. Le petit emblème d'État est similaire à celui du milieu (§ 5 de cette annexe), mais sans le dais impérial, sans images du Saint Archange Michel et de l'Archange Gabriel, et sans l'emblème familial de Sa Majesté Impériale ; la chaîne de l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier-Appelé est placée sur la poitrine de l'aigle autour du bouclier avec les armoiries de Moscou, et les armoiries des Royaumes et Grands Duchés (§ 2 de cet adj. .) sur les ailes de l'aigle comme suit : sur l'aile droite, en premier lieu, les armoiries du Royaume de Kazan ; à gauche, en premier lieu, les armoiries du royaume d'Astrakhan ; sur l'aile droite, en second lieu, les armoiries du Royaume de Pologne ; à gauche, à la deuxième place, les armoiries du royaume de Sibérie ; sur l'aile droite, à la troisième place, les armoiries du royaume de Tauric Chersonis ; à gauche, à la troisième place, les armoiries du Royaume de Géorgie ; sur l'aile droite, à la quatrième place, les armoiries combinées des grands-duchés de Kyiv, Vladimir et Novgorod ; à gauche, à la quatrième place, les armoiries du Grand-Duché de Finlande.
§ 8. Sous cette forme (§ 7 de cet adj.), mais dans un écu et avec l'ajout du dais impérial, l'emblème d'État est représenté sur le petit sceau d'État (§ 17 de cet adj.). Sur d'autres petits sceaux et dans les décorations, il peut être représenté selon le § 7 de cette annexe et sans blasons sur les ailes d'un aigle, mais toujours avec les armoiries de Moscou sur sa poitrine, entouré d'une chaîne de l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé.
§ 9. Lorsque le petit emblème d'État est représenté dans un bouclier (qui doit toujours être en or), la chaîne de l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé n'entoure pas les armoiries de Moscou sur la poitrine de l'aigle (§ 7 de cet adj.), mais le bouclier lui-même.
§ 10. Selon la spéciale, annoncée par l'intermédiaire du ministre de la Cour impériale, les plus hauts commandements, ils peuvent être attachés au petit emblème d'État ; ou le dais impérial (§ 1 de cet adj.), tel qu'il est déterminé sur le petit sceau d'État (§ 8 de cet adj.), ou, lorsque l'aigle est placé dans un écu couronné de la couronne impériale, des images du Saint Archange Michel et l'Archange Gabriel.
ARMES DES MEMBRES DE LA MAISON IMPÉRIALE
Les armoiries de la famille Romanov, de la maison régnante actuelle et de tous les membres de la famille impériale (grands et petits, établis par le degré de leur origine de la personne de l'empereur) ont été approuvées par le plus haut le 8 décembre 1856 .
Les dessins de ces armoiries sont reproduits dans le Recueil complet des lois, tome XXXII (1857), sous le n° 31720.
Les descriptions des armoiries sont données dans le Code des lois de l'Empire russe, volume I, partie 1, Code des lois fondamentales de l'État. Éd. 1906 Annexe II.
Description détaillée des armoiries des membres de la maison impériale.
I. Armoiries des plus hautes personnes du sexe masculin.
1) Les armoiries personnelles de Sa Majesté Impériale.
§ 1. Les armoiries personnelles de Sa Majesté Impériale sont les mêmes que les petites armoiries de l'État (Annexe I, § 7), dans un écu couronné du casque du Saint Grand-Duc Alexandre Nevski, avec l'insigne décrit dans le premier paragraphe de l'annexe I. Crête, sous la couronne impériale, il y a un aigle russe bicéphale émergeant.
2) Armoiries de Son Altesse Impériale, le Grand-Duc Héritier Tsesarevich.
§ 2. Le grand blason de Son Altesse Impériale est le même que le blason moyen de l'État (Annexe I, § 5).
§ 3. Les petites armoiries de Son Altesse Impériale sont les mêmes que les armoiries personnelles de Sa Majesté Impériale (§ 1), à la seule différence que sur le casque au lieu de l'Impériale se trouve l'ancienne Couronne Royale.
3) Les armoiries de Son Altesse Impériale, le fils aîné du Grand-Duc Héritier Tsesarevich.
§ 4. Les armoiries de Son Altesse Impériale sont les mêmes que les armoiries du tsésarévitch de son parent (§§ 2 et 3), mais en elles, pour distinction, l'ancienne couronne royale est représentée sur le cou de l'aigle.
4) Armoiries de Leurs Altesses Impériales, Grands Ducs, fils cadets Empereur.
§ 5. Le grand blason de Leurs Altesses Impériales est le même que le blason moyen de l'État (Annexe I, § 5), mais il y a deux Varègues comme porte-boucliers.
§ 6. Le petit blason de Leurs Altesses Impériales est le même que le blason du Grand-Duc Héritier Tsesarevich (§ 3), avec l'ajout d'une bordure des armoiries de la Famille Romanov (Annexe I, § 2, fin)
Noter. Aux emblèmes du blason, c'est-à-dire au grade occupé par un Membre de la Maison Impériale dans la lignée descendant de l'Empereur, des signes particuliers peuvent être ajoutés à son blason, à la demande de l'Empereur régnant, pour distinguer son armoiries des armoiries d'autres députés du même degré. Ainsi, deux canons rejoignent les armoiries de Son Altesse Impériale, le Grand-Duc Mikhail Nikolaevich, Général Feldzeugmeister.
5) Armoiries de Leurs Altesses Impériales, Grands Ducs, petits-enfants de l'Empereur (enfants de Ses fils cadets).
§ 7. Le grand blason de Leurs Altesses Impériales est le même que le blason de Leurs Altesses Impériales des fils cadets de l'Empereur Souverain (§ 5), mais les porte-boucliers de celui-ci sont des licornes dorées, aux yeux écarlates et les langues.
§ 8. Leur petit blason est le même (§ 6), mais l'aigle russe à deux têtes qui figure sur le casque n'a pas les emblèmes des Royaumes et Grands Duchés sur les ailes.
6) Armoiries de Leurs Altesses, Princes du Sang Impérial, arrière-petits-enfants de l'Empereur.
§ 9. Le grand blason de Leurs Altesses est le même que le blason des petits-fils de l'Empereur Souverain (§ 7), mais au lieu d'or, des licornes noires, aux cornes et aux sabots d'or, aux yeux et aux langues écarlates , sont des porte-boucliers.
§ 10. Leur petit blason est le même que le blason des petits-enfants de l'Empereur Souverain (§ 8), mais l'aigle russe à deux têtes qui figure sur le casque n'a pas de blason sur la poitrine .
7) Armoiries de Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes, Princes du Sang Impérial, arrière-arrière-petits-enfants de l'Empereur.
§ 11. Le grand blason de Leurs Altesses et de Leurs Altesses Sérénissimes est le même que le blason des arrière-petits-enfants de l'Empereur Souverain (§ 9), mais les porteurs d'écus sont des vautours dorés, aux yeux et aux langues écarlates .
§ 12. Leur petit blason est le même que le blason des arrière-petits-enfants de l'Empereur Souverain (§ 10), mais dans l'écu l'aigle russe à deux têtes ne porte pas sur les ailes les emblèmes du Royaumes et les Grandes Principautés.
8) Armoiries de Leurs Altesses et Leurs Seigneuries, Princes du Sang Impérial, fils arrière-arrière-petits-enfants de l'Empereur, et leurs descendants dans la génération masculine.
§ 13. Le grand blason de Leurs Altesses et Leurs Seigneuries est également un bouclier avec un aigle russe à deux têtes, mais sans blasons sur la poitrine et les ailes, des vautours noirs avec des becs et des griffes d'or, avec des yeux et des langues noirs ; au lieu du dais impérial, un manteau d'or parsemé d'aigles bicéphales russes, doublé d'hermine.
§ 14. Leurs petites armoiries sont les mêmes que les grandes (§ 13), mais sans porte-bouclier ni manteau. Sur le casque, il y a un aigle russe à deux têtes sans armoiries sur la poitrine et les ailes.
9) Armoiries de Leurs Altesses Impériales, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes les Princes Romanovsky.
§ 15. Le grand blason de Leurs Altesses Impériales, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes les Princes Romanovsky, est un aigle russe bicéphale doré, ayant un quadruple écu sur la poitrine avec un petit écu au milieu. Dans les première et quatrième parties, argent, ceinture d'azur. Dans la seconde partie, verte, une épée d'argent ; la poignée est dorée, le sommet de l'épée est entouré de six étoiles dorées. Dans la troisième partie, sur un champ d'argent, une ceinture noire ; au-dessus, trois oiseaux noirs. Dans un petit écu, sur fond doré, écarlate couronné d'une couronne écarlate, le chiffre de l'Empereur Souverain Nicolas Ier (H) sur l'écu est la couronne Ducale. Le bouclier principal est couronné du casque du Saint Grand-Duc Alexandre Nevski ; autour de la chaîne de l'Ordre du Saint Apôtre André le Premier Appelé, insigne or et noir; les supports sont deux vautours dorés, aux yeux et à la langue écarlates. Au lieu du dais impérial, un manteau d'or parsemé d'aigles bicéphales russes, doublé d'hermine ; au-dessus se trouve la couronne impériale.
§ 16. Les petites armoiries de Leurs Altesses Impériales, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes les Princes Romanovsky sont les mêmes que Leurs grandes armoiries, mais sans porte-boucliers ni manteaux. La crête est l'aigle russe bicéphale émergent, qui a un bouclier doré sur sa poitrine avec un écarlate, sous la même couronne, le chiffre de l'empereur souverain Nicolas Ier (H).
II. Armoiries des plus hautes personnalités féminines.
1) Armoiries de Leurs Majestés, Impératrices Souveraines.
§ 17. Le grand blason de Leurs Majestés, les impératrices, est le même que l'emblème d'État russe moyen (annexe I, § 5), à la seule différence que les blasons entourant le bouclier principal sont placés avec lui. sur le même bouclier, et au milieu de celui-ci au-dessus du petit bouclier se trouve la couronne de Monomakh. A ce blason, sur le même écu ou sur un autre, se joint le blason familial de l'Impératrice. Au-dessus du ou des boucliers, au lieu d'un casque, il y a une petite couronne impériale. Autour des armoiries se trouvent des signes des ordres du Saint Apôtre André le Premier Appelé et de la Sainte Grande Martyre Catherine.
§ 18. Le petit blason de Leurs Majestés est le même que le petit emblème d'État russe (annexe I, § 7), combiné avec le blason familial de l'impératrice; l'écu est surmonté de la couronne impériale et décoré des insignes des ordres du Saint Apôtre André le Premier-Appelé et de la Sainte Grande Martyre Catherine.
2). Armoiries de Leurs Altesses Impériales, Grandes Duchesses, Leurs Altesses et Leurs
Altesses Sérénissimes, Princesses du Sang Impérial.
§ 19. Le grand blason des Grandes Duchesses et Princesses du Sang Impérial est le même que le grand blason de Leurs époux, à la seule différence que les armoiries entourant l'écu principal sont placées avec lui sur le même bouclier et au milieu de celui-ci au-dessus du petit bouclier se trouve la couronne de Monomakh. Ce blason, sur le même écu ou sur un autre, est rejoint par le blason familial de la Grande-Duchesse, ou Princesse du Sang Impérial. Le ou les boucliers sont surmontés d'une petite couronne impériale et décorés des insignes de l'Ordre de Sainte Catherine la Grande Martyr. Porte-boucliers, baldaquin impérial ou à la place, un manteau, tout comme dans les armoiries du conjoint.
§ 20. Le petit blason des Grandes Duchesses et Princesses du Sang Impérial est le même que le petit blason de Leurs époux, combiné avec le petit blason de la famille de la Grande Duchesse ou Princesse du Sang Impérial. Sang; l'écu est surmonté de la couronne impériale et décoré des insignes de l'Ordre de la Sainte Grande Martyre Catherine.
3) Armoiries de Leurs Altesses Impériales, Grandes Duchesses, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes, Princesses du Sang Impérial.
a) Armoiries de Leurs Altesses Impériales, filles de l'Empereur.
§ 21. Le grand blason des filles de l'empereur est le même que le petit emblème d'État russe (annexe I, § 7), dans un écu en forme de rhomboïde, couronné de la couronne impériale et décoré de palmiers et de signes de l'Ordre de la Sainte Grande Martyre Catherine. Les supporters sont les deux Varègues. Le blason est entouré du dais impérial ; au-dessus se trouve la couronne impériale.
§ 22. Le petit blason de Leurs Altesses Impériales, les filles de l'Empereur, est le même que le grand (§ 21), mais sans porte-bouclier ni baldaquin.
b) Les armoiries de Leurs Altesses Impériales, petit-fils de l'Empereur (par genou masculin).
§ 23. Le grand blason de Leurs Altesses Impériales, le petit-fils de l'Empereur, est semblable au blason des filles de l'Empereur (§ 21), à la seule différence que les porte-boucliers sont des licornes d'or, avec yeux et langues écarlates.
§ 24. Le petit blason de Leurs Altesses Impériales est le même que le grand (§ 23), mais sans porte-bouclier ni auvent, et avec l'ajout d'une bordure des armoiries de la famille Romanov (annexe I , § 2, fin).
c) Armoiries de Leurs Altesses, arrière-petit-fils de l'Empereur.
§ 25. Le grand blason de Leurs Altesses, l'arrière-petit-fils de l'Empereur, est semblable au blason des filles de l'Empereur (§ 21), à la seule différence que les porte-boucliers sont des licornes noires avec cornes et sabots d'or, avec des yeux et des langues écarlates.
§ 26. Le petit blason de Leurs Altesses est le même que le grand (§ 25), mais sans blason sur les ailes d'un aigle, sans porte-bouclier ni dais.
d) Armoiries de Leurs Seigneuries, arrière-arrière-petit-fils de l'Empereur.
§ 27. Le grand blason de Leurs Seigneuries, l'arrière-arrière-petit-fils de l'Empereur, est semblable au blason des filles de l'Empereur (§ 21), mais sans blasons sur les ailes d'un aigle, et ses porte-boucliers sont des vautours dorés, aux yeux et à la langue écarlates.
§ 28. Les petites armoiries de Leurs Seigneuries sont les mêmes que leurs grandes armoiries (§ 27), mais sans porte-bouclier ni auvent, et avec l'ajout d'une bordure des armoiries de la famille Romanov au armoiries (Annexe I, § 2, terminé).
e) Les armoiries de Leurs Seigneuries, filles des arrière-arrière-petits-enfants de l'Empereur et des Princes du Sang Impérial suivants.
§ 29. Le grand blason de Leurs Seigneuries est un aigle russe à deux têtes sans blasons sur la poitrine et les ailes, dans un écu de forme rhomboïdale, sous la couronne impériale. Le bouclier est décoré de palmiers et de signes de l'Ordre de la Sainte Grande Martyre Catherine. Les supports sont deux vautours noirs, aux yeux et à la langue écarlates ; au lieu du dais impérial, un manteau d'or parsemé d'aigles à deux têtes, doublé d'hermine.
§ 30. Le petit blason de Leurs Seigneuries est le même que le grand (§ 31), mais sans porte-bouclier ni manteau.
f) Les armoiries de Leurs Altesses Impériales, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes, les Princesses Romanovsky.
§ 31. Le grand blason de Leurs Altesses Impériales, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes, les Princes Romanovskiy est le même que le grand blason de Leurs Altesses Impériales, les Princes Romanovskiy (§ 15), à la différence qu'il est dans un bouclier en forme de rhomboïde, sous la couronne impériale ; le bouclier est décoré de palmiers et de signes de l'Ordre de la Sainte Grande Martyre Catherine.
§ 32. Leurs petites armoiries sont les mêmes que les grandes (§ 31), mais sans porte-bouclier ni manteau (§ 15).
§ 33. Il appartient à Leurs Majestés, Leurs Altesses et Leurs Seigneuries de déterminer en quels lieux et sur quels objets Leurs grandes et petites armoiries doivent être représentées. De grandes armoiries peuvent être représentées sur de petites choses sans la verrière impériale et sans armoiries situées autour du bouclier principal.
§ 34. Le choix des formes des écus dépend également de la discrétion de Leurs Majestés, Leurs Altesses et Leurs Seigneuries. Ces formes peuvent être les suivantes : 1 Bouclier rond byzantin. Cette forme, adoptée en Russie, était également couramment utilisée au Moyen Âge. 2) Bouclier triangulaire varègue. 5) Split, la forme dite allemande du XVIe siècle. 4) Quadrangulaire, arrondie en bas, la forme dite espagnole. 5) Quadrangulaire, avec une pointe acérée en bas, la soi-disant Forme française. 6) Un écu de forme rhomboïdale, qui, soit dit en passant, est attribué exclusivement aux Grandes Duchesses et Princesses du Sang Impérial, ainsi qu'aux Grandes Duchesses et Princesses douairières du Sang Impérial.
§ 35. Toutes les figures des armoiries de Leurs Majestés, Leurs Altesses et Leurs Altesses Sérénissimes sont toujours présentées selon les règles de l'Héraldique, tournées vers le côté droit de l'écu, c'est-à-dire vers la gauche du spectateur.
DESCRIPTION DES DÉCORATIONS HAUTEMENT APPROUVÉES DES ARMES DES PROVINCES, DES RÉGIONS, DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX, DES VILLES ET DE LA POSAD
Une description de ces décorations d'armoiries hautement approuvées est publiée dans le Recueil complet des lois, tome XXXII, n° 32027, mais sans dessins (voir tableau XIX).
COURONNES :
la Couronne impériale pour les armoiries des provinces et des capitales (XIX, 1).
Ancienne couronne royale pour les armoiries des comtés, régions et cantons (XI.V 3).
chapeau royal, sous la forme de la couronne de Monomakhov, pour les anciennes villes russes qui étaient les sièges des grands-ducs régnants, par exemple : Kyiv, Novgorod, Tver, etc. (XIX, 2).
Pour les armoiries des villes de province de plus de 50 000 habitants, par exemple : Odessa, Riga, Saratov, Vilna, etc. (XIX, 4).
Couronne tour d'or à cinq dents, surmontée de l'Aigle Impérial, pour les villes de province de 50 000 habitants ou plus, et qui ensemble sont des forteresses.
Couronne de tour dorée à trois griffes pour les autres villes de province (XIX, 5).
La même couronne avec l'aigle impérial pour les villes de province de moins de 50 000 habitants, et qui ensemble sont des forteresses (XIX, 6).
Couronne de tour en argent à trois griffes pour les chefs-lieux de comté (XIX, 7).
Pour les chefs-lieux, qui sont ensemble et forteresses.
Couronne de tour écarlate à trois griffes pour les villes de banlieue.
Une telle couronne, avec l'aigle Impérial, pour les forteresses qui ne sont pas des villes de province ou de district.
Couronne de tour écarlate à deux dents pour les célèbres établissements (XIX, 8).
DÉCORATIONS AUTOUR DES BOUCLIERS.
Feuilles de chêne, avec ruban de Saint-André, pour les provinces (XIX, 9).
Feuilles de chêne, avec ruban Alexander, pour les régions et les gouvernements municipaux.
Ruban de Saint-André, avec deux sceptres impériaux, pour les capitales et pour les villes de leur résidence habituelle Majestés Impériales: Peterhof, Tsarskoïe Selo et Gatchina (XIX, 10).
Alexander Ribbon, avec deux marteaux d'or, pour les villes industrielles (XIX, 13).
Ruban Alexandre, aux deux épis dorés, pour les villes caractérisées par l'agriculture et le commerce des grains (XIX, 11).
Alexander Ribbon, avec deux ancres d'or, pour les villes côtières (XIX, 14).
Ruban Alexandre, avec deux médailles d'or vignes , pour les villes engagées dans la viticulture (XIX, 12).
Alexander Ribbon, avec deux médiators en argent, pour les villes engagées dans l'exploitation minière (XIX, 15).
Ruban d'Alexandre, avec deux bannières décorées de l'aigle impérial, pour les forteresses (XIX, 16).
Ruban Saint-Georges, avec deux bannières droites et décorées du chiffre du nom de cet empereur, au moment où il y eut siège, pour des forteresses qui différaient de l'ennemi (XIX, 17).
USAGE DES ARMES DE LA PROVINCE DANS LES ARMES DES VILLES, SAUF LA PROVINCE.
Les armoiries provinciales dans les armoiries de la ville doivent occuper la partie libre à droite ou, si elle est occupée par une autre figure appartenant aux armoiries de la ville, alors dans la partie libre à gauche.

Formulaire d'écusson de famille peut être différent, selon vos préférences et désirs individuels. Plus important encore, rappelez-vous qu'il existe certaines normes à suivre, surtout si vous ne créez pas seulement des armoiries pour une école, mais avant tout des armoiries pour vous et votre famille.
Les principales formes d'armoiries pour la famille
Le blason est un élément unique de l'identité du clan, une sorte de famille. Comme vous l'avez compris, la création d'un tel symbole comporte de nombreuses fonctionnalités. Dans cet article, nous parlerons de la base des armoiries - le bouclier sur lequel toutes les autres images thématiques sont dessinées. Les boucliers peuvent prendre différentes formes. Les experts notent 12 options de conception principales.- Le bouclier, d'une part, présente une légère concavité vers l'intérieur. Très version originale. Le bas est semi-circulaire, le haut est une ligne claire.
- Bouclier avec encadrement. La forme du bouclier est standard. Sur les côtés de la branche en forme d'ornement ;
- Le bouclier a une concavité interne des deux côtés. Le bas est semi-circulaire, le haut est un léger demi-cercle à l'intérieur du bouclier. Sur le côté supérieur, il y a une image sous la forme d'ailes d'oiseau.
- Bouclier standard avec fond conique et dessus plat ;
- Un bouclier de forme convexe de type carré;
- Bouclier standard sans fond conique ;
- Bouclier carré à fond rétréci;
- Bouclier rond;
- Bouclier avec des formes décoratives;
- Bouclier rhomboïde;
- Bouclier semi-circulaire;
- Bouclier carré.
Règles pour choisir la forme des armoiries de la famille
Nous avons déjà décidé que la base est un bouclier clair ou figure géométrique. Faites-le comme vous l'aimez. En même temps, il ne faut pas oublier que l'entourage supplémentaire du design ne fait pas de mal du tout. Le plus souvent, le bouclier était décoré d'une sorte d'ornement. Souvent, ils utilisaient un namet, qui était exécuté sous la forme de branches de plantes ou d'un arbre. Ils ont également utilisé l'option lorsque le bouclier était tenu entre les mains d'animaux mythiques ou ordinaires. Cela a donné l'unicité, la sévérité, la signification à l'ensemble des armoiries.Si vous essayez de compléter les armoiries avec la devise de la famille, vous devez dessiner un ruban de manière très organique au bas du bouclier. Il peut avoir votre devise écrite dessus. De plus, la devise peut être écrite sur la bordure de l'écu.
Il n'y a pas de règles claires pour choisir une forme pour un blason. Ici, comme vous le comprenez, tout dépend de vos désirs, préférences et aspects créatifs individuels. Si vous ne pouvez pas dessiner vous-même un blason, demandez l'aide de professionnels expérimentés qui feront tout le travail correctement, avec le sens de l'affaire.
La symbolique des armoiries familiales est très intéressante et variée. Tout d'abord, il faut dire que le blason est un symbole du clan, de la famille. Il doit donc être conçu avec...
Le blason est inaliénable partie importante chaque famille et chaque personne. Un blason personnel peut être fourni à une personne spécifique et contenir vraies valeurs et qualité...
Créer un blason familial n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît au départ. Le fait est qu'ici, vous avez besoin non seulement la créativité mais aussi une certaine connaissance du sujet. Pourtant, aujourd'hui...
La famille comtale des Orlov remonte historiquement à 1613, dont l'ancêtre était Vladimir Lukyanovich Orlov, le chef du village de Bezhetsky Verkh. Son arrière-petit-fils Grégory...
Le bouclier est l'élément principal de tout blason, mais les boucliers peuvent être les plus diverses formes. Le tout premier à être utilisé était un bouclier triangulaire (proche du bouclier varègue), mais du fait que peu de personnages pouvaient tenir sur un tel bouclier, il a été progressivement remplacé par d'autres formes.
Les formes les plus courantes de boucliers :
bouclier français
bouclier espagnol
Bouclier varègue
Bouclier polonais
Boucliers allemands

Boucliers anglais

Boucliers ovales (italiens) et ronds (orientaux) 
Selon les règles de l'héraldique, la forme de l'écu dans le blason n'est jamais décrite, car. on pense qu'un bouclier de n'importe quelle forme peut être pris comme base pour les armoiries. Selon les règles de l'héraldique, le blason (c'est-à-dire la description des armoiries) est toujours primaire, selon lequel le dessin lui-même est reproduit. Par conséquent, il peut y avoir plusieurs dessins artistiquement différents du même blason, dont chacun est égal aux autres, s'ils suivent tous exactement la description héraldique verbale. Prendre n'importe quelle image comme standard selon les canons de l'héraldique classique est considéré comme inacceptable.
De plus, le bouclier est toujours représenté comme s'il regardait l'observateur - par conséquent, le côté droit du bouclier sera laissé à l'observateur (et vice versa, respectivement). C'est pourquoi l'héraldique "gauche/droite" reflète la pratique habituelle.
Le bouclier peut être non seulement solide, mais aussi divisé. Il existe trois manières principales de diviser le bouclier - intersection, dissection et biseautage, elles peuvent être combinées.
intersection
dissection
Biseau à gauche et à droite

Souvent, le bouclier a une forme irrégulière, arrondie plutôt que quadrangulaire, mais le coin supérieur, même dans forme complexe le bouclier peut être déterminé même s'il se trouve en dehors du contour du bouclier. À partir de ce point, une ligne doit être tracée. Parfois, les boucliers sont représentés non seulement comme de forme complexe, mais également légèrement concaves, à la suite de quoi les lignes de séparation acquièrent également une forme incurvée. Mais dans tous les cas, la ligne biseautée doit passer par le centre du bouclier.
Ces quatre divisions principales sont appelées divisions simples du bouclier. Cependant, il existe de nombreuses autres façons de diviser le bouclier, en utilisant plusieurs lignes de division à la fois et en combinant des lignes de différentes directions. Ces divisions sont dites composites. Les deux plus courantes d'entre elles sont les divisions quadruples du bouclier.
Bouclier quadruple

Les divisions peuvent être effectuées non seulement par des lignes droites, mais également par des dents, des points, des vagues, etc. lignes - ces divisions sont considérées comme secondaires.
Division en trois parties du bouclier
Lorsque vous flambez un bouclier en trois parties, l'ordre dans lequel la direction de la division est mentionnée est important. Conformément à la hiérarchie acceptée, celui de droite ou (s'il n'y a rien à droite) d'en haut est appelé en premier. Lors de la recréation des armoiries selon la description, la division mentionnée en premier est effectuée en premier. Cet ordre évite de surcharger le texte du blason avec des indications droite, gauche, haut, bas. Lorsque vous flambez des boucliers en trois parties séparés par des biseaux et des demi-biseaux (à l'exception de deux types appartenant au même genre - droit et fourchu inversé), il est important de faire attention à la circonstance suivante : les demi-biseaux qui se trouvent dans la partie inférieure du bouclier ne sont pas appelés par le point de départ (à droite ou à gauche ), c'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut : droite et gauche. Le principe d'ordre de mention dans le blason des couleurs des champs de l'écu tripartite est expliqué plus loin.
 |  |  |  |  |
|
| Le bouclier est fourchu divisé en écarlate, or et argent | Le bouclier est à fourche inversée divisé en azur, écarlate et argent | Le bouclier est à moitié croisé et disséqué en noir, écarlate et or | L'écu est coupé et demi-croisé en écarlate, noir et or | L'écu est croisé et semi-découpé en écarlate, noir et or | |
 |  |  |  |  |
|
| Le bouclier est à moitié coupé et croisé en noir, or et écarlate | L'écu est biseauté à droite et semi-biseauté à gauche pour le noir, l'écarlate et l'or | L'écu est biseauté à droite et demi biseauté à gauche pour l'écarlate, le noir et l'or | L'écu est biseauté à gauche et semi-biseauté à droite pour l'écarlate, le noir et l'or | L'écu est demi-obliqué à droite et biseauté à gauche pour le noir, l'or et l'écarlate | |
BLASONNEMENT D'UN BOUCLIER FENDU
Vue générale
La blasonisation doit toujours être faite de manière aussi concise que possible, mais aussi précise que possible, de sorte que, à partir d'une seule description verbale, il soit possible de dessiner une image des armoiries en cours de description ou de l'imaginer mentalement.
Au Moyen Âge, une description verbale (orale ou écrite dans un livre sans illustrations) était le seul moyen de fixer le blason dans la mémoire ou dans un document, car il était loin d'être toujours possible d'ajouter un dessin à la description verbale. Pour cela dans Europe de l'Ouest les hérauts ont développé un langage héraldique spécial - un blason, conçu pour décrire n'importe quel blason aussi précisément et brièvement que possible à l'aide de termes spéciaux. Désormais, grâce aux réalisations de l'imprimerie, il est presque toujours possible d'accompagner l'histoire des armoiries d'un dessin en couleur, de sorte que l'importance de la description s'est estompée.
Les blasons anglais, français et allemand sont éprouvés, raffinés et concis. Ces langues spéciales permettront de décrire n'importe quel blason beaucoup plus court que la langue russe, même en utilisant une terminologie spéciale. En même temps, le souci de la brièveté du blason ne doit jamais l'emporter sur le souci de son exactitude. La précision est la chose principale dans la description des armoiries, et au nom de la précision, il est parfois nécessaire de sacrifier la brièveté.
Particularités de flamboyer un bouclier divisé.
Contrairement au blason anglais, la langue héraldique russe ne compte pas le nombre de rayures formées par les lignes de séparation, mais le nombre de lignes de séparation elles-mêmes. Ainsi, si l'écu est divisé, par exemple, en quatre parties, il est indiqué qu'il s'agit d'un écu trois fois coupé, trois fois croisé ou trois fois biseauté (gauche ou droite). Vient ensuite la mention des couleurs dans lesquelles les pièces résultantes sont peintes. Il n'est pas nécessaire de décrire chacune de ces parties séparément - nommez-en d'abord une, puis une autre couleur (si le bouclier divisé est peint avec deux teintures, comme c'est le plus souvent le cas). Par exemple : un écu trois fois taillé en azur et en argent. Ce faisant, il est important de suivre le principe suivant :
 | si le bouclier est disséqué, la couleur du champ droit est appelée la première.Le bouclier est disséqué en écarlate et argent |  | si le bouclier est croisé, alors la couleur du champ supérieur est appelée en premier. Le bouclier est croisé en écarlate et argent |
 | si le bouclier est biseauté à gauche, la couleur du champ occupant la région du coin supérieur droit est appelée la première.Le bouclier est trois fois biseauté à gauche pour l'écarlate et l'argent |  | si le bouclier est biseauté à droite, la couleur du champ occupant la région du coin supérieur droit est appelée la première; lorsque le coin est divisé en deux parties, la moitié supérieure est considérée comme la principale, c'est-à-dire bordant le bord supérieur de l'écu.L'écu est biseauté trois fois à droite pour l'argent et le vert |
 | si le coin supérieur droit est divisé en deux parties, sa partie supérieure est considérée comme la principale, c'est-à-dire qu'elle borde le bord supérieur du bouclier.Le bouclier est biseauté à droite et cinq fois à gauche en verts alternés et argent |  | si le coin supérieur droit est divisé en deux parties, sa partie supérieure, c'est-à-dire bordant le bord supérieur du bouclier, est considérée comme la principale. L'écu est biseauté cinq fois à droite et une fois à gauche pour l'écarlate et l'argent variables |
Ici, vous pouvez voir que les boucliers les plus difficiles à blasonner sont les boucliers divisés de manière complexe. Quelle couleur appeler la première dans de tels cas, à partir de quelle partie du bouclier commencer à compter ? Vous devez recommencer à partir du coin supérieur droit du bouclier. Mais il arrive souvent (par exemple, dans le cas des boucliers en forme de losange) que ce coin soit divisé en diagonale en deux parties. De ces deux moitiés, la principale est sur le dessus ou adjacente au bord supérieur du bouclier. Lorsque nous devons blasonner un bouclier aussi complexe (ou lorsque nous devons en peindre un nouveau), nous divisons d'abord le bouclier en quartiers. Ensuite, nous sélectionnons le premier quart du bouclier et le tondons mentalement vers la droite, quelle que soit la manière dont il est réellement divisé. Après cela, nous obtenons une indication exacte de la zone à partir de laquelle commencer le compte à rebours - c'est-à-dire que, comme dans le cas d'un simple biseau à droite, la couleur en haut est appelée en premier. Ce principe peut être illustré par le schéma suivant :
Une difficulté encore plus grande peut être fournie par des boucliers non standard peints en plusieurs couleurs, par exemple, un bouclier biseauté trois fois à droite, mais peint non pas avec deux, mais avec quatre teintures. Un tel bouclier a - contrairement à une logique évidente - décrit par le milieu, puis est revenu à cet endroit par le haut. Mais l'héraldique a sa propre logique :
Selon la hiérarchie des directions de division du bouclier et des parties du bouclier, des boucliers sont également décrits, divisés en trois parties. Dans les deux premiers exemples donnés, une ligne verticale s'étendant uniquement jusqu'au centre du bouclier est qualifiée de demi-coupe. Dans le premier cas, la demi-section est mentionnée en premier, car elle est située dans la partie supérieure principale du bouclier, et dans le second cas - après l'intersection, elle sépare donc la partie inférieure, deuxième partie la plus importante du bouclier. Dans les troisième et quatrième exemples, par souci de simplicité, il est conseillé d'utiliser le terme division fourchue (droite et inversée), bien que cette division soit une combinaison de demi-biseaux à droite et à gauche avec demi-coupe (Fig. 3) et demi-coupe avec demi-biseaux à droite et à gauche (Fig. 4).
En général, on privilégie toujours la droite sur la gauche et le haut sur le bas. Dans ce cas, la coupe est plus importante que l'intersection, la coupe et l'intersection sont plus importantes que les deux biseaux, et le biseau droit est plus important que le gauche.
Tout cela, bien sûr, se réfère spécifiquement aux divisions du bouclier, c'est-à-dire aux zones obtenues à la suite de la coupe, du croisement, du biseautage du bouclier ou d'une combinaison de ces divisions. Les divisions ne doivent pas être confondues avec les principales figures armoriées, dont le blason a ses propres règles. À proprement parler, il n'y a pas de différence entre, par exemple, un pilier d'argent dans un champ écarlate et un bouclier taillé deux fois en écarlate et en argent. Ou entre une ceinture d'argent dans un champ écarlate et un bouclier deux fois croisé d'écarlate et d'argent. Le même - dans les cas avec un bandage et un double biseau. Cependant, les divisions simples de l'écu diffèrent des principales figures héraldiques en ce que les premières forment toujours un nombre égal de bandes verticales, horizontales et diagonales de chaque couleur. Un écu, coupé, croisé ou biseauté deux fois, est en réalité toujours un écu, portant respectivement un pilier, une ceinture ou un baudrier. Il en va de même pour tous les boucliers divisés un nombre pair de fois. Tout nombre pair de coupes, d'intersections ou de biseaux ne forme pas toujours des rayures, mais des poteaux, des ceintures et des bandages en quantité appropriée. Les rayures qui ne sont pas des figures héraldiques ne se forment que lorsque nombre impair coupes, intersections ou biseaux. Par exemple, un bouclier "quatre fois coupé en or et noir" devrait en fait être lu comme "deux piliers noirs dans un champ doré".
Divisions vraies composées (exemples)
Les divisions divisant le bouclier en un nombre égal de champs de chaque couleur sont dites vraies. Voici à quoi ressemblent les principaux types de telles divisions du bouclier:
 |  |  |  |
 |  |  |  |
| Le bouclier est coupé cinq fois en écarlate et or | L'écu est taillé sept fois en azur et argent | L'écu est incliné trois fois sur la droite pour l'argent et le vert | L'écu est incliné trois fois sur la gauche pour l'écarlate et l'argent |
 |  |  |  |
| L'écu est biseauté cinq fois à droite pour le noir et or | L'écu est biseauté cinq fois à gauche pour l'azur et l'or | L'écu est biseauté sept fois à droite pour l'argent et l'écarlate | L'écu est biseauté sept fois à gauche pour le vert et l'argent |
 |  |  |  |
| Le bouclier est trois fois coupé et trois fois coupé en azur et argent | Le bouclier est coupé et croisé, les premier et quatrième quarts sont coupés et croisés en noir et argent, et les deuxième et troisième - en écarlate et or | L'écu est croisé, les parties supérieure et inférieure sont biseautées à gauche et à droite pour l'argent et le noir | Le bouclier est coupé et croisé, les premier et quatrième quarts sont biseautés à droite et à gauche pour l'écarlate et l'argent, et les deuxième et troisième - pour l'argent et le noir |
 |  |  |  |
| L'écu est biseauté cinq fois à droite et une fois à gauche pour l'écarlate et l'argent variables | L'écu est biseauté à droite et cinq fois à gauche en alternance de verts et d'argent | L'écu est biseauté deux fois à droite et cinq fois à gauche en alternance de verts et d'argent | L'écu est biseauté cinq fois à droite et deux fois à gauche pour l'or variable et l'azur |
 |  |  |  |
| Le bouclier est incliné trois fois à gauche et à droite sur l'écarlate et l'argent | L'écu est croisé et biseauté à gauche et à droite en vert et or | Dans l'écu, biseauté à droite pour l'azur et l'or, un pilier de couleur variable | Dans l'écu, biseauté à gauche pour l'azur et l'or, un pilier de couleur variable |
 |  |  |
|
| L'écu est trois fois croisé et biseauté à droite et à gauche en azur et or variables | L'écu est coupé deux fois et biseauté cinq fois à gauche en argent et noir variables | L'écu est coupé deux fois et biseauté cinq fois à droite pour l'écarlate et l'or variables | Le bouclier est divisé en forme de diamant en écarlate et argent |
 |  |  | |
| L'écu est coupé deux fois et croisé et biseauté cinq fois à gauche en variables d'azur et d'argent | L'écu est coupé deux fois et croisé et biseauté cinq fois à droite pour l'azur variable et l'argent | L'écu est disséqué, les parties droite et gauche sont biseautées à droite et à gauche en écarlate et noir | |
| Les divisions peuvent être faites non pas par des lignes droites, mais par des lignes arquées: | |||
 |  |  |  |
| Le bouclier est six fois divisé en arc de cercle en argent et noir | Le bouclier est divisé huit fois dans un motif arqué en azur et or. | Le bouclier est douze fois arqué écarlate et argenté | Le bouclier est divisé seize fois dans un motif arqué en vert et or. |
| Plus rares, mais très originales, caractéristiques de l'héraldique allemande sont les divisions suivantes : | |||
 |  |  |  |
| Le bouclier droit en forme de cochléaire est en forme d'escargot biseauté vers la droite sur le noir et l'or | En forme d'escargot à gauche L'écu est en forme d'escargot biseauté à gauche pour l'or et le noir | Blason inférieur en forme d'escargot croisé en forme d'escargot en or et nielle | Bouclier supérieur en forme d'escargot croisé en forme d'escargot en nielle et or |
 |  |  | |
| En forme de feuille L'écu est biseauté à droite avec deux feuilles d'argent et d'écarlate | En forme de trèfle (trèfle) L'écu est biseauté à droite avec deux trèfles pour l'or et le vert | Bouclier en forme de lis biseauté à droite avec deux lis sur azur et or |
Fausses divisions
Les fausses divisions sont celles qui divisent le bouclier en parties inégales en superficie :
 |  |  |  |
| Bouclier en forme d'empiècement traversé d'un empiècement en azur et argent (cette division n'existe que dans la version horizontale) | Bouclier en forme de joug inversé croisé avec un joug inversé en argent et écarlate (cette division n'existe que dans la version horizontale) | Croissant droit L'écu est taillé en croissant à droite en azur et or (cette division n'existe que dans la version verticale) | Croissant gauche L'écu est taillé en croissant à gauche en or et azur (cette division n'existe que dans la version verticale) |
 | Arqué à gauche L'écu est disséqué par l'arc de gauche en or et azur | ||
 |  | ||
| L'écu est traversé par deux marches ascendantes sur l'écarlate et l'argent | |||
| Division avec une pointe concave | |||
| Il existe également une autre façon de diviser le bouclier de manière complexe: à l'aide d'une pointe concave - simple, renversée et pressée. La division principale est obtenue en traçant deux lignes concaves du centre du bord supérieur du bouclier aux deux coins inférieurs. La zone triangulaire résultante peut, d'une part, être considérée comme une partie du champ de bouclier mis en évidence en couleur, et d'autre part, une figure héraldique secondaire (une pointe concave). L'héraldique française adhère au premier point de vue, l'allemand - au second. Dans tous les cas, on obtient une sorte de découpage en trois parties, qui permet de remplir chacune des trois parties avec son propre contenu, indépendant des deux autres. Le champ du bouclier, dans lequel se situe la pointe concave, n'est pas toujours de la même couleur : il est souvent divisé en deux ou quatre parties par dissection et intersection. Dans ces cas, la pointe concave s'avère être superposée à un champ en plusieurs parties, et parfois la couleur de la région triangulaire coïncide en genre avec la couleur de l'une des deux autres parties. Cependant, la règle héraldique des couleurs n'est pas violée. La description des armoiries est compilée en fonction du point de vue, car il n'y a pas de différence réelle entre un bouclier à pointe concave et un bouclier divisé en parties le long de la même pointe - quelle que soit la méthode du blason, le champ est marqué de la même manière. Néanmoins, l'héraldique russe définit cette région triangulaire de forme particulière comme une figure<вогнутое остриё>, par conséquent, dans tous les cas, quelle que soit la composition et la forme de la pointe concave utilisée, elle doit être flambée comme une figure, et d'abord (mais après la description de la division principale du bouclier lui-même) la pointe est mentionnée, et puis le contenu des parties du champ multiple, sur lequel ce point est superposé (voir Fig. 7 ci-dessous). | Dans un écu disséqué et croisé à pointe concave pressée écarlate, chargé d'un lys d'argent, il y a deux clés d'or en noir et deux poissons écarlates en argent. |
©2015-2019site
Tous les droits appartiennent à leurs auteurs. Ce site ne revendique pas la paternité, mais fournit une utilisation gratuite.
Date de création de la page : 2016-04-15