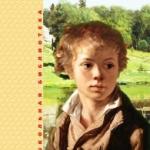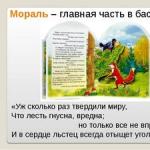En quelle année était la première guerre ? Pays participant à la Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale est une guerre entre deux coalitions de puissances : Pouvoirs centraux, ou Union quadruple(Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie, Bulgarie) et Entente(Russie, France, Grande-Bretagne).
Un certain nombre d'autres États ont soutenu l'Entente pendant la Première Guerre mondiale (c'est-à-dire qu'ils étaient ses alliés). Cette guerre a duré environ 4 ans (officiellement du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918). C'était le premier conflit militaire à l'échelle mondiale, dans lequel 38 des 59 États indépendants qui existaient à l'époque étaient impliqués.
Pendant la guerre, la composition des coalitions a changé.

Europe en 1914
Entente
Empire britannique
La France
l'empire russe
En plus de ces principaux pays, plus d'une vingtaine d'États se sont regroupés du côté de l'Entente, et le terme "Entente" a commencé à être utilisé pour désigner l'ensemble de la coalition anti-allemande. Ainsi, la coalition anti-allemande comprenait les pays suivants : Andorre, Belgique, Bolivie, Brésil, Chine, Costa Rica, Cuba, Équateur, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Italie (depuis le 23 mai 1915), Japon, Libéria, Monténégro, Nicaragua, Panama, Pérou, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Siam, USA, Uruguay.

Cavalerie de la garde impériale russe
Pouvoirs centraux
Empire allemand
Autriche-Hongrie
Empire ottoman
royaume bulgare(depuis 1915)
Le prédécesseur de ce bloc était Triple alliance, formé en 1879-1882 à la suite d'accords conclus entre Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. En vertu du traité, ces pays étaient obligés de se soutenir mutuellement en cas de guerre, principalement avec la France. Mais l'Italie a commencé à se rapprocher de la France et au début de la Première Guerre mondiale a déclaré sa neutralité, et en 1915 s'est retirée de la Triple Alliance et est entrée en guerre aux côtés de l'Entente.
Empire ottoman et Bulgarie rejoint l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie déjà pendant la guerre. L'Empire ottoman est entré en guerre en octobre 1914, la Bulgarie - en octobre 1915.

Certains pays ont participé en partie à la guerre, d'autres sont entrés dans la guerre déjà dans sa phase finale. Parlons de certaines caractéristiques de la participation à la guerre de pays individuels.
Albanie
Dès le début de la guerre, le prince albanais Wilhelm Vid, un Allemand de naissance, a fui le pays vers l'Allemagne. L'Albanie prend la neutralité, mais est occupée par les troupes de l'Entente (Italie, Serbie, Monténégro). Cependant, en janvier 1916, la majeure partie (nord et centre) était occupée par les troupes austro-hongroises. Dans les territoires occupés, avec le soutien des autorités d'occupation, la Légion albanaise a été créée à partir des volontaires albanais - une formation militaire composée de neuf bataillons d'infanterie et comptant jusqu'à 6 000 combattants dans ses rangs.
Azerbaïdjan
Le 28 mai 1918, la République démocratique d'Azerbaïdjan est proclamée. Bientôt, elle conclut un accord « Sur la paix et l'amitié » avec l'Empire ottoman, selon lequel ce dernier était obligé de « fournir une assistance par la force armée au gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, si cela est nécessaire pour assurer l'ordre et la sécurité dans le pays". Et lorsque les formations armées du Conseil des commissaires du peuple de Bakou ont lancé une attaque contre Elizavetpol, cela a servi de base à la République démocratique d'Azerbaïdjan pour demander une assistance militaire à l'Empire ottoman.En conséquence, les troupes bolcheviques ont été vaincues. Le 15 septembre 1918, l'armée turco-azerbaïdjanaise occupe Bakou.

M. Dimer "La Première Guerre mondiale. Bataille aérienne"
Saoudite
Au début de la Première Guerre mondiale, elle était la principale alliée de l'Empire ottoman dans la péninsule arabique.
Libye
L'ordre religieux et politique musulman soufi Senussia a commencé à mener des opérations militaires contre les colonialistes italiens en Libye dès 1911. Sénusie- un ordre religieux et politique musulman soufi (confrérie) en Libye et au Soudan, fondé à La Mecque en 1837 par le Grand Senussi, Muhammad ibn Ali as-Senussi, et visant à surmonter le déclin de la pensée et de la spiritualité islamiques et l'affaiblissement de la politique musulmane unité). En 1914, les Italiens ne contrôlaient que la côte. Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les Senusites ont reçu de nouveaux alliés dans la lutte contre les colonialistes - les empires ottoman et allemand, avec leur aide, à la fin de 1916, Senusia a chassé les Italiens de la majeure partie de la Libye. En décembre 1915, des détachements sénusites envahissent l'Égypte britannique, où ils subissent une cuisante défaite.
Pologne
Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, les cercles nationalistes polonais d'Autriche-Hongrie ont avancé l'idée de créer la Légion polonaise afin d'obtenir le soutien des puissances centrales et avec leur aide de résoudre partiellement la question polonaise. En conséquence, deux légions ont été formées - orientale (Lviv) et occidentale (Cracovie). La Légion orientale, après l'occupation de la Galice par les troupes russes le 21 septembre 1914, s'est dissoute et la Légion occidentale a été divisée en trois brigades de légionnaires (chacune de 5 à 6 000 personnes) et a continué à participer aux hostilités sous cette forme. jusqu'en 1918.
En août 1915, les Allemands et les Austro-Hongrois occupent le territoire de tout le Royaume de Pologne et, le 5 novembre 1916, les autorités d'occupation promulguent l'"Acte des deux empereurs", proclamant la création du Royaume de Pologne - un État indépendant avec une monarchie héréditaire et un système constitutionnel, dont les frontières sont précisément définies ne l'étaient pas.
Soudan
Au début de la Première Guerre mondiale, le sultanat du Darfour était sous protectorat de la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont refusé d'aider le Darfour, ne voulant pas gâcher leurs relations avec leur allié de l'Entente. En conséquence, le 14 avril 1915, le sultan a officiellement déclaré l'indépendance du Darfour. Le sultan du Darfour espérait recevoir le soutien de l'Empire ottoman et de l'ordre soufi de Senusia, avec qui le sultanat avait noué une alliance solide. Un deux millième corps anglo-égyptien envahit le Darfour, l'armée du sultanat subit une série de défaites et, en janvier 1917, l'adhésion du sultanat du Darfour au Soudan est officiellement annoncée.

Artillerie russe
Pays neutres
Les pays suivants ont maintenu une neutralité totale ou partielle : Albanie, Afghanistan, Argentine, Chili, Colombie, Danemark, El Salvador, Éthiopie, Liechtenstein, Luxembourg (il n'a pas déclaré la guerre aux puissances centrales, bien qu'il ait été occupé par les troupes allemandes), Mexique , Pays-Bas, Norvège, Paraguay, Perse, Espagne, Suède, Suisse, Tibet, Venezuela, Italie (3 août 1914 - 23 mai 1915)
Suite à la guerre
À la suite de la Première Guerre mondiale, le bloc des puissances centrales a cessé d'exister avec la défaite de la Première Guerre mondiale à l'automne 1918. A la signature de l'armistice, ils ont tous accepté sans condition les conditions des vainqueurs. L'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman se sont désintégrés à la suite de la guerre; les États créés sur le territoire de l'Empire russe ont été contraints de rechercher le soutien de l'Entente. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande ont conservé leur indépendance, les autres ont de nouveau été annexées à la Russie (directement à la RSFSR ou entrées en Union soviétique).
Première Guerre mondiale- l'un des plus grands conflits armés de l'histoire de l'humanité. À la suite de la guerre, quatre empires ont cessé d'exister : russe, austro-hongrois, ottoman et allemand. Les pays participants ont perdu environ 12 millions de personnes tuées (y compris des civils), environ 55 millions ont été blessées.

F. Roubaud "La Première Guerre mondiale. 1915"
Guerre russo-suédoise 1808-1809 |
|
Europe, Afrique et Moyen-Orient (brièvement en Chine et dans les îles du Pacifique) |
|
Impérialisme économique, revendications territoriales et économiques, barrières commerciales, course aux armements, militarisme et autocratie, rapports de force, conflits locaux, obligations alliées des puissances européennes. |
|
Victoire de l'Entente. Révolutions de février et d'octobre en Russie et révolution de novembre en Allemagne. Effondrement de l'Empire ottoman et de l'Autriche-Hongrie. Le début de la pénétration du capital américain en Europe. |
|
Adversaires |
|
Bulgarie (depuis 1915) |
|
Italie (depuis 1915) |
|
Roumanie (depuis 1916) |
|
États-Unis (depuis 1917) |
|
Grèce (depuis 1917) |
|
Commandants |
|
Nicolas II † |
François-Joseph I † |
Grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch |
|
MV Alekseev † |
F. von Gotzendorf |
A. A. Broussilov |
A. von Straussenburg |
L. G. Kornilov † |
Guillaume II |
A. F. Kerensky |
E. von Falkenhayn |
N. N. Dukhonine † |
Paul de Hindenburg |
NV Krylenko |
H. von Moltke (Le Jeune) |
R. Poincaré |
|
J. Clémenceau |
E. Ludendorff |
Prince héritier Ruprecht |
|
Mehmed V † |
|
R. Nivelle |
|
Enver Pacha |
|
M. Atatürk |
|
G.Asquith |
Ferdinand Ier |
D.Lloyd George |
|
J. Jellicoe |
G. Stoyanov-Todorov |
G. Kitchener † |
|
L.Dunsterville |
|
Prince Régent Alexandre |
|
R.Poutnik † |
|
Albert Ier |
|
J.Vukotic |
|
Victor-Emmanuel III |
|
L. cadorna |
|
Prince Louis |
|
Ferdinand Ier |
|
K. Prezan |
|
A.Averescu |
|
T.Wilson |
|
J.Pershing |
|
P. Dunglis |
|
Okuma Shigenobu |
|
Terauchi Masatake |
|
Hussein ben Ali |
|
Pertes militaires |
|
Décès militaires : 5 953 372 |
Morts militaires : 4 043 397 |
(28 juillet 1914 - 11 novembre 1918) - l'un des plus grands conflits armés de l'histoire de l'humanité.
Ce nom n'a été établi dans l'historiographie qu'après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Dans l'entre-deux-guerres, le nom " Grande Guerre" (ang. leGénialGuerre, fr. La Grandeguerre), dans l'Empire russe, on l'appelait parfois " Deuxième patriotique", ainsi que de manière informelle (avant et après la révolution) -" Allemand» ; puis en URSS - " guerre impérialiste».
La raison immédiate de la guerre était l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc autrichien François-Ferdinand par l'étudiante serbe de dix-neuf ans Gavrila Princip, qui était l'un des membres de l'organisation terroriste Mlada Bosna, qui s'est battue pour unir tous les peuples slaves du sud en un seul État.
À la suite de la guerre, quatre empires ont cessé d'exister : russe, austro-hongrois, allemand et ottoman. Les pays participants ont perdu environ 12 millions de personnes tuées (y compris des civils), environ 55 millions ont été blessées.
Membres
Alliés de l'Entente(a soutenu l'Entente dans la guerre) : États-Unis, Japon, Serbie, Italie (ont participé à la guerre aux côtés de l'Entente depuis 1915, bien qu'étant membre de la Triple Alliance), Monténégro, Belgique, Égypte, Portugal, Roumanie, Grèce, Brésil, Chine, Cuba, Nicaragua, Siam, Haïti, Libéria, Panama, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Bolivie, République dominicaine, Pérou, Uruguay, Équateur.
Chronologie de la déclaration de guerre |
||
Qui a déclaré la guerre |
A qui la guerre a été déclarée |
|
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Empire britannique et France |
||
Allemagne |
||
Empire britannique et France |
||
Allemagne |
le Portugal |
|
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Panama et Cuba |
Allemagne |
|
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Allemagne |
||
Brésil |
Allemagne |
|
Fin de la guerre |
||
Contexte du conflit
Bien avant la guerre en Europe, les contradictions grandissaient entre les grandes puissances - Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Russie.
L'Empire allemand, formé après la guerre franco-prussienne de 1870, cherchait à dominer politiquement et économiquement le continent européen. N'ayant rejoint la lutte pour les colonies qu'après 1871, l'Allemagne voulait redistribuer en sa faveur les possessions coloniales de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas et du Portugal.
La Russie, la France et la Grande-Bretagne ont cherché à contrecarrer les aspirations hégémoniques de l'Allemagne. Pourquoi l'Entente a-t-elle été formée ?
L'Autriche-Hongrie, étant un empire multinational, était un foyer constant d'instabilité en Europe en raison de contradictions interethniques internes. Elle a essayé de s'accrocher à la Bosnie-Herzégovine, qu'elle a capturée en 1908 (voir : La crise bosniaque). Elle oppose la Russie, qui assume le rôle de défenseur de tous les Slaves des Balkans, et la Serbie, qui prétend être le centre unificateur des Slaves du Sud.
Au Moyen-Orient, les intérêts de presque toutes les puissances se sont affrontés, s'efforçant d'être à temps pour la division de l'Empire ottoman en ruine (Turquie). Selon les accords conclus entre les membres de l'Entente, à la fin de la guerre, tous les détroits entre la mer Noire et la mer Égée iraient à la Russie, ainsi la Russie recevrait le contrôle total de la mer Noire et de Constantinople.
La confrontation entre les pays de l'Entente d'une part et l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie d'autre part a conduit à la Première Guerre mondiale, où les ennemis de l'Entente : la Russie, la Grande-Bretagne et la France, et ses alliés formaient le bloc des puissances centrales. : Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie et Bulgarie, - dans lesquelles l'Allemagne a joué un rôle de premier plan. En 1914, deux blocs avaient enfin pris forme :
Le bloc de l'Entente (formé en 1907 après la conclusion des traités alliés russo-français, anglo-français et anglo-russe) :
- Grande Bretagne;
Bloquer la Triple Alliance :
- Allemagne;
L'Italie, cependant, est entrée en guerre en 1915 aux côtés de l'Entente - mais la Turquie et la Bulgarie ont rejoint l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pendant la guerre, formant la Quadruple Alliance (ou bloc des puissances centrales).
Les raisons de la guerre évoquées dans diverses sources incluent l'impérialisme économique, les barrières commerciales, la course aux armements, le militarisme et l'autocratie, l'équilibre des forces, les conflits locaux qui ont eu lieu la veille (les guerres balkaniques, la guerre italo-turque), les ordres pour la mobilisation générale en Russie et en Allemagne, les revendications territoriales et les obligations d'alliance des puissances européennes.
L'état des forces armées au début de la guerre
Un coup dur porté à l'armée allemande a été la réduction de ses effectifs: la raison en est considérée comme la politique à courte vue des sociaux-démocrates. Pour la période 1912-1916, une réduction de l'armée était prévue en Allemagne, ce qui ne contribuait en rien à une augmentation de son efficacité au combat. Le gouvernement des sociaux-démocrates a constamment réduit le financement de l'armée (qui, cependant, ne s'applique pas à la marine).
Cette politique destructrice envers l'armée a conduit au fait qu'au début de 1914, le chômage en Allemagne avait augmenté de 8% (par rapport aux chiffres de 1910). L'armée a connu une pénurie chronique de l'équipement militaire nécessaire. Manque d'armes modernes. Il n'y avait pas assez de fonds pour équiper adéquatement l'armée de mitrailleuses - l'Allemagne était à la traîne dans ce domaine. Il en va de même pour l'aviation - la flotte aérienne allemande était nombreuse, mais dépassée. L'avion principal de l'Allemand Luftstreitkraftétait l'avion le plus massif, mais en même temps désespérément dépassé d'Europe - un monoplan de type Taube.
Lors de la mobilisation, un nombre important d'avions civils et postaux ont également été réquisitionnés. De plus, l'aviation n'a été définie comme une branche distincte de l'armée qu'en 1916, avant qu'elle ne soit répertoriée dans les "troupes de transport" ( Kraftfahrer). Mais l'aviation avait peu d'importance dans toutes les armées, à l'exception des armées françaises, où l'aviation était censée effectuer des raids aériens réguliers sur le territoire de l'Alsace-Lorraine, de la Rhénanie et du Palatinat bavarois. Le coût financier total de l'aviation militaire en France en 1913 s'élevait à 6 millions de francs, en Allemagne - 322 000 marks, en Russie - environ 1 million de roubles. Ce dernier obtint d'importants succès, ayant construit, peu avant le début de la guerre, le premier quadrimoteur au monde, destiné à devenir le premier bombardier stratégique. Depuis 1865, l'Université agraire d'État et l'usine Obukhov coopèrent avec succès avec la société Krupp. Cette firme Krupp a coopéré avec la Russie et la France jusqu'au tout début de la guerre.
Les chantiers navals allemands (dont Blohm & Voss) ont construit, mais n'ont pas réussi à achever avant le début de la guerre, 6 destroyers pour la Russie, selon le projet du plus tard célèbre Novik, construit à l'usine de Putilov et armé d'armes produites au Usine d'Obukhov. Malgré l'alliance russo-française, Krupp et d'autres entreprises allemandes ont régulièrement envoyé leurs dernières armes en Russie pour des tests. Mais sous Nicolas II, la préférence commença à être donnée aux canons français. Ainsi, la Russie, compte tenu de l'expérience des deux principaux fabricants d'artillerie, est entrée en guerre avec une bonne artillerie de petit et moyen calibre, tout en ayant 1 baril pour 786 soldats contre 1 baril pour 476 soldats dans l'armée allemande, mais en termes de artillerie lourde l'armée russe accusait un retard significatif par rapport à l'armée allemande, avec 1 baril pour 22 241 soldats et officiers contre 1 baril pour 2 798 soldats dans l'armée allemande. Et c'est sans compter les mortiers, qui étaient déjà en service dans l'armée allemande et qui n'étaient pas du tout en 1914 dans l'armée russe.
En outre, il convient de noter que la saturation des unités d'infanterie avec des mitrailleuses dans l'armée russe n'était pas inférieure aux armées allemande et française. Ainsi, le régiment d'infanterie russe de la composition du 4e bataillon (16 compagnie) avait dans son état le 6 mai 1910 une équipe de mitrailleuses de 8 mitrailleuses Maxim, soit 0,5 mitrailleuse par compagnie, "il y en avait six dans l'allemand et Armées françaises sur le régiment "12 états-majors de compagnie.
Événements avant la Première Guerre mondiale
Le 28 juin 1914, Gabriel Princip, un Serbe de Bosnie de dix-neuf ans, étudiant, membre de l'organisation terroriste nationaliste serbe Mlada Bosna, tue l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc François-Ferdinand, et son épouse Sofia Hotek en Sarajevo. Les milieux dirigeants autrichiens et allemands décidèrent d'utiliser ce massacre de Sarajevo comme prétexte pour déclencher une guerre européenne. Le 5 juillet, l'Allemagne promet de soutenir l'Autriche-Hongrie en cas de conflit avec la Serbie.
Le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie, déclarant que la Serbie était à l'origine de l'assassinat de François-Ferdinand, annonce un ultimatum à la Serbie, dans lequel elle demande à la Serbie de remplir des conditions manifestement impossibles, notamment : purger l'appareil d'État et l'armée des officiers et fonctionnaires vus dans propagande anti-autrichienne; arrêter les terroristes présumés ; permettre à la police austro-hongroise de mener des enquêtes et de sanctionner les responsables d'actions anti-autrichiennes sur le territoire serbe. Seulement 48 heures ont été accordées pour une réponse.
Le même jour, la Serbie commence la mobilisation, cependant, accepte toutes les exigences de l'Autriche-Hongrie, à l'exception de l'admission de la police autrichienne sur son territoire. L'Allemagne pousse constamment l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie.
Le 25 juillet, l'Allemagne entame une mobilisation clandestine : sans l'annoncer officiellement, elle commence à envoyer des convocations aux réservistes dans les postes de recrutement.
26 juillet L'Autriche-Hongrie annonce la mobilisation et commence à concentrer ses troupes à la frontière avec la Serbie et la Russie.
28 juillet L'Autriche-Hongrie, déclarant que les exigences de l'ultimatum n'ont pas été remplies, déclare la guerre à la Serbie. La Russie dit qu'elle ne permettra pas l'occupation de la Serbie.
Le même jour, l'Allemagne présente un ultimatum à la Russie : arrêtez la conscription ou l'Allemagne déclarera la guerre à la Russie. La France, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne se mobilisent. L'Allemagne attire des troupes aux frontières belges et françaises.
Dans le même temps, le matin du 1er août, le ministre britannique des Affaires étrangères E. Gray a promis à l'ambassadeur d'Allemagne à Londres, Likhnovsky, qu'en cas de guerre entre l'Allemagne et la Russie, l'Angleterre resterait neutre, à condition que la France ne soit pas attaquée. .
Campagne de 1914
La guerre s'est déroulée sur deux principaux théâtres d'opérations militaires - en Europe occidentale et orientale, ainsi que dans les Balkans, dans le nord de l'Italie (à partir de mai 1915), dans le Caucase et au Moyen-Orient (à partir de novembre 1914) dans les colonies d'Europe États - en Afrique, en Chine, en Océanie. En 1914, tous les participants à la guerre allaient mettre fin à la guerre en quelques mois par une offensive décisive ; personne ne s'attendait à ce que la guerre prenne un caractère prolongé.
Début de la Première Guerre mondiale
L'Allemagne, conformément au plan précédemment élaboré pour mener une guerre éclair, la "blitzkrieg" (plan Schlieffen), a envoyé les forces principales sur le front occidental, dans l'espoir de vaincre la France d'un coup rapide avant l'achèvement de la mobilisation et du déploiement de l'armée russe, puis s'occuper de la Russie.
Le commandement allemand avait l'intention de porter le coup principal à travers la Belgique au nord de la France non défendu, de contourner Paris par l'ouest et d'emmener l'armée française, dont les principales forces étaient concentrées sur la frontière orientale fortifiée, franco-allemande, dans une énorme "chaudière" .
Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, le même jour les Allemands envahissent le Luxembourg sans aucune déclaration de guerre.
La France s'est tournée vers l'Angleterre pour obtenir de l'aide, mais le gouvernement britannique, par 12 voix contre 6, a refusé de soutenir la France, déclarant que "la France ne doit pas compter sur une aide que nous ne sommes pas actuellement en mesure d'apporter", tout en ajoutant que "si le Les Allemands envahissent la Belgique et n'occupent que le "coin" de ce pays le plus proche du Luxembourg, et non la côte, l'Angleterre restera neutre.
À quoi l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne, Cambo, a déclaré que si l'Angleterre trahissait maintenant ses alliés: la France et la Russie, alors après la guerre, elle-même passerait un mauvais moment, quel que soit le vainqueur. Le gouvernement britannique, en effet, pousse les Allemands à l'agression. Les dirigeants allemands décidèrent que l'Angleterre n'entrerait pas en guerre et passèrent à une action décisive.
Le 2 août, les troupes allemandes occupent finalement le Luxembourg et un ultimatum est lancé à la Belgique pour permettre aux armées allemandes de passer la frontière avec la France. Seulement 12 heures ont été accordées pour la réflexion.
Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, l'accusant « d'attaques organisées et de bombardements aériens contre l'Allemagne » et de « violation de la neutralité belge ».
Le 4 août, les troupes allemandes franchissent la frontière belge. Le roi Albert de Belgique lance un appel à l'aide aux pays garants de la neutralité belge. Londres, contrairement à ses déclarations précédentes, a envoyé un ultimatum à Berlin : arrêter l'invasion de la Belgique ou l'Angleterre déclarerait la guerre à l'Allemagne, à laquelle Berlin a annoncé "la trahison". Après l'expiration de l'ultimatum, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne et envoie 5,5 divisions pour aider la France.
La Première Guerre mondiale a commencé.
Le déroulement des hostilités
Théâtre d'Opérations Français - Front Ouest
Plans stratégiques des parties au début de la guerre. Au début de la guerre, l'Allemagne était guidée par une doctrine militaire assez ancienne - le plan Schlieffen - qui prévoyait la défaite instantanée de la France avant que la Russie "maladroite" ne puisse se mobiliser et pousser son armée jusqu'aux frontières. L'attaque était envisagée à travers le territoire belge (afin de contourner les principales forces françaises), Paris devait initialement être prise en 39 jours. En un mot, l'essence du plan a été esquissée par Guillaume II : « Nous déjeunerons à Paris et dînerons à Saint-Pétersbourg ». En 1906, le plan fut modifié (sous la direction du général Moltke) et acquit un caractère moins catégorique - une partie importante des troupes devait encore être laissée sur le front de l'Est, il fallait attaquer à travers la Belgique, mais sans toucher Hollande neutre.
La France, à son tour, était guidée par la doctrine militaire (le soi-disant Plan-17), qui prescrit de commencer la guerre avec la libération de l'Alsace-Lorraine. Les Français s'attendaient à ce que les principales forces de l'armée allemande soient initialement concentrées contre l'Alsace.
Invasion allemande de la Belgique. Après avoir traversé la frontière belge le matin du 4 août, l'armée allemande, suivant le plan Schlieffen, a facilement balayé les faibles barrières de l'armée belge et s'est enfoncée profondément en Belgique. L'armée belge, que les Allemands étaient plus de 10 fois plus nombreuse, a offert de manière inattendue une résistance active, qui, cependant, n'a pas pu retarder considérablement l'ennemi. Contournant et bloquant les forteresses belges bien fortifiées : Liège (tombée le 16 août, voir : Sturm de Liège), Namur (tombée le 25 août) et Anvers (tombée le 9 octobre), les Allemands ont poussé l'armée belge devant eux et prit Bruxelles le 20 août, en ce même jour entrant en contact avec les forces anglo-françaises. Le mouvement des troupes allemandes est rapide, les Allemands, sans s'arrêter, contournent les villes et les forteresses qui continuent à se défendre. Le gouvernement belge s'enfuit au Havre. Le roi Albert I a continué à défendre Anvers avec les dernières unités restantes. L'invasion de la Belgique a surpris le commandement français, mais les Français ont réussi à organiser le transfert de leurs unités dans le sens de la percée beaucoup plus rapidement que ne le laissaient prévoir les plans allemands.
Actions en Alsace et en Lorraine. Le 7 août, les Français, avec les forces des 1ère et 2ème armées, lancent une offensive en Alsace, et le 14 août - en Lorraine. L'offensive avait une signification symbolique pour les Français - le territoire de l'Alsace-Lorraine a été pris à la France en 1871, après la défaite dans la guerre franco-prussienne. Bien qu'ils aient d'abord réussi à pénétrer en territoire allemand, capturant Sarrebruck et Mulhouse, l'offensive allemande qui se déroulait simultanément en Belgique les obligeait à y transférer une partie de leurs troupes. Les contre-attaques qui ont suivi n'ont pas rencontré une résistance suffisante de la part des Français et, à la fin du mois d'août, l'armée française s'est repliée sur ses positions précédentes, laissant à l'Allemagne une petite partie du territoire français.
Bataille frontalière. Le 20 août, les troupes anglo-françaises et allemandes entrent en contact - la bataille de la frontière commence. Au début de la guerre, le commandement français ne s'attendait pas à ce que la principale offensive des troupes allemandes passe par la Belgique, les forces principales des troupes françaises étaient concentrées contre l'Alsace. Dès le début de l'invasion de la Belgique, les Français ont commencé à déplacer activement des unités dans la direction de la percée, au moment où ils sont entrés en contact avec les Allemands, le front était suffisamment désordonné et les Français et les Britanniques ont été contraints de se battre avec trois groupes de troupes sans contact. Sur le territoire de la Belgique, près de Mons, le corps expéditionnaire britannique (BEF) était situé, au sud-est, près de Charleroi, il y avait la 5e armée française. Dans les Ardennes, approximativement le long de la frontière de la France avec la Belgique et le Luxembourg, les 3e et 4e armées françaises étaient stationnées. Dans les trois zones, les troupes anglo-françaises ont subi une lourde défaite (bataille de Mons, bataille de Charleroi, opération des Ardennes (1914)), perdant environ 250 000 personnes, et les Allemands du nord ont envahi la France sur un large front, livrant le coup principal à l'ouest, contournant Paris, prenant ainsi l'armée française en tenailles géantes.
Les armées allemandes avançaient rapidement. Les unités britanniques se replient en désordre sur la côte, le commandement français n'est pas sûr de la possibilité de tenir Paris, le 2 septembre, le gouvernement français se déplace à Bordeaux. La défense de la ville était dirigée par l'énergique général Gallieni. Les forces françaises se regroupaient sur une nouvelle ligne de défense le long de la Marne. Les Français se préparent énergiquement à la défense de la capitale en prenant des mesures extraordinaires. L'épisode est largement connu lorsque Gallieni ordonne le transfert urgent d'une brigade d'infanterie vers le front, utilisant à cet effet des taxis parisiens.
Les actions infructueuses de l'armée française en août ont forcé son commandant, le général Joffre, à remplacer immédiatement un grand nombre (jusqu'à 30% du total) de généraux peu performants; le renouvellement et le rajeunissement des généraux français ont ensuite été évalués très positivement.
Bataille de la Marne. Pour mener à bien l'opération de contournement de Paris et d'encerclement de l'armée française, l'armée allemande n'a pas assez d'effectifs. Les troupes, après avoir combattu des centaines de kilomètres, étaient épuisées, les communications s'étiraient, il n'y avait rien pour couvrir les flancs et les lacunes émergentes, il n'y avait pas de réserves, elles devaient manœuvrer avec les mêmes unités, les faisant aller et venir, de sorte que le quartier général d'accord avec la proposition du commandant : faire une manœuvre de détour 1 e armée de von Kluck pour réduire le front de l'offensive et ne pas faire un enveloppement profond de l'armée française autour de Paris, mais tourner à l'est au nord de la capitale française et frapper l'arrière de les principales forces de l'armée française.
Tournant vers l'est au nord de Paris, les Allemands exposent leur flanc droit et leur arrière à l'attaque du groupement français concentré pour défendre Paris. Il n'y avait rien pour couvrir le flanc droit et l'arrière : 2 corps et une division de cavalerie, destinés à l'origine à renforcer le groupe qui avançait, furent envoyés en Prusse orientale pour aider la 8e armée allemande vaincue. Néanmoins, le commandement allemand se fait une manœuvre fatale : il tourne ses troupes vers l'est sans atteindre Paris, espérant la passivité de l'ennemi. Le commandement français ne manque pas de profiter de l'occasion et frappe le flanc nu et l'arrière de l'armée allemande. La première bataille de la Marne a commencé, au cours de laquelle les Alliés ont réussi à renverser le cours des hostilités en leur faveur et à repousser les troupes allemandes sur le front de Verdun à Amiens à 50-100 kilomètres en arrière. La bataille sur la Marne a été intense, mais de courte durée - la bataille principale a commencé le 5 septembre, le 9 septembre la défaite de l'armée allemande est devenue évidente, les 12 et 13 septembre le retrait de l'armée allemande sur la ligne le long des rivières Aisne et Vel a été achevé.
La bataille de la Marne était d'une grande importance morale pour toutes les parties. Pour les Français, c'était la première victoire sur les Allemands, surmontant la honte de la défaite dans la guerre franco-prussienne. Après la bataille de la Marne, l'humeur capitulaire en France a sensiblement commencé à décliner. Les Britanniques ont réalisé la puissance de combat insuffisante de leurs troupes et ont ensuite suivi un cours pour augmenter leurs forces armées en Europe et renforcer leur entraînement au combat. Les plans allemands pour une défaite rapide de la France ont échoué; Moltke, qui dirigeait l'état-major de campagne, a été remplacé par Falkenhain. Joffre, en revanche, acquiert un grand prestige en France. La bataille de la Marne a été le tournant de la guerre sur le théâtre d'opérations français, après quoi la retraite continue des troupes anglo-françaises s'est arrêtée, le front s'est stabilisé et les forces des adversaires étaient à peu près égales.
"Courir à la mer". Batailles en Flandre. La bataille sur la Marne s'est transformée en la soi-disant "Course vers la mer" - en mouvement, les deux armées ont tenté de s'entourer du flanc, ce qui n'a conduit qu'à la fermeture de la ligne de front, reposant sur la côte du Nord Mer. Les actions des armées dans cette zone plate et peuplée, saturée de routes et de voies ferrées, se distinguaient par une extrême mobilité ; dès que certains affrontements ont pris fin dans la stabilisation du front, les deux camps ont rapidement déplacé leurs troupes vers le nord, vers la mer, et la bataille a repris à l'étape suivante. Lors de la première étape (deuxième quinzaine de septembre), les combats se sont déroulés le long des lignes de l'Oise et de la Somme, puis, lors de la deuxième étape (29 septembre - 9 octobre), les combats se sont déroulés le long de la rivière Scarpa (bataille d'Arras) ; dans la troisième étape, des combats ont eu lieu à Lille (10-15 octobre), sur l'Isère (18-20 octobre), à Ypres (30 octobre-15 novembre). Le 9 octobre, le dernier centre de résistance de l'armée belge, Anvers, tombe, et les unités belges battues rejoignent les anglo-françaises, occupant la position extrême nord du front.
Le 15 novembre, tout l'espace entre Paris et la mer du Nord était densément rempli de troupes des deux côtés, le front s'est stabilisé, le potentiel offensif des Allemands était épuisé et les deux parties sont passées à la lutte de position. Un succès important de l'Entente peut être considéré comme le fait qu'elle a réussi à conserver les ports les plus propices à la communication maritime avec l'Angleterre (principalement Calais).
À la fin de 1914, la Belgique était presque entièrement conquise par l'Allemagne. L'Entente n'a laissé qu'une petite partie occidentale de la Flandre à la ville d'Ypres. Plus loin, au sud de Nancy, le front traversait le territoire de la France (le territoire perdu par les Français avait la forme d'un fuseau, long de 380 à 400 km le long du front, profond de 100 à 130 km à son point le plus large depuis le pré- frontière de guerre de la France vers Paris). Lille est donnée aux Allemands, Arras et Laon restent aux Français ; le plus proche de Paris (environ 70 km), le front s'approche dans le secteur de Noyon (derrière les Allemands) et de Soissons (derrière les Français). Le front s'oriente alors vers l'est (Reims reste derrière les Français) et passe dans la zone fortifiée de Verdun. Après cela, dans la région de Nancy (derrière les Français), la zone d'hostilités actives de 1914 a pris fin, le front s'est poursuivi dans son ensemble le long de la frontière franco-allemande. La Suisse et l'Italie neutres n'ont pas participé à la guerre.
Résultats de la campagne de 1914 sur le théâtre d'opérations français. La campagne de 1914 est extrêmement dynamique. Les grandes armées des deux camps ont manœuvré activement et rapidement, aidées par le réseau routier dense de la zone de combat. La disposition des troupes n'a pas toujours formé un front solide, les troupes n'ont pas érigé de lignes défensives à long terme. En novembre 1914, une ligne de front stable commença à se dessiner. Les deux camps, ayant épuisé leur potentiel offensif, ont commencé à construire des tranchées et des barbelés, conçus pour un usage permanent. La guerre est entrée dans une phase positionnelle. Étant donné que la longueur de l'ensemble du front occidental (de la mer du Nord à la Suisse) était d'un peu plus de 700 kilomètres, la densité des troupes y était nettement plus élevée que sur le front oriental. Une caractéristique de la compagnie était que des opérations militaires intensives n'étaient menées que dans la moitié nord du front (au nord de la région fortifiée de Verdun), où les deux camps concentraient leurs forces principales. Le front de Verdun et du sud était considéré par les deux camps comme secondaire. La zone perdue pour les Français (dont la Picardie était le centre) était densément peuplée et importante tant sur le plan agricole qu'industriel.
Au début de 1915, les puissances belligérantes ont été confrontées au fait que la guerre avait pris un caractère qui n'était pas prévu par les plans d'avant-guerre de part et d'autre - elle s'était prolongée. Bien que les Allemands aient réussi à capturer la quasi-totalité de la Belgique et une partie importante de la France, leur objectif principal - une victoire rapide sur les Français - s'est avéré totalement inaccessible. L'Entente et les puissances centrales devaient essentiellement déclencher un nouveau type de guerre que l'humanité n'avait pas encore connu - épuisant, long, nécessitant une mobilisation totale de la population et des économies.
L'échec relatif de l'Allemagne a eu un autre résultat important - l'Italie, troisième membre de la Triple Alliance, s'est abstenue d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.
Opération prussienne orientale. Sur le front de l'Est, la guerre a commencé avec l'opération de la Prusse orientale. Le 4 août (17), l'armée russe franchit la frontière, lançant une offensive contre la Prusse orientale. La 1ère armée s'est déplacée à Koenigsberg depuis le nord des lacs de Mazurie, la 2ème armée - depuis l'ouest d'eux. La première semaine des actions des armées russes a été couronnée de succès, les Allemands, numériquement inférieurs, se sont progressivement retirés; La bataille Gumbinen-Goldap du 7 (20) août s'est terminée en faveur de l'armée russe. Cependant, le commandement russe n'a pas pu profiter des fruits de la victoire. Le mouvement des deux armées russes ralentit et dépareillé, ce qui ne tarde pas à profiter des Allemands, qui frappent de l'ouest sur le flanc ouvert de la 2e armée. Du 13 au 17 août (26-30) la 2e armée du général Samsonov est complètement vaincue, une partie importante est encerclée et faite prisonnière. Dans la tradition allemande, ces événements sont appelés la bataille de Tanneberg. Après cela, la 1ère armée russe, menacée d'encerclement par des forces allemandes supérieures, a été forcée de se replier sur sa position d'origine avec des batailles, le retrait a été achevé le 3 septembre (16). Les actions du général Rennenkampf, qui commandait la 1ère armée, ont été considérées comme infructueuses, ce qui a été le premier épisode de la méfiance ultérieure envers les chefs militaires portant des noms de famille allemands et, en général, de l'incrédulité quant à la capacité du commandement militaire. Dans la tradition allemande, les événements étaient mythifiés et considérés comme la plus grande victoire des armes allemandes ; un immense mémorial a été construit sur le site des batailles, dans lequel le maréchal Hindenburg a ensuite été enterré.
Bataille galicienne. Le 16 (23) août, la bataille de Galice a commencé - une énorme bataille en termes d'ampleur des forces engagées entre les troupes russes du front sud-ouest (5 armées) sous le commandement du général N. Ivanov et quatre armées austro-hongroises sous le commandement de l'archiduc Friedrich. Les troupes russes sont passées à l'offensive sur un large front (450-500 km), avec Lvov comme centre de l'offensive. Les combats de grandes armées, qui se sont déroulés sur un long front, ont été divisés en de nombreuses opérations indépendantes, accompagnées à la fois d'offensives et de retraites de part et d'autre.
Les actions sur la partie sud de la frontière avec l'Autriche se sont d'abord développées défavorablement pour l'armée russe (opération Lublin-Kholm). Les 19 et 20 août (1er et 2 septembre), les troupes russes se sont retirées sur le territoire du Royaume de Pologne, à Lublin et Kholm. Les actions au centre du front (opération Galych-Lvov) ont échoué pour les Austro-Hongrois. L'offensive russe débute le 6 (19) août et se développe très rapidement. Après la première retraite, l'armée austro-hongroise a opposé une résistance farouche aux frontières des rivières Golden Lipa et Rotten Lipa, mais a été forcée de battre en retraite. Les Russes ont pris Lvov le 21 août (3 septembre) et Galich le 22 août (4 septembre). Jusqu'au 31 août (12 septembre), les Austro-Hongrois n'ont cessé d'essayer de reprendre Lvov, les combats se sont poursuivis à 30-50 km à l'ouest et au nord-ouest de la ville (Gorodok - Rava-Russkaya), mais se sont soldés par une victoire complète pour l'armée russe. Le 29 août (11 septembre), la retraite générale de l'armée autrichienne a commencé (plus comme une fuite, car il y avait peu de résistance à l'avancée des Russes). L'armée russe a maintenu un rythme d'avance élevé et, dans les plus brefs délais, a capturé un immense territoire stratégiquement important - la Galice orientale et une partie de la Bucovine. Le 13 septembre (26 septembre), le front s'était stabilisé à une distance de 120 à 150 km à l'ouest de Lvov. La forte forteresse autrichienne de Przemysl était assiégée à l'arrière de l'armée russe.
La victoire importante a provoqué des réjouissances en Russie. La prise de la Galice, avec sa population slave majoritairement orthodoxe (et uniate), n'a pas été perçue en Russie comme une occupation, mais comme un retour de la partie déchirée de la Russie historique (voir Gouverneur général galicien). L'Autriche-Hongrie perdit confiance dans la force de son armée et ne risqua pas à l'avenir de lancer des opérations majeures sans l'aide des troupes allemandes.
Opérations militaires dans le Royaume de Pologne. La frontière d'avant-guerre de la Russie avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie avait une configuration loin d'être lisse - au centre de la frontière, le territoire du Royaume de Pologne dépassait fortement à l'ouest. Les deux camps ont apparemment commencé la guerre en essayant d'aplatir le front - les Russes essayaient d'aplanir les "bosses" en avançant vers le nord en Prusse orientale et vers le sud en Galice, tandis que l'Allemagne cherchait à supprimer le "rebord", avançant au centre vers Pologne. Après l'échec de l'offensive russe en Prusse-Orientale, l'Allemagne ne pouvait avancer que plus au sud, en Pologne, pour éviter que le front ne s'effondre en deux parties incohérentes. De plus, le succès de l'offensive dans le sud de la Pologne pourrait aider les Austro-Hongrois vaincus.
Le 15 (28) septembre, l'opération Varsovie-Ivangorod débute avec l'offensive allemande. L'offensive s'est déroulée dans une direction nord-est, visant Varsovie et la forteresse d'Ivangorod. Le 30 septembre (12 octobre), les Allemands atteignent Varsovie et atteignent la ligne de la Vistule. Des batailles féroces ont commencé, au cours desquelles l'avantage de l'armée russe a été progressivement déterminé. Le 7 (20) octobre, les Russes commencent à traverser la Vistule et le 14 (27) octobre, l'armée allemande entame une retraite générale. Le 26 octobre (8 novembre), les troupes allemandes, n'ayant pas obtenu de résultats, se sont retirées sur leurs positions d'origine.
Le 29 octobre (11 novembre), les Allemands, depuis les mêmes positions le long de la frontière d'avant-guerre, lancent une deuxième offensive dans la même direction nord-est (opération Lodz). Le centre de la bataille était la ville de Lodz, capturée et abandonnée par les Allemands quelques semaines plus tôt. Dans une bataille qui se déroule de manière dynamique, les Allemands ont d'abord encerclé Lodz, puis ils ont eux-mêmes été encerclés par des forces russes supérieures et se sont retirés. Les résultats des batailles étaient incertains - les Russes ont réussi à défendre à la fois Lodz et Varsovie; mais en même temps, l'Allemagne réussit à capturer la partie nord-ouest du Royaume de Pologne - le front, qui s'était stabilisé le 26 octobre (8 novembre), allait de Lodz à Varsovie.
Les positions des partis à la fin de 1914. Au nouvel an 1915, le front ressemblait à ceci - à la frontière de la Prusse orientale et de la Russie, le front longeait la frontière d'avant-guerre, suivi d'un vide mal rempli de troupes des deux côtés, après quoi un front stable recommença de Varsovie à Lodz (nord-est et est du royaume de Pologne avec Petrokov, Czestochowa et Kalisz était occupé par l'Allemagne), dans la région de Cracovie (restée derrière l'Autriche-Hongrie), le front traversait la frontière d'avant-guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Russie et pénétra dans le territoire autrichien occupé par les Russes. La majeure partie de la Galice est allée en Russie, Lvov (Lemberg) est tombé dans l'arrière profond (à 180 km du front). Au sud, le front reposait sur les Carpates, pratiquement inoccupées par les troupes des deux camps. Située à l'est des Carpates, la Bucovine avec Tchernivtsi passa à la Russie. La longueur totale du front était d'environ 1200 km.
Résultats de la campagne de 1914 sur le front russe. La campagne dans son ensemble s'est développée en faveur de la Russie. Les affrontements avec l'armée allemande se sont terminés en faveur des Allemands, et sur la partie allemande du front, la Russie a perdu une partie du territoire du Royaume de Pologne. La défaite de la Russie en Prusse orientale a été moralement douloureuse et s'est accompagnée de lourdes pertes. Mais l'Allemagne, elle aussi, n'a pu atteindre à aucun moment les résultats qu'elle avait prévus, tous ses succès d'un point de vue militaire ont été modestes. Pendant ce temps, la Russie a réussi à infliger une défaite majeure à l'Autriche-Hongrie et à capturer des territoires importants. Un certain schéma d'actions de l'armée russe s'est formé - les Allemands ont été traités avec prudence, les Austro-Hongrois étaient considérés comme un ennemi plus faible. L'Autriche-Hongrie est passée pour l'Allemagne d'un allié à part entière à un partenaire faible nécessitant un soutien continu. Au nouvel an 1915, les fronts s'étaient stabilisés et la guerre entrait dans une phase positionnelle; mais en même temps, la ligne de front (contrairement au théâtre d'opérations français) continuait à rester non lissée, et les armées des partis la remplissaient de manière inégale, avec de larges brèches. Cette inégalité l'année prochaine rendra les événements sur le front de l'Est beaucoup plus dynamiques que sur le front de l'Ouest. Au début de l'année, l'armée russe a commencé à ressentir les premiers signes d'une crise imminente dans l'approvisionnement en munitions. Il s'est également avéré que les soldats austro-hongrois étaient enclins à se rendre, contrairement aux soldats allemands.
Les pays de l'Entente ont pu coordonner leurs actions sur deux fronts - l'offensive russe en Prusse orientale a coïncidé avec le moment le plus difficile pour la France dans les combats, l'Allemagne a été obligée de se battre dans deux directions en même temps, ainsi que de transférer des troupes de d'avant en avant.
Théâtre d'opérations des Balkans
Sur le front serbe, les choses n'allaient pas bien pour les Autrichiens. Malgré la grande supériorité numérique, ils n'ont réussi à occuper Belgrade, qui était à la frontière, que le 2 décembre, mais le 15 décembre, les Serbes ont repris Belgrade et chassé les Autrichiens de leur territoire. Bien que les exigences de l'Autriche-Hongrie envers la Serbie aient été la cause directe de la guerre, c'est en Serbie que les hostilités de 1914 ont été plutôt molles.
L'entrée du Japon dans la guerre
En août 1914, les pays de l'Entente (surtout l'Angleterre) parviennent à convaincre le Japon de s'opposer à l'Allemagne, alors que ces deux pays n'ont pas de conflits d'intérêts significatifs. Le 15 août, le Japon présente un ultimatum à l'Allemagne, exigeant le retrait des troupes de Chine, et le 23 août, il déclare la guerre (voir Le Japon dans la Première Guerre mondiale). Fin août, l'armée japonaise entame le siège de Qingdao, la seule base navale allemande en Chine, qui se termine le 7 novembre par la reddition de la garnison allemande (voir Siège de Qingdao).
En septembre-octobre, le Japon a activement commencé à s'emparer des colonies insulaires et des bases de l'Allemagne (Micronésie allemande et Nouvelle-Guinée allemande. Le 12 septembre, les îles Caroline ont été capturées, le 29 septembre, les îles Marshall. En octobre, les Japonais ont débarqué sur les îles Caroline et capturé le port clé de Rabaul. À la fin En août, les troupes néo-zélandaises ont capturé les Samoa allemandes. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord avec le Japon sur la division des colonies allemandes, l'équateur a été adopté comme ligne de démarcation des intérêts Les forces allemandes dans la région étaient insignifiantes et nettement inférieures à celles des Japonais, de sorte que les combats ne s'accompagnaient pas de pertes importantes.
La participation du Japon à la guerre aux côtés de l'Entente s'est avérée extrêmement bénéfique pour la Russie, sécurisant complètement sa partie asiatique. La Russie n'avait plus besoin de dépenser des ressources pour entretenir l'armée, la marine et les fortifications dirigées contre le Japon et la Chine. En outre, le Japon est progressivement devenu une source importante d'approvisionnement de la Russie en matières premières et en armes.
Entrée en guerre de l'Empire ottoman et ouverture du théâtre d'opérations asiatique
Avec le déclenchement de la guerre en Turquie, il n'y avait pas d'accord sur l'opportunité d'entrer en guerre et de quel côté. Dans le triumvirat non officiel des Jeunes Turcs, le ministre de la Guerre Enver Pacha et le ministre de l'Intérieur Talaat Pacha étaient des partisans de la Triple Alliance, mais Djemal Pacha était un partisan de l'Entente. Le 2 août 1914, un traité d'alliance germano-turque est signé, selon lequel l'armée turque est effectivement placée sous la direction de la mission militaire allemande. La mobilisation a été annoncée dans le pays. Cependant, au même moment, le gouvernement turc a publié une déclaration de neutralité. Le 10 août, les croiseurs allemands Goeben et Breslau pénètrent dans les Dardanelles, ayant échappé à la poursuite de la flotte britannique en Méditerranée. Avec l'avènement de ces navires, non seulement l'armée turque, mais aussi la flotte étaient sous le commandement des Allemands. Le 9 septembre, le gouvernement turc a annoncé à toutes les puissances qu'il avait décidé d'abolir le régime des capitulations (statut juridique préférentiel des citoyens étrangers). Cela provoqua des protestations de toutes les puissances.
Cependant, la plupart des membres du gouvernement turc, y compris le Grand Vizir, s'opposaient toujours à la guerre. Puis Enver Pacha, avec le commandement allemand, a commencé la guerre sans le consentement du reste du gouvernement, mettant le pays devant le fait accompli. La Turquie a déclaré le "jihad" (guerre sainte) aux pays de l'Entente. Les 29 et 30 octobre (11 et 12 novembre), la flotte turque sous le commandement de l'amiral allemand Souchon a tiré sur Sébastopol, Odessa, Feodosia et Novorossiysk. Le 2 (15) novembre, la Russie déclare la guerre à la Turquie. L'Angleterre et la France ont suivi les 5 et 6 novembre.
Le Front du Caucase est né entre la Russie et la Turquie. En décembre 1914 - janvier 1915, lors de l'opération Sarykamysh, l'armée russe du Caucase stoppa l'avancée des troupes turques sur Kars, puis les vainquit et lança une contre-offensive (voir Front du Caucase).
L'utilité de la Turquie en tant qu'alliée était réduite par le fait que les puissances centrales n'avaient aucune communication avec elle ni par voie terrestre (entre la Turquie et l'Autriche-Hongrie se trouvait la Serbie non encore capturée et jusqu'ici neutre la Roumanie), ni par mer (la Méditerranée La mer était contrôlée par l'Entente).
Dans le même temps, la Russie a également perdu le moyen de communication le plus pratique avec ses alliés - à travers la mer Noire et le détroit. La Russie a encore deux ports adaptés au transport d'une grande quantité de marchandises - Arkhangelsk et Vladivostok ; la capacité de charge des chemins de fer à l'approche de ces ports était faible.
Combat en mer
Avec le déclenchement de la guerre, la flotte allemande a lancé des opérations de croisière dans tout l'océan mondial, ce qui n'a cependant pas entraîné de perturbation significative de la navigation marchande de ses adversaires. Néanmoins, une partie de la flotte des pays de l'Entente fut détournée pour combattre les pillards allemands. L'escadre allemande de l'amiral von Spee a réussi à vaincre l'escadre anglaise lors de la bataille du cap Coronel (Chili) le 1er novembre, mais plus tard, elle a elle-même été vaincue par les Britanniques lors de la bataille des Malouines le 8 décembre.
En mer du Nord, les flottes des parties adverses ont mené des opérations de raid. Le premier affrontement majeur a eu lieu le 28 août près de l'île d'Helgoland (bataille d'Helgoland). La flotte britannique a gagné.
Les flottes russes se sont comportées passivement. La flotte russe de la Baltique occupait une position défensive, à laquelle la flotte allemande, occupée par des opérations sur d'autres théâtres, ne s'est même pas approchée.La flotte de la mer Noire, qui n'avait pas de grands navires de type moderne, n'a pas osé entrer en collision avec le deux nouveaux navires germano-turcs.
Campagne de 1915
Le déroulement des hostilités
Théâtre d'Opérations Français - Front Ouest
Actions au début de 1915. Depuis le début de 1915, l'intensité des opérations sur le front occidental a considérablement diminué. L'Allemagne concentre ses forces sur la préparation des opérations contre la Russie. Les Français et les Britanniques ont également choisi de profiter de la pause qui en a résulté pour renforcer leurs forces. Pendant les quatre premiers mois de l'année, une accalmie presque totale régnait sur le front, les hostilités ne se déroulaient qu'en Artois, dans le secteur de la ville d'Arras (tentative d'offensive française en février) et au sud-est de Verdun, où les positions allemandes formaient la corniche dite de Ser-Miel vers la France (tentative d'offensive française en avril). En mars, les Britanniques ont tenté une offensive infructueuse près du village de Neuve Chapelle.
Les Allemands lancent à leur tour une contre-attaque au nord du front, en Flandre près d'Ypres, contre les troupes britanniques (22 avril - 25 mai, voir Seconde bataille d'Ypres). Dans le même temps, l'Allemagne, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et à la surprise totale des anglo-français, utilise des armes chimiques (le chlore est libéré des bouteilles). 15 000 personnes ont été touchées par le gaz, dont 5 000 sont décédées. Les Allemands ne disposaient pas de réserves suffisantes pour profiter du résultat de l'attaque au gaz et percer le front. Après l'attaque au gaz d'Ypres, les deux parties ont très rapidement réussi à développer des masques à gaz de différentes conceptions, et de nouvelles tentatives d'utilisation d'armes chimiques n'ont plus pris de grandes masses de troupes par surprise.
Au cours de ces hostilités, qui ont donné les résultats les plus insignifiants avec des pertes notables, les deux parties sont devenues convaincues que l'assaut sur des positions bien équipées (plusieurs lignes de tranchées, pirogues, clôtures de barbelés) était futile sans une préparation d'artillerie active.
Opération de printemps en Artois. Le 3 mai, l'Entente lance une nouvelle offensive en Artois. L'offensive a été menée par des forces conjointes anglo-françaises. Les Français avançaient au nord d'Arras, les Britanniques - dans une zone adjacente de la région de Neuve Chapelle. L'offensive est organisée d'une manière nouvelle : des forces énormes (30 divisions d'infanterie, 9 corps de cavalerie, plus de 1700 canons) sont concentrées sur 30 kilomètres du secteur offensif. L'offensive est précédée d'une préparation d'artillerie de six jours (2,1 millions d'obus sont utilisés) qui, comme prévu, va complètement écraser la résistance des troupes allemandes. Les calculs n'étaient pas justifiés. Les énormes pertes de l'Entente (130 000 personnes) subies en six semaines de combats ne correspondaient pas pleinement aux résultats obtenus - à la mi-juin, les Français avaient avancé de 3 à 4 km sur un front de 7 km, et les Britanniques - moins de 1 km sur un front de 3 km.
Opération d'automne en Champagne et Artois. Début septembre, l'Entente avait préparé une nouvelle grande offensive dont la tâche était de libérer le nord de la France. L'offensive débute le 25 septembre et se déroule simultanément sur deux secteurs distants de 120 km - sur le front de 35 km en Champagne (à l'est de Reims) et sur le front de 20 km en Artois (près d'Arras). En cas de succès, les troupes avançant des deux côtés devaient se refermer à 80-100 km sur la frontière de la France (près de Mons), ce qui conduirait à la libération de la Picardie. Par rapport à l'offensive de printemps en Artois, l'ampleur est augmentée : 67 divisions d'infanterie et de cavalerie participent à l'offensive, jusqu'à 2600 canons ; plus de 5 millions d'obus ont été tirés au cours de l'opération. Les troupes anglo-françaises ont utilisé les nouvelles tactiques offensives en plusieurs "vagues". Au moment de l'offensive, les troupes allemandes ont pu améliorer leurs positions défensives - à 5-6 kilomètres derrière la première ligne défensive, une deuxième ligne défensive a été aménagée, peu visible des positions ennemies (chacune des lignes défensives consistait, à son tour , de trois rangées de tranchées). L'offensive, qui a duré jusqu'au 7 octobre, a donné des résultats extrêmement limités - dans les deux secteurs, il n'a été possible de percer que la première ligne de la défense allemande et de ne pas reprendre plus de 2 à 3 km de territoire. Dans le même temps, les pertes des deux côtés étaient énormes - les Anglo-Français ont perdu 200 000 personnes tuées et blessées, les Allemands - 140 000 personnes.
Les positions des partis à la fin de 1915 et les résultats de la campagne. Pendant toute l'année 1915, le front n'a pratiquement pas bougé - le résultat de toutes les offensives féroces a été l'avancée de la ligne de front d'au plus 10 km. Les deux camps, renforçant de plus en plus leurs positions défensives, n'ont pas été en mesure de développer des tactiques permettant de percer le front, même dans les conditions d'une concentration extrêmement élevée de forces et de plusieurs jours de préparation d'artillerie. D'énormes sacrifices des deux côtés n'ont produit aucun résultat significatif. La situation a cependant permis à l'Allemagne d'intensifier l'assaut sur le front de l'Est - tout le renforcement de l'armée allemande visait à combattre la Russie, tandis que l'amélioration des lignes défensives et des tactiques de défense a permis aux Allemands d'avoir confiance dans la force de l'Ouest. Front avec une réduction progressive des troupes qui y participent.
Les actions du début de 1915 ont montré que le type d'hostilités en vigueur crée un énorme fardeau sur les économies des pays belligérants. De nouvelles batailles nécessitaient non seulement la mobilisation de millions de citoyens, mais aussi une quantité gigantesque d'armes et de munitions. Les stocks d'armes et de munitions d'avant-guerre étaient épuisés et les pays en guerre ont commencé à reconstruire activement leurs économies pour les besoins militaires. La guerre a progressivement commencé à se transformer d'une bataille d'armées en une bataille d'économies. Le développement de nouveaux équipements militaires s'est intensifié comme moyen de sortir de l'impasse du front ; les armées sont de plus en plus mécanisées. Les armées ont remarqué les avantages importants apportés par l'aviation (reconnaissance et réglage des tirs d'artillerie) et les voitures. Les méthodes de guerre des tranchées ont été améliorées - des canons de tranchée, des mortiers légers et des grenades à main sont apparus.
La France et la Russie ont de nouveau tenté de coordonner les actions de leurs armées - l'offensive de printemps en Artois était destinée à détourner les Allemands d'une offensive active contre les Russes. Le 7 juillet s'ouvre à Chantilly la première conférence interalliée visant à planifier des actions conjointes des alliés sur différents fronts et à organiser divers types d'assistance économique et militaire. Du 23 au 26 novembre, la deuxième conférence y a eu lieu. Il a été reconnu comme nécessaire de commencer les préparatifs d'une offensive coordonnée par toutes les armées alliées dans les trois théâtres principaux - français, russe et italien.
Théâtre d'opérations russe - Front de l'Est
Opération d'hiver en Prusse orientale. En février, l'armée russe a tenté une nouvelle fois d'attaquer la Prusse orientale, cette fois depuis le sud-est, depuis la Mazurie, depuis la ville de Suwalki. Mal préparée, dépourvue d'appui d'artillerie, l'offensive s'enlise aussitôt et se transforme en contre-attaque des troupes allemandes, opération dite d'August (du nom de la ville d'Augustow). Le 26 février, les Allemands ont réussi à repousser les troupes russes hors du territoire de la Prusse orientale et à pénétrer profondément dans le Royaume de Pologne sur 100 à 120 km, capturant Suwalki, après quoi le front s'est stabilisé dans la première quinzaine de mars, Grodno est resté avec la Russie. Le XXe corps russe a été encerclé et s'est rendu. Malgré la victoire des Allemands, leurs espoirs d'effondrement complet du front russe ne se sont pas réalisés. Au cours de la bataille suivante - l'opération Prasnysh (25 février - fin mars), les Allemands se sont heurtés à une résistance féroce des troupes russes, qui s'est transformée en contre-attaque dans la région de Prasnysh, ce qui a conduit au retrait des Allemands vers le pré -frontière de guerre de la Prusse orientale (la province de Suwalki est restée avec l'Allemagne).
Opération d'hiver dans les Carpates. Du 9 au 11 février, les troupes austro-allemandes lancent une offensive dans les Carpates, en appuyant particulièrement sur la partie la plus faible du front russe au sud, en Bucovine. Dans le même temps, l'armée russe lance une contre-offensive, espérant traverser les Carpates et envahir la Hongrie du nord au sud. Dans la partie nord des Carpates, plus près de Cracovie, les forces des adversaires se sont avérées égales et le front n'a pratiquement pas bougé pendant les combats de février et mars, restant dans les contreforts des Carpates du côté russe. Mais dans le sud des Carpates, l'armée russe n'a pas eu le temps de se regrouper et, fin mars, les Russes ont perdu la majeure partie de la Bucovine avec Tchernivtsi. Le 22 mars, la forteresse autrichienne assiégée de Przemysl est tombée, plus de 120 000 personnes se sont rendues. La prise de Przemysl fut le dernier grand succès de l'armée russe en 1915.
Percée de Gorlitsky. Le début de la Grande Retraite des armées russes est la perte de la Galice. Au milieu du printemps, la situation sur le front de Galice avait changé. Les Allemands ont élargi leur zone d'opérations en transférant leurs troupes dans la partie nord et centrale du front en Autriche-Hongrie, les Austro-Hongrois les plus faibles n'étant désormais responsables que de la partie sud du front. Sur un secteur de 35 km, les Allemands concentrent 32 divisions et 1 500 canons ; Les troupes russes étaient inférieures en nombre de 2 fois et étaient complètement privées d'artillerie lourde, et le manque d'obus du calibre principal (trois pouces) a commencé à affecter. Le 19 avril (2 mai), les troupes allemandes ont lancé une attaque contre le centre de la position russe en Autriche-Hongrie - Gorlitsa - visant le coup principal à Lvov. D'autres événements se sont développés défavorablement pour l'armée russe: la prédominance numérique des Allemands, les manœuvres infructueuses et l'utilisation de réserves, la pénurie croissante d'obus et la prédominance complète de l'artillerie lourde allemande ont conduit au fait que le 22 avril (5 mai) le front dans la région de Gorlitz a été percé. La retraite des armées russes qui avait commencé se poursuivit jusqu'au 9 (22) juin (voir La Grande Retraite de 1915). Tout le front au sud de Varsovie s'est déplacé vers la Russie. Dans le Royaume de Pologne, les provinces de Radom et de Kielce étaient laissées, le front passait par Lublin (au-delà de la Russie) ; la majeure partie de la Galice a été laissée des territoires de l'Autriche-Hongrie (le Przemysl nouvellement pris a été laissé le 3 juin (16) et Lvov le 9 juin (22), seule une petite bande (jusqu'à 40 km de profondeur) avec Brody est restée derrière les Russes, toute la région de Tarnopol et une petite partie de la Bucovine. La retraite, qui a commencé avec la percée des Allemands, au moment où Lvov a été abandonné, avait acquis un caractère planifié, les troupes russes se sont retirées dans un ordre relatif. Mais néanmoins, un échec militaire aussi majeur s'est accompagné d'une perte de moral de l'armée russe et de redditions massives.
La suite de la Grande Retraite des armées russes est la perte de la Pologne. Après avoir remporté le succès dans la partie sud du théâtre d'opérations, le commandement allemand a décidé de poursuivre immédiatement une offensive active dans sa partie nord - en Pologne et en Prusse orientale - la région d'Ostsee. Étant donné que la percée de Gorlitsky n'a finalement pas conduit à l'effondrement complet du front russe (les Russes ont pu stabiliser la situation et fermer le front au prix d'une retraite importante), cette fois, la tactique a été modifiée - elle n'était pas censée percer le front à un moment donné, mais trois offensives indépendantes. Deux directions de l'offensive visaient le Royaume de Pologne (où le front russe continuait à former un rebord vers l'Allemagne) - les Allemands prévoyaient des percées du front du nord, de la Prusse orientale (une percée au sud entre Varsovie et Lomza , dans la région de la rivière Narew), et du sud, des côtés de la Galice (au nord le long de l'interfluve de la Vistule et du Bug); dans le même temps, les directions des deux percées convergent vers la frontière du Royaume de Pologne, dans la région de Brest-Litovsk ; en cas d'exécution du plan allemand, les troupes russes devaient quitter toute la Pologne pour éviter l'encerclement dans la région de Varsovie. La troisième offensive, de la Prusse orientale vers Riga, était planifiée comme une offensive sur un large front, sans se concentrer sur un secteur étroit et sans percer.
L'offensive entre la Vistule et le Boug est lancée le 13 juin (26) et le 30 juin (13 juillet) débute l'opération Narew. Après de violents combats, le front est rompu aux deux endroits et l'armée russe, comme prévu par le plan allemand, entame un retrait général du Royaume de Pologne. Le 22 juillet (4 août), Varsovie et la forteresse d'Ivangorod sont abandonnées, le 7 (20) la forteresse de Novogeorgievsk tombe, le 9 (22) la forteresse d'Osovets, le 13 (26) les Russes quittent Brest-Litovsk, et le 19 août (2 septembre) - Grodno.
L'offensive de la Prusse orientale (l'opération Riga-Shavel) débute le 1er juillet (14). Pendant un mois de combats, les troupes russes sont repoussées au-delà du Neman, les Allemands s'emparent de la Courlande avec Mitava et la base navale la plus importante de Libava, Kovno, se rapproche de Riga.
Le succès de l'offensive allemande a été facilité par le fait qu'à l'été, la crise de l'approvisionnement militaire de l'armée russe avait atteint son maximum. La soi-disant "faim d'obus" était particulièrement importante - une pénurie aiguë d'obus pour les canons de 75 mm qui prévalaient dans l'armée russe. La prise de la forteresse de Novogeorgievsk, accompagnée de la reddition d'une grande partie des troupes et d'armes et de biens intacts sans combat, a provoqué une nouvelle flambée de manie d'espionnage et des rumeurs de trahison dans la société russe. Le Royaume de Pologne a donné à la Russie environ un quart de la production de charbon, la perte des gisements polonais n'a jamais été compensée, à partir de la fin de 1915, une crise du carburant a commencé en Russie.
La fin de la grande retraite et la stabilisation du front. Le 9 (22) août, les Allemands ont déplacé la direction de l'attaque principale; maintenant, l'offensive principale se déroulait le long du front au nord de Vilna, dans la région de Sventsyan, et était dirigée vers Minsk. Les 27 et 28 août (8 et 9 septembre), les Allemands, profitant de la position lâche des unités russes, ont pu percer le front (percée de Sventsyansky). Le résultat a été que les Russes n'ont pu remplir le front qu'après s'être retirés directement à Minsk. La province de Vilna a été perdue par les Russes.
Le 14 (27) décembre, les Russes lancent une offensive contre les troupes austro-hongroises sur la rivière Strypa, dans la région de Ternopil, provoquée par la nécessité de détourner les Autrichiens du front serbe, où la position des Serbes devient très difficile . Les tentatives d'attaque n'ont abouti à aucun succès et le 15 (29) janvier, l'opération a été arrêtée.
Pendant ce temps, la retraite des armées russes se poursuit au sud de la zone de percée de Sventsyansky. En août, Vladimir-Volynsky, Kovel, Lutsk et Pinsk sont abandonnés par les Russes. Sur la partie la plus méridionale du front, la situation était stable, car à ce moment-là, les forces des Austro-Hongrois étaient détournées par des combats en Serbie et sur le front italien. Fin septembre et début octobre, le front s'est stabilisé et il y a eu une accalmie sur toute sa longueur. Le potentiel offensif des Allemands étant épuisé, les Russes entreprennent de reconstituer leurs troupes, qui avaient été gravement endommagées lors de la retraite, et de renforcer de nouvelles lignes défensives.
Les positions des partis à la fin de 1915.À la fin de 1915, le front était devenu pratiquement une ligne droite reliant la mer Baltique et la mer Noire ; la saillie du front dans le Royaume de Pologne a complètement disparu - la Pologne était complètement occupée par l'Allemagne. La Courlande est occupée par l'Allemagne, le front se rapproche de Riga puis longe la Dvina occidentale jusqu'à la zone fortifiée de Dvinsk. Plus loin, le front passait le long du Territoire du Nord-Ouest: provinces de Kovno, Vilna, Grodno, la partie ouest de la province de Minsk était occupée par l'Allemagne (Minsk restait avec la Russie). Puis le front traversa le Territoire du Sud-Ouest : le tiers ouest de la province de Volyn avec Loutsk était occupé par l'Allemagne, Rivne resta avec la Russie. Après cela, le front s'est déplacé vers l'ancien territoire de l'Autriche-Hongrie, où les Russes ont quitté une partie de la région de Tarnopol en Galice. Plus loin, dans la province de Bessarabie, le front est revenu à la frontière d'avant-guerre avec l'Autriche-Hongrie et s'est terminé à la frontière avec la Roumanie neutre.
La nouvelle configuration du front, qui n'avait pas de rebords et était densément rempli de troupes des deux côtés, a naturellement poussé à une transition vers la guerre de position et les tactiques défensives.
Résultats de la campagne de 1915 sur le front de l'Est. Les résultats de la campagne de 1915 pour l'Allemagne à l'est étaient d'une certaine manière similaires à la campagne de 1914 à l'ouest : l'Allemagne a pu remporter des victoires militaires importantes et capturer le territoire ennemi, l'avantage tactique de l'Allemagne dans la guerre de manœuvre était évident ; mais en même temps, l'objectif général - la défaite complète de l'un des adversaires et son retrait de la guerre - n'a pas non plus été atteint en 1915. Tout en remportant des victoires tactiques, les puissances centrales n'ont pas été en mesure de vaincre complètement les principaux adversaires, tandis que leur économie était de plus en plus affaiblie. La Russie, malgré de lourdes pertes en territoire et en main-d'œuvre, a pleinement conservé la capacité de poursuivre la guerre (bien que son armée ait perdu son esprit offensif pendant la longue période de retraite). De plus, à la fin de la Grande Retraite, les Russes ont réussi à surmonter la crise de l'approvisionnement militaire et la situation de l'artillerie et des obus est revenue à la normale à la fin de l'année. Une lutte acharnée et de nombreuses pertes en vies humaines ont amené les économies de la Russie, de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie à une surcharge, dont les résultats négatifs seront de plus en plus perceptibles dans les années à venir.
Les échecs de la Russie se sont accompagnés d'importants changements de personnel. Le 30 juin (13 juillet), le ministre de la Guerre V. A. Sukhomlinov a été remplacé par A. A. Polivanov. Par la suite, Sukhomlinov a été jugé, ce qui a provoqué une nouvelle flambée de suspicion et de manie d'espionnage. Le 10 (23) août, Nicolas II a assumé les fonctions de commandant en chef de l'armée russe, déplaçant le grand-duc Nikolai Nikolayevich sur le front du Caucase. Dans le même temps, la direction effective des opérations militaires est passée de N. N. Yanushkevich à M. V. Alekseev. L'acceptation du commandement suprême par le tsar a entraîné des conséquences politiques intérieures extrêmement importantes.
L'entrée en guerre de l'Italie
Avec le déclenchement de la guerre, l'Italie est restée neutre. Le 3 août 1914, le roi d'Italie informa Guillaume II que les conditions du déclenchement de la guerre ne correspondaient pas aux conditions du traité de la Triple Alliance en vertu desquelles l'Italie devait entrer en guerre. Le même jour, le gouvernement italien a publié une déclaration de neutralité. Après de longues négociations entre l'Italie et les puissances centrales et les pays de l'Entente, le 26 avril 1915, le pacte de Londres a été conclu, selon lequel l'Italie s'engageait à déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie dans un délai d'un mois, et aussi à s'opposer à tous les ennemis de l'Entente. En "paiement du sang", l'Italie s'est vu promettre un certain nombre de territoires. L'Angleterre a accordé à l'Italie un prêt de 50 millions de livres. Malgré les propositions réciproques de territoires des puissances centrales qui s'ensuivent, sur fond de violents affrontements politiques internes entre opposants et partisans des deux blocs, le 23 mai, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie.
Théâtre d'opérations des Balkans, entrée en guerre de la Bulgarie
Jusqu'à l'automne, il n'y avait aucune activité sur le front serbe. Au début de l'automne, après l'achèvement d'une campagne réussie pour chasser les troupes russes de Galice et de Bucovine, les Austro-Hongrois et les Allemands ont pu transférer un grand nombre de troupes pour attaquer la Serbie. En même temps, on s'attendait à ce que la Bulgarie, impressionnée par les succès des puissances centrales, entende entrer en guerre à leurs côtés. Dans ce cas, une Serbie peu peuplée avec une petite armée se retrouverait entourée d'ennemis sur deux fronts et ferait face à une inévitable défaite militaire. L'aide anglo-française est arrivée très tard - ce n'est que le 5 octobre que les troupes ont commencé à débarquer à Thessalonique (Grèce); La Russie ne pouvait pas aider, car la Roumanie neutre refusait de laisser passer les troupes russes. Le 5 octobre, l'offensive des puissances centrales du côté de l'Autriche-Hongrie a commencé, le 14 octobre, la Bulgarie a déclaré la guerre aux pays de l'Entente et a commencé des opérations militaires contre la Serbie. Les troupes des Serbes, des Britanniques et des Français étaient numériquement inférieures aux forces des puissances centrales de plus de 2 fois et n'avaient aucune chance de succès.
Fin décembre, les troupes serbes ont quitté le territoire de la Serbie, partant pour l'Albanie, d'où en janvier 1916 leurs restes ont été évacués vers l'île de Corfou et Bizerte. En décembre, les troupes anglo-françaises se sont retirées sur le territoire grec, à Thessalonique, où elles ont pu prendre pied, formant le front de Thessalonique le long de la frontière de la Grèce avec la Bulgarie et la Serbie. Le personnel de l'armée serbe (jusqu'à 150 000 personnes) a été retenu et au printemps 1916, ils ont renforcé le front de Thessalonique.
L'adhésion de la Bulgarie aux puissances centrales et la chute de la Serbie ont ouvert une communication terrestre directe avec la Turquie pour les puissances centrales.
Opérations militaires dans les Dardanelles et sur la péninsule de Gallipoli
Au début de 1915, le commandement anglo-français avait mis au point une opération conjointe pour percer les Dardanelles et pénétrer dans la mer de Marmara, jusqu'à Constantinople. La tâche de l'opération était d'assurer la libre communication maritime à travers le détroit et de détourner les forces turques du front du Caucase.
Selon le plan initial, la percée devait être effectuée par la flotte britannique, qui devait détruire les batteries côtières sans débarquer. Après les premières attaques infructueuses en petites forces (19-25 février), la flotte britannique lance une attaque générale le 18 mars, qui implique plus de 20 cuirassés, croiseurs de guerre et cuirassés obsolètes. Après la perte de 3 navires, les Britanniques, n'ayant pas réussi, ont quitté le détroit.
Après cela, la tactique de l'Entente a changé - il a été décidé de débarquer des forces expéditionnaires sur la péninsule de Gallipoli (du côté européen du détroit) et sur la côte asiatique opposée. Le débarquement de l'Entente (80 000 personnes), composée de Britanniques, de Français, d'Australiens et de Néo-Zélandais, a commencé le débarquement le 25 avril. Les débarquements ont été effectués sur trois têtes de pont réparties entre les pays participants. Les assaillants n'ont réussi à tenir que dans l'une des sections de Gallipoli, où le Corps australo-néo-zélandais (ANZAC) a été parachuté. Des combats acharnés et le transfert de nouveaux renforts de l'Entente se sont poursuivis jusqu'à la mi-août, mais aucune des tentatives d'attaque contre les Turcs n'a donné de résultat significatif. À la fin du mois d'août, l'échec de l'opération est devenu évident et l'Entente a commencé à se préparer à l'évacuation progressive des troupes. Les dernières troupes de Gallipoli sont évacuées début janvier 1916. Le plan stratégique audacieux initié par Winston Churchill s'est soldé par un échec complet.
Sur le front du Caucase en juillet, les troupes russes repoussent l'offensive des troupes turques dans la zone du lac de Van, tout en perdant une partie du territoire (opération Alashkert). Les combats se sont étendus au territoire de la Perse. Le 30 octobre, les troupes russes ont débarqué dans le port d'Anzeli. Fin décembre, elles ont vaincu les groupes armés pro-turcs et pris le contrôle du territoire du nord de la Perse, empêchant la Perse de s'opposer à la Russie et sécurisant le flanc gauche de l'armée du Caucase. .
Campagne de 1916
N'ayant pas obtenu de succès décisif sur le front de l'Est lors de la campagne 1915 de l'année, le commandement allemand a décidé en 1916 de porter le coup principal à l'ouest et de retirer la France de la guerre. Il prévoyait de le couper par de puissantes frappes de flanc à la base de la corniche de Verdun, ceinturant tout le groupement ennemi de Verdun, et créant ainsi une énorme brèche dans les défenses alliées, à travers laquelle il devait alors frapper de flanc et à l'arrière de les armées centrales françaises et vaincre tout le front allié.
Le 21 février 1916, les troupes allemandes lancent une opération offensive dans le secteur de la forteresse de Verdun, appelée la bataille de Verdun. Après des combats acharnés avec d'énormes pertes des deux côtés, les Allemands ont réussi à avancer de 6 à 8 kilomètres et à prendre certains des forts de la forteresse, mais leur avance a été stoppée. Cette bataille dura jusqu'au 18 décembre 1916. Les Français et les Britanniques ont perdu 750 000 personnes, les Allemands - 450 000.
Lors de la bataille de Verdun, pour la première fois, une nouvelle arme a été utilisée par l'Allemagne - un lance-flammes. Dans le ciel de Verdun, pour la première fois dans l'histoire des guerres, les principes des opérations de combat aérien ont été élaborés - l'escadron américain Lafayette a combattu aux côtés des troupes de l'Entente. Les Allemands ont d'abord commencé à utiliser un avion de chasse dans lequel des mitrailleuses tiraient à travers une hélice en rotation sans l'endommager.
Le 3 juin 1916, une opération offensive majeure de l'armée russe a commencé, appelée la percée Brusilov après le commandant du front A. A. Brusilov. À la suite de l'opération offensive, le front sud-ouest a infligé une lourde défaite aux troupes allemandes et austro-hongroises en Galice et en Bucovine, dont les pertes totales se sont élevées à plus de 1,5 million de personnes. Dans le même temps, les opérations Naroch et Baranovichi des troupes russes se sont terminées sans succès.
En juin, la bataille de la Somme commence, qui dure jusqu'en novembre, au cours de laquelle des chars sont utilisés pour la première fois.
Sur le front du Caucase en janvier-février lors de la bataille d'Erzurum, les troupes russes ont complètement vaincu l'armée turque et capturé les villes d'Erzurum et de Trébizonde.
Les succès de l'armée russe ont incité la Roumanie à prendre le parti de l'Entente. Le 17 août 1916, un accord est conclu entre la Roumanie et les quatre puissances de l'Entente. La Roumanie a pris l'obligation de déclarer la guerre à l'Autriche-Hongrie. Pour cela, on lui a promis la Transylvanie, une partie de la Bucovine et du Banat. Le 28 août, la Roumanie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Cependant, à la fin de l'année, l'armée roumaine a été vaincue et la majeure partie du territoire du pays a été occupée.
La campagne militaire de 1916 est marquée par un événement important. Du 31 mai au 1er juin, la plus grande bataille navale du Jutland a eu lieu de toute la guerre.
Tous les événements décrits précédemment ont démontré la supériorité de l'Entente. À la fin de 1916, les deux parties ont perdu 6 millions de personnes tuées, environ 10 millions ont été blessées. En novembre-décembre 1916, l'Allemagne et ses alliés proposent la paix, mais l'Entente rejette la proposition, soulignant que la paix est impossible "jusqu'à la restauration des droits et libertés violés, la reconnaissance du principe des nationalités et la libre existence des petits États " est assuré.
Campagne de 1917
La position des puissances centrales à la 17e année est devenue catastrophique: il n'y avait plus de réserves pour l'armée, l'ampleur de la famine, la dévastation des transports et la crise du carburant ont augmenté. Les pays de l'Entente ont commencé à recevoir une aide importante des États-Unis (nourriture, biens industriels, puis renforts), tout en renforçant le blocus économique de l'Allemagne, et leur victoire, même sans opérations offensives, n'est devenue qu'une question de temps.
Néanmoins, lorsque, après la Révolution d'Octobre, le gouvernement bolchevique, arrivé au pouvoir sous le slogan de la fin de la guerre, a conclu une trêve avec l'Allemagne et ses alliés le 15 décembre, les dirigeants allemands avaient l'espoir d'une issue favorable de la guerre.
Front de l'Est
Du 1er au 20 février 1917, la conférence de Petrograd des pays de l'Entente a eu lieu, au cours de laquelle les plans de la campagne de 1917 et, officieusement, la situation politique interne en Russie ont été discutés.
En février 1917, l'effectif de l'armée russe, après une importante mobilisation, dépasse les 8 millions de personnes. Après la révolution de février en Russie, le gouvernement provisoire a préconisé la poursuite de la guerre, à laquelle s'opposaient les bolcheviks, dirigés par Lénine.
Le 6 avril, les États-Unis prennent le parti de l'Entente (après le soi-disant "télégramme Zimmermann"), ce qui change finalement le rapport de force en faveur de l'Entente, mais l'offensive qui débute en avril (l'Offensive Nivel) a échoué. Les opérations privées dans le secteur de la ville de Messines, sur la rivière Ypres, près de Verdun et à Cambrai, où les chars ont d'abord été massivement utilisés, n'ont pas changé la situation générale sur le front occidental.
Sur le front de l'Est, en raison de l'agitation défaitiste des bolcheviks et de la politique indécise du gouvernement provisoire, l'armée russe se décomposait et perdait en efficacité au combat. L'offensive lancée en juin par les forces du front sud-ouest échoue et les armées du front reculent de 50 à 100 km. Cependant, malgré le fait que l'armée russe avait perdu la capacité de se battre activement, les puissances centrales, qui ont subi d'énormes pertes lors de la campagne de 1916, n'ont pas pu profiter de l'occasion qui s'était créée pour infliger une défaite décisive à la Russie et la retirer de la guerre par des moyens militaires.
Sur le front de l'Est, l'armée allemande se limite à des opérations privées qui n'affectent en rien la position stratégique de l'Allemagne : à la suite de l'opération Albion, les troupes allemandes capturent les îles de Dago et Ezel et forcent la flotte russe à partir. le golfe de Riga.
Sur le front italien en octobre-novembre, l'armée austro-hongroise inflige une défaite majeure à l'armée italienne à Caporetto et avance de 100 à 150 km en territoire italien, atteignant les abords de Venise. Ce n'est qu'avec l'aide des troupes britanniques et françaises transférées en Italie qu'il a été possible d'arrêter l'offensive autrichienne.
En 1917, un calme relatif s'installe sur le front de Thessalonique. En avril 1917, les forces alliées (qui se composaient de troupes britanniques, françaises, serbes, italiennes et russes) menèrent une opération offensive qui apporta peu de résultats tactiques aux troupes de l'Entente. Cependant, cette offensive ne pouvait pas changer la situation sur le front de Thessalonique.
En raison de l'hiver extrêmement rigoureux de 1916-1917, l'armée russe du Caucase n'a pas mené d'opérations actives dans les montagnes. Afin de ne pas subir de pertes inutiles dues au gel et aux maladies, Yudenich n'a laissé que des avant-postes militaires sur les lignes atteintes et a déployé les forces principales dans les vallées des colonies. Début mars, le 1st Caucasian Cavalry Corps, Gen. Baratov a vaincu le groupement persan des Turcs et, après avoir capturé l'important carrefour routier Sinnakh (Senandej) et la ville de Kermanshah en Perse, s'est déplacé vers le sud-ouest vers l'Euphrate en direction des Britanniques. A la mi-mars, des unités de la 1re division cosaque du Caucase de Raddatz et de la 3e division du Kouban, ayant parcouru plus de 400 km, rejoignent les alliés à Kizyl Rabat (Irak). La Turquie a perdu la Mésopotamie.
Après la révolution de février, les hostilités actives de l'armée russe sur le front turc n'ont pas été menées, et après la conclusion du gouvernement bolchevique en décembre 1917, la trêve avec les pays de la Quadruple Union a complètement cessé.
Sur le front mésopotamien, les troupes britanniques en 1917 ont remporté des succès significatifs. Après avoir augmenté le nombre de troupes à 55 000 personnes, l'armée britannique a lancé une offensive décisive en Mésopotamie. Les Britanniques ont capturé un certain nombre de villes importantes: El Kut (janvier), Bagdad (mars), etc. Des volontaires de la population arabe ont combattu aux côtés des troupes britanniques, qui ont rencontré l'avancée des troupes britanniques en tant que libérateurs. De plus, au début de 1917, les troupes britanniques ont envahi la Palestine, où de féroces batailles ont commencé près de Gaza. En octobre, après avoir porté le nombre de leurs troupes à 90 000 personnes, les Britanniques ont lancé une offensive décisive près de Gaza et les Turcs ont été contraints de battre en retraite. À la fin de 1917, les Britanniques ont capturé un certain nombre de colonies : Jaffa, Jérusalem et Jéricho.
En Afrique de l'Est, les troupes coloniales allemandes sous le commandement du colonel Lettov-Vorbeck, nettement plus nombreuses que l'ennemi, offrent une résistance prolongée et en novembre 1917, sous la pression des troupes anglo-portugaises-belges, envahissent le territoire de la colonie portugaise de Mozambique.
Efforts diplomatiques
Le 19 juillet 1917, le Reichstag allemand adopte une résolution sur la nécessité d'une paix d'un commun accord et sans annexions. Mais cette résolution n'a pas rencontré de réponse sympathique de la part des gouvernements britannique, français et américain. En août 1917, le pape Benoît XV propose sa médiation pour conclure la paix. Cependant, les gouvernements de l'Entente ont également rejeté la proposition papale, l'Allemagne refusant obstinément de donner son consentement sans équivoque à la restauration de l'indépendance belge.
Campagne de 1918
Victoires décisives de l'Entente
Après la conclusion des traités de paix avec la République populaire ukrainienne (ukr. Le monde Beresteysky), la Russie soviétique et la Roumanie et la liquidation du front de l'Est, l'Allemagne a pu concentrer la quasi-totalité de ses forces sur le front de l'Ouest et tenter d'infliger une défaite décisive aux troupes anglo-françaises avant l'arrivée des principales forces de l'armée américaine devant.
En mars-juillet, l'armée allemande lança une puissante offensive en Picardie, en Flandre, sur l'Aisne et la Marne, et au cours de violents combats avança de 40 à 70 km, mais ne put ni vaincre l'ennemi ni percer le front. Les ressources humaines et matérielles limitées de l'Allemagne ont été épuisées pendant les années de guerre. De plus, après avoir occupé les vastes territoires de l'ancien Empire russe après la signature du traité de Brest-Litovsk, le commandement allemand a été contraint de laisser de grandes forces à l'est afin d'en garder le contrôle, ce qui a eu un impact négatif sur cours des hostilités contre l'Entente. Le général Kuhl, chef d'état-major du groupe d'armées du prince Ruprecht, évalue le nombre de soldats allemands sur le front occidental à environ 3,6 millions ; sur le front de l'Est, y compris la Roumanie et à l'exclusion de la Turquie, il y avait environ 1 million de personnes.
En mai, les troupes américaines ont commencé à opérer sur le front. En juillet-août a lieu la deuxième bataille de la Marne qui marque le début de la contre-offensive de l'Entente. Fin septembre, les troupes de l'Entente, au cours d'une série d'opérations, ont liquidé les résultats de la précédente offensive allemande. Au cours d'une nouvelle offensive générale en octobre et début novembre, la majeure partie du territoire français occupé et une partie du territoire belge sont libérés.
Sur le théâtre italien fin octobre, les troupes italiennes battent l'armée austro-hongroise à Vittorio Veneto et libèrent le territoire italien capturé par l'ennemi l'année précédente.
Sur le théâtre balkanique, l'offensive de l'Entente débute le 15 septembre. Le 1er novembre, les troupes de l'Entente ont libéré le territoire de la Serbie, de l'Albanie, du Monténégro, sont entrées sur le territoire de la Bulgarie après la trêve et ont envahi le territoire de l'Autriche-Hongrie.
La Bulgarie a signé une trêve avec l'Entente le 29 septembre, la Turquie le 30 octobre, l'Autriche-Hongrie le 3 novembre et l'Allemagne le 11 novembre.
Autres théâtres de guerre
Il y eut une accalmie sur le front mésopotamien tout au long de 1918, les combats s'y terminèrent le 14 novembre, lorsque l'armée britannique, ne rencontrant pas la résistance des troupes turques, occupa Mossoul. En Palestine aussi, il y a eu une accalmie, les yeux des parties étant tournés vers des théâtres de guerre plus importants. A l'automne 1918, l'armée britannique lance une offensive et occupe Nazareth, l'armée turque est encerclée et vaincue. Après avoir capturé la Palestine, les Britanniques ont envahi la Syrie. Les combats ici ont pris fin le 30 octobre.
En Afrique, les troupes allemandes, pressées par des forces ennemies supérieures, continuent de résister. Quittant le Mozambique, les Allemands envahissent le territoire de la colonie anglaise de Rhodésie du Nord. Ce n'est que lorsque les Allemands ont appris la défaite de l'Allemagne dans la guerre que les troupes coloniales (qui ne comptaient que 1 400 hommes) ont déposé les armes.
Les résultats de la guerre
Résultats politiques
En 1919, les Allemands ont été contraints de signer le Traité de Versailles, qui a été rédigé par les États victorieux lors de la Conférence de paix de Paris.
Traités de paix avec
- Allemagne (Traité de Versailles (1919))
- Autriche (Traité de Saint-Germain (1919))
- Bulgarie (Traité de Neuilly (1919))
- Hongrie (Traité de paix de Trianon (1920))
- Turquie (Traité de paix de Sèvres (1920)).
Les résultats de la Première Guerre mondiale furent les révolutions de février et d'octobre en Russie et la révolution de novembre en Allemagne, la liquidation de trois empires : les empires russe, ottoman et austro-hongrois, ces deux derniers étant divisés. L'Allemagne, ayant cessé d'être une monarchie, a été abattue territorialement et économiquement affaiblie. La guerre civile a commencé en Russie, du 6 au 16 juillet 1918, les socialistes-révolutionnaires de gauche (partisans de la participation continue de la Russie à la guerre) ont organisé l'assassinat de l'ambassadeur allemand, le comte Wilhelm von Mirbach à Moscou et de la famille royale à Ekaterinbourg, avec le but de perturber le traité de Brest-Litovsk entre la Russie soviétique et l'Allemagne Kaiser. Les Allemands après la révolution de février, malgré la guerre avec la Russie, s'inquiétaient du sort de la famille impériale russe, car l'épouse de Nicolas II, Alexandra Feodorovna, était allemande et leurs filles étaient à la fois des princesses russes et des princesses allemandes. Les États-Unis sont devenus une grande puissance. Les conditions difficiles pour l'Allemagne du traité de Versailles (paiement des réparations, etc.) et l'humiliation nationale dont elle a été victime ont suscité des sentiments revanchards, qui sont devenus l'une des conditions préalables à l'arrivée des nazis au pouvoir et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. .
Changements territoriaux
À la suite de la guerre, il y a eu : l'annexion par l'Angleterre de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud-Ouest, de l'Irak et de la Palestine, de certaines parties du Togo et du Cameroun ; Belgique - Burundi, Rwanda et Ouganda ; Grèce - Thrace orientale ; Danemark - Nord du Schleswig ; Italie - Tyrol du Sud et Istrie ; Roumanie - Transylvanie et Dobroudja méridionale ; France - Alsace-Lorraine, Syrie, certaines parties du Togo et du Cameroun ; Japon - les îles allemandes de l'océan Pacifique au nord de l'équateur ; Occupation française de la Sarre.
L'indépendance de la République populaire de Biélorussie, de la République populaire d'Ukraine, de la Hongrie, de Dantzig, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Finlande et de la Yougoslavie a été proclamée.
La République d'Autriche est fondée. L'Empire allemand est devenu une république de facto.
La région du Rhin et le détroit de la mer Noire sont démilitarisés.
Totaux militaires
La Première Guerre mondiale a stimulé le développement de nouvelles armes et moyens de combat. Des chars, des armes chimiques, des masques à gaz, des canons antiaériens et antichars ont été utilisés pour la première fois. Les avions, les mitrailleuses, les mortiers, les sous-marins et les torpilleurs étaient largement utilisés. La puissance de feu des troupes a fortement augmenté. De nouveaux types d'artillerie apparaissent : anti-aériens, anti-chars, escortes d'infanterie. L'aviation est devenue une branche indépendante de l'armée, qui a commencé à être subdivisée en reconnaissance, chasseur et bombardier. Il y avait des troupes de chars, des troupes chimiques, des troupes de défense aérienne, de l'aviation navale. Le rôle des troupes du génie a augmenté et le rôle de la cavalerie a diminué. Apparaissent également des «tactiques de tranchées» de guerre afin d'épuiser l'ennemi et d'épuiser son économie, travaillant sur ordre militaire.
Résultats économiques
L'ampleur grandiose et la nature prolongée de la Première Guerre mondiale ont conduit à une militarisation sans précédent de l'économie des États industrialisés. Cela a eu un impact sur le cours du développement économique de tous les grands États industriels dans la période entre les deux guerres mondiales : renforcement de la régulation étatique et de la planification économique, formation de complexes militaro-industriels, accélération du développement des infrastructures économiques nationales (systèmes énergétiques, un réseau de routes revêtues, etc.) , croissance de la part de la production de produits de défense et de produits à double usage.
Opinions des contemporains
|
L'humanité n'a jamais été dans une telle position auparavant. Sans atteindre un niveau de vertu beaucoup plus élevé et sans beaucoup de conseils plus sages, les gens ont pour la première fois mis la main sur de tels outils avec lesquels ils peuvent détruire toute l'humanité sans faute. Tel est l'accomplissement de toute leur histoire glorieuse, de tous les travaux glorieux des générations précédentes. Et les gens s'en tireront bien s'ils s'arrêtent et réfléchissent à cette nouvelle responsabilité qui leur incombe. La mort est en alerte, obéissante, en attente, prête à servir, prête à balayer tous les peuples « en masse », prête, s'il le faut, à pulvériser, sans espoir de renaissance, tout ce qui reste de civilisation. Elle attend juste un mot d'ordre. Elle attend ce mot de la créature frêle et apeurée, qui a longtemps été sa victime et qui est maintenant devenue son maître pour la seule fois. Churchill |
Churchill sur la Russie pendant la Première Guerre mondiale :
Pertes pendant la Première Guerre mondiale
Les pertes des forces armées de toutes les puissances participant à la guerre mondiale se sont élevées à environ 10 millions de personnes. Jusqu'à présent, il n'y a pas de données généralisées sur les pertes de la population civile dues à l'impact des armes militaires. La famine et les épidémies provoquées par la guerre ont causé la mort d'au moins 20 millions de personnes.
Mémoire de guerre
France, Royaume-Uni, Pologne
Jour de l'Armistice (Fr. jour de l'armistice) 1918 (11 novembre) est une fête nationale en Belgique et en France, célébrée chaque année. Jour de l'armistice en Angleterre armisticejournée) est célébré le dimanche le plus proche du 11 novembre en tant que dimanche du Souvenir. Ce jour-là, les morts de la Première et de la Seconde Guerre mondiale sont commémorés.
Dans les premières années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale, chaque commune de France a érigé un monument aux soldats tombés au combat. En 1921, le monument principal est apparu - la Tombe du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris.
Le principal monument britannique à ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale est le cénotaphe (cénotaphe grec - "cercueil vide") à Londres sur Whitehall Street, un monument au soldat inconnu. Il a été construit en 1919 à l'occasion du premier anniversaire de la fin de la guerre. Le deuxième dimanche de chaque mois de novembre, le cénotaphe devient le centre du Memorial Day national. Une semaine avant, des millions de Britanniques portaient sur la poitrine de petits coquelicots en plastique, achetés auprès d'un fonds caritatif spécial pour les vétérans et les veuves de militaires. A 23 heures dimanche, la reine, les ministres, les généraux, les évêques et les ambassadeurs déposent des couronnes de coquelicots au cénotaphe, et tout le pays s'arrête pour deux minutes de silence.
La tombe du soldat inconnu à Varsovie a également été construite à l'origine en 1925 à la mémoire de ceux qui sont tombés sur les champs de la Première Guerre mondiale. Maintenant, ce monument est un monument à ceux qui sont tombés amoureux de la patrie au fil des années.
La Russie et l'émigration russe
La Russie n'a pas de jour officiel de commémoration pour ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, malgré le fait que les pertes de la Russie dans cette guerre étaient les plus importantes de tous les pays qui y ont participé.
Selon le plan de l'empereur Nicolas II, Tsarskoe Selo devait devenir un lieu spécial de mémoire de la guerre. La Chambre Militaire du Souverain fondée en 1913 allait devenir le Musée de la Grande Guerre. Par ordre de l'empereur, une zone spéciale a été attribuée à l'enterrement des fonctionnaires décédés et décédés de la garnison de Tsarskoïe Selo. Ce site est devenu connu sous le nom de "Cimetière des héros". Au début de 1915, le "Cimetière des Héros" prend le nom de Premier Cimetière Fraternel. Le 18 août 1915, une église temporaire en bois est érigée sur son territoire en l'honneur de l'icône de la Mère de Dieu "Apaisez mes douleurs" pour les funérailles des morts et des blessés. Après la fin de la guerre, au lieu d'une église temporaire en bois, il était censé ériger un temple - un monument de la Grande Guerre, conçu par l'architecte S. N. Antonov.
Cependant, ces plans n'étaient pas destinés à se réaliser. En 1918, le Musée national de la guerre de 1914-1918 a été créé dans le bâtiment de la Chambre militaire, mais déjà en 1919, il a été supprimé et ses expositions ont reconstitué les fonds d'autres musées et dépôts. En 1938, l'église temporaire en bois du cimetière fraternel est démantelée et un terrain vague recouvert d'herbe reste des tombes des soldats.
Le 16 juin 1916, un monument aux héros de la "Seconde Guerre patriotique" a été dévoilé à Viazma. Dans les années 1920, ce monument a été détruit.
Le 11 novembre 2008, une stèle commémorative (croix) dédiée aux héros de la Première Guerre mondiale a été installée sur le territoire du cimetière fraternel de la ville de Pouchkine.
Toujours à Moscou, le 1er août 2004, à l'occasion du 90e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, sur le site du cimetière fraternel de la ville de Moscou dans le quartier de Sokol, des panneaux commémoratifs ont été placés «Aux morts dans le Guerre mondiale de 1914-1918 », « Sœurs russes de la miséricorde », « Aviateurs russes enterrés au cimetière fraternel de la ville de Moscou.
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
(28 juillet 1914 - 11 novembre 1918), le premier conflit militaire à l'échelle mondiale, dans lequel 38 des 59 États indépendants qui existaient à l'époque étaient impliqués. Environ 73,5 millions de personnes ont été mobilisées ; 9,5 millions d'entre eux ont été tués et sont morts des suites de blessures, plus de 20 millions ont été blessés, 3,5 millions sont restés infirmes.
Raisons principales. La recherche des causes de la guerre mène à 1871, lorsque le processus d'unification de l'Allemagne est achevé et que l'hégémonie de la Prusse est consolidée dans l'Empire allemand. Sous le chancelier O. von Bismarck, qui cherchait à faire revivre le système des alliances, la politique étrangère du gouvernement allemand était déterminée par le désir d'atteindre la position dominante de l'Allemagne en Europe. Pour priver la France de la possibilité de venger la défaite de la guerre franco-prussienne, Bismarck tente de lier la Russie et l'Autriche-Hongrie à l'Allemagne par des accords secrets (1873). Cependant, la Russie a apporté son soutien à la France et l'Union des Trois Empereurs s'est effondrée. En 1882, Bismarck renforce les positions de l'Allemagne en créant l'Alliance tripartite, qui unit l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Allemagne. En 1890, l'Allemagne s'est imposée dans la diplomatie européenne. La France est sortie de l'isolement diplomatique en 1891-1893. Profitant du refroidissement des relations entre la Russie et l'Allemagne, ainsi que du besoin de la Russie de nouveaux capitaux, elle conclut une convention militaire et un traité d'alliance avec la Russie. L'alliance russo-française devait servir de contrepoids à la Triple Alliance. La Grande-Bretagne s'est jusqu'ici tenue à l'écart des rivalités sur le continent, mais la pression des circonstances politiques et économiques l'a finalement forcée à faire son choix. Les Britanniques ne pouvaient qu'être troublés par les sentiments nationalistes qui prévalaient en Allemagne, sa politique coloniale agressive, son expansion industrielle rapide et, surtout, la montée en puissance de la marine. Une série de manœuvres diplomatiques relativement rapides a conduit à l'élimination des différences dans les positions de la France et de la Grande-Bretagne et à la conclusion en 1904 de la soi-disant. "consentement cordial" (Entente cordiale). Les obstacles à la coopération anglo-russe ont été surmontés et, en 1907, un accord anglo-russe a été conclu. La Russie est devenue membre de l'Entente. La Grande-Bretagne, la France et la Russie ont formé une alliance Triple Entente (Triple Entente) par opposition à la Triple Alliance. Ainsi se dessine la division de l'Europe en deux camps armés. L'une des causes de la guerre était le renforcement généralisé des sentiments nationalistes. En formulant leurs intérêts, les milieux dirigeants de chacun des pays européens ont cherché à les présenter comme des aspirations populaires. La France a élaboré des plans pour le retour des territoires perdus de l'Alsace et de la Lorraine. L'Italie, même alliée à l'Autriche-Hongrie, rêvait de rendre ses terres au Trentin, Trieste et Fiume. Les Polonais ont vu dans la guerre une opportunité de recréer l'État détruit par les divisions du XVIIIe siècle. De nombreux peuples qui habitaient l'Autriche-Hongrie aspiraient à l'indépendance nationale. La Russie était convaincue qu'elle ne pouvait se développer sans limiter la concurrence allemande, protéger les Slaves de l'Autriche-Hongrie et étendre son influence dans les Balkans. À Berlin, l'avenir était associé à la défaite de la France et de la Grande-Bretagne et à l'unification des pays d'Europe centrale sous la direction de l'Allemagne. À Londres, on croyait que le peuple britannique ne vivrait en paix qu'en écrasant l'ennemi principal - l'Allemagne. La tension dans les relations internationales est exacerbée par une série de crises diplomatiques - l'affrontement franco-allemand au Maroc en 1905-1906 ; l'annexion autrichienne de la Bosnie-Herzégovine en 1908-1909 ; enfin, les guerres balkaniques de 1912-1913. La Grande-Bretagne et la France ont soutenu les intérêts de l'Italie en Afrique du Nord et ont ainsi tellement affaibli son engagement envers la Triple Alliance que l'Allemagne ne pouvait guère compter sur l'Italie comme alliée dans une guerre future.
Crise de juillet et début de la guerre. Après les guerres balkaniques, une propagande nationaliste active est lancée contre la monarchie austro-hongroise. Un groupe de Serbes, membres de l'organisation conspiratrice "Jeune Bosnie", a décidé de tuer l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François-Ferdinand. L'occasion s'en présenta quand lui et sa femme se rendirent en Bosnie pour suivre les enseignements des troupes austro-hongroises. Franz Ferdinand a été tué dans la ville de Sarajevo par Gavrilo Princip le 28 juin 1914. Dans l'intention de déclencher une guerre contre la Serbie, l'Autriche-Hongrie a obtenu le soutien de l'Allemagne. Ces derniers estimaient que la guerre prendrait un caractère local si la Russie ne défendait pas la Serbie. Mais si elle aide la Serbie, alors l'Allemagne sera prête à remplir ses obligations conventionnelles et à soutenir l'Autriche-Hongrie. Dans un ultimatum présenté à la Serbie le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie a exigé que ses formations militaires soient autorisées à entrer sur le territoire serbe afin d'empêcher des actions hostiles avec les forces serbes. La réponse à l'ultimatum a été donnée dans le délai convenu de 48 heures, mais elle n'a pas satisfait l'Autriche-Hongrie et, le 28 juillet, elle a déclaré la guerre à la Serbie. SD Sazonov, ministre des Affaires étrangères de Russie, s'est ouvertement prononcé contre l'Autriche-Hongrie, après avoir reçu des assurances de soutien du président français R. Poincaré. Le 30 juillet, la Russie annonce une mobilisation générale ; L'Allemagne profita de cette occasion pour déclarer la guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août. La position de la Grande-Bretagne est restée incertaine en raison de ses obligations conventionnelles de protéger la neutralité belge. En 1839, puis pendant la guerre franco-prussienne, la Grande-Bretagne, la Prusse et la France ont fourni à ce pays des garanties collectives de neutralité. Après l'invasion de la Belgique par les Allemands le 4 août, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Maintenant, toutes les grandes puissances d'Europe étaient entraînées dans la guerre. Avec eux, leurs dominions et colonies ont été impliqués dans la guerre. La guerre peut être divisée en trois périodes. Au cours de la première période (1914-1916), les puissances centrales ont atteint la supériorité sur terre, tandis que les Alliés dominaient la mer. La situation semblait être une impasse. Cette période s'est terminée par des négociations sur une paix mutuellement acceptable, mais chaque partie espérait toujours la victoire. Dans la période suivante (1917), deux événements se produisirent qui conduisirent à un déséquilibre des forces : le premier fut l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Entente, le second fut la révolution en Russie et sa sortie du guerre. La troisième période (1918) a commencé avec la dernière avancée majeure des puissances centrales à l'ouest. L'échec de cette offensive fut suivi de révolutions en Autriche-Hongrie et en Allemagne et de la reddition des puissances centrales.
Première période. Les forces alliées comprenaient initialement la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Serbie, le Monténégro et la Belgique et jouissaient d'une supériorité navale écrasante. L'Entente avait 316 croiseurs, tandis que les Allemands et les Autrichiens en avaient 62. Mais ces derniers ont trouvé une contre-mesure puissante - les sous-marins. Au début de la guerre, les armées des puissances centrales comptaient 6,1 millions de personnes ; Armée de l'Entente - 10,1 millions de personnes. Les puissances centrales avaient un avantage dans les communications internes, ce qui leur permettait de transférer rapidement des troupes et du matériel d'un front à l'autre. A long terme, les pays de l'Entente disposaient de ressources supérieures en matières premières et en nourriture, d'autant plus que la flotte britannique paralysait les relations de l'Allemagne avec les pays d'outre-mer, d'où avant la guerre les entreprises allemandes recevaient du cuivre, de l'étain et du nickel. Ainsi, en cas de guerre prolongée, l'Entente pouvait compter sur la victoire. L'Allemagne, sachant cela, s'est appuyée sur une guerre éclair - la "blitzkrieg". Les Allemands mettent en œuvre le plan Schlieffen, censé assurer un succès rapide à l'Ouest avec une large offensive contre la France via la Belgique. Après la défaite de la France, l'Allemagne espérait, avec l'Autriche-Hongrie, en transférant les troupes libérées, porter un coup décisif à l'Est. Mais ce plan n'a pas été exécuté. L'une des principales raisons de son échec est l'envoi d'une partie des divisions allemandes en Lorraine afin de bloquer l'invasion ennemie du sud de l'Allemagne. Dans la nuit du 4 août, les Allemands envahissent le territoire belge. Il leur fallut plusieurs jours pour briser la résistance des défenseurs des places fortes de Namur et de Liège, qui barraient la route vers Bruxelles, mais grâce à ce retard, les Britanniques transportèrent près de 90 000 corps expéditionnaires à travers la Manche vers la France (9 août -17). Les Français, en revanche, gagnent du temps pour former 5 armées qui freinent l'avance allemande. Néanmoins, le 20 août, l'armée allemande occupe Bruxelles, puis contraint les Britanniques à quitter Mons (23 août), et le 3 septembre, l'armée du général A. von Kluk est à 40 km de Paris. Poursuivant l'offensive, les Allemands traversent la Marne et le 5 septembre s'arrêtent le long de la ligne Paris-Verdun. Le commandant des forces françaises, le général J. Joffre, ayant formé deux nouvelles armées à partir des réserves, décide de passer à la contre-offensive. La première bataille sur la Marne débute le 5 et se termine le 12 septembre. Il a été suivi par 6 armées anglo-françaises et 5 armées allemandes. Les Allemands sont vaincus. L'une des raisons de leur défaite était l'absence de plusieurs divisions sur le flanc droit, qui devaient être transférées sur le front oriental. L'avancée française sur le flanc droit affaibli rendait inévitable la retraite des armées allemandes vers le nord jusqu'à la ligne de l'Aisne. Les batailles en Flandre sur les rivières Yser et Ypres du 15 octobre au 20 novembre ont également échoué pour les Allemands. De ce fait, les principaux ports de la Manche restent aux mains des Alliés, qui assurent la communication entre la France et l'Angleterre. Paris est sauvé et les pays de l'Entente ont le temps de mobiliser des ressources. La guerre à l'ouest a pris un caractère positionnel; les espoirs de l'Allemagne de vaincre et de retirer la France de la guerre se sont avérés intenables. L'opposition a suivi une ligne allant au sud de Newport et Ypres en Belgique à Compiègne et Soissons, puis à l'est autour de Verdun et au sud jusqu'au saillant près de Saint-Miyel, puis au sud-est jusqu'à la frontière suisse. Le long de cette ligne de tranchées et de barbelés, env. La guerre des tranchées de 970 km a duré quatre ans. Jusqu'en mars 1918, tous les changements, même mineurs, de la ligne de front étaient réalisés au prix d'énormes pertes des deux côtés. L'espoir subsistait que sur le front de l'Est, les Russes seraient en mesure d'écraser les armées du bloc des puissances centrales. Le 17 août, les troupes russes entrent en Prusse orientale et commencent à repousser les Allemands vers Koenigsberg. Les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff sont chargés de diriger la contre-offensive. Profitant des erreurs du commandement russe, les Allemands parviennent à creuser un "coin" entre les deux armées russes, les battent du 26 au 30 août près de Tannenberg et les chassent de la Prusse orientale. L'Autriche-Hongrie n'a pas agi avec autant de succès, abandonnant l'intention de vaincre rapidement la Serbie et concentrant de grandes forces entre la Vistule et le Dniestr. Mais les Russes lancèrent une offensive en direction du sud, percèrent les défenses des troupes austro-hongroises et, après avoir capturé plusieurs milliers de personnes, occupèrent la province autrichienne de Galice et une partie de la Pologne. L'avancée des troupes russes menaçait la Silésie et Poznan, régions industrielles importantes pour l'Allemagne. L'Allemagne a été forcée de transférer des forces supplémentaires de la France. Mais une grave pénurie de munitions et de vivres arrête l'avancée des troupes russes. L'offensive a coûté d'énormes pertes à la Russie, mais a sapé la puissance de l'Autriche-Hongrie et contraint l'Allemagne à conserver des forces importantes sur le front de l'Est. Dès août 1914, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. En octobre 1914, la Turquie entre en guerre aux côtés du bloc des puissances centrales. Avec le déclenchement de la guerre, l'Italie, membre de la Triple Alliance, a déclaré sa neutralité au motif que ni l'Allemagne ni l'Autriche-Hongrie n'avaient été attaquées. Mais lors des pourparlers secrets de Londres en mars-mai 1915, les pays de l'Entente ont promis de satisfaire les revendications territoriales de l'Italie dans le cadre du règlement de paix d'après-guerre si l'Italie se rangeait de leur côté. Le 23 mai 1915, l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et le 28 août 1916 à l'Allemagne. Sur le front occidental, les Britanniques sont vaincus lors de la deuxième bataille d'Ypres. Ici, lors des combats qui ont duré un mois (22 avril - 25 mai 1915), des armes chimiques ont été utilisées pour la première fois. Après cela, des gaz toxiques (chlore, phosgène et plus tard gaz moutarde) ont commencé à être utilisés par les deux parties belligérantes. L'opération de débarquement à grande échelle des Dardanelles, une expédition navale que les pays de l'Entente ont équipée au début de 1915 dans le but de prendre Constantinople, d'ouvrir les Dardanelles et le Bosphore pour communiquer avec la Russie par la mer Noire, de retirer la Turquie de la guerre et d'attirer les États des Balkans aux côtés des alliés, s'est également soldée par une défaite. Sur le front de l'Est, vers la fin de 1915, les troupes allemandes et austro-hongroises chassent les Russes de la quasi-totalité de la Galice et de la majeure partie du territoire de la Pologne russe. Mais il n'était pas possible de forcer la Russie à une paix séparée. En octobre 1915, la Bulgarie déclara la guerre à la Serbie, après quoi les puissances centrales, avec un nouvel allié balkanique, traversèrent les frontières de la Serbie, du Monténégro et de l'Albanie. Après avoir capturé la Roumanie et couvert le flanc des Balkans, ils se sont retournés contre l'Italie.
Guerre en mer. Le contrôle de la mer permettait aux Britanniques de déplacer librement des troupes et du matériel de toutes les parties de leur empire vers la France. Ils ont gardé les voies maritimes ouvertes aux navires marchands américains. Les colonies allemandes ont été capturées et le commerce des Allemands par les routes maritimes a été supprimé. En général, la flotte allemande - à l'exception du sous-marin - était bloquée dans leurs ports. Ce n'est qu'occasionnellement que de petites flottes sont sorties pour attaquer les villes balnéaires britanniques et attaquer les navires marchands alliés. Pendant toute la guerre, une seule bataille navale majeure a eu lieu - lorsque la flotte allemande est entrée dans la mer du Nord et a rencontré de manière inattendue les Britanniques près de la côte danoise du Jutland. La bataille du Jutland du 31 mai au 1er juin 1916 a entraîné de lourdes pertes des deux côtés : les Britanniques ont perdu 14 navires, env. 6 800 tués, capturés et blessés ; Les Allemands qui se considéraient comme des gagnants - 11 navires et env. 3100 personnes tuées et blessées. Néanmoins, les Britanniques ont forcé la flotte allemande à se replier sur Kiel, où elle a été effectivement bloquée. La flotte allemande n'apparaissait plus en haute mer et la Grande-Bretagne restait la maîtresse des mers. Ayant occupé une position dominante en mer, les Alliés ont progressivement coupé les puissances centrales des sources étrangères de matières premières et de nourriture. Selon le droit international, les pays neutres, tels que les États-Unis, pouvaient vendre des marchandises qui n'étaient pas considérées comme de la "contrebande militaire" à d'autres pays neutres - les Pays-Bas ou le Danemark, d'où ces marchandises pouvaient être livrées en Allemagne. Cependant, les pays belligérants ne s'engageaient généralement pas au respect du droit international, et la Grande-Bretagne a tellement élargi la liste des marchandises considérées comme contrebande qu'en fait rien ne traversait ses barrières en mer du Nord. Le blocus naval contraint l'Allemagne à recourir à des mesures drastiques. Son seul moyen efficace en mer reste la flotte sous-marine, capable de contourner librement les barrières de surface et de couler les navires marchands des pays neutres qui approvisionnent les alliés. C'est au tour des pays de l'Entente d'accuser les Allemands de violer le droit international qui les oblige à sauver les équipages et les passagers des navires torpillés. Le 18 février 1915, le gouvernement allemand déclara les eaux autour des îles britanniques zone militaire et avertit du danger que des navires de pays neutres y pénètrent. Le 7 mai 1915, un sous-marin allemand torpille et coule le vapeur océanique Lusitania avec des centaines de passagers à bord, dont 115 citoyens américains. Le président Wilson a protesté, les États-Unis et l'Allemagne ont échangé de vives notes diplomatiques.
Verdun et la Somme. L'Allemagne était prête à faire des concessions en mer et à chercher une issue à l'impasse sur terre. En avril 1916, les troupes britanniques avaient déjà subi une grave défaite à Kut-el-Amar en Mésopotamie, où 13 000 personnes se sont rendues aux Turcs. Sur le continent, l'Allemagne se prépare à une opération offensive de grande envergure sur le front occidental, censée renverser le cours de la guerre et obliger la France à réclamer la paix. Le point clé de la défense française était l'ancienne forteresse de Verdun. Après un bombardement d'artillerie d'une puissance sans précédent, 12 divisions allemandes passent à l'offensive le 21 février 1916. Les Allemands ont lentement avancé jusqu'au début de juillet, mais ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Le "hachoir à viande" de Verdun ne justifiait manifestement pas les calculs du commandement allemand. Les opérations sur les fronts est et sud-ouest ont été d'une grande importance au cours du printemps et de l'été 1916. En mars, à la demande des Alliés, les troupes russes ont mené une opération près du lac Naroch, qui a considérablement influencé le cours des hostilités en France. Le commandement allemand a été contraint d'arrêter les attaques sur Verdun pendant un certain temps et, retenant 0,5 million de personnes sur le front de l'Est, y a transféré une partie supplémentaire des réserves. Fin mai 1916, le haut commandement russe lance une offensive sur le front sud-ouest. Pendant les combats sous le commandement de A.A. Brusilov, il a été possible d'effectuer une percée des troupes austro-allemandes à une profondeur de 80 à 120 km. Les troupes de Brusilov ont occupé une partie de la Galice et de la Bucovine, sont entrées dans les Carpates. Pour la première fois de toute la période précédente de la guerre des tranchées, le front était percé. Si cette offensive avait été soutenue par d'autres fronts, elle se serait soldée par un désastre pour les puissances centrales. Pour relâcher la pression sur Verdun, le 1er juillet 1916, les Alliés lancent une contre-attaque sur la Somme, près de Bapaume. Pendant quatre mois - jusqu'en novembre - il y a eu des attaques incessantes. Les troupes anglo-françaises, ayant perdu env. 800 000 personnes n'ont jamais pu percer le front allemand. Finalement, en décembre, le commandement allemand décide d'arrêter l'offensive, qui coûte la vie à 300 000 soldats allemands. La campagne de 1916 a fait plus d'un million de morts, mais n'a apporté de résultats tangibles ni d'un côté ni de l'autre.
Base pour les négociations de paix. Au début du 20ème siècle a complètement changé la manière de faire la guerre. La longueur des fronts a considérablement augmenté, les armées se sont battues sur des lignes fortifiées et ont attaqué depuis les tranchées, les mitrailleuses et l'artillerie ont commencé à jouer un rôle énorme dans les batailles offensives. De nouveaux types d'armes sont utilisés : chars, chasseurs et bombardiers, sous-marins, gaz asphyxiants, grenades à main. Un habitant sur dix du pays belligérant était mobilisé et 10% de la population était engagée dans le ravitaillement de l'armée. Dans les pays belligérants, il n'y avait presque pas de place pour la vie civile ordinaire : tout était subordonné aux efforts titanesques visant à maintenir la machine militaire. Le coût total de la guerre, y compris les pertes de biens, selon diverses estimations, variait de 208 à 359 milliards de dollars. À la fin de 1916, les deux parties étaient fatiguées de la guerre et il semblait que le bon moment était venu de commencer la paix. négociations.
Deuxième période.
Le 12 décembre 1916, les puissances centrales ont demandé aux États-Unis d'envoyer une note aux Alliés avec une proposition d'entamer des négociations de paix. L'Entente a rejeté cette proposition, soupçonnant qu'elle était faite pour briser la coalition. De plus, elle ne voulait pas parler d'un monde qui ne prévoirait pas le paiement de réparations et la reconnaissance du droit des nations à l'autodétermination. Le président Wilson décida d'engager des négociations de paix et, le 18 décembre 1916, se tourna vers les pays belligérants avec une demande pour déterminer des conditions de paix mutuellement acceptables. Dès le 12 décembre 1916, l'Allemagne propose de convoquer une conférence de paix. Les autorités civiles allemandes aspirent clairement à la paix, mais elles sont combattues par les généraux, en particulier le général Ludendorff, confiant dans la victoire. Les Alliés précisent leurs conditions : la restauration de la Belgique, de la Serbie et du Monténégro ; retrait des troupes de France, de Russie et de Roumanie ; réparations; le retour de l'Alsace et de la Lorraine à la France ; libération des peuples soumis, dont les Italiens, les Polonais, les Tchèques, élimination de la présence turque en Europe. Les Alliés ne faisaient pas confiance à l'Allemagne et n'ont donc pas pris au sérieux l'idée de négociations de paix. L'Allemagne avait l'intention de participer à une conférence de paix en décembre 1916, s'appuyant sur les avantages de sa loi martiale. L'affaire s'est terminée par la signature par les Alliés d'accords secrets destinés à vaincre les puissances centrales. En vertu de ces accords, la Grande-Bretagne revendiquait les colonies allemandes et une partie de la Perse ; La France devait recevoir l'Alsace et la Lorraine, ainsi qu'établir le contrôle sur la rive gauche du Rhin ; La Russie a acquis Constantinople ; Italie - Trieste, Tyrol autrichien, la majeure partie de l'Albanie ; Les possessions de la Turquie devaient être réparties entre tous les alliés.
Entrée des États-Unis dans la guerre. Au début de la guerre, l'opinion publique aux États-Unis était divisée : certains se rangeaient ouvertement du côté des Alliés ; d'autres - comme les Irlando-Américains hostiles à l'Angleterre, et les Germano-Américains - soutenaient l'Allemagne. Au fil du temps, les responsables gouvernementaux et les citoyens ordinaires se sont de plus en plus penchés du côté de l'Entente. Cela a été facilité par plusieurs facteurs, et surtout la propagande des pays de l'Entente et la guerre sous-marine allemande. Le 22 janvier 1917, le président Wilson présenta au Sénat des conditions de paix acceptables pour les États-Unis. La principale se réduisait à l'exigence de « paix sans victoire », c'est-à-dire sans annexes ni indemnités ; d'autres comprenaient les principes de l'égalité des peuples, le droit des nations à l'autodétermination et à la représentation, la liberté des mers et du commerce, la réduction des armements, le rejet du système des alliances rivales. Si la paix est faite sur la base de ces principes, a soutenu Wilson, alors une organisation mondiale d'États peut être créée qui garantit la sécurité de tous les peuples. Le 31 janvier 1917, le gouvernement allemand annonce la reprise de la guerre sous-marine illimitée afin de perturber les communications ennemies. Les sous-marins bloquent les lignes de ravitaillement de l'Entente et placent les alliés dans une position extrêmement difficile. Il y avait une hostilité croissante envers l'Allemagne parmi les Américains, car le blocus de l'Europe par l'ouest était de mauvais augure pour les États-Unis. En cas de victoire, l'Allemagne pourrait établir le contrôle de tout l'océan Atlantique. Parallèlement aux circonstances notées, d'autres motifs ont également poussé les États-Unis à la guerre aux côtés des alliés. Les intérêts économiques des États-Unis étaient directement liés aux pays de l'Entente, puisque les commandes militaires entraînaient la croissance rapide de l'industrie américaine. En 1916, l'esprit guerrier est stimulé par des projets de développement de programmes d'entraînement au combat. Les sentiments anti-allemands des Nord-Américains s'accrurent encore plus après la publication le 1er mars 1917 de la dépêche secrète de Zimmermann du 16 janvier 1917, qui fut interceptée par les services secrets britanniques et remise à Wilson. Le ministre allemand des Affaires étrangères A. Zimmerman a proposé au Mexique les États du Texas, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona s'il soutenait les actions de l'Allemagne en réponse à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Entente. Début avril, le sentiment anti-allemand aux États-Unis atteignit un tel niveau que le 6 avril 1917, le Congrès vota la déclaration de guerre à l'Allemagne.
La sortie de la guerre de la Russie. En février 1917, une révolution éclate en Russie. Le tsar Nicolas II est contraint d'abdiquer. Le gouvernement provisoire (mars-novembre 1917) ne peut plus mener d'opérations militaires actives sur les fronts, la population étant extrêmement fatiguée de la guerre. Le 15 décembre 1917, les bolcheviks, arrivés au pouvoir en novembre 1917, signent un accord d'armistice avec les puissances centrales au prix d'énormes concessions. Trois mois plus tard, le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk est conclu. La Russie a renoncé à ses droits sur la Pologne, l'Estonie, l'Ukraine, une partie de la Biélorussie, la Lettonie, la Transcaucasie et la Finlande. Ardagan, Kars et Batum sont allés en Turquie ; d'énormes concessions ont été faites à l'Allemagne et à l'Autriche. Au total, la Russie a perdu env. 1 million de m² km. Elle a également été obligée de payer à l'Allemagne une indemnité d'un montant de 6 milliards de marks.
Troisième période.
Les Allemands avaient de bonnes raisons d'être optimistes. Les dirigeants allemands ont utilisé l'affaiblissement de la Russie, puis son retrait de la guerre, pour reconstituer les ressources. Désormais, il pouvait transférer l'armée de l'est vers l'ouest et concentrer les troupes sur les principales directions de l'offensive. Les alliés, ne sachant pas d'où viendrait le coup, furent contraints de renforcer leurs positions sur tout le front. L'aide américaine était en retard. En France et en Grande-Bretagne, le défaitisme grandit avec une force menaçante. Le 24 octobre 1917, les troupes austro-hongroises percèrent le front italien près de Caporetto et battirent l'armée italienne.
Offensive allemande 1918. Par un matin brumeux du 21 mars 1918, les Allemands lancent une attaque massive contre les positions britanniques près de Saint-Quentin. Les Britanniques ont été contraints de se retirer presque à Amiens, et sa perte a menacé de briser le front uni anglo-français. Le sort de Calais et de Boulogne était en jeu. Le 27 mai, les Allemands lancent une puissante offensive contre les Français dans le sud, les repoussant vers Château-Thierry. La situation de 1914 se répète : les Allemands atteignent la Marne, à seulement 60 km de Paris. Cependant, l'offensive a coûté à l'Allemagne de lourdes pertes - humaines et matérielles. Les troupes allemandes sont épuisées, leur système de ravitaillement est brisé. Les Alliés ont pu neutraliser les sous-marins allemands en créant des convois et des systèmes de défense anti-sous-marins. Dans le même temps, le blocus des puissances centrales a été mis en œuvre avec une telle efficacité que des pénuries alimentaires ont commencé à se faire sentir en Autriche et en Allemagne. Bientôt, l'aide américaine tant attendue a commencé à arriver en France. Les ports de Bordeaux à Brest étaient remplis de troupes américaines. Au début de l'été 1918, environ 1 million de soldats américains avaient débarqué en France. Le 15 juillet 1918, les Allemands font leur dernière tentative de percée à Château-Thierry. Une deuxième bataille décisive se déroule sur la Marne. En cas de percée, les Français devraient quitter Reims, ce qui, à son tour, pourrait entraîner le retrait des alliés sur tout le front. Dans les premières heures de l'offensive, les troupes allemandes avancent, mais pas aussi vite que prévu.
La dernière offensive des alliés. Le 18 juillet 1918, une contre-attaque des troupes américaines et françaises commence à relâcher la pression sur Château-Thierry. Ils avancèrent d'abord avec difficulté, mais le 2 août ils prirent Soissons. Lors de la bataille d'Amiens le 8 août, les troupes allemandes subissent une lourde défaite, ce qui mine leur moral. Auparavant, le chancelier allemand, le prince von Gertling, croyait que les Alliés demanderaient la paix d'ici septembre. "Nous espérions prendre Paris fin juillet, se souvient-il. Nous pensions donc au 15 juillet. Et le 18, même les plus optimistes d'entre nous se rendaient compte que tout était perdu." Certains militaires ont convaincu Kaiser Wilhelm II que la guerre était perdue, mais Ludendorff a refusé d'admettre sa défaite. L'avancée alliée a également commencé sur d'autres fronts. Du 20 au 26 juin, les troupes austro-hongroises ont été repoussées de l'autre côté de la rivière Piave, leurs pertes s'élevant à 150 000 personnes. Des troubles ethniques ont éclaté en Autriche-Hongrie - non sans l'influence des Alliés, qui ont encouragé la défection des Polonais, des Tchèques et des Slaves du Sud. Les puissances centrales rassemblèrent leurs dernières forces pour contenir l'invasion attendue de la Hongrie. La voie vers l'Allemagne était ouverte. Les chars et les bombardements massifs d'artillerie sont devenus des facteurs importants de l'offensive. Début août 1918, les attaques contre les principales positions allemandes s'intensifient. Dans ses Mémoires, Ludendorff a qualifié le 8 août - le début de la bataille d'Amiens - de "journée noire pour l'armée allemande". Le front allemand est déchiré : des divisions entières se rendent presque sans combat. Fin septembre, même Ludendorff était prêt à se rendre. Après l'offensive de septembre de l'Entente sur le front de Solonik, la Bulgarie signe une trêve le 29 septembre. Un mois plus tard, la Turquie capitulait, et le 3 novembre, l'Autriche-Hongrie. Pour les négociations de paix en Allemagne, un gouvernement modéré est formé, dirigé par le prince Max de Bade, qui, le 5 octobre 1918, propose au président Wilson d'entamer le processus de négociation. Dans la dernière semaine d'octobre, l'armée italienne lance une offensive générale contre l'Autriche-Hongrie. Le 30 octobre, la résistance des troupes autrichiennes était brisée. La cavalerie et les véhicules blindés italiens ont effectué un raid rapide derrière les lignes ennemies et ont capturé le quartier général autrichien à Vittorio Veneto, la ville qui a donné son nom à toute la bataille. Le 27 octobre, l'empereur Charles I a lancé un appel à une trêve, et le 29 octobre 1918, il a accepté une paix à n'importe quelles conditions.
Révolution en Allemagne. Le 29 octobre, le Kaiser quitta secrètement Berlin et se dirigea vers l'état-major général, ne se sentant en sécurité que sous la protection de l'armée. Le même jour, dans le port de Kiel, une équipe de deux navires de guerre a rompu l'obéissance et a refusé de prendre la mer pour une mission de combat. Le 4 novembre, Kiel passa sous le contrôle des marins rebelles. 40 000 hommes armés entendent établir des conseils de députés de soldats et de marins sur le modèle russe dans le nord de l'Allemagne. Le 6 novembre, les rebelles ont pris le pouvoir à Lübeck, Hambourg et Brême. Pendant ce temps, le commandant suprême allié, le général Foch, annonce qu'il est prêt à recevoir des représentants du gouvernement allemand et à discuter avec eux des termes d'une trêve. Le Kaiser fut informé que l'armée n'était plus sous son commandement. Le 9 novembre, il abdique et une république est proclamée. Le lendemain, l'empereur allemand s'enfuit aux Pays-Bas, où il vécut en exil jusqu'à sa mort (décédé en 1941). Le 11 novembre, à la station de la Retonde en forêt de Compiègne (France), la délégation allemande signe la trêve de Compiègne. Les Allemands reçurent l'ordre de libérer les territoires occupés dans les deux semaines, y compris l'Alsace et la Lorraine, la rive gauche du Rhin et les têtes de pont de Mayence, Coblence et Cologne ; établir une zone neutre sur la rive droite du Rhin ; transférer aux alliés 5 000 canons lourds et de campagne, 25 000 mitrailleuses, 1 700 avions, 5 000 locomotives à vapeur, 150 000 wagons de chemin de fer, 5 000 véhicules ; libérer immédiatement tous les prisonniers. Les forces navales devaient rendre tous les sous-marins et presque toute la flotte de surface et rendre tous les navires marchands alliés capturés par l'Allemagne. Les dispositions politiques du traité prévoyaient la dénonciation des traités de paix de Brest-Litovsk et de Bucarest ; financier - le paiement des réparations pour la destruction et le retour des objets de valeur. Les Allemands ont tenté de négocier une trêve basée sur les quatorze points de Wilson, qui, selon eux, pourraient servir de base provisoire à une « paix sans victoire ». Les termes de l'armistice exigeaient une reddition quasi inconditionnelle. Les Alliés ont dicté leurs conditions à une Allemagne exsangue.
La fin du monde. Une conférence de paix a eu lieu en 1919 à Paris; au cours des sessions, des accords sur cinq traités de paix ont été conclus. Après son achèvement, les textes suivants ont été signés : 1) le traité de Versailles avec l'Allemagne le 28 juin 1919 ; 2) Traité de paix de Saint-Germain avec l'Autriche le 10 septembre 1919 ; 3) Traité de paix de Neuilly avec la Bulgarie le 27 novembre 1919 ; 4) Traité de paix de Trianon avec la Hongrie le 4 juin 1920 ; 5) Traité de paix de Sèvres avec la Turquie du 20 août 1920. Par la suite, conformément au traité de Lausanne du 24 juillet 1923, des modifications ont été apportées au traité de Sèvres. A la conférence de paix de Paris, 32 Etats étaient représentés. Chaque délégation disposait de son propre personnel de spécialistes qui fournissaient des informations sur la situation géographique, historique et économique des pays sur lesquels des décisions étaient prises. Après qu'Orlando ait quitté le conseil interne, mécontent de la solution du problème des territoires dans l'Adriatique, les "trois grands" - Wilson, Clemenceau et Lloyd George - sont devenus le principal architecte du monde d'après-guerre. Wilson a fait des compromis sur plusieurs points importants afin d'atteindre l'objectif principal - la création de la Société des Nations. Il était d'accord avec le désarmement des seules puissances centrales, bien qu'il ait d'abord insisté sur le désarmement général. La taille de l'armée allemande était limitée et ne devait pas dépasser 115 000 personnes; le service militaire universel a été aboli; les forces armées allemandes devaient être recrutées parmi des volontaires ayant une durée de service de 12 ans pour les soldats et jusqu'à 45 ans pour les officiers. Il était interdit à l'Allemagne d'avoir des avions de combat et des sous-marins. Des conditions similaires figuraient dans les traités de paix signés avec l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie. Entre Clemenceau et Wilson se déroule une discussion acharnée sur le statut de la rive gauche du Rhin. Les Français, pour des raisons de sécurité, avaient l'intention d'annexer la région avec ses puissantes mines de charbon et son industrie et de créer une Rhénanie autonome. Le plan de la France allait à l'encontre des propositions de Wilson, qui s'opposait aux annexions et prônait l'autodétermination des nations. Un compromis a été atteint après que Wilson a accepté de signer des traités militaires libres avec la France et la Grande-Bretagne, en vertu desquels les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont engagés à soutenir la France en cas d'attaque allemande. La décision suivante a été prise : la rive gauche du Rhin et la bande de 50 kilomètres sur la rive droite sont démilitarisées, mais restent une partie de l'Allemagne et sous sa souveraineté. Les Alliés ont occupé un certain nombre de points dans cette zone pendant une période de 15 ans. Les gisements houillers, connus sous le nom de bassin de la Sarre, sont également passés en possession de la France pendant 15 ans ; la Sarre elle-même passa sous le contrôle de la Commission de la Société des Nations. Après une période de 15 ans, il était prévu d'organiser un plébiscite sur la question de la propriété étatique de ce territoire. L'Italie a obtenu le Trentin, Trieste et la majeure partie de l'Istrie, mais pas l'île de Fiume. Néanmoins, les extrémistes italiens ont capturé Fiume. L'Italie et le nouvel État de Yougoslavie ont reçu le droit de décider eux-mêmes de la question des territoires contestés. Avec le traité de Versailles, l'Allemagne a perdu ses possessions coloniales. La Grande-Bretagne a acquis l'Afrique orientale allemande et la partie occidentale du Cameroun et du Togo allemands, les dominions britanniques - l'Union de l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande - ont été transférés en Afrique du Sud-Ouest, les régions du nord-est de la Nouvelle-Guinée avec les régions adjacentes l'archipel et les îles Samoa. La France a obtenu la majeure partie du Togo allemand et de la partie orientale du Cameroun. Le Japon a reçu les îles Marshall, Mariana et Caroline appartenant à l'Allemagne dans l'océan Pacifique et le port de Qingdao en Chine. Des traités secrets entre les puissances victorieuses ont également supposé la division de l'Empire ottoman, mais après le soulèvement des Turcs, dirigé par Mustafa Kemal, les alliés ont accepté de réviser leurs demandes. Le nouveau traité de Lausanne annule le traité de Sèvres et permet à la Turquie de conserver la Thrace orientale. La Turquie a repris l'Arménie. la Syrie passa à la France ; La Grande-Bretagne a reçu la Mésopotamie, la Transjordanie et la Palestine ; les îles du Dodécanèse dans la mer Égée ont été cédées à l'Italie ; le territoire arabe du Hijaz sur la côte de la mer Rouge devait accéder à l'indépendance. Les violations du principe d'autodétermination des nations ont provoqué le désaccord de Wilson, en particulier, il a vivement protesté contre le transfert du port chinois de Qingdao au Japon. Le Japon a accepté de restituer ce territoire à la Chine à l'avenir et a tenu sa promesse. Les conseillers de Wilson ont suggéré qu'au lieu de remettre réellement les colonies à de nouveaux propriétaires, ils devraient être autorisés à administrer en tant qu'administrateurs de la Société des Nations. Ces territoires étaient appelés "obligatoires". Bien que Lloyd George et Wilson se soient opposés aux pénalités pour dommages, la lutte sur la question s'est terminée par la victoire de la partie française. Des réparations ont été imposées à l'Allemagne; la question de savoir ce qui devait figurer sur la liste des destructions présentées contre paiement a également fait l'objet de longues discussions. Au début, le montant exact ne figurait pas, ce n'est qu'en 1921 que sa taille a été déterminée - 152 milliards de marks (33 milliards de dollars); plus tard, ce montant a été réduit. Le principe de l'autodétermination des nations est devenu un principe clé pour de nombreux peuples représentés à la conférence de paix. La Pologne est restaurée. La tâche de définir ses limites s'est avérée difficile; une importance particulière était le transfert à elle de la soi-disant. "Couloir polonais", qui donnait au pays un accès à la mer Baltique, séparant la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. De nouveaux États indépendants sont apparus dans la région de la Baltique : la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande. Au moment où la conférence a été convoquée, la monarchie austro-hongroise avait déjà cessé d'exister et l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie et la Roumanie ont surgi à sa place; les frontières entre ces états étaient contestées. Le problème s'est avéré difficile en raison de l'implantation mixte de différents peuples. Lors de l'établissement des frontières de l'État tchèque, les intérêts des Slovaques ont été lésés. La Roumanie a doublé son territoire avec la Transylvanie, les terres bulgares et hongroises. La Yougoslavie a été créée à partir des anciens royaumes de Serbie et du Monténégro, de certaines parties de la Bulgarie et de la Croatie, de la Bosnie, de l'Herzégovine et du Banat dans le cadre de Timisoara. L'Autriche est restée un petit État avec une population de 6,5 millions d'Allemands autrichiens, dont un tiers vivaient dans la Vienne appauvrie. La population de la Hongrie a considérablement diminué et est maintenant d'env. 8 millions de personnes. Lors de la Conférence de Paris, une lutte exceptionnellement acharnée a été menée autour de l'idée de créer une Société des Nations. Selon les plans de Wilson, du général J. Smuts, de Lord R. Cecil et de leurs autres associés, la Société des Nations devait devenir une garantie de sécurité pour tous les peuples. Enfin, la charte de la Société des Nations est adoptée et, après de longs débats, quatre groupes de travail sont constitués : l'Assemblée, le Conseil de la Société des Nations, le Secrétariat et la Cour permanente de Justice internationale. La Société des Nations a établi des mécanismes qui pourraient être utilisés par ses États membres pour prévenir la guerre. Dans son cadre, diverses commissions ont également été formées pour résoudre d'autres problèmes.
Voir aussi SOCIÉTÉ DES NATIONS. L'accord de la Société des Nations représentait la partie du traité de Versailles que l'Allemagne était également invitée à signer. Mais la délégation allemande a refusé de le signer au motif que l'accord n'était pas conforme aux quatorze points de Wilson. Finalement, l'Assemblée nationale allemande reconnut le traité le 23 juin 1919. La signature dramatique eut lieu cinq jours plus tard au château de Versailles, où en 1871 Bismarck, ravi de la victoire dans la guerre franco-prussienne, proclama la création de l'Empire allemand.
LITTÉRATURE
Histoire de la Première Guerre mondiale, en 2 vol. M., 1975 Ignatiev A.V. La Russie dans les guerres impérialistes du début du XXe siècle. La Russie, l'URSS et les conflits internationaux dans la première moitié du XXe siècle. M., 1989 A l'occasion du 75e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. M., 1990 Pisarev Yu.A. Secrets de la Première Guerre mondiale. La Russie et la Serbie en 1914-1915. M., 1990 Kudrina Yu.V. Retour aux origines de la Première Guerre mondiale. Les chemins vers la sécurité. M., 1994 La Première Guerre mondiale : problèmes discutables de l'histoire. M., 1994 Première Guerre mondiale : pages d'histoire. Tchernivtsi, 1994 Bobyshev S.V., Seregin S.V. La Première Guerre mondiale et les perspectives de développement social de la Russie. Komsomolsk-on-Amur, 1995 Première Guerre mondiale : prologue du XXe siècle. M., 1998
Wikipédia
Le 11 novembre 1918, l'armistice de Compiègne, qui signifie la capitulation de l'Allemagne, met fin à la Première Guerre mondiale, qui a duré quatre ans et trois mois. Près de 10 millions de personnes sont mortes dans son incendie, environ 20 millions ont été blessées.
Première Guerre mondiale(28 juillet 1914 - 11 novembre 1918) - l'un des plus grands conflits armés de l'histoire de l'humanité. Le nom même de "Première Guerre mondiale" n'a été établi dans l'historiographie qu'après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Dans l'entre-deux-guerres, le nom de "Grande Guerre" était utilisé, dans l'Empire russe, on l'appelait parfois la "Seconde Guerre patriotique", et aussi de manière informelle (avant et après la révolution) - "Allemand" ; puis en URSS - "guerre impérialiste".
À la suite de la Première Guerre mondiale, la carte du monde a dû être reconstruite. L'Allemagne a dû renoncer non seulement à l'aviation et à la marine, mais aussi à un certain nombre de terres et de terres. Les compagnons d'armes de l'Allemagne dans les hostilités - l'Autriche-Hongrie et la Turquie ont été démembrés et la Bulgarie a perdu une partie importante de ses terres.
La Première Guerre mondiale a détruit les derniers empires significatifs et significatifs qui existaient sur le continent européen - il s'agit de l'Empire allemand, des empires austro-hongrois et russe. Au même moment, l'Empire ottoman s'effondre en Asie.
Les résultats de la Première Guerre mondiale furent les révolutions de février et d'octobre en Russie et la révolution de novembre en Allemagne, la liquidation de trois empires : les empires russe, ottoman et austro-hongrois, ces deux derniers étant divisés. L'Allemagne, ayant cessé d'être une monarchie, a été abattue territorialement et économiquement affaiblie.
La guerre civile a commencé en Russie. Du 6 au 16 juillet 1918, les socialistes-révolutionnaires de gauche (partisans de la poursuite de la participation de la Russie à la guerre) organisèrent l'assassinat de l'ambassadeur allemand, le comte Wilhelm von Mirbach, à Moscou et de la famille royale à Ekaterinbourg, dans le but de perturber le traité de Brest-Litovsk entre la Russie soviétique et l'Allemagne Kaiser. Les Allemands après la révolution de février, malgré la guerre avec la Russie, s'inquiétaient du sort de la famille impériale russe, car l'épouse de Nicolas II, Alexandra Feodorovna, était allemande et leurs filles étaient à la fois des princesses russes et des princesses allemandes.
Les États-Unis sont devenus une grande puissance. Les conditions difficiles pour l'Allemagne du traité de Versailles (paiement des réparations, etc.) et l'humiliation nationale dont elle a été victime ont suscité des sentiments revanchards, qui sont devenus l'une des conditions préalables à l'arrivée des nazis au pouvoir et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. .
Première Guerre mondialeétait le résultat de l'aggravation des contradictions de l'impérialisme, des inégalités, du développement spasmodique des pays capitalistes. Les contradictions les plus aiguës existaient entre la Grande-Bretagne, la plus ancienne puissance capitaliste, et l'Allemagne économiquement renforcée, dont les intérêts s'opposaient dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Leur rivalité s'est transformée en une lutte acharnée pour la domination du marché mondial, pour la saisie de territoires étrangers, pour l'asservissement économique d'autres peuples. L'Allemagne s'est fixé pour objectif de vaincre les forces armées de l'Angleterre, de la priver de la primauté coloniale et navale, de subordonner les pays des Balkans à son influence et de créer un empire semi-colonial au Moyen-Orient. L'Angleterre, à son tour, avait l'intention d'empêcher l'établissement de l'Allemagne dans la péninsule balkanique et au Moyen-Orient, de détruire ses forces armées et d'étendre ses possessions coloniales. De plus, elle espérait s'emparer de la Mésopotamie, pour établir sa domination en Palestine et en Égypte. De fortes contradictions existaient également entre l'Allemagne et la France. La France a cherché à rendre les provinces d'Alsace et de Lorraine, capturées à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, et aussi à prendre le bassin de la Sarre à l'Allemagne, pour préserver et étendre ses possessions coloniales (voir Colonialisme).
Les troupes bavaroises sont envoyées par chemin de fer vers le front. Août 1914

Division territoriale du monde à la veille de la Première Guerre mondiale (vers 1914)

L'arrivée de Poincaré à Saint-Pétersbourg, 1914. Raymond Poincaré (1860-1934) - Président de la France en 1913-1920. Il a poursuivi une politique militariste réactionnaire, pour laquelle il a reçu le surnom de « guerre de Poincaré ».

Partition de l'Empire ottoman (1920-1923)

Un fantassin américain affecté par une exposition au phosgène.

Changements territoriaux en Europe en 1918-1923.

Le général von Kluck (en voiture) et son état-major lors de grandes manœuvres, 1910

Changements territoriaux après la Première Guerre mondiale en 1918-1923.
Les intérêts de l'Allemagne et de la Russie se sont affrontés principalement au Moyen-Orient et dans les Balkans. L'Allemagne de Kaiser a également cherché à arracher l'Ukraine, la Pologne et les États baltes à la Russie. Des contradictions existaient également entre la Russie et l'Autriche-Hongrie en raison de la volonté des deux parties d'établir leur domination dans les Balkans. La Russie tsariste avait l'intention de s'emparer du Bosphore et des Dardanelles, des terres ukrainiennes occidentales et polonaises, qui étaient sous la domination des Habsbourg.
Les contradictions entre les puissances impérialistes ont eu un impact significatif sur l'alignement des forces politiques sur la scène internationale et la formation d'alliances militaro-politiques opposées. en Europe à la fin du XIXe siècle. - début du 20ème siècle deux plus grands blocs ont été formés - la Triple Alliance, qui comprenait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie ; et l'Entente en tant que partie de l'Angleterre, de la France et de la Russie. La bourgeoisie de chaque pays poursuivait ses propres objectifs égoïstes, qui contredisaient parfois les objectifs des alliés de la coalition. Cependant, tous ont été relégués au second plan sur fond de contradictions principales entre les deux groupements d'États : d'une part, entre l'Angleterre et ses alliés, et l'Allemagne et ses alliés, d'autre part.
Les cercles dirigeants de tous les pays étaient à blâmer pour le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais l'initiative de la déclencher appartenait à l'impérialisme allemand.
Le désir de la bourgeoisie d'affaiblir la lutte de classe croissante du prolétariat et du mouvement de libération nationale dans les colonies, de détourner la classe ouvrière de la lutte pour sa libération sociale par la guerre, de décapiter son avant-garde au moyen de mesures répressives en temps de guerre, a joué un rôle important dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Les gouvernements des deux groupes hostiles cachaient soigneusement à leurs peuples les véritables buts de la guerre, tentaient de leur inculquer l'idée fausse du caractère défensif des préparatifs militaires, puis de la conduite de la guerre elle-même. Les partis bourgeois et petits-bourgeois de tous les pays ont soutenu leurs gouvernements et, jouant sur les sentiments patriotiques des masses, ont proposé le mot d'ordre de "défendre la patrie" contre les ennemis extérieurs.
Les forces éprises de paix de l'époque n'ont pas pu empêcher le déclenchement d'une guerre mondiale. La véritable force capable de lui barrer largement la route était la classe ouvrière internationale qui, à la veille de la guerre, comptait plus de 150 millions de personnes. Cependant, le manque d'unité dans le mouvement socialiste international a contrecarré la formation d'un front anti-impérialiste uni. La direction opportuniste des partis sociaux-démocrates d'Europe occidentale n'a rien fait pour mettre en pratique les décisions anti-guerre prises lors des congrès de la IIe Internationale tenus avant la guerre. Une idée fausse sur les sources et la nature de la guerre a joué un rôle important à cet égard. Les socialistes de droite, se trouvant dans les camps belligérants, ont convenu que "leur" propre gouvernement n'avait rien à voir avec son émergence. Ils ont même continué à condamner la guerre, mais seulement comme un mal qui s'approche du pays de l'extérieur.
La Première Guerre mondiale a duré plus de quatre ans (du 1er août 1914 au 11 novembre 1918). 38 États y ont participé, plus de 70 millions de personnes se sont battues sur ses champs, dont 10 millions de personnes ont été tuées et 20 millions mutilées. La cause immédiate de la guerre fut l'assassinat par des membres de l'organisation conspiratrice serbe Jeune Bosnie le 28 juin 1914 à Sarajevo (Bosnie) de l'héritier du trône austro-hongrois, Franz Ferdinand. Incitée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie adresse un ultimatum évidemment impossible à la Serbie et déclare le 28 juillet la guerre à la Serbie. Dans le cadre de l'ouverture des hostilités par l'Autriche-Hongrie en Russie le 31 juillet, la mobilisation générale a commencé. En réponse, le gouvernement allemand a averti la Russie que si la mobilisation n'était pas arrêtée dans les 12 heures, la mobilisation serait également annoncée en Allemagne. À cette époque, les forces armées allemandes étaient déjà pleinement préparées pour la guerre. Le gouvernement tsariste ne répondit pas à l'ultimatum allemand. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 3 août à la France et à la Belgique, le 4 août la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Plus tard, la plupart des pays du monde ont été impliqués dans la guerre (du côté de l'Entente - 34 États, du côté du bloc austro-allemand - 4).
Les deux parties belligérantes ont commencé la guerre avec des armées de plusieurs millions. Des opérations militaires ont eu lieu en Europe, en Asie et en Afrique. Les principaux fronts de terre en Europe : Ouest (en Belgique et en France) et Est (en Russie). Selon la nature des tâches à résoudre et les résultats militaro-politiques obtenus, les événements de la Première Guerre mondiale peuvent être divisés en cinq campagnes, chacune comprenant plusieurs opérations.
En 1914, dans les tout premiers mois de la guerre, les plans militaires élaborés dans les états-majors des deux coalitions bien avant la guerre et conçus pour sa courte durée échouent. Les combats sur le front occidental ont commencé début août. Le 2 août, l'armée allemande occupe le Luxembourg et le 4 août envahit la Belgique, violant sa neutralité. La petite armée belge n'a pas été en mesure d'offrir une résistance sérieuse et a commencé à battre en retraite vers le nord. Le 20 août, les troupes allemandes occupent Bruxelles et peuvent se déplacer sans encombre jusqu'aux frontières de la France. Trois armées françaises et une britannique ont été avancées pour les rencontrer. Du 21 au 25 août, dans une bataille frontalière, les armées allemandes repoussent les troupes anglo-françaises, envahissent le Nord de la France et, poursuivant l'offensive, atteignent la Marne entre Paris et Verdun début septembre. Le commandement français, après avoir formé deux nouvelles armées à partir des réserves, décide de lancer une contre-offensive. La bataille de la Marne débute le 5 septembre. Elle a réuni 6 armées anglo-françaises et 5 armées allemandes (environ 2 millions de personnes). Les Allemands sont vaincus. Le 16 septembre, des batailles venant en sens inverse se sont déroulées, appelées "Courir vers la mer" (elles se sont terminées lorsque le front a atteint la côte maritime). En octobre et novembre, de sanglantes batailles en Flandre épuisent et équilibrent les forces des partis. De la frontière suisse à la mer du Nord s'étendait une solide ligne de front. La guerre en Occident a pris un caractère positionnel. Ainsi, le calcul de l'Allemagne pour vaincre et retirer la France de la guerre a échoué.
Le commandement russe, cédant aux demandes insistantes du gouvernement français, décide de passer aux opérations actives avant même la fin de la mobilisation et de la concentration de leurs armées. Le but de l'opération était de vaincre la 8e armée allemande et de capturer la Prusse orientale. Le 4 août, la 1ère armée russe sous le commandement du général P.K. Rennenkampf a traversé la frontière de l'État et est entrée sur le territoire de la Prusse orientale. Au cours de violents combats, les troupes allemandes ont commencé à battre en retraite vers l'ouest. Bientôt, la frontière de la Prusse orientale fut franchie par la 2e armée russe du général A.V. Samsonov. L'état-major allemand avait déjà décidé de retirer ses troupes au-delà de la Vistule, mais, profitant du manque d'interaction entre les 1ère et 2ème armées, des errements du haut commandement russe, les troupes allemandes parvinrent à infliger une lourde défaite au début de la 2ème armée, puis repousser la 1ère armée à ses positions de départ.
Malgré l'échec de l'opération, l'invasion de la Prusse orientale par l'armée russe eut des résultats importants. Il oblige les Allemands à transférer deux corps d'armée et une division de cavalerie de France vers le front russe, ce qui affaiblit gravement leur force de frappe à l'Ouest et est l'une des raisons de sa défaite lors de la bataille de la Marne. Dans le même temps, par leurs actions en Prusse orientale, les armées russes enchaînent les troupes allemandes et les empêchent d'aider les troupes alliées austro-hongroises. Cela a permis aux Russes d'infliger une défaite majeure à l'Autriche-Hongrie en direction de la Galice. Pendant l'opération, la menace d'une invasion de la Hongrie et de la Silésie a été créée; la puissance militaire de l'Autriche-Hongrie a été considérablement minée (les troupes austro-hongroises ont perdu environ 400 000 personnes, dont plus de 100 000 ont été capturées). L'armée austro-hongroise jusqu'à la fin de la guerre a perdu la capacité de mener des opérations de manière indépendante, sans le soutien des troupes allemandes. L'Allemagne a de nouveau été forcée de retirer une partie de ses forces du front occidental et de les transférer sur le front oriental.
À la suite de la campagne de 1914, aucune des deux parties n'a atteint ses objectifs. Les plans pour mener une guerre à court terme et la gagner au prix d'une bataille générale se sont effondrés. Sur le front occidental, la période de la guerre mobile est révolue. Début de la guerre de position et des tranchées. Le 23 août 1914, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne ; en octobre, la Turquie entre en guerre aux côtés du bloc allemand. De nouveaux fronts se forment en Transcaucasie, en Mésopotamie, en Syrie et aux Dardanelles.
Lors de la campagne de 1915, le centre de gravité des hostilités se déplace vers le front de l'Est. La défense était prévue sur le front occidental. Les opérations sur le front russe ont commencé en janvier et se sont poursuivies avec de courtes pauses jusqu'à la fin de l'automne. En été, le commandement allemand a effectué une percée du front russe près de Gorlitsa. Bientôt, il lança une offensive dans les États baltes et les troupes russes furent contraintes de quitter la Galice, la Pologne, une partie de la Lettonie et la Biélorussie. Cependant, le commandement russe, passé à la défense stratégique, réussit à soustraire ses armées aux coups de l'ennemi et à stopper sa progression. Les armées austro-allemandes et russes exsangues et épuisées sont passées sur la défensive sur tout le front en octobre. L'Allemagne était confrontée à la nécessité de poursuivre une longue guerre sur deux fronts. La Russie porte le poids de la lutte, ce qui donne à la France et à l'Angleterre un répit pour mobiliser l'économie pour les besoins de la guerre. Ce n'est qu'à l'automne que le commandement anglo-français a mené une opération offensive en Artois et en Champagne, ce qui n'a pas changé la situation de manière significative. Au printemps 1915, le commandement allemand a utilisé pour la première fois des armes chimiques (chlore) sur le front occidental, près d'Ypres, à la suite de quoi 15 000 personnes ont été empoisonnées. Après cela, les gaz ont commencé à être utilisés par les deux parties belligérantes.
A l'été, l'Italie entre en guerre aux côtés de l'Entente ; en octobre, la Bulgarie rejoint le bloc austro-allemand. L' opération de débarquement à grande échelle des Dardanelles de la flotte anglo-française visait à capturer les Dardanelles et le Bosphore , percer à Constantinople et retirer la Turquie de la guerre. Elle se solda par un échec et les Alliés fin 1915 cessèrent les hostilités et évacuèrent les troupes vers la Grèce.
Lors de la campagne de 1916, les Allemands ont de nouveau déplacé leurs principaux efforts vers l'Ouest. Pour leur attaque principale, ils ont choisi une section étroite du front dans la région de Verdun, car une percée ici constituait une menace pour toute l'aile nord des armées alliées. Les combats près de Verdun commencent le 21 février et se poursuivent jusqu'en décembre. Cette opération, appelée le hachoir à viande de Verdun, a été réduite à des batailles épuisantes et sanglantes, où les deux camps ont perdu environ 1 million de personnes. Les opérations offensives des troupes anglo-françaises sur la Somme, qui ont commencé le 1er juillet et se sont poursuivies jusqu'en novembre, ont également échoué. Les troupes anglo-françaises, ayant perdu environ 800 000 personnes, n'ont pas pu percer les défenses ennemies.
Les opérations sur le front de l'Est ont été d'une grande importance dans la campagne de 1916. En mars, à la demande des Alliés, les troupes russes ont mené une opération offensive près du lac Naroch, qui a considérablement influencé le cours des hostilités en France. Il a non seulement bloqué environ 0,5 million de soldats allemands sur le front de l'Est, mais a également forcé le commandement allemand à arrêter les attaques sur Verdun pendant un certain temps et à transférer une partie des réserves sur le front de l'Est. En lien avec la lourde défaite de l'armée italienne dans le Trentin en mai, le haut commandement russe lance une offensive le 22 mai, avec deux semaines d'avance sur le calendrier. Pendant les combats, les troupes russes sur le front sud-ouest sous le commandement de A. A. Brusilov ont réussi à percer la solide défense de position des troupes austro-allemandes à une profondeur de 80 à 120 km. L'ennemi a subi de lourdes pertes - environ 1,5 million de personnes ont été tuées, blessées et capturées. Le commandement austro-allemand a été contraint de transférer d'importantes forces sur le front russe, ce qui a facilité la position des armées alliées sur d'autres fronts. L'offensive russe sauva l'armée italienne de la défaite, soulagea la position des Français près de Verdun et précipita l'apparition de la Roumanie aux côtés de l'Entente. Le succès des troupes russes a été assuré par l'utilisation par le général A. A. Brusilov d'une nouvelle forme de percée du front par des frappes simultanées dans plusieurs secteurs. En conséquence, l'ennemi a perdu la possibilité de déterminer la direction de l'attaque principale. Avec la bataille de la Somme, l'offensive sur le front sud-ouest marque le début d'un tournant dans le cours de la Première Guerre mondiale. L'initiative stratégique passa entièrement entre les mains de l'Entente.
Du 31 mai au 1er juin, la plus grande bataille navale de toute la Première Guerre mondiale a eu lieu au large de la péninsule du Jutland en mer du Nord. Les Britanniques y ont perdu 14 navires, environ 6800 personnes ont été tuées, blessées et capturées; les Allemands ont perdu 11 navires, environ 3 100 hommes tués et blessés.
En 1916, le bloc germano-autrichien subit d'énormes pertes et perd son initiative stratégique. Des batailles sanglantes épuisèrent les ressources de toutes les puissances belligérantes. La situation des travailleurs s'est fortement détériorée. Les épreuves de la guerre, leur prise de conscience de son caractère anti-populaire ont provoqué un profond mécontentement parmi les masses. Dans tous les pays, les sentiments révolutionnaires grandissent à l'arrière et au front. Une montée particulièrement rapide du mouvement révolutionnaire a été observée en Russie, où la guerre a révélé la corruption de l'élite dirigeante.
Les opérations militaires de 1917 se sont déroulées dans des conditions de croissance significative du mouvement révolutionnaire dans tous les pays belligérants et de renforcement des sentiments anti-guerre à l'arrière et au front. La guerre a considérablement affaibli l'économie des factions opposées.
L'avantage de l'Entente est devenu encore plus significatif après l'entrée en guerre des États-Unis à ses côtés. L'état des armées de la coalition allemande était tel qu'elles ne pouvaient agir activement ni à l'Ouest ni à l'Est. Le commandement allemand décida en 1917 de passer à la défense stratégique sur tous les fronts terrestres et concentra son attention principale sur la conduite d'une guerre sous-marine illimitée, espérant ainsi perturber la vie économique de l'Angleterre et la retirer de la guerre. Mais, malgré un certain succès, la guerre sous-marine n'a pas donné le résultat escompté. Le commandement militaire de l'Entente passe à des frappes coordonnées sur les fronts occidental et oriental afin d'infliger une défaite définitive à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie.
Cependant, l'offensive des troupes anglo-françaises, entreprise en avril, échoue. Le 27 février (12 mars) une révolution démocratique bourgeoise a eu lieu en Russie. Le gouvernement provisoire arrivé au pouvoir, se dirigeant vers la poursuite de la guerre, organisa une grande offensive des armées russes avec le soutien des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks. Elle débute le 16 juin sur le front sud-ouest en direction générale de Lvov, mais après quelques succès tactiques, faute de réserves fiables, la résistance accrue de l'ennemi s'enlise. L'inaction des alliés sur le front occidental permet au commandement allemand de transférer rapidement des troupes sur le front oriental, d'y créer un groupement puissant et de passer à la contre-offensive le 6 juillet. Les unités russes, incapables de résister à l'assaut, ont commencé à battre en retraite. Les opérations offensives des armées russes se sont également terminées sans succès sur les fronts nord, ouest et roumain. Le nombre total de pertes sur tous les fronts a dépassé 150 000 personnes tuées, blessées et portées disparues.
L'impulsion offensive artificiellement créée des masses de soldats a été remplacée par une prise de conscience de l'absurdité de l'offensive, de la réticence à poursuivre la guerre de conquête, à se battre pour des intérêts qui leur étaient étrangers.