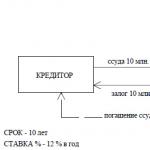Les facteurs anthropiques qui ont. Facteurs anthropiques : exemples
Facteurs environnementaux anthropiques
Facteurs anthropiques- est le résultat de l'impact humain sur l'environnement dans le processus des activités économiques et autres. Les facteurs anthropiques peuvent être divisés en 3 groupes :
) qui ont un impact direct sur l'environnement en raison d'activités soudaines, intenses et de courte durée, par ex. construction d'une route ou d'une voie ferrée à travers la taïga, chasse commerciale saisonnière dans une certaine zone, etc. ;
) impact indirect - par le biais d'activités économiques de longue durée et de faible intensité, par exemple. la pollution environnementémissions gazeuses et liquides d'une usine construite à proximité d'une voie ferrée posée sans les installations de traitement nécessaires, entraînant le dessèchement progressif des arbres et l'empoisonnement lent des animaux peuplant la taïga environnante avec des métaux lourds ;
) l'impact complexe des facteurs ci-dessus, conduisant à une modification lente mais significative de l'environnement (croissance démographique, augmentation du nombre d'animaux domestiques et d'animaux accompagnant les établissements humains - corbeaux, rats, souris, etc., transformation des terres, l'apparition d'impuretés dans l'eau, etc.).
Impact anthropique sur enveloppe géographique terrain
Au début du XXe siècle, dans l'interaction de la nature et de la société, nouvelle ère. L'impact de la société sur l'environnement géographique, l'impact anthropique, a considérablement augmenté. Cela a conduit à la transformation des paysages naturels en paysages anthropiques, ainsi qu'à l'émergence problèmes mondiaux l'écologie, c'est-à-dire des problèmes qui ne connaissent pas de frontières. La tragédie de Tchernobyl a mis en danger l'ensemble de l'Est et Europe du Nord. Les émissions de déchets affectent le réchauffement climatique, les trous d'ozone menacent la vie, les animaux migrent et mutent.
Le degré d'impact de la société sur l'enveloppe géographique dépend principalement du degré d'industrialisation de la société. Aujourd'hui, environ 60% des terres sont occupées par des paysages anthropiques. Ces paysages comprennent des villes, des villages, des lignes de communication, des routes, des centres industriels et agricoles. Les huit pays les plus développés consomment plus de la moitié ressources naturelles Terre et émettent 2/5 de la pollution dans l'atmosphère.
La pollution de l'air
L'activité humaine conduit au fait que la pollution pénètre dans l'atmosphère principalement sous deux formes - sous forme d'aérosols (particules en suspension) et de substances gazeuses.
Les principales sources d'aérosols sont l'industrie matériaux de construction, production de ciment, exploitation à ciel ouvert de charbon et de minerais, métallurgie ferreuse et autres industries. La quantité totale d'aérosols d'origine anthropique entrant dans l'atmosphère au cours de l'année est de 60 millions de tonnes. C'est plusieurs fois moins que la quantité de pollution d'origine naturelle (tempêtes de poussière, volcans).
Beaucoup plus dangereuses sont les substances gazeuses, qui représentent 80 à 90 % de toutes les émissions anthropiques. Ce sont des composés de carbone, de soufre et d'azote. Les composés carbonés, principalement le dioxyde de carbone, ne sont pas toxiques en eux-mêmes, mais le danger d'un processus aussi global que "l'effet de serre" est associé à son accumulation. De plus, du monoxyde de carbone est émis, principalement par les moteurs à combustion interne. pollution anthropique atmosphère hydrosphère Les composés azotés sont représentés par des gaz toxiques - oxyde d'azote et peroxyde. Ils se forment également lors du fonctionnement des moteurs à combustion interne, lors du fonctionnement des centrales thermiques et lors de la combustion des déchets solides. Le plus grand danger est la pollution de l'atmosphère par des composés soufrés, et principalement par du dioxyde de soufre. Des composés soufrés sont émis dans l'atmosphère lors de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans la fusion de métaux non ferreux et la production d'acide sulfurique. La pollution anthropique au soufre est deux fois plus élevée que la pollution naturelle. Le dioxyde de soufre atteint les concentrations les plus élevées dans l'hémisphère nord, en particulier sur le territoire des États-Unis, de l'Europe étrangère, de la partie européenne de la Russie et de l'Ukraine. Elle est plus faible dans l'hémisphère sud. Les pluies acides sont directement liées à la libération de composés soufrés et azotés dans l'atmosphère. Le mécanisme de leur formation est très simple. Le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote dans l'air se combinent avec la vapeur d'eau. Puis, avec les pluies et les brouillards, ils tombent sur le sol sous forme d'acides sulfurique et nitrique dilués. De telles précipitations violent fortement les normes d'acidité du sol, aggrave l'échange d'eau des plantes et contribue à l'assèchement des forêts, en particulier des conifères. En pénétrant dans les rivières et les lacs, ils oppriment leur flore et leur faune, entraînant souvent la destruction complète de la vie biologique - des poissons aux micro-organismes. Grand mal les pluies acides provoquent et divers modèles(ponts, monuments, etc.). Les principales régions de distribution des précipitations acides dans le monde sont les États-Unis, Europe d'outre-mer, la Russie et les pays de la CEI. Mais récemment, ils ont été observés dans les régions industrielles du Japon, de la Chine et du Brésil. La distance entre les zones de formation et les zones de précipitations acides peut atteindre même des milliers de kilomètres. Par exemple, les principaux responsables des précipitations acides en Scandinavie sont les régions industrielles de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne. Pollution anthropique de l'hydrosphère
Les scientifiques distinguent trois types de pollution de l'hydrosphère : physique, chimique et biologique. La pollution physique désigne principalement la pollution thermique résultant du rejet d'eau chauffée utilisée pour le refroidissement des centrales thermiques et des centrales nucléaires. Le rejet de ces eaux entraîne une violation du régime naturel des eaux. Par exemple, les rivières dans les endroits où ces eaux sont déversées ne gèlent pas. Dans les réservoirs fermés, cela entraîne une diminution de la teneur en oxygène, ce qui entraîne la mort des poissons et le développement rapide d'algues unicellulaires ("blooming" de l'eau). La contamination physique comprend également la contamination radioactive. La pollution biologique est créée par des micro-organismes, souvent pathogènes. Ils pénètrent dans le milieu aquatique avec les effluents des industries chimiques, des pâtes et papiers, des industries alimentaires et des complexes d'élevage. Ces effluents peuvent être sources de diverses maladies. Un problème particulier dans ce domaine est la pollution des océans. Cela se passe de trois manières. Le premier d'entre eux est le ruissellement des rivières, avec lequel des millions de tonnes de divers métaux, composés de phosphore et pollution organique pénètrent dans l'océan. Dans le même temps, presque toutes les substances en suspension et la plupart des substances dissoutes se déposent à l'embouchure des rivières et des plateaux adjacents. La deuxième voie de pollution est associée aux précipitations, avec lesquelles la majeure partie du plomb, la moitié du mercure et les pesticides pénètrent dans l'océan mondial. Enfin, la troisième voie est directement liée à l'activité économique humaine dans les eaux de l'océan mondial. Le type de pollution le plus courant est la pollution par les hydrocarbures lors du transport et de l'extraction du pétrole. Résultats de l'impact anthropique
le réchauffement climatique a commencé. En raison de "l'effet de serre", la température de la surface de la Terre au cours des 100 dernières années a augmenté de 0,5 à 0,6°C. Les sources de CO2 responsables de la majeure partie de l'effet de serre sont les processus de combustion du charbon, du pétrole et du gaz et la perturbation de l'activité des communautés de micro-organismes du sol dans la toundra, consommant jusqu'à 40 % du CO2 émis dans l'atmosphère ; En raison de la charge anthropique sur la biosphère, de nouveaux problèmes environnementaux sont apparus : la montée du niveau des océans de la planète s'est considérablement accélérée. Au cours des 100 dernières années, le niveau de la mer a augmenté de 10 à 12 cm et ce processus s'est maintenant multiplié par dix. Cela menace d'inonder de vastes zones sous le niveau de la mer (Hollande, région de Venise, Saint-Pétersbourg, Bangladesh, etc.) ; il y a eu un appauvrissement de la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre (ozonosphère), retardant la destruction de tous les êtres vivants rayonnement ultraviolet. On pense que la principale contribution à la destruction de l'ozonosphère est apportée par les chloro-fluoro-carbones (c'est-à-dire les fréons). Ils sont utilisés comme réfrigérants et dans des bombes aérosols. Pollution de l'océan mondial, enfouissement de substances toxiques et radioactives, saturation de ses eaux en dioxyde de carbone de l'atmosphère, pollution par les produits pétroliers, les métaux lourds, les composés organiques complexes, perturbation de la connexion écologique normale entre l'océan et les eaux terrestres en raison de la construction de barrages et autres ouvrages hydrauliques. Épuisement et pollution les eaux de surface sushis et eaux souterraines, déséquilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Contamination radioactive de zones locales et de certaines régions, en lien avec l'accident de Tchernobyl, l'exploitation d'engins nucléaires et les essais nucléaires. Accumulation continue de substances toxiques et radioactives, de déchets ménagers et de déchets industriels (en particulier les plastiques non en décomposition) à la surface du sol, apparition de réactions chimiques secondaires avec formation de substances toxiques. Désertification de la planète, expansion des déserts déjà existants et approfondissement du processus de désertification lui-même. Réduction des superficies de forêts tropicales et septentrionales, entraînant une diminution de la quantité d'oxygène et la disparition d'espèces animales et végétales.
Facteurs anthropiques - un ensemble de facteurs environnementaux causés par des activités humaines accidentelles ou intentionnelles pendant la période de son existence.
Types de facteurs anthropiques :
· physique - utilisation énergie atomique, la circulation dans les trains et les avions, l'impact du bruit et des vibrations, etc. ;
· chimique - utilisation engrais minéraux et pesticides, pollution des enveloppes terrestres par les déchets industriels et de transport ; tabagisme, consommation d'alcool et de drogues, consommation excessive médicaments;
· social - associés aux relations humaines et à la vie en société.
· Au cours des dernières décennies, l'impact des facteurs anthropiques a considérablement augmenté, ce qui a conduit à l'émergence de problèmes environnementaux mondiaux : l'effet de serre, les pluies acides, la déforestation et la désertification des territoires, la pollution de l'environnement par des substances nocives et une réduction de la diversité de la planète.
Habitat humain. Les facteurs anthropiques affectent l'environnement humain. Puisqu'il est une créature biosociale, ils distinguent les habitats naturels et sociaux.
habitat naturel donne à une personne la santé et le matériel pour activité de travail, est en étroite interaction avec lui : une personne modifie constamment le milieu naturel au cours de son activité ; l'environnement naturel transformé, à son tour, affecte une personne.
Une personne communique tout le temps avec d'autres personnes, nouant avec elles des relations interpersonnelles, ce qui détermine habitat social . La communication peut être favorable(favorisant le développement personnel) et défavorable(conduisant à une surcharge psychologique et des dépressions, à l'acquisition d'addictions - alcoolisme, toxicomanie, etc.).
Environnement abiotique (facteurs environnementaux) - Il s'agit d'un ensemble de conditions de l'environnement inorganique qui affectent le corps. (Lumière, température, vent, air, pression, humidité, etc.)
Par exemple : l'accumulation d'éléments toxiques et chimiques dans le sol, l'assèchement des masses d'eau lors d'une sécheresse, l'allongement de la durée du jour, le rayonnement ultraviolet intense.
FACTEURS ABIOTIQUES, divers facteurs non liés aux organismes vivants.
Lumière - le facteur abiotique le plus important auquel toute vie sur Terre est liée. Dans le spectre lumière du soleil allouer trois zones biologiquement inégales ; ultraviolet, visible et infrarouge.
Toutes les plantes en relation avec la lumière peuvent être divisées dans les groupes suivants:
■ plantes photophiles - héliophytes(du grec "helios" - le soleil et fiton - une plante);
■ plantes d'ombrage - sciophytes(du grec "scia" - une ombre et "phyton" - une plante);
■ plantes tolérantes à l'ombre - héliophytes facultatifs.
Températureà la surface de la terre dépend de la latitude géographique et de la hauteur au-dessus du niveau de la mer. De plus, il change avec les saisons de l'année. À cet égard, les animaux et les plantes ont diverses adaptations aux conditions de température. Dans la plupart des organismes, les processus vitaux se déroulent dans la plage de -4°С à +40…45°С
La thermorégulation la plus parfaite n'est apparue qu'en vertébrés supérieurs - oiseaux et mammifères, leur offrant un large peuplement dans toutes les zones climatiques. Ils ont reçu le nom d'organismes homoiothermiques (grec h o m o y o s - égal).
7. Le concept de population. Structure, système, caractéristiques et dynamique des populations. homéostasie de la population.
9. Le concept de niche écologique. Loi d'exclusion compétitive G. F. Gause.
niche écologique- c'est l'ensemble de toutes les connexions de l'espèce avec l'habitat, qui assurent l'existence et la reproduction des individus de cette espèce dans la nature.
Le terme niche écologique a été proposé en 1917 par J. Grinnell pour caractériser la distribution spatiale des groupes écologiques intraspécifiques.
Initialement, le concept de niche écologique était proche du concept d'habitat. Mais en 1927, C. Elton définit une niche écologique comme la position d'une espèce dans une communauté, soulignant l'importance particulière des relations trophiques. L'écologiste domestique G.F. Gause a élargi cette définition : une niche écologique est la place d'une espèce dans un écosystème.
En 1984, S. Spurr et B. Barnes ont identifié trois composantes d'une niche : spatiale (où), temporelle (quand) et fonctionnelle (comment). Ce concept de niche met l'accent sur l'importance des composantes spatiales et temporelles de la niche, y compris ses changements saisonniers et diurnes, en tenant compte des biorythmes circadiens et circadiens.
Une définition figurative d'une niche écologique est souvent utilisée : un habitat est l'adresse d'une espèce, et une niche écologique est son métier (Yu. Odum).
Le principe d'exclusion compétitive ; (= Théorème de Gause ; = Loi de Gause)
Le principe d'exclusion de Gause - en écologie - la loi selon laquelle deux espèces ne peuvent exister dans la même localité si elles occupent la même niche écologique.
En lien avec ce principe, lorsque les possibilités de séparation spatio-temporelle sont limitées, l'une des espèces développe une nouvelle niche écologique ou disparaît.
Le principe d'exclusion compétitive contient deux dispositions générales relatives aux espèces sympatriques :
1) si deux espèces occupent la même niche écologique, alors presque certainement l'une d'entre elles surpasse l'autre dans cette niche et finira par déplacer les espèces les moins adaptées. Ou, en plus forme courte, « la coexistence entre concurrents complets est impossible » (Hardin, 1960*). La seconde proposition découle de la première ;
2) si deux espèces coexistent dans un état d'équilibre stable, alors elles doivent être écologiquement différenciées afin qu'elles puissent occuper des niches différentes. ,
Le principe d'exclusion compétitive peut être traité de différentes manières : comme un axiome et comme une généralisation empirique. Si on le considère comme un axiome, alors il est logique, cohérent et s'avère très heuristique. Si on la considère comme une généralisation empirique, elle est valable dans de larges limites, mais n'est pas universelle.
Modules complémentaires
La compétition interspécifique peut être observée dans des populations mixtes de laboratoire ou dans communautés naturelles. Pour ce faire, il suffit de supprimer artificiellement une espèce et de voir s'il y a des changements dans l'abondance d'une autre espèce sympatrique ayant des besoins écologiques similaires. Si le nombre de cette autre espèce augmente après la suppression de la première espèce, alors nous pouvons conclure qu'elle a été précédemment supprimée sous l'influence de la compétition interspécifique.
Ce résultat a été obtenu dans des populations mixtes de laboratoire de Paramecium aurelia et P. caudatum (Gause, 1934*) et dans des communautés littorales naturelles de balanes (Chthamalus et Balanus) (Connell, 1961*), ainsi que dans un certain nombre d'études relativement récentes , par exemple, sur les sauteurs sacculaires et les salamandres sans poumons (Lemen et Freeman, 1983; Hairston, 1983*).
La concurrence interspécifique se manifeste sous deux grands aspects, que l'on peut appeler concurrence de consommation et concurrence d'interférence. Le premier aspect est l'utilisation passive différents types la même ressource.
Par exemple, entre divers types arbustes dans une communauté désertique, une compétition passive ou non agressive pour les ressources limitées en humidité du sol est très probable. Les espèces de Geospiza et d'autres pinsons terrestres des Galápagos se disputent la nourriture, et cette compétition est un facteur important dans la détermination de leur répartition écologique et géographique sur plusieurs îles (Lack, 1947 ; B. R. Grant, P. R. Grant, 1982 ; P. R. Grant, 1986* ) .
Le deuxième aspect, qui chevauche souvent le premier, est la suppression directe d'une espèce par une autre espèce concurrente.
Les feuilles de certaines espèces végétales produisent des substances qui pénètrent dans le sol et inhibent la germination et la croissance des plantes voisines (Muller, 1966 ; 1970 ; Whittaker et Feeny, 1971*). Chez les animaux, la suppression d'une espèce par une autre peut être obtenue par un comportement agressif ou une affirmation de supériorité basée sur des menaces d'attaque. Dans le désert de Mojave (Californie et Nevada), le mouflon indigène (Ovis canadensis) et l'âne sauvage (Equus asinus) se disputent l'eau et la nourriture. Dans les affrontements directs, les ânes dominent les moutons : lorsque les ânes s'approchent des points d'eau occupés par les moutons, ces derniers leur cèdent la place, et parfois même quittent la zone (Laycock, 1974 ; voir aussi Monson et Summer, 1980*).
La compétition d'exploitation a reçu beaucoup d'attention en écologie théorique, mais comme le souligne Hurston (1983*), la compétition d'interférence est probablement plus favorable pour une espèce donnée.
10. Chaînes alimentaires, réseaux trophiques, niveaux trophiques. pyramides écologiques.
11. Le concept d'écosystème. Changements cycliques et dirigés dans les écosystèmes. Structure et productivité biologique des écosystèmes.
12. Les agroécosystèmes et leurs caractéristiques. Stabilité et instabilité des écosystèmes.
13. Écosystèmes et biogéocénoses. Théorie de la biogéocénologie VN Sukacheva.
14. Dynamique et problèmes de stabilité des écosystèmes. Succession écologique : classification et types.
15. La biosphère en tant que plus haut niveau d'organisation des systèmes vivants. Les limites de la biosphère.
La biosphère est une coquille organisée et définie de la croûte terrestre, associée à la vie. La base du concept de biosphère est l'idée de matière vivante. Plus de 90% de toute la matière vivante se trouve dans la végétation terrestre.
La principale source de biochimie Les activités des organismes - l'énergie solaire utilisée dans le processus de photosynthèse est verte. Plantes et certains micro-organismes. Pour créer un bio une substance qui fournit de la nourriture et de l'énergie à d'autres organismes. La photosynthèse a conduit à l'accumulation d'oxygène libre dans l'atmosphère, à la formation d'une couche d'ozone qui protège des rayonnements ultraviolets et cosmiques. Il maintient la composition gazeuse moderne de l'atmosphère. Les organismes vivants et leur habitat forment des systèmes intégraux - les biogéocénoses.
Le plus haut niveau d'organisation de la vie sur la planète Terre est la biosphère. Ce terme a été introduit en 1875. Il a été utilisé pour la première fois par le géologue autrichien E. Suess. Cependant, la doctrine de la biosphère en tant que système biologique est apparue dans les années 20 de ce siècle, son auteur est le scientifique soviétique V.I. Vernadsky. La biosphère est cette coquille de la Terre dans laquelle les organismes vivants ont existé et existent encore, et dans la formation de laquelle ils ont joué et jouent le rôle principal. La biosphère a ses propres limites, déterminées par la propagation de la vie. V.I. Vernadsky a distingué trois sphères de vie dans la biosphère :
L'atmosphère est la coquille gazeuse de la Terre. Elle n'est pas toute habitée par la vie, sa propagation est empêchée par le rayonnement ultraviolet. La limite de la biosphère dans l'atmosphère est située à une altitude d'environ 25-27 km, où se trouve la couche d'ozone, absorbant environ 99% rayons ultraviolets. La plus peuplée est la couche superficielle de l'atmosphère (1-1,5 km, et dans les montagnes jusqu'à 6 km d'altitude).
La lithosphère est la coquille solide de la Terre. Il n'est pas non plus complètement habité par des organismes vivants. Distribution
L'existence de la vie ici est limitée par la température, qui augmente progressivement avec la profondeur et, lorsqu'elle atteint 100°C, provoque le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. La profondeur maximale à laquelle des organismes vivants ont été trouvés dans la lithosphère est de 4 à 4,5 km. C'est la limite de la biosphère dans la lithosphère.
3. L'hydrosphère est la coquille liquide de la Terre. Elle est pleine de vie. Vernadsky a tracé la limite de la biosphère dans l'hydrosphère sous le fond de l'océan, car le fond est un produit de l'activité vitale des organismes vivants.
La biosphère est un système biologique gigantesque, qui comprend une grande variété de composants constitutifs, qui sont extrêmement difficiles à caractériser séparément. Vernadsky a proposé d'unir tout ce qui fait partie de la biosphère en groupes en fonction de la nature de l'origine de la substance. Il distingue sept groupes de matière : 1) la matière vivante est la totalité de tous les producteurs, consommateurs et décomposeurs habitant la biosphère ; 2) la matière inerte est un ensemble de substances à la formation desquelles les organismes vivants n'ont pas participé, cette substance s'est formée avant l'apparition de la vie sur Terre (roches montagneuses, rocheuses, éruptions volcaniques); 3) la substance biogénique est un ensemble de substances formées par les organismes eux-mêmes ou résultant de leur activité vitale (charbon, pétrole, calcaire, tourbe et autres minéraux); 4) la substance bioinerte est une substance qui est un système d'équilibre dynamique entre la matière vivante et la matière inerte (sol, croûte d'altération); 5) une substance radioactive est un ensemble de tous les éléments isotopiques qui sont dans un état de désintégration radioactive ; 6) la substance des atomes dispersés est la totalité de tous les éléments qui sont à l'état atomique et ne font partie d'aucune autre substance ; 7) la matière cosmique est un ensemble de substances qui pénètrent dans la biosphère depuis l'espace et qui sont d'origine cosmique (météorites, poussière cosmique).
Vernadsky croyait que la matière vivante joue le rôle principal de transformation dans la biosphère.
16. Le rôle de l'homme dans l'évolution de la biosphère. Influence de l'activité humaine sur les processus modernes dans la biosphère.
17. Matière vivante de la biosphère selon V.I. Vernadsky, ses caractéristiques Le concept de noosphère selon V. I. Vernadsky.
18. Le concept, les causes et les principales tendances de la crise environnementale actuelle.
19. Réduction de la diversité génétique, perte du pool génétique. Croissance démographique et urbanisation.
20. Classification des ressources naturelles. Ressources naturelles épuisables et inépuisables.
Les ressources naturelles sont: --- épuisables - sont divisées en non renouvelables, relativement renouvelables (sols, forêts), renouvelables (animaux). --- inépuisable - air, énergie solaire, eau, sol
21. Sources et étendue de la pollution atmosphérique. Des précipitations acides.
22. Ressources énergétiques du monde. Sources d'énergie alternatives.
23. Effet de serre. L'état de la couche d'ozone.
24. une brève description de le cycle du carbone. Stagnation des cycles.
25. Cycle de l'azote. Fixateurs d'azote. Une brève description de.
26. Le cycle de l'eau dans la nature. Une brève description de.
27. Détermination du cycle biogéochimique. Liste des principaux cycles.
28. Le flux d'énergie et les cycles des éléments biogéniques dans l'écosystème (schéma).
29. Liste des principaux facteurs de formation du sol (selon Dokuchaev).
30. "Succession écologique". "Communauté Climax". Définitions. Exemples.
31. Principes de base de la structure naturelle de la biosphère.
32. "Livre rouge" international. Types d'espaces naturels.
33. Principal zones climatiques le globe (liste courte selon G. Walter).
34. Pollution des eaux océaniques : échelle, composition des polluants, conséquences.
35. Déforestation : ampleur, conséquences.
36. Le principe de la division de l'écologie humaine en écologie humaine en tant qu'organisme et écologie sociale. L'écologie humaine comme autécologie de l'organisme.
37. Pollution biologique de l'environnement. MPC.
38. Classification des polluants rejetés dans les masses d'eau.
39. Facteurs environnementaux qui causent des maladies du système digestif, du système circulatoire, capables de provoquer des néoplasmes malins.
40. Rationnement: concept, types, MPC "Smog": concept, raisons de sa formation, préjudice.
41. Explosion démographique et son danger pour l'état actuel de la biosphère. L'urbanisation et ses conséquences négatives.
42. Le concept de "développement durable". Perspectives du concept de "développement durable" pour le "milliard d'or" de la population des pays économiquement développés.
43. Réserves : fonctions et valeurs. Types de réserves et leur nombre dans la Fédération de Russie, aux États-Unis, en Allemagne et au Canada.
Conditions d'existence
Définition 1
Les conditions d'existence (Conditions de vie) sont l'ensemble des éléments nécessaires aux organismes, avec lesquels ils sont inséparablement liés et sans lesquels ils ne peuvent exister.
L'adaptation des organismes à l'environnement s'appelle l'adaptation. La capacité d'adaptation est l'une des propriétés les plus importantes de la vie, qui offre la possibilité de sa vie, de sa reproduction et de sa survie. Les adaptations apparaissent dans différents niveaux– de la biochimie de la cellule et du comportement d'un organisme individuel au fonctionnement et à la structure de la communauté et de l'écosystème. L'adaptation survient et change au cours de l'évolution des espèces.
Certains éléments de l'environnement ou propriétés qui affectent le corps sont appelés facteurs environnementaux. Il existe de nombreux facteurs environnementaux. Ils ont une nature et une spécificité d'action différentes. Tous les facteurs environnementaux sont divisés en trois grands groupes : biotiques, abiotiques et anthropiques.
Définition 2
Un facteur abiotique est un ensemble de conditions environnementales inorganiques qui affectent indirectement ou directement un organisme vivant : lumière, température, rayonnement radioactif, humidité de l'air, pression, composition saline de l'eau, etc.
Définition 3
Le facteur biotique de l'environnement est un ensemble d'influences exercées sur les plantes par d'autres organismes. toute plante ne vit pas isolée, mais en interconnexion avec d'autres plantes, champignons, micro-organismes, animaux.
Définition 4
Le facteur anthropique est un ensemble de facteurs environnementaux déterminés par les activités intentionnelles ou accidentelles de l'homme et ayant un impact significatif sur le fonctionnement et la structure des écosystèmes.
Facteurs anthropiques
Le groupe de facteurs le plus important à notre époque, qui modifie intensément l'environnement, est directement lié à l'activité humaine multiforme.
Le développement et la formation de l'homme sur le globe ont toujours été associés à des impacts environnementaux, mais à l'heure actuelle, ce processus s'est considérablement accéléré.
Le facteur anthropique comprend tout impact (indirect ou direct) de l'homme sur l'environnement - biogéocénoses, organismes, biosphère, paysages.
en modifiant la nature et en l'adaptant à ses besoins personnels, les gens changent l'habitat des plantes et des animaux, influençant ainsi leur existence. Les impacts peuvent être directs, indirects et accidentels.
Les impacts directs sont dirigés directement sur les organismes vivants. Par exemple, la chasse et la pêche irrationnelles ont considérablement réduit le nombre de nombreuses espèces. Le rythme accéléré et la force croissante de la modification de la nature par l'homme éveillent la nécessité de sa protection.
Les impacts indirects sont réalisés en modifiant le climat, les paysages, la chimie et l'état physique des masses d'eau et de l'atmosphère, la structure des surfaces des sols, la flore et la faune. Une personne déplace ou extermine inconsciemment et consciemment un type de plante ou d'animal, tout en en propageant un autre ou en créant des conditions favorables pour celui-ci. Pour les animaux domestiques et les plantes cultivées, l'humanité a créé en grande partie un nouvel environnement, multipliant par cent la productivité des terres aménagées. Mais cela a rendu impossible l'existence de nombreuses espèces sauvages.
Remarque 1
Il convient de noter que de nombreuses espèces de plantes et d'animaux ont disparu de la planète Terre même sans activité anthropique humaine. Comme un organisme séparé, chaque espèce a sa jeunesse, sa floraison, sa vieillesse et sa mort - c'est un processus naturel. Mais dans des conditions naturelles, cela se produit très lentement, et généralement l'espèce sortante a le temps d'être remplacée par une nouvelle, plus adaptée aux conditions de vie. L'humanité, en revanche, a accéléré les processus d'extinction à un rythme tel que l'évolution a cédé la place à des réorganisations irréversibles et révolutionnaires des écosystèmes.
Les facteurs environnementaux sont tous les facteurs environnementaux agissant sur le corps. Ils sont divisés en 3 groupes :
La meilleure valeur d'un facteur pour un organisme s'appelle optimal(point optimal), par exemple, la température optimale de l'air pour une personne est de 22º.
Facteurs anthropiques
Les influences humaines modifient l'environnement trop rapidement. Cela conduit au fait que de nombreuses espèces deviennent rares et disparaissent. La biodiversité diminue à cause de cela.
Par exemple, conséquences de la déforestation :
- L'habitat des habitants de la forêt (animaux, champignons, lichens, graminées) est en train d'être détruit. Ils peuvent disparaître complètement (diminution de la biodiversité).
- La forêt avec ses racines détient la couche supérieure du sol fertile. Sans support, le sol peut être emporté par le vent (vous obtenez un désert) ou l'eau (vous obtenez des ravins).
- La forêt évapore beaucoup d'eau de la surface de ses feuilles. Si vous supprimez la forêt, l'humidité de l'air dans la région diminuera et l'humidité du sol augmentera (un marécage peut se former).
1. Choisissez trois options. Quels facteurs anthropiques influencent la taille de la population de sangliers dans la communauté forestière ?
1) augmentation du nombre de prédateurs
2) tirer sur des animaux
3) nourrir les animaux
4) la propagation des maladies infectieuses
5) abattre des arbres
6) sévère Météo l'hiver
Réponse
2. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Quels facteurs anthropiques influencent la taille de la population de muguet de mai dans la communauté forestière?
1) abattre des arbres
2) augmentation de l'ombrage
4) cueillette de plantes sauvages
5) basse température de l'air en hiver
6) piétiner le sol
Réponse
3. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Quels processus dans la nature sont classés comme facteurs anthropiques ?
1) appauvrissement de la couche d'ozone
2) changement quotidien de l'éclairage
3) concurrence dans la population
4) accumulation d'herbicides dans le sol
5) relation entre les prédateurs et leurs proies
6) augmentation de l'effet de serre
Réponse
4. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Quels facteurs anthropiques influencent le nombre de plantes répertoriées dans le Livre rouge ?
1) destruction de leur cadre de vie
2) augmentation de l'ombrage
3) manque d'humidité en été
4) extension des zones d'agrocénoses
5) changements de température soudains
6) piétiner le sol
Réponse
5. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Les facteurs environnementaux anthropiques comprennent
1) faire engrais organiques dans le sol
2) diminution de l'éclairement dans les réservoirs avec la profondeur
3) précipitations
4) éclaircir les semis de pin
5) cessation de l'activité volcanique
6) diminution de la profondeur des rivières à la suite de la déforestation
Réponse
6. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Quelles perturbations environnementales dans la biosphère sont causées par des interférences anthropiques ?
1) la destruction de la couche d'ozone de l'atmosphère
2) changements saisonniers de l'éclairement de la surface terrestre
3) diminution du nombre de cétacés
4) l'accumulation de métaux lourds dans les corps des organismes à proximité des autoroutes
5) accumulation d'humus dans le sol à la suite de la chute des feuilles
6) accumulation de roches sédimentaires dans les profondeurs des océans
Réponse
1. Établir une correspondance entre l'exemple et le groupe de facteurs environnementaux qu'il illustre : 1) biotiques, 2) abiotiques
A) surcroissance de l'étang avec des lentilles d'eau
B) augmentation du nombre d'alevins
C) manger des alevins de poisson par un coléoptère nageur
D) formation de glace
E) rejet dans la rivière d'engrais minéraux
Réponse
2. Établir une correspondance entre le processus se déroulant dans la biocénose forestière et le facteur environnemental qu'il caractérise : 1) biotique, 2) abiotique
A) la relation entre les pucerons et les coccinelles
B) l'engorgement du sol
C) changement quotidien de l'éclairage
D) compétition entre espèces de grives
D) augmentation de l'humidité de l'air
E) l'effet du champignon de l'amadou sur le bouleau
Réponse
3. Établir une correspondance entre les exemples et les facteurs environnementaux qui sont illustrés par ces exemples : 1) abiotique, 2) biotique. Écris les nombres 1 et 2 dans le bon ordre.
A) une augmentation de la pression atmosphérique
B) modification de la topographie de l'écosystème causée par un tremblement de terre
C) un changement dans la population de lièvres à la suite d'une épidémie
D) interaction entre loups en meute
D) concurrence pour le territoire entre les pins dans la forêt
Réponse
4. Établir une correspondance entre les caractéristiques du facteur environnemental et son type : 1) biotique, 2) abiotique. Écris les nombres 1 et 2 dans le bon ordre.
A) rayons ultraviolets
B) assèchement des masses d'eau pendant une sécheresse
C) la migration des animaux
D) pollinisation des plantes par les abeilles
D) photopériodisme
E) une diminution du nombre d'écureuils pendant les années de vaches maigres
Réponse
Réponse
6f. Établir une correspondance entre les exemples et les facteurs environnementaux qui sont illustrés par ces exemples : 1) abiotique, 2) biotique. Notez les chiffres 1 et 2 dans l'ordre correspondant aux lettres.
A) une augmentation de l'acidité du sol causée par une éruption volcanique
B) modification du relief de la biogéocénose de la prairie après la crue
C) modification de la population de sangliers suite à l'épidémie
D) interaction entre les trembles dans l'écosystème forestier
E) compétition de territoire entre tigres mâles
Réponse
7f. Établir une correspondance entre les facteurs environnementaux et les groupes de facteurs : 1) biotiques, 2) abiotiques. Notez les chiffres 1 et 2 dans l'ordre correspondant aux lettres.
A) fluctuations quotidiennes de la température de l'air
B) changement de la durée du jour
B) relation prédateur-proie
D) symbiose d'algues et de champignons dans le lichen
D) modification de l'humidité de l'environnement
Réponse
Réponse
2. Associez les exemples aux facteurs environnementaux illustrés par ces exemples : 1) biotique, 2) abiotique, 3) anthropique. Écris les nombres 1, 2 et 3 dans le bon ordre.
A) les feuilles d'automne
B) Planter des arbres dans le parc
C) La formation d'acide nitrique dans le sol lors d'un orage
D) Éclairage
E) La lutte pour les ressources dans la population
E) Émissions de fréon dans l'atmosphère
Réponse
3. Établir une correspondance entre exemples et facteurs environnementaux : 1) abiotiques, 2) biotiques, 3) anthropiques. Notez les chiffres 1 à 3 dans l'ordre correspondant aux lettres.
A) modification de la composition gazeuse de l'atmosphère
B) dispersion des graines de plantes par les animaux
C) l'assèchement humain des marécages
D) une augmentation du nombre de consommateurs dans la biocénose
D) changement de saisons
E) déforestation
Réponse
Réponse
Réponse
1. Choisissez trois bonnes réponses sur six et notez-les dans les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Pour une diminution du nombre de protéines dans forêt de conifères donner les facteurs suivants :
1) réduction du nombre d'oiseaux de proie et de mammifères
2) couper conifères des arbres
3) récolte des cônes d'épinette après un été chaud et sec
4) augmentation de l'activité des prédateurs
5) déclenchement d'épidémies
6) couverture de neige épaisse en hiver
Réponse
Réponse
Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. La destruction des forêts dans de vastes zones conduit à
1) une augmentation de la quantité d'impuretés azotées nocives dans l'atmosphère
2) violation de la couche d'ozone
3) violation du régime des eaux
4) modification des biogéocénoses
5) violation de la direction des flux d'air
6) réduction de la diversité des espèces
Réponse
1. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Précisez les facteurs biotiques parmi les facteurs environnementaux.
1) inondation
2) compétition entre les individus de l'espèce
3) baisser la température
4) la prédation
5) manque de lumière
6) formation de mycorhizes
Réponse
2. Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Les facteurs biotiques sont
1) la prédation
2) feu de forêt
3) compétition entre individus d'espèces différentes
4) montée en température
5) formation de mycorhizes
6) manque d'humidité
Réponse
1. Choisissez trois bonnes réponses sur six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées dans le tableau. Parmi les facteurs environnementaux suivants, lesquels sont abiotiques ?
1) température de l'air
2) la pollution par les gaz à effet de serre
3) la présence de déchets non recyclables
4) la présence d'une route
5) éclairage
6) concentration en oxygène
Réponse
2. Choisissez trois bonnes réponses sur six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées dans le tableau. Les facteurs abiotiques comprennent :
1) Migration saisonnière des oiseaux
2) Éruption volcanique
3) L'apparition d'une tornade
4) Construction par des castors de platine
5) La formation d'ozone lors d'un orage
6) Déforestation
Réponse
3. Choisissez trois bonnes réponses sur six et notez dans la réponse les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Les composants abiotiques de l'écosystème steppique comprennent:
1) végétation herbacée
2) érosion éolienne
3) composition minérale sol
4) mode pluie
5) composition spécifique des micro-organismes
6) pâturage saisonnier du bétail
Réponse
Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Quels facteurs environnementaux peuvent être limitants pour l'omble de fontaine?
1) eau douce
2) teneur en oxygène inférieure à 1,6 mg/l
3) température de l'eau +29 degrés
4) salinité de l'eau
5) éclairage du réservoir
6) la vitesse de la rivière
Réponse
1. Établir une correspondance entre le facteur environnemental et le groupe auquel il appartient : 1) anthropique, 2) abiotique. Écris les nombres 1 et 2 dans le bon ordre.
A) irrigation artificielle des terres
B) chute de météorite
B) labourer une terre vierge
D) crue printanière des eaux
D) construire un barrage
E) mouvement des nuages
Réponse
2. Établir une correspondance entre les caractéristiques du milieu et le facteur environnemental : 1) anthropique, 2) abiotique. Notez les chiffres 1 et 2 dans l'ordre correspondant aux lettres.
A) la déforestation
B) douches tropicales
B) la fonte des glaciers
D) plantations forestières
D) drainage des marécages
E) une augmentation de la durée du jour au printemps
Réponse
Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Les facteurs anthropiques suivants peuvent modifier le nombre de producteurs dans un écosystème :
1) collection de plantes à fleurs
2) augmentation du nombre de consommateurs de premier ordre
3) le piétinement des plantes par les touristes
4) diminution de l'humidité du sol
5) abattre des arbres creux
6) augmentation du nombre de consommateurs des deuxième et troisième ordres
Réponse
Lisez le texte. Choisissez trois phrases décrivant des facteurs abiotiques. Notez les numéros sous lesquels ils sont indiqués. (1) La principale source de lumière sur Terre est le Soleil. (2) Chez les plantes photophiles, en règle générale, des limbes fortement disséqués, un grand nombre de stomates dans l'épiderme. (3) Humidité ambiante - condition importante l'existence d'organismes vivants. (4) Les plantes ont développé des adaptations pour maintenir l'équilibre hydrique du corps. (5) La teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère est essentielle pour les organismes vivants.
Réponse
Choisissez trois bonnes réponses parmi six et notez les chiffres sous lesquels elles sont indiquées. Avec une forte diminution du nombre d'insectes pollinisateurs dans le pré au fil du temps
1) le nombre de plantes pollinisées par les insectes est réduit
2) le nombre d'oiseaux de proie augmente
3) le nombre d'herbivores augmente
4) le nombre de plantes pollinisées par le vent augmente
5) l'horizon hydrique du sol change
6) le nombre d'oiseaux insectivores diminue
Réponse
© D.V.Pozdnyakov, 2009-2019
Facteurs anthropiques - un ensemble de diverses influences humaines sur la nature inanimée et vivante. Ce n'est que par leur existence physique que les gens ont un impact notable sur l'environnement : en respirant, ils libèrent chaque année 1 10 12 kg de CO 2 dans l'atmosphère et consomment plus de 5 à 10 15 kcal avec de la nourriture.
En raison de l'impact humain, le climat, la topographie de surface, la composition chimique de l'atmosphère changent, les espèces et les écosystèmes naturels disparaissent, etc. Le facteur anthropique le plus important pour la nature est l'urbanisation.
L'activité anthropique affecte de manière significative les facteurs climatiques, modifiant leurs régimes. Par exemple, les émissions massives de particules solides et liquides dans l'atmosphère par les entreprises industrielles peuvent modifier radicalement le régime de dispersion du rayonnement solaire dans l'atmosphère et réduire l'apport de chaleur à la surface de la Terre. La destruction des forêts et autres végétations, la création de grands réservoirs artificiels sur d'anciennes terres augmentent la réflexion de l'énergie, et la pollution par la poussière, par exemple la neige et la glace, au contraire, augmente l'absorption, ce qui entraîne leur fonte intensive.
Dans une bien plus grande mesure, la biosphère est affectée par activité de production de personnes. Du fait de cette activité, le relief, la composition de la croûte terrestre et de l'atmosphère, le changement climatique et la redistribution des eau fraiche, les écosystèmes naturels disparaissent et des agro- et techno-écosystèmes artificiels se créent, plantes cultivées, les animaux sont domestiqués, etc.
L'impact humain peut être direct ou indirect. Par exemple, la déforestation et le déracinement des forêts ont non seulement un effet direct, mais aussi un effet indirect - les conditions d'existence des oiseaux et des animaux changent. On estime que depuis 1600, 162 espèces d'oiseaux, plus de 100 espèces de mammifères et de nombreuses autres espèces de plantes et d'animaux ont été détruites par l'homme. Mais, d'autre part, il crée de nouvelles variétés de plantes et de races animales, augmente leur rendement et leur productivité. La migration artificielle des plantes et des animaux affecte également la vie des écosystèmes. Ainsi, les lapins amenés en Australie se sont tellement multipliés qu'ils ont causé de grands dégâts à l'agriculture.
La manifestation la plus évidente de l'influence anthropique sur la biosphère est la pollution de l'environnement. L'importance des facteurs anthropiques ne cesse de croître, à mesure que l'homme subjugue de plus en plus la nature.
L'activité humaine est une combinaison de la transformation par l'homme de facteurs environnementaux naturels à ses propres fins et de la création de nouveaux facteurs qui n'existaient pas auparavant dans la nature. La fusion de métaux à partir de minerais et la production d'équipements sont impossibles sans la création de températures élevées, de pressions et de champs électromagnétiques puissants. Recevoir et sauvegarder rendements élevés cultures nécessite la production d'engrais et de moyens de protection chimique des plantes contre les ravageurs et les agents pathogènes. Les soins de santé modernes ne peuvent être imaginés sans chimiothérapie et physiothérapie.
Les réalisations du progrès scientifique et technologique ont commencé à être utilisées à des fins politiques et économiques, ce qui s'est extrêmement manifesté dans la création de facteurs environnementaux spéciaux affectant une personne et ses biens: des armes à feu aux moyens d'impact physique, chimique et biologique de masse. Dans ce cas, on parle d'un ensemble d'anthropotropes (visant à corps humain) et les facteurs anthropiques à l'origine de la pollution de l'environnement.
D'autre part, en plus de ces facteurs utiles, dans le processus d'exploitation et de traitement des ressources naturelles, des composés chimiques secondaires et des zones de niveaux élevés de facteurs physiques se forment inévitablement. Dans des conditions d'accidents et de catastrophes, ces processus peuvent être de nature spasmodique avec de graves conséquences environnementales et matérielles. Par conséquent, il était nécessaire de créer des voies et moyens de protéger une personne contre des facteurs nocifs qui a été réalisé à l'heure actuelle dans le système mentionné ci-dessus - la sécurité des personnes.
plasticité écologique. Malgré grande variété facteurs environnementaux, dans la nature de leur impact et dans les réponses des organismes vivants, un certain nombre de schémas généraux peuvent être identifiés.
L'effet de l'influence des facteurs dépend non seulement de la nature de leur action (qualité), mais également de la valeur quantitative perçue par les organismes - température élevée ou basse, degré d'éclairage, humidité, quantité de nourriture, etc. Au cours de l'évolution, la capacité des organismes à s'adapter aux facteurs environnementaux dans certaines limites quantitatives s'est développée. Une diminution ou une augmentation de la valeur du facteur au-delà de ces limites inhibe l'activité vitale et lorsqu'un certain niveau minimum ou maximum est atteint, les organismes meurent.
Les zones d'action du facteur écologique et la dépendance théorique de l'activité vitale d'un organisme, d'une population ou d'une communauté dépendent de la valeur quantitative du facteur. La gamme quantitative de tout facteur environnemental, le plus favorable à la vie, est appelée l'optimum écologique (lat. ortimus- le meilleur). Les valeurs du facteur situé dans la zone d'oppression sont appelées le pessimum écologique (le pire).
Les valeurs minimale et maximale du facteur auquel le décès survient sont appelées respectivement minimum écologique et maximum écologique
Toutes les espèces d'organismes, de populations ou de communautés sont adaptées, par exemple, pour exister dans une certaine plage de température.
La propriété des organismes à s'adapter à l'existence dans une gamme particulière de facteurs environnementaux s'appelle la plasticité écologique.
Plus la gamme du facteur écologique dans lequel un organisme donné peut vivre est large, plus sa plasticité écologique est grande.
Selon le degré de plasticité, on distingue deux types d'organismes : les sténobiontes (stenoeks) et les eurybiontes (euryeks).
Les organismes sténobiotiques et eurybiontes diffèrent par la gamme de facteurs écologiques dans lesquels ils peuvent vivre.
Sténobionte(gr. sténos- étroites, à l'étroit), ou étroitement adaptées, les espèces ne peuvent exister qu'avec de petites déviations
facteur de la valeur optimale.
Eurybiontique(gr. eirys- large) sont appelés des organismes largement adaptés qui peuvent supporter une grande amplitude de fluctuations du facteur environnemental.
Historiquement, s'adaptant aux facteurs environnementaux, les animaux, les plantes, les micro-organismes se sont répartis dans divers milieux, formant toute la diversité des écosystèmes qui forment la biosphère terrestre.
des facteurs limitants. La notion de facteurs limitants repose sur deux lois de l'écologie : la loi du minimum et la loi de la tolérance.
La loi du minimum. Au milieu du siècle dernier, le chimiste allemand J. Liebig (1840), étudiant l'effet des nutriments sur la croissance des plantes, a découvert que le rendement ne dépend pas des nutriments nécessaires à grandes quantités et sont présents en abondance (par exemple, CO 2 et H 2 0), mais de ceux qui, bien que la plante en ait besoin en plus petites quantités, sont pratiquement absents du sol ou inaccessibles (par exemple, phosphore, zinc, bore).
Liebig a formulé ce modèle comme suit : "La croissance d'une plante dépend de l'élément nutritif présent en quantité minimale." Plus tard, cette conclusion est devenue connue sous le nom de Loi du minimum de Liebig et a été étendu à de nombreux autres facteurs environnementaux. Le développement des organismes peut être limité ou limité par la chaleur, la lumière, l'eau, l'oxygène et d'autres facteurs, si leur valeur correspond au minimum écologique. Par exemple, les poissons-anges tropicaux meurent si la température de l'eau descend en dessous de 16 °C. Et le développement des algues dans les écosystèmes des grands fonds est limité par la profondeur de pénétration de la lumière solaire : il n'y a pas d'algues dans les couches inférieures.
La loi du minimum de Liebig en termes généraux peut être formulée comme suit: la croissance et le développement des organismes dépendent avant tout des facteurs environnementaux dont les valeurs se rapprochent du minimum écologique.
La recherche a montré que la loi du minimum a deux limites qui doivent être prises en compte dans l'application pratique.
La première limitation est que la loi de Liebig n'est strictement applicable que dans des conditions d'état stationnaire du système. Par exemple, dans une certaine masse d'eau, la croissance des algues est limitée à vivo manque de phosphate. Les composés azotés sont contenus dans l'eau en excès. S'ils commencent à se déverser dans ce réservoir Eaux usées avec une teneur élevée en phosphore minéral, le réservoir peut alors «fleurir». Ce processus progressera jusqu'à ce que l'un des éléments soit utilisé jusqu'au minimum limite. Maintenant, ce pourrait être de l'azote si le phosphore continue de couler. Au moment de la transition (quand il y a encore assez d'azote et qu'il y a déjà assez de phosphore), l'effet minimum n'est pas observé, c'est-à-dire qu'aucun de ces éléments n'affecte la croissance des algues.
La deuxième limite est liée à l'interaction de plusieurs facteurs. Parfois, l'organisme est capable de remplacer l'élément déficient par un autre chimiquement proche. Ainsi, dans les endroits où il y a beaucoup de strontium, dans les coquilles de mollusques, il peut remplacer le calcium en manque de ce dernier. Ou, par exemple, le besoin en zinc de certaines plantes est réduit s'ils poussent à l'ombre. Ainsi, une faible concentration en zinc limitera moins la croissance des plantes à l'ombre qu'en pleine lumière. Dans ces cas, l'effet limitant d'une quantité même insuffisante de l'un ou l'autre élément peut ne pas se manifester.
Loi de tolérance(lat . tolérance- patience) a été découvert par le biologiste anglais W. Shelford (1913), qui a attiré l'attention sur le fait que non seulement les facteurs environnementaux, dont les valeurs sont minimales, mais aussi ceux qui se caractérisent par un maximum écologique, peuvent limiter le développement des organismes vivants. Trop de chaleur, de lumière, d'eau et même de nutriments peuvent être tout aussi dommageables que trop peu. La plage du facteur environnemental entre le minimum et le maximum W. Shelford appelé limite de tolérance.
La limite de tolérance décrit l'amplitude des fluctuations des facteurs, ce qui assure l'existence la plus complète de la population. Les individus peuvent avoir des plages de tolérance légèrement différentes.
Plus tard, des limites de tolérance ont été établies pour divers facteurs environnementaux pour de nombreuses plantes et animaux. Les lois de J. Liebig et W. Shelford ont aidé à comprendre de nombreux phénomènes et la distribution des organismes dans la nature. Les organismes ne peuvent pas être distribués partout car les populations ont une certaine limite de tolérance par rapport aux fluctuations des facteurs environnementaux environnementaux.
La loi de tolérance de W. Shelford est formulée comme suit: la croissance et le développement des organismes dépendent principalement des facteurs environnementaux dont les valeurs se rapprochent du minimum écologique ou du maximum écologique.
Ce qui suit a été établi :
Les organismes avec une large gamme de tolérance à tous les facteurs sont largement distribués dans la nature et sont souvent cosmopolites, comme de nombreuses bactéries pathogènes ;
Les organismes peuvent avoir une large plage de tolérance pour un facteur et une plage étroite pour un autre. Par exemple, les gens sont plus tolérants au manque de nourriture qu'au manque d'eau, c'est-à-dire que la limite de tolérance pour l'eau est plus étroite que pour la nourriture ;
Si les conditions pour l'un des facteurs environnementaux deviennent sous-optimales, la limite de tolérance pour d'autres facteurs peut également changer. Par exemple, avec un manque d'azote dans le sol, les céréales nécessitent beaucoup plus d'eau ;
Les limites réelles de tolérance observées dans la nature sont inférieures au potentiel d'adaptation de l'organisme à ce facteur. Cela s'explique par le fait que dans la nature les limites de tolérance par rapport aux conditions physiques du milieu peuvent être rétrécies par les relations biotiques : compétition, manque de pollinisateurs, prédateurs, etc. Toute personne réalise mieux son potentiel dans des conditions favorables (rassemblements d'athlètes pour un entraînement spécial avant des compétitions importantes, ). La plasticité écologique potentielle de l'organisme, déterminée en laboratoire, est supérieure aux possibilités réalisées dans les conditions naturelles. Ainsi, les niches écologiques potentielles et réalisées sont distinguées ;
Les limites de tolérance chez les individus reproducteurs et leur progéniture sont inférieures à celles des adultes, c'est-à-dire que les femelles pendant la saison de reproduction et leur progéniture sont moins robustes que les organismes adultes. Ainsi, la répartition géographique du gibier à plumes est plus souvent déterminée par l'influence du climat sur les œufs et les poussins, et non sur les oiseaux adultes. Le soin de la progéniture et le respect de la maternité sont dictés par les lois de la nature. Malheureusement, parfois les "réalisations" sociales contredisent ces lois ;
Les valeurs extrêmes (de stress) de l'un des facteurs entraînent une diminution de la limite de tolérance pour les autres facteurs. Si de l'eau chauffée est déversée dans la rivière, les poissons et autres organismes dépensent presque toute leur énergie pour faire face au stress. Ils n'ont pas assez d'énergie pour se nourrir, se protéger des prédateurs, se reproduire, ce qui conduit à une extinction progressive. Le stress psychologique peut également causer de nombreux troubles somatiques (gr. soma- corps) maladies non seulement chez les humains, mais aussi chez certains animaux (par exemple, chez les chiens). Aux valeurs stressantes du facteur, l'adaptation à celui-ci devient de plus en plus «coûteuse».
De nombreux organismes sont capables de modifier leur tolérance à des facteurs individuels si les conditions changent progressivement. Vous pouvez, par exemple, vous habituer à la température élevée de l'eau dans le bain, si vous montez dans de l'eau tiède, puis ajoutez progressivement de l'eau chaude. Cette adaptation à l'évolution lente du facteur est une propriété protectrice utile. Mais cela peut aussi être dangereux. Inattendu, sans signaux d'avertissement, même un petit changement peut être critique. Il y a un effet de seuil : la "goutte d'eau" peut être fatale. Par exemple, une brindille fine peut casser le dos déjà trop tendu d'un chameau.
Si la valeur d'au moins un des facteurs environnementaux s'approche d'un minimum ou d'un maximum, l'existence et la prospérité d'un organisme, d'une population ou d'une communauté deviennent dépendantes de ce facteur limitant la vie.
Un facteur limitant est tout facteur environnemental qui approche ou dépasse les valeurs extrêmes des limites de tolérance. Ces facteurs fortement déviants deviennent d'une importance primordiale dans la vie des organismes et des systèmes biologiques. Ce sont eux qui contrôlent les conditions d'existence.
L'intérêt du concept de facteurs limitants réside dans le fait qu'il permet de comprendre les relations complexes dans les écosystèmes.
Heureusement, tous les facteurs environnementaux possibles ne régulent pas la relation entre l'environnement, les organismes et les humains. Priorité dans une période de temps donnée sont divers facteurs limitants. C'est sur ces facteurs que l'écologiste doit porter son attention dans l'étude des écosystèmes et de leur gestion. Par exemple, la teneur en oxygène dans les habitats terrestres est élevée et il est tellement disponible qu'il ne sert presque jamais de facteur limitant (à l'exception des hautes altitudes et des systèmes anthropiques). L'oxygène intéresse peu les écologistes terrestres. Et dans l'eau, c'est souvent un facteur limitant le développement des organismes vivants (« kills » de poissons par exemple). Par conséquent, un hydrobiologiste mesure toujours la teneur en oxygène de l'eau, contrairement à un vétérinaire ou à un ornithologue, bien que l'oxygène ne soit pas moins important pour les organismes terrestres que pour les organismes aquatiques.
Des facteurs limitatifs déterminent également l'aire de répartition géographique de l'espèce. Ainsi, le mouvement des organismes vers le sud est généralement limité par un manque de chaleur. Les facteurs biotiques limitent également souvent la distribution de certains organismes. Par exemple, les figues apportées de la Méditerranée en Californie n'y ont pas porté de fruits tant qu'elles n'ont pas deviné d'y apporter un certain type de guêpe - le seul pollinisateur de cette plante. L'identification des facteurs limitants est très importante pour de nombreuses activités, notamment l'agriculture. Avec un impact ciblé sur les conditions limites, il est possible d'augmenter rapidement et efficacement le rendement des plantes et la productivité des animaux. Ainsi, lors de la culture du blé sur sols acides aucune mesure agronomique n'aura d'effet si le chaulage n'est pas appliqué, ce qui réduira l'effet limitant des acides. Ou si vous cultivez du maïs sur des sols à très faible teneur en phosphore, alors même avec suffisamment d'eau, d'azote, de potassium et d'autres nutriments, il cesse de pousser. Le phosphore est le facteur limitant dans ce cas. Et seuls les engrais phosphatés peuvent sauver la récolte. Les plantes peuvent mourir de trop un grand nombre l'eau ou l'excès d'engrais, qui dans ce cas sont également des facteurs limitants.
Connaître les facteurs limitants fournit la clé de la gestion des écosystèmes. Cependant, à différentes périodes de la vie de l'organisme et dans situations différentes divers facteurs agissent comme des facteurs limitants. Par conséquent, seule une régulation habile des conditions d'existence peut donner des résultats de gestion efficaces.
Interaction et compensation des facteurs. Dans la nature, les facteurs environnementaux n'agissent pas indépendamment les uns des autres - ils interagissent. L'analyse de l'influence d'un facteur sur un organisme ou une communauté n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'évaluer l'importance comparative conditions diverses agir ensemble dans de véritables écosystèmes.
Influence conjointe des facteurs peut être envisagée sur l'exemple de la dépendance de la mortalité des larves de crabe à la température, à la salinité et à la présence de cadmium. En l'absence de cadmium, l'optimum écologique (mortalité minimale) est observé dans la gamme de température de 20 à 28 °C et de salinité de 24 à 34 %. Si du cadmium, toxique pour les crustacés, est ajouté à l'eau, l'optimum écologique est alors déplacé: la température se situe entre 13 et 26 ° C et la salinité est de 25 à 29%. Les limites de tolérance évoluent également. La différence entre le maximum et le minimum écologiques pour la salinité après l'ajout de cadmium diminue de 11 - 47 % à 14 - 40 %. La limite de tolérance pour le facteur de température, au contraire, s'étend de 9 - 38 °C à 0 - 42 °C.
La température et l'humidité sont les facteurs climatiques les plus importants dans les habitats terrestres. L'interaction de ces deux facteurs forme essentiellement deux principaux types de climat: maritime et continentale.
Les réservoirs adoucissent le climat terrestre, car l'eau a une chaleur spécifique de fusion et une capacité thermique élevées. Par conséquent, le climat maritime se caractérise par des fluctuations de température et d'humidité moins fortes que le climat continental.
L'effet de la température et de l'humidité sur les organismes dépend également du rapport de leurs valeurs absolues. Ainsi, la température a un effet limitant plus prononcé si l'humidité est très élevée ou très faible. Tout le monde sait que haut et basses températures sont moins bien tolérés humidité élevée qu'avec modéré
La relation entre la température et l'humidité en tant que principaux facteurs climatiques est souvent représentée sous la forme de graphiques de climogrammes, qui permettent de comparer visuellement différentes années et régions et de prédire la production de plantes ou d'animaux pour certaines conditions climatiques.
Les organismes ne sont pas esclaves de l'environnement. Ils s'adaptent aux conditions d'existence et les modifient, c'est-à-dire qu'ils compensent l'impact négatif des facteurs environnementaux.
La compensation des facteurs environnementaux est le désir des organismes d'affaiblir l'effet limitant des influences physiques, biotiques et anthropiques. La compensation des facteurs est possible au niveau de l'organisme et de l'espèce, mais elle est plus efficace au niveau de la communauté.
À différentes températures la même espèce, qui a une large répartition géographique, peut acquérir des propriétés physiologiques et morphologiques (colonne torphe - forme, contour) caractéristiques adaptées aux conditions locales. Par exemple, chez les animaux, les oreilles, les queues, les pattes sont les plus courtes et le corps est le plus massif, plus le climat est froid.
Ce schéma s'appelle la règle d'Allen (1877), selon laquelle les parties saillantes du corps des animaux à sang chaud augmentent à mesure qu'ils se déplacent du nord au sud, ce qui est associé à une adaptation au maintien d'une température corporelle constante dans diverses conditions climatiques. Ainsi, les renards vivant au Sahara ont de longs membres et d'énormes oreilles ; le renard européen est plus trapu, ses oreilles sont beaucoup plus courtes ; et le renard arctique - le renard arctique - a de très petites oreilles et un museau court.
Chez les animaux ayant une activité motrice bien développée, la compensation des facteurs est possible en raison du comportement adaptatif. Ainsi, les lézards n'ont pas peur du refroidissement soudain, car pendant la journée, ils sortent au soleil et la nuit, ils se cachent sous des pierres chauffées. Les changements qui surviennent dans le processus d'adaptation sont souvent génétiquement fixés. Au niveau de la communauté, la compensation des facteurs peut être effectuée en changeant les espèces le long du gradient des conditions environnementales ; par exemple, avec les changements saisonniers, un changement régulier d'espèces végétales se produit.
Les organismes utilisent également la périodicité naturelle des changements des facteurs environnementaux pour répartir les fonctions dans le temps. Ils "programment" Les cycles de la vie afin de profiter au maximum des conditions favorables.
L'exemple le plus frappant est le comportement des organismes en fonction de la durée de la journée - photopériode. L'amplitude de la durée du jour augmente avec la latitude géographique, ce qui permet aux organismes de tenir compte non seulement de la saison, mais aussi de la latitude de la zone. La photopériode est un "commutateur temporel" ou un mécanisme de déclenchement pour une séquence de processus physiologiques. Elle détermine la floraison des plantes, la mue, la migration et la reproduction chez les oiseaux et les mammifères, etc. La photopériode est associée à l'horloge biologique et sert de mécanisme universel de régulation des fonctions dans le temps. L'horloge biologique relie les rythmes des facteurs environnementaux aux rythmes physiologiques, permettant aux organismes de s'adapter à la dynamique quotidienne, saisonnière, des marées et autres des facteurs.
En modifiant la photopériode, il est possible de modifier les fonctions corporelles. Ainsi, les floriculteurs, en modifiant le régime d'éclairage dans les serres, obtiennent une floraison hors saison des plantes. Si après décembre vous augmentez immédiatement la durée du jour, cela peut provoquer des phénomènes qui se produisent au printemps : floraison des plantes, mue chez les animaux, etc. Dans de nombreux organismes supérieurs, les adaptations à la photopériode sont fixées génétiquement, c'est-à-dire l'horloge biologique. peut fonctionner même en l'absence d'une dynamique quotidienne ou saisonnière régulière.
Ainsi, le sens de l'analyse des conditions environnementales n'est pas de compiler une immense liste de facteurs environnementaux, mais de découvrir importants sur le plan fonctionnel, facteurs limitants et évaluer dans quelle mesure la composition, la structure et les fonctions des écosystèmes dépendent de l'interaction de ces facteurs.
Ce n'est que dans ce cas qu'il est possible de prédire de manière fiable les résultats des changements et des perturbations et de gérer les écosystèmes.
Facteurs limitants anthropiques. Il convient de considérer les incendies et les stress anthropiques comme des exemples de facteurs limitants anthropiques qui permettent de gérer les écosystèmes naturels et artificiels.
les feux comme facteur anthropique ne sont le plus souvent évalués que négativement. Les recherches menées au cours des 50 dernières années ont montré que les incendies naturels peuvent faire partie du climat de nombreux habitats terrestres. Ils influencent l'évolution de la flore et de la faune. Les communautés biotiques ont "appris" à compenser ce facteur et à s'y adapter comme la température ou l'humidité. Le feu peut être considéré et étudié comme un facteur écologique, au même titre que la température, les précipitations et le sol. Lorsqu'il est utilisé correctement, le feu peut être un outil environnemental précieux. Certaines tribus brûlaient les forêts pour leurs besoins bien avant que les gens ne commencent à modifier systématiquement et délibérément l'environnement. Le feu est un facteur très important, également parce qu'une personne peut le contrôler dans une plus grande mesure que d'autres facteurs limitants. Il est difficile de trouver un terrain, surtout dans les zones à périodes sèches, où un incendie ne s'est pas produit au moins une fois en 50 ans. La cause la plus fréquente des incendies de forêt est un coup de foudre.
Il y a des incendies divers types et conduisent à des résultats différents.
Les incendies montés ou "sauvages" sont généralement très intenses et ne peuvent pas être contenus. Ils détruisent la cime des arbres et détruisent toute la matière organique du sol. Les incendies de ce type ont un effet limitant sur presque tous les organismes de la communauté. Il faudra de nombreuses années pour que le site se rétablisse.
Les feux au sol sont complètement différents. Ils ont un effet sélectif : pour certains organismes ils sont plus limitants que pour d'autres. Ainsi, les feux de sol contribuent au développement d'organismes à haute tolérance à leurs conséquences. Elles peuvent être naturelles ou spécialement organisées par l'homme. Par exemple, le brûlage planifié dans une forêt est entrepris pour éliminer la concurrence pour race précieuse pin des marais de côté arbres à feuilles caduques. Le pin des marais, contrairement aux feuillus, résiste au feu, car le bourgeon apical de ses semis est protégé par un bouquet d'aiguilles longues et mal brûlantes. En l'absence d'incendies, la croissance des arbres à feuilles caduques noie les pins, ainsi que les céréales et les légumineuses. Cela conduit à l'oppression des perdrix et des petits herbivores. Par conséquent, les pinèdes vierges à gibier abondant sont des écosystèmes de type "feu", c'est-à-dire nécessitant des feux de sol périodiques. Dans ce cas, le feu n'entraîne pas la perte d'éléments nutritifs dans le sol, ne nuit pas aux fourmis, aux insectes et aux petits mammifères.
Avec les légumineuses fixatrices d'azote, un petit feu est même bénéfique. Le brûlage est effectué le soir, de sorte que la nuit, le feu est éteint par la rosée et que le front étroit du feu peut être facilement enjambé. De plus, de petits feux de sol complètent l'action des bactéries pour transformer les résidus morts en minéraux. nutriments adapté à une nouvelle génération de plantes. Dans le même but, les feuilles mortes sont souvent brûlées au printemps et en automne. Le brûlage planifié est un exemple de gestion d'un écosystème naturel à l'aide d'un facteur environnemental limitant.
La question de savoir si la possibilité d'incendies doit être complètement éliminée ou si le feu doit être utilisé comme facteur de gestion doit dépendre entièrement du type de communauté souhaité dans la région. L'écologiste américain G. Stoddard (1936) a été l'un des premiers à "défendre" le brûlage planifié contrôlé pour augmenter la production de bois précieux et de gibier même à l'époque où, du point de vue des forestiers, tout incendie était considéré comme nocif.
La relation étroite entre l'épuisement et la composition de l'herbe joue un rôle clé dans le maintien de l'étonnante diversité des antilopes et de leurs prédateurs dans les savanes d'Afrique de l'Est. Les incendies ont un effet positif sur de nombreuses céréales, car leurs points de croissance et leurs réserves d'énergie sont souterrains. Après l'épuisement des parties aériennes sèches, les batteries retournent rapidement au sol et les herbes poussent abondamment.
La question « brûler ou ne pas brûler », bien sûr, peut prêter à confusion. Par négligence, une personne est souvent à l'origine d'une augmentation de la fréquence des feux "sauvages" destructeurs. La lutte pour la sécurité incendie dans les forêts et les aires de loisirs est l'autre face du problème.
En aucun cas, une personne privée ne peut intentionnellement ou accidentellement provoquer un incendie dans la nature - c'est le privilège de personnes spécialement formées et familiarisées avec les règles d'utilisation des terres.
Stress anthropique peut également être considéré comme une sorte de facteur limitant. Les écosystèmes sont largement capables de compenser le stress anthropique. Il est possible qu'ils soient naturellement adaptés aux contraintes périodiques aiguës. Et de nombreux organismes ont besoin d'influences perturbatrices occasionnelles qui contribuent à leur stabilité à long terme. Les grandes masses d'eau ont souvent une bonne capacité à s'auto-nettoyer et à se remettre de la pollution de la même manière que de nombreux écosystèmes terrestres. Cependant, des violations à long terme peuvent entraîner des conséquences négatives prononcées et persistantes. Dans de tels cas, l'histoire évolutive de l'adaptation ne peut pas aider les organismes - les mécanismes de compensation ne sont pas illimités. Cela est particulièrement vrai lorsque sont déversés des déchets hautement toxiques, qui sont constamment produits par une société industrialisée et qui étaient auparavant absents de l'environnement. Si nous ne parvenons pas à isoler ces déchets toxiques des systèmes mondiaux de maintien de la vie, ils menaceront directement notre santé et deviendront un facteur limitant majeur pour l'humanité.
Le stress anthropique est classiquement divisé en deux groupes : aiguë et chronique.
La première se caractérise par un début brutal, une montée rapide en intensité et une courte durée. Dans le second cas, les infractions de faible intensité se prolongent longtemps ou se répètent. Les systèmes naturels ont souvent une capacité suffisante pour faire face à un stress aigu. Par exemple, la stratégie des graines dormantes permet à la forêt de se régénérer après défrichement. Les conséquences du stress chronique peuvent être plus graves, car les réactions à celui-ci ne sont pas si évidentes. Cela peut prendre des années avant que des changements dans les organismes soient remarqués. Ainsi, le lien entre le cancer et le tabagisme n'a été révélé qu'il y a quelques décennies, alors qu'il existait depuis longtemps.
L'effet de seuil explique en partie pourquoi certains problèmes environnementaux apparaissent de manière inattendue. En fait, ils ont accumulé de longues années. Par exemple, dans les forêts, la mort massive des arbres commence après une exposition prolongée aux polluants atmosphériques. Nous commençons à remarquer le problème seulement après la mort de nombreuses forêts en Europe et en Amérique. À ce moment-là, nous étions en retard de 10 à 20 ans et nous n'avons pas pu empêcher la tragédie.
Pendant la période d'adaptation à la maladie chronique impacts anthropiques la tolérance des organismes à d'autres facteurs, comme les maladies, diminue également. Le stress chronique est souvent associé à des substances toxiques qui, bien qu'en petites concentrations, sont constamment rejetées dans l'environnement.
L'article "The Poisoning of America" (Times magazine, 22/09/80) fournit les données suivantes : "De toutes les interventions humaines dans l'ordre naturel des choses, aucune ne se développe à un rythme aussi alarmant que la création de nouvelles composants chimiques. Aux États-Unis seulement, des "alchimistes" rusés créent environ 1 000 nouveaux médicaments chaque année. Il existe environ 50 000 produits chimiques différents sur le marché. Beaucoup d'entre eux sont indéniablement très bénéfiques pour l'homme, mais près de 35 000 composés utilisés aux États-Unis sont connus ou potentiellement nocifs pour la santé humaine.
Le danger, peut-être catastrophique, est la pollution des eaux souterraines et des aquifères profonds, qui constituent une part importante des ressources mondiales en eau. Contrairement aux eaux souterraines de surface, elles ne sont pas soumises à des processus naturels d'auto-épuration en raison du manque de lumière solaire, d'un écoulement rapide et de composants biotiques.
Les préoccupations ne sont pas seulement causées par des substances nocives qui pénètrent dans l'eau, le sol et les aliments. Des millions de tonnes de composés dangereux sont rejetés dans l'atmosphère. Seulement sur l'Amérique à la fin des années 70. émis : particules en suspension - jusqu'à 25 millions de tonnes/an, SO 2 - jusqu'à 30 millions de tonnes/an, NO - jusqu'à 23 millions de tonnes/an.
Nous contribuons tous à la pollution de l'air par l'utilisation de voitures, d'électricité, de produits manufacturés, etc. La pollution de l'air est un signal clair de retour d'information, ce qui peut sauver la société de la destruction, car il est facilement détecté par tout le monde.
Traitement des déchets solides pendant longtemps considérée comme une affaire secondaire. Jusqu'en 1980, il y avait des cas où Aires résidentielles. Maintenant, bien qu'avec un certain retard, c'est devenu clair : l'accumulation de déchets limite le développement de l'industrie. Sans la création de technologies et de centres pour leur élimination, leur neutralisation et leur recyclage, tout progrès ultérieur de la société industrielle est impossible. Tout d'abord, il est nécessaire d'isoler en toute sécurité les substances les plus toxiques. La pratique illégale des "décharges nocturnes" devrait être remplacée par un isolement fiable. Nous devons chercher des substituts aux produits chimiques toxiques. Avec le bon leadership, l'élimination et le recyclage des déchets peuvent devenir une industrie distincte qui créera de nouveaux emplois et contribuera à l'économie.
La solution au problème du stress anthropique doit être basée sur un concept holistique et nécessite une approche systématique. Tenter de traiter chaque polluant comme un problème en soi est inefficace - cela ne fait que déplacer le problème d'un endroit à un autre.
Si au cours de la prochaine décennie, il n'est pas possible de contenir le processus de détérioration de la qualité de l'environnement, il est fort probable que non la pénurie de ressources naturelles, mais l'impact des substances nocives deviendra un facteur limitant le développement de la civilisation .