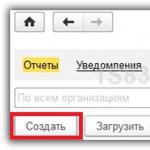Combien de temps dure la guerre entre Israël et la Palestine ? Cours de formation "Conflictologie" : conflit israélo-arabe
Brève description.
À notre époque, l’un des problèmes les plus importants et les plus importants de l’humanité est le conflit au Moyen-Orient.
Conflit israélo-arabe - une confrontation entre un certain nombre de pays arabes, ainsi que des groupes paramilitaires radicaux arabes soutenus par une partie de la population arabe indigène des territoires palestiniens contrôlés (occupés) par Israël, d'une part, et le mouvement sioniste, puis l'État. d'Israël, de l'autre. Bien que l’État d’Israël n’ait été créé qu’en 1948, l’histoire du conflit s’étend en réalité sur environ un siècle, commençant à la fin du XIXe siècle, lorsque le mouvement politique sioniste a été créé, marquant le début de la lutte des Juifs pour leur propre État. .
Les pays arabes (Liban, Syrie, Arabie saoudite, Yémen, Égypte, Irak et autres pays arabes) et l’État juif d’Israël ont participé et participent au conflit. Au cours des conflits, de nombreux accords de trêve ont été conclus entre différents pays, mais le conflit a continué et chaque année il est devenu de plus en plus agressif de la part des Juifs et des Arabes. De nouvelles raisons et objectifs de guerre apparaissent. Mais l’objectif le plus important des Arabes est la création d’un État souverain en Palestine, qui aurait dû être créé après la résolution de l’ONU du 29 novembre 1947.
Dans le cadre du conflit israélo-arabe à grande échelle, il est d'usage de distinguer le conflit israélo-palestinien régional, provoqué avant tout par le choc des intérêts territoriaux d'Israël et de la population arabe indigène de Palestine. Ces dernières années, c’est ce conflit qui a été à l’origine de tensions politiques et d’affrontements armés ouverts dans la région.
Histoire du conflit.

29 novembre 1947 L'Assemblée générale de l'ONU a voté à la majorité l'abolition du régime du mandat britannique en Palestine en mai 1948 et la création de deux États indépendants sur son territoire, l'un arabe et l'autre juif. Dans le même temps, un organe représentatif de la population juive est créé : le Conseil populaire. Exactement à l’heure de l’expiration de la domination britannique en Palestine dans la nuit du 14 au 15 mai 1948 Le Conseil populaire a tenu sa réunion au cours de laquelle l'un des principaux dirigeants politiques, D. Ben Gourion, a lu la Déclarationl'indépendance, qui a proclamé la création de l'État d'Israël. Les Juifs, ayant pris le pouvoir sur le territoire qui leur était attribué, commencèrent à expulser les Arabes palestiniens de leurs terres natales. Ainsi, l’aspect le plus aigu et le plus dramatique du problème palestinien est devenu la situation des réfugiés.
Selon les données de l'ONU de juin 1950. Sur 1 350 000 Arabes palestiniens, 960 000 sont devenus des réfugiés. La situation de la majorité des réfugiés était extrêmement difficile.
De manière générale, l'histoire du conflit peut être divisée en plusieurs étapes clés :Guerre israélo-arabe de 1948 (première guerre), Crise de Suez de 1956(seconde guerre), Guerres israélo-arabes de 1967 et 1973(3e et 4e guerres israélo-arabes), K Processus de paix de Camp David 1978-79, guerre du Liban 1982(cinquième guerre), le processus de paix des années 90 (Accords de Camp David 2000) et Intifada 2000., qui a débuté le 29 septembre 2000 et est souvent définie par les experts comme la « sixième guerre » ou « guerre d’usure ».
Étape 1. Immédiatement après la proclamation de l’État d’Israël, les armées de 7 pays arabes voisins ont envahi son territoire. La première guerre israélo-arabe commence.
Malgré le fait qu'au début les hostilités se soient développées en faveur des Arabes, la situation a rapidement changé. L'unité arabe était minée par de graves contradictions.
En conséquence, Israël, s'appuyant sur l'aide des États-Unis, a réussi non seulement à repousser l'offensive des forces arabes, mais également à annexer 6 700 mètres carrés à son territoire. km alloués par l'ONU à l'État arabe, ainsi qu'à la partie occidentale de Jérusalem. La partie orientale de la ville et la rive ouest du Jourdain étaient occupées par la Jordanie, l'Égypte et la bande de Gaza. Les négociations de février-juillet 1949, qui aboutirent à une trêve entre Israël et les pays arabes, fixèrent la frontière temporaire entre les parties opposées au niveau des lignes de contact militaire au début de 1949.
Étape 2. La seconde guerre éclata sept ans plus tard. Sous prétexte de protéger le canal de Suez, nationalisé par le gouvernement égyptien et qui appartenait auparavant à des sociétés européennes, Israël a envoyé ses troupes dans la péninsule du Sinaï. Cinq jours après le début du conflit, des colonnes de chars israéliens s'emparent de la bande de Gaza, occupent la majeure partie du Sinaï et atteignent le canal de Suez. En décembre, à la suite d'une intervention conjointe anglo-française contre l'Égypte, des troupes de l'ONU ont été déployées dans la zone de conflit. Les forces militaires israéliennes se sont retirées du Sinaï et de la bande de Gaza en mars 1957.
Étape 3. La troisième guerre, appelée Guerre des Six Jours en raison de son caractère éphémère, s'est déroulée du 5 au 10 juin 1967. La raison en était l'intensification des bombardements de cibles militaires israéliennes par des avions syriens au début de 1967. Pendant la Guerre des Six Jours, Israël a pratiquement détruit l’armée de l’air égyptienne et établi son hégémonie dans les airs. La guerre a coûté aux Arabes la perte de contrôle sur Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan, à la frontière israélo-syrienne.
Étape 4. Les affrontements armés périodiques qui ont suivi la guerre des Six Jours ont donné lieu à une nouvelle escalade du conflit le 6 octobre 1973. Le jour de la fête religieuse juive de Yom Kippour, des unités de l'armée israélienne ont été attaquées par l'Égypte dans la région du canal de Suez. Les Israéliens ont réussi à pénétrer en Syrie et à y encercler la Troisième Armée égyptienne. Un autre succès stratégique de Tel-Aviv a été de traverser le canal de Suez et d’établir sa présence sur sa rive ouest. Israël et l'Égypte ont signé un accord d'armistice en novembre, qui a été scellé par des accords de paix le 18 janvier 1974. Ces documents prévoyaient le retrait des forces israéliennes du territoire du Sinaï à l'ouest des cols de Mitla et de Gidi en échange d'une réduction de la présence militaire égyptienne dans la zone du canal de Suez. Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont été déployées entre les deux armées opposées.
Le 26 mars 1979, Israël et l’Égypte signent à Camp David (États-Unis) un traité de paix mettant fin à l’état de guerre qui existait entre les deux pays depuis 30 ans. Conformément aux accords de Camp David, Israël a restitué toute la péninsule du Sinaï à l'Égypte et l'Égypte a reconnu le droit d'Israël à exister. Les deux États ont établi des relations diplomatiques entre eux. Les accords de Camp David ont coûté la vie à l'Égypte de l'Organisation de la Conférence islamique et de la Ligue arabe, ainsi qu'à son président Anouar Sadate.
 Étape 5. Le 5 juin 1982, les tensions s'accentuent entre Israéliens et Palestiniens réfugiés au Liban. Cela a abouti à la cinquième guerre israélo-arabe, au cours de laquelle Israël a bombardé Beyrouth et les zones du sud du Liban où étaient concentrés les camps militants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le 14 juin, les forces terrestres israéliennes s’enfoncèrent profondément au Liban, jusqu’à la périphérie de Beyrouth, qu’elles encerclèrent. Après le bombardement israélien massif de l'ouest de Beyrouth, l'OLP a évacué ses forces armées de la ville. Les troupes israéliennes ont quitté Beyrouth-Ouest et la majeure partie du Liban en juin 1985. Seule une petite zone du sud du Liban est restée sous contrôle israélien.
Étape 5. Le 5 juin 1982, les tensions s'accentuent entre Israéliens et Palestiniens réfugiés au Liban. Cela a abouti à la cinquième guerre israélo-arabe, au cours de laquelle Israël a bombardé Beyrouth et les zones du sud du Liban où étaient concentrés les camps militants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le 14 juin, les forces terrestres israéliennes s’enfoncèrent profondément au Liban, jusqu’à la périphérie de Beyrouth, qu’elles encerclèrent. Après le bombardement israélien massif de l'ouest de Beyrouth, l'OLP a évacué ses forces armées de la ville. Les troupes israéliennes ont quitté Beyrouth-Ouest et la majeure partie du Liban en juin 1985. Seule une petite zone du sud du Liban est restée sous contrôle israélien.
À la fin des années 80, de réelles perspectives d’une sortie pacifique du conflit prolongé au Moyen-Orient sont apparues. Le soulèvement populaire palestinien (Intifada) qui a éclaté dans les territoires occupés en décembre 1987 a contraint les autorités israéliennes à recourir à la recherche d'un compromis. Le 31 juillet 1988, le roi Hussein de Jordanie a annoncé la fin des liens administratifs et autres de son pays avec la Cisjordanie de Jordanie ; en novembre 1988, l'indépendance de l'État de Palestine a été proclamée. En septembre 1993, grâce à la médiation des États-Unis et de la Russie, une déclaration fut signée à Washington, ouvrant de nouvelles voies pour résoudre la crise. Dans ce document, Israël acceptait l'organisation de l'Autorité nationale palestinienne (mais pas d'un État), et l'OLP reconnaissait le droit d'Israël à exister.
Dans l’ensemble, les cinq guerres israélo-arabes ont démontré qu’aucune des deux parties ne pouvait vaincre l’autre de manière décisive. Cela était dû en grande partie à l’implication des parties au conflit dans la confrontation mondiale de la guerre froide. La situation en termes de résolution des conflits a changé qualitativement avec l’effondrement de l’URSS et la disparition du monde bipolaire.

!--> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 !-->!--> !-->!--> !-->Le conflit arabo-israélien, ou comme on l'appelle souvent, le conflit du Moyen-Orient, est le plus long de tous les conflits non résolus dans le monde. Son début remonte aux années 40 du 20e siècle et est associé au problème de la création d'États juifs et arabes en Palestine. Cette décision a été prise par l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 novembre 1947. Cependant, cette décision a été initialement rejetée à la fois par les États arabes voisins et par la population arabe de Palestine elle-même. Les Arabes n'ont fondamentalement pas reconnu l'idée duretour des Juifs en Palestine, considérant ce territoire comme le leur.
Première guerre
29 novembre 1947 L'Assemblée générale des Nations Unies a voté la création de deux États – juif et arabe – en Cisjordanie (Résolution n° 181). La population juive a accueilli favorablement ce projet, mais la population arabe l'a rejeté : le territoire de l'État juif s'est avéré beaucoup plus vaste.
14 mai 1948 Le Conseil national juif a proclamé la création de l'État d'Israël.
Dans la nuit du 15 mai, des avions égyptiens bombardent Tel-Aviv. Les armées de cinq pays arabes, comptant 30 000 personnes, ont lancé des opérations militaires contre l'État nouvellement proclamé. Le 31 mai, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont été créées à partir des formations paramilitaires « Haganah » (Organisation de défense), « Etzel » (Organisation militaire nationale) et « Léhi » (Combattants de la liberté d'Israël), face aux troupes syriennes et égyptiennes. , la Transjordanie, le Liban, l’Irak, l’Arabie saoudite et l’armée palestinienne.
Au cours des premiers mois de 1949, sous les auspices de l’ONU, des négociations eurent lieu entre tous les pays belligérants. En février 1949, une trêve égypto-israélienne est conclue sur l'île de Rhodes, à laquelle rejoint la Transjordanie.
20 juillet un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et la Syrie. L'accord d'armistice est entré en vigueur le 17 juillet à Jérusalem et dans tout le pays le 18 juillet. En conséquence, la bande côtière, la Galilée et tout le désert du Néguev sont allés à Israël ; Bande de Gaza - en Egypte. Le territoire de la Palestine à l'ouest du Jourdain, non occupé par les troupes israéliennes, passa sous le contrôle de la Transjordanie qui, après avoir annexé ce territoire en avril 1950, reçut son nom moderne - Jordanie. La ville de Jérusalem était divisée en deux parties : la partie occidentale allait à Israël et la partie orientale à la Jordanie. Dans la partie orientale se trouvait la vieille ville avec le mont du Temple, lieu saint de trois religions mondiales : le christianisme, l'islam et le judaïsme. Un État arabe palestinien n’a jamais été créé. Les États arabes continuaient de se considérer en guerre contre Israël ; L’existence même d’Israël était considérée par eux comme une « agression ». Cela a conduit à une escalade du conflit
Deuxième guerre israélo-arabe 1956"Campagne de Suez"
Les tensions dans la région s'accentuèrent fortement en octobre 1956 sur l'avenir du canal de Suez, nationalisé par l'Égypte le 26 juillet de la même année. Les actionnaires de la chaîne - la France et la Grande-Bretagne - ont commencé à préparer l'opération militaire "Mousquetaire" - Israël devait agir comme principale force de frappe.
Le 29 octobre 1956, Israël lance une opération contre l’Égypte dans la péninsule du Sinaï. Le lendemain, l’Angleterre et la France commencèrent à bombarder l’Égypte et une semaine plus tard, elles entrèrent à Port-Saïd. La campagne s'est terminée le 5 novembre, lorsque les troupes israéliennes ont occupé Charm el-Cheikh. Presque toute la péninsule du Sinaï, ainsi que Gaza, sont passées sous contrôle israélien.
Mais les actions de l’Angleterre, de la France et d’Israël ont été fermement condamnées par les deux superpuissances, l’URSS et les États-Unis. L'Union soviétique a menacé d'envoyer ses volontaires dans la zone du canal de Suez. Dans la soirée du 6 novembre, alors que tout le Sinaï était sous contrôle israélien, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur. Au début de 1957, les troupes anglo-françaises furent retirées de la zone du canal de Suez et les troupes israéliennes de la péninsule du Sinaï. Les forces de l'ONU étaient stationnées dans le Sinaï, le long de la frontière égypto-israélienne, ainsi que dans le port de Charm el-Cheikh.
En 1964, à l’initiative du président égyptien Gamal Abdel Nasser, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) est créée. Le document politique de l'OLP, la Charte nationale, déclarait que la division de la Palestine et la création d'un État juif étaient illégales. La tâche était de libérer complètement le territoire de leur patrie. L'OLP a été créée comme un prototype d'État palestinien et sa structure comprenait des unités conçues pour traiter les questions politiques, économiques, sociales, culturelles, éducatives et militaires.
Troisième guerre israélo-arabe ("guerre des six jours")
La guerre, connue sous le nom de Guerre des Six Jours, débute le 5 juin 1967. L'Égypte, la Syrie et la Jordanie ont massé leurs troupes aux frontières d'Israël, expulsé les soldats de maintien de la paix de l'ONU et bloqué l'entrée des navires israéliens dans la mer Rouge et le canal de Suez. En termes d'équilibre des forces, les Arabes étaient 1,8 fois plus nombreux que les Israéliens en personnel, 1,7 fois en chars, 2,6 fois en artillerie et 1,4 fois en avions de combat. Israël a lancé une offensive préventive ; en un jour, l’armée de l’air israélienne a complètement détruit les avions de combat égyptiens et la plupart des avions syriens. Après avoir perdu 679 personnes, Israël a acquis toute la péninsule du Sinaï, le plateau du Golan et a pris le contrôle de la Judée et de la Samarie. Tout Jérusalem appartenait à Israël.
Quatrième Guerre 1969-1970 ("guerre d'usure")
Il a été lancé par l’Égypte dans le but de restituer la péninsule du Sinaï, capturée par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Il y eut des échanges d'artillerie, des raids sur le canal de Suez et des combats aériens. La guerre s’est déroulée avec plus ou moins de succès et s’est terminée après l’intervention diplomatique américaine. En 1970, un accord de cessez-le-feu est signé sans changements territoriaux pour les parties au conflit.
Cinquième guerre 1973 ("Guerre du Kippour")
6 octobre , le Jour du Jugement dernier, jour le plus saint du calendrier juif, l'Égypte a attaqué le Sinaï et la Syrie a attaqué le plateau du Golan. L’offensive arabe réussie des premiers jours a cédé la place à leur retraite à la fin de la semaine. Malgré des pertes importantes, l'attaque des armées égyptienne et syrienne a été repoussée avec succès par Tsahal, après quoi les troupes sont retournées à leurs positions précédentes.
Après cela, grâce à la médiation de l'URSS et des États-Unis, le 23 octobre, un accord a été conclu sur un cessez-le-feu sur les fronts du Sinaï et de la Syrie. Pendant la guerre, plus de 8 500 Arabes et plus de 2 800 Israéliens sont morts.
En janvier 1974, les troupes israéliennes se retirèrent de la rive ouest du canal de Suez et de Quneitra, mais conservèrent le contrôle du plateau du Golan. En mars 1979, le traité de paix égypto-israélien, négocié par le président américain Jimmy Carter, le président égyptien Anwar Sadat et le Premier ministre israélien Menachem Begin, entre en vigueur. Israël s'est retiré du Sinaï, ne gardant sous son contrôle que la bande de Gaza.
Nom de code de la sixième guerre (libanaise) de 1982"Paix pour la Galilée"
Israël s'est donné pour mission d'éliminer les terroristes de l'OLP : les terroristes de l'OLP basés au sud du Liban ont constamment bombardé la Galilée. La raison en était l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres le 3 juin par des terroristes palestiniens.
L'offensive a débuté le 5 juin, jour du 15e anniversaire de la guerre des Six Jours. Les troupes israéliennes ont vaincu l'armée syrienne, les forces palestiniennes et leurs alliés libanais, ont capturé les villes de Tyr et de Sidon et sont entrées dans la capitale Beyrouth. Au cours de cette guerre, 600 soldats israéliens ont été tués, mais l'objectif fixé par Israël - la destruction de l'OLP - n'a pas été atteint. Après la prise de Beyrouth par les Israéliens, le protégé israélien, le Libanais Christian Bashir Gemayel, a été élu président du Liban. Il a promis de signer un traité de paix avec Israël après son entrée en fonction, mais a été rapidement tué par des terroristes islamistes pro-syriens. Ses partisans, avec l'autorisation du commandement israélien, sont entrés dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila - prétendument pour détruire les terroristes de l'OLP, ils y ont commis un massacre, tuant environ un millier de personnes. Parmi eux, il y avait un nombre négligeable de militants.
En 1985, Israël s’est retiré de la majeure partie du Liban, à l’exception de la zone tampon, qui est restée sous contrôle israélien jusqu’en 2000.
En 1993, un accord a été conclu à Oslo sur la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël en tant que partenaires de négociation. La direction de l'OLP a officiellement annoncé son renoncement au terrorisme. La même année, le chef de l’OLP, Yasser Arafat, a rencontré le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin.
En 1994, un accord a été conclu sur la première phase d'établissement de l'autonomie gouvernementale dans une partie des territoires palestiniens. En 1995, un autre accord a été signé à Oslo sur les principes d'autonomie gouvernementale dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et sur le retrait des troupes israéliennes de plusieurs villes palestiniennes.
En 1999, l’Autorité nationale palestinienne a été créée en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, dont une partie a été entièrement contrôlée par les Palestiniens. Dans cette zone, un corps de police palestinien armé et l'Autorité palestinienne ont été formés.
Afin de résoudre la question arabo-israélienne, de nombreuses conférences internationales ont été convoquées ces dernières années : la Conférence de Madrid en 1991, la Conférence d'Oslo (1993), la Conférence de Camp David (2000), l'adoption du « quatuor des médiateurs internationaux » » (USA, UE, ONU, Russie) du plan « Feuille de route » en avril 2003.
En 2006, la Ligue des États arabes (LEA) a présenté son plan pour résoudre le conflit du Moyen-Orient : reconnaissance par les États arabes du droit d'Israël à exister, renonciation aux actions violentes des deux côtés, reconnaissance palestinienne de tous les accords antérieurs, retrait des troupes israéliennes jusqu'aux frontières de 1967 et retour des réfugiés palestiniens. Toutefois, le règlement du conflit n’a pas progressé.
En 2005, suite au plan de désengagement unilatéral du Premier ministre Ariel Sharon, Israël a retiré ses troupes de la bande de Gaza et détruit toutes les colonies juives. Quatre colonies dans la partie nord de Samarie ont également été détruites. À la suite d’un coup d’État armé, le pouvoir à l’intérieur de la zone a été retiré au Fatah par le mouvement palestinien radical Hamas.
Deuxième guerre du Liban (dans le monde arabe -"Guerre de juillet") 2006
Un affrontement armé entre l'État d'Israël, d'une part, et le groupe chiite radical Hezbollah, qui contrôlait en réalité les régions du sud de l'État du Liban, d'autre part, en juillet-août 2006.
Le conflit a été provoqué le 12 juillet par une attaque à la roquette et au mortier contre le point fortifié de Nurit et la colonie frontalière de Shlomi au nord, avec une attaque simultanée contre la patrouille frontalière des Forces de défense israéliennes à la frontière israélo-libanaise par le Hezbollah. militants. Au cours de l'opération terrestre, l'armée israélienne a réussi à avancer de 15 à 20 km en profondeur sur le territoire libanais, à atteindre le fleuve Litani et à débarrasser en grande partie le territoire occupé des militants du Hezbollah. En outre, les combats dans le sud du Liban se sont accompagnés de bombardements continus contre des zones peuplées et des infrastructures dans tout le Liban. Les militants du Hezbollah ont mené pendant un mois des attaques massives à la roquette sur les villes du nord d’Israël, d’une ampleur sans précédent.
Les combats se sont poursuivis du 12 juillet au 14 août 2006, lorsqu'un cessez-le-feu a été déclaré conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le 1er octobre 2006, Israël a achevé son retrait du sud du Liban. Le contrôle du sud du Liban a été entièrement transféré aux unités de l'armée gouvernementale libanaise et aux soldats de la paix de l'ONU.
Depuis 2006, la situation au sein de l’Autorité nationale palestinienne est compliquée par la confrontation intra-palestinienne entre les mouvements Fatah et Hamas.
En octobre 2007, Israël a déclaré la bande de Gaza « État hostile » et a instauré un blocus économique partiel, coupant périodiquement l’approvisionnement en électricité, en arrêtant l’approvisionnement en énergie, etc.
En novembre 2007, une réunion sur le règlement du Moyen-Orient s'est tenue dans la ville américaine d'Annapolis, au cours de laquelle un accord préliminaire a notamment été conclu pour mener des négociations constructives sur la création d'un État palestinien indépendant d'ici un an.
Pendant de nombreuses décennies, le conflit israélo-arabe est resté l'un des « points chauds » les plus explosifs du Moyen-Orient, dont l'escalade des événements pourrait à tout moment conduire à une nouvelle guerre régionale, ainsi qu'affecter considérablement le système de relations internationales dans leur ensemble.
Le conflit entre Arabes et Juifs à propos de la Palestine a commencé avant même la création de l’État d’Israël. Les racines du conflit remontent au mandat britannique et même plus tôt, lorsque la position des Juifs dans l’Empire ottoman et en Palestine était déterminée par la loi religieuse islamique, selon laquelle le statut et les droits des minorités religieuses étaient inférieurs à ceux des musulmans. Les Juifs furent alors soumis à toutes sortes de discriminations de la part des autorités locales, concentrées entre les mains des représentants de la noblesse arabe et de la population musulmane locale. Cette situation ne pouvait que laisser des traces dans les relations entre les deux peuples.
En outre, il faut rechercher les racines du choc des psychologies de deux peuples : la population arabe, attachée aux anciennes traditions religieuses et au mode de vie, croyait en l'autorité spirituelle des autorités et des représentants du mouvement sioniste, qui apportaient avec eux d'Europe un tout nouveau mode de vie.
Depuis 1917, après la proclamation de la Déclaration Balfour en Palestine, les relations entre Juifs et Arabes ont commencé à s'échauffer et à se transformer en un conflit politique qui s'aggrave chaque année. Le conflit a été alimenté par l’influence de la Grande-Bretagne, puis de l’Allemagne et de l’Italie, sur la population arabe.
Depuis 1947, la guerre en Palestine pour la création d’un État national juif battait déjà son plein. En mai 1948, l’État d’Israël a été proclamé sur la base de la résolution n° 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en novembre 1947. Les pays arabes ont réagi de manière extrêmement négative à ce qui se passait en ne reconnaissant pas Israël, ce qui a conduit à une escalade du conflit entre Israël et les pays arabes voisins. Pendant la guerre israélo-arabe (1947-49), Israël a réussi à défendre son indépendance et à prendre possession de Jérusalem-Ouest et d’une partie du territoire attribué à la Palestine sous mandat de l’ONU. L’Iran n’a pas participé à cette guerre, car elle a dû surmonter les graves conséquences de la Seconde Guerre mondiale.
Lors du prochain affrontement israélo-arabe (Guerre des Six Jours, 1967), Israël s'avança profondément dans la péninsule du Sinaï et s'empara du plateau du Golan, la Cisjordanie du fleuve. Jordanie, bande de Gaza et Jérusalem-Est.
Cependant, au cours des années 1970, l’Iran a continué à coopérer avec Israël en termes de commerce ainsi que dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Pendant la guerre du Yom Kippour (1973), l’Iran a fourni un soutien modeste et secret à Israël sous la forme d’avions de combat et d’autres équipements militaires. La guerre s'est terminée par la victoire d'Israël, et les membres arabes vaincus de l'OPEP ont imposé un embargo pétrolier aux pays soutenant Israël et ont considérablement gonflé le prix du baril de pétrole, conduisant à un état de « choc pétrolier » dans le monde.
Après 1979, les relations irano-israéliennes se sont fortement détériorées. L’idée clé soulevée en Iran à cette époque était la propagation et l’expansion de la révolution islamique au-delà des frontières de l’État. Israël, qui contrôle Jérusalem, où se trouve la mosquée al-Aqsa (le troisième lieu saint de l'Islam), est devenu une pierre d'achoppement.
En 1981, l’Iran a rejeté le projet de création de la Palestine en Cisjordanie. Jordan. L'Iran a commencé à déclarer que la Palestine devait être créée à l'intérieur de ses anciennes frontières et que la présence d'Israël là-bas portait atteinte aux intérêts du monde islamique tout entier. Les présidents iraniens ultérieurs ont encouragé une attitude négative à l’égard d’Israël et ont construit leur politique dans un esprit anti-israélien. Sur cette base, l’Iran s’est allié au Liban, en Palestine, en Syrie, en Turquie et dans d’autres pays arabes.
En septembre 1980, la guerre Iran-Irak éclate sur le territoire frontalier, qui accapare toute l’attention de l’Iran. Les deux belligérants ont reçu une aide financière et militaire colossale de l'extérieur, ainsi que des structures individuelles. En 1988, la guerre s'est terminée par un match nul.
En 1995, l'Iran a été soumis à des sanctions de la part des États-Unis, qui se sont traduites par une interdiction des livraisons d'armes, à laquelle la Russie a adhéré. Ce n’est qu’en 2001 que la Russie a rétabli ses approvisionnements.
En 1997, Khatami est devenu président de l’Iran, puis remplacé par Ahmadinejad. Khatami a tenté de sortir l’Iran de son isolement et d’établir des contacts avec l’Occident. Cependant, il a dû faire face à des chefs religieux qui façonnaient l’opinion publique anti-israélienne.
Dans ce contexte, au début des années 2000, les États-Unis ont soutenu volontairement Israël et ont attiré l’attention de l’AIEA sur les actions de l’Iran. L'Iran a signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1968 et l'a ratifié en 1970. L'AIEA a maintenant appelé l'Iran à accepter le Protocole additionnel au TNP, qui permettrait des inspections non autorisées de toutes les installations situées sur le territoire iranien afin de déterminer leur conformité au Traité de non-prolifération.
En décembre 2003, l'Iran l'a signé à Vienne, au siège de l'AIEA. À partir de ce moment, la communauté mondiale a été entraînée dans le débat sur le programme nucléaire iranien. Ce document donne à l'AIEA l'opportunité d'accepter la mise en œuvre des programmes nucléaires iraniens. L'Iran a fait preuve d'une totale ouverture dans ses actions concernant ses obligations internationales.
Le parlement iranien n'a pas encore ratifié le protocole, l'Iran ne se considère donc pas obligé de faire rapport aux inspecteurs de l'AIEA.
Lorsque Khatami était au pouvoir, il a rendu possible les tentatives pour que l'AIEA cesse de discriminer l'Iran et reconnaisse son droit de mener des recherches nucléaires dans le cadre du TNP, tout en soulignant que, conformément à ce traité, l'Iran a le droit de mener des recherches nucléaires. cycle nucléaire complet, y compris l'enrichissement de l'uranium. Cependant, au fil du temps, il est devenu clair que plus l’Iran prouvait avec persistance qu’il avait raison, plus la position de l’Occident devenait inconciliable, position qu’Israël partageait pleinement. C’est pourquoi, à partir de 2005, l’Iran a fortement resserré sa position et a de nouveau attiré l’attention de la communauté mondiale sur Israël en tant que propriétaire de véritables armes nucléaires.
En août 2005, Mahmoud Ahmadinejad accède au pouvoir en Iran. En juin 2006, Ahmadinejad a proposé d’organiser un référendum non seulement en Iran, mais aussi en Europe sur le thème « Quels sentiments les citoyens éprouvent-ils à l’égard d’Israël ? Ahmadinejad nie que l’Iran possède la bombe nucléaire et estime que l’Iran a parfaitement le droit de développer des armes nucléaires. Il se concentre toujours sur la présence d’armes nucléaires dans d’autres pays, notamment en Israël, et ne voit aucune raison de s’inquiéter, car l’ère des armes nucléaires est révolue.
Aujourd’hui, l’Iran tient le monde entier en haleine. Il y a une guerre ouverte de l’information entre l’Iran, Israël et les États-Unis. De nouvelles sanctions entrent en vigueur, l'ONU reçoit de nouveaux rapports de l'AIEA, mais cela ne fait qu'accroître l'isolement de l'Iran. Cependant, Ahmadinejad développe son potentiel nucléaire avec une vigueur renouvelée. Chaque année, l'AIEA rassemble de nouvelles preuves en faveur du développement d'armes nucléaires par l'Iran. L’Iran continue d’insister sur le fait que le programme est pacifique. Le programme nucléaire iranien est évoqué partout. Début 2012, Israël a entamé des discussions avec les États-Unis sur la possibilité d’envahir l’Iran et de bombarder des installations nucléaires. À cette fin, des négociations sont régulièrement organisées. Israël défend sa position en disant qu’il craint pour son sort futur et qu’il est donc contraint d’agir de manière radicale.
Le conflit israélo-arabe implique actuellement quatre processus parallèles : le processus de rétablissement de la paix entre les Arabes et Israël ; le processus de destruction progressive du pays d’Israël ; le processus d'intensification du conflit israélo-arabe ; le processus de confrontation globale entre la civilisation musulmane et le reste de l’humanité.
Le programme nucléaire iranien hante à la fois Israël et la communauté mondiale tout entière.
Le 19 décembre 2012, Israël lance une frappe aérienne sur plusieurs sites en Iran soupçonnés de faire partie de l'infrastructure du programme nucléaire iranien. Moins de 30 minutes après l'attaque israélienne, l'armée de l'air iranienne a lancé un raid aérien quelque peu infructueux sur plusieurs villes israéliennes - Tel Aviv, Haïfa, Dimona et Beer Sheva. Plusieurs bombes tombent également dans les limites de la ville de Jérusalem.
Un conflit armé pourrait potentiellement dégénérer en une guerre régionale, voire mondiale, dans laquelle seraient entraînés les États-Unis, les pays arabes, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays du monde.
Si le conflit se poursuit, des dégâts colossaux sont attendus en raison des bombardements d'installations nucléaires et des opérations militaires, en particulier sur le territoire iranien, où la population civile sera la plus menacée. Cela vaut également pour d’autres pays de la région du Moyen-Orient, qui seront ensuite impliqués dans le conflit. Il est désormais très important d’empêcher le conflit de s’étendre à l’échelle régionale, et encore moins à l’échelle mondiale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est obligé d'intervenir et de créer des mécanismes pour contrer la détérioration de la situation dans la région, ainsi que de contribuer à la cessation rapide du conflit armé et au début d'un règlement pacifique entre les parties.
Le 19 décembre 2012, à 6 heures du matin, Israël a commencé à mener des frappes ciblées sur certaines installations iraniennes, notamment l'installation nucléaire iranienne Parchin, située à 30 km au sud-est de Téhéran. Parchin n’a pas été choisi comme cible par hasard. C’est dans cette base militaire que les inspecteurs de l’AIEA et les services de renseignement israéliens ont découvert le développement d’armes nucléaires. L’Iran a commencé à enrichir l’uranium jusqu’à 20 %, ce qui est absolument inacceptable. Cette situation porte atteinte au caractère pacifique du programme nucléaire iranien, car L'uranium enrichi à moins de 5 % est largement suffisant pour maintenir le fonctionnement des centrales nucléaires.
Au printemps-été 2012, des images satellite de la base militaire de Parchin ont été publiées sur le site Internet de l'Institut des sciences et de la sécurité internationale (ISIS) à l'attention de la communauté mondiale. Une fois de plus, l'Iran n'a pas permis aux inspecteurs de l'AIEA de vérifier la base de Parchin. Sur cette base, Israël a décidé de lancer des frappes préventives contre une installation nucléaire. Les États-Unis, à leur tour, l’ont soutenu.
L'Iran réagit immédiatement aux actions israéliennes. Moins de 30 minutes après l'attaque israélienne, l'armée de l'air iranienne a mené, sans succès, un raid aérien de représailles sur plusieurs villes israéliennes - Tel Aviv, Haïfa, Dimona et Beer Sheva. Plusieurs bombes tombent également dans les limites de la ville de Jérusalem.
La mobilisation des forces aériennes et terrestres américaines commence. Les États-Unis retirent leurs forces terrestres d'Afghanistan et de la péninsule arabique et leurs forces navales du golfe Persique jusqu'aux frontières de l'Iran. La communauté mondiale est désormais confrontée à la question : les dirigeants régionaux décideront-ils d'intervenir dans les hostilités, ou le feront-ils ? tout cela aboutit au bombardement d’installations nucléaires, comme ce fut le cas en Syrie ? et en Irak ? Quelle sera la réaction du Conseil de sécurité de l’ONU ?
Une situation plus dramatique se développe autour de l’Iran. Sans le soutien des pays arabes, l’Iran ne pourra pas résister aux États-Unis et à Israël. On ne sait pas comment le conflit prendra fin. Il est peu probable que l’Iran veuille abandonner ses ambitions nucléaires, comme l’ont fait l’Irak et la Syrie.
Le conflit israélo-arabe constitue aujourd’hui l’un des problèmes internationaux les plus urgents, et les problèmes de migration (des musulmans vers l’Europe et des Asiatiques centraux vers la Russie) dans le monde moderne sont également aigus.
Sotskova V.P.
Littérature
- Rapoport M.A. Perceptions de l'immigration juive en Palestine par le public arabe, 1882-1948. - Saint-Pétersbourg, 2013. - 71 p.
- Mesamed V. Israël - Iran - de l'amitié à l'inimitié. URL : http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1266528060.
- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml.
Droujilovski S.B. Les relations irano-israéliennes à la lumière du développement du programme nucléaire iranien. URL : http://www.iimes.ru/rus/stat/2006/04-05-06a.htm.
Contexte du conflit entre Israël et la Palestine.
Afin de comprendre pourquoi le conflit entre Israël et la Palestine est apparu, considérons tout d’abord son contexte. La Palestine est un territoire situé près de la mer Méditerranée au Moyen-Orient. L'histoire de ce petit bout de terre remonte à plusieurs siècles. Les racines du conflit actuel entre Israël et la Palestine se trouvent dans le passé, dans la lutte territoriale et ethnique entre Arabes palestiniens et Juifs. Mais il faut reconnaître qu’une situation aussi tendue entre les deux peuples n’a pas toujours existé.
Pendant longtemps, Arabes et Juifs ont vécu en paix en tant que voisins en Palestine. La Palestine était considérée comme faisant partie de la Syrie sous l’Empire ottoman. La population palestinienne à cette époque était dominée par les Arabes. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, des colonies juives commencèrent à apparaître en Palestine, principalement autour de la ville de Jérusalem. Mais il faut admettre que la colonisation de la Palestine par les Juifs s'est déroulée très lentement. Selon les statistiques, en 1918, la population de la Palestine était composée d'Arabes, avec une population totale de 93 %. La situation a commencé à changer radicalement lorsque, après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a obtenu le droit de gouverner la Palestine. Ce mandat entra en vigueur en septembre 1923.
Une propagande généralisée a commencé en faveur de la colonisation de la Palestine par les Juifs. Cette idée a été avancée en 1917 par le ministre britannique des Affaires étrangères A. Balfour, écrivant une lettre au dirigeant sioniste. La lettre annonçait la création d'un foyer national pour les Juifs. La lettre devint plus tard connue sous le nom de Déclaration Balfour.
Au début du 20e siècle, dans les années 1920, l'organisation militaire « Hagana » a été créée et déjà en 1935, les Juifs ont créé une organisation d'extrémistes - « Irgun Zvai Leumi ». Certes, il convient de noter qu’au début, le déplacement des Arabes de Palestine s’est déroulé de manière pacifique.
Après l’arrivée au pouvoir des nazis et le début de la guerre mondiale, l’émigration des Juifs vers la Palestine a fortement augmenté. Ainsi, en 1932, il y avait 184 000 Juifs en Palestine, en 1938 il y avait déjà 414 000 personnes et à la fin de 1947, il y avait plus de 600 000 Juifs, soit à cette époque un tiers de la population de Palestine. Beaucoup de gens disent que le but ultime de l’émigration juive en Israël est la conquête des terres palestiniennes et la création d’un État juif. L’idée de créer l’État d’Israël remonte à loin, mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la mise en œuvre de cette idée est devenue possible. L’idée de créer un État juif a été soutenue par la communauté mondiale ; l’Holocauste a joué un rôle important dans le renforcement de cette idée. En novembre 1945, la situation en Palestine était extrêmement tendue. Le conflit entre la Palestine et Israël couvait.
Outre le fait que la Palestine a été secouée par des affrontements entre Arabes et Juifs, le mouvement de terreur sioniste s'est intensifié au cours de cette période, dirigé contre les autorités britanniques. La Grande-Bretagne n'a pas été en mesure de résoudre ce problème par elle-même et a soumis en 1947 une décision sur l'avenir de la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU.
A cette époque, il y avait deux solutions pour l’avenir de la Palestine. Un comité spécial pour les affaires palestiniennes à l'ONU a été créé, qui, composé de 11 personnes, a signé une lettre recommandant la création de deux États indépendants et indépendants sur le territoire de la Palestine actuelle : juif et arabe. Et laissez entre eux une zone internationale - la ville de Jérusalem. Jérusalem devait recevoir un statut international. Le plan de division de la Palestine fut longuement discuté et fut approuvé en novembre 1947. Parmi les pays qui ont reconnu et approuvé cette division entre la Palestine et Israël figuraient les États-Unis et l’URSS.
Selon la résolution n° 181/11 du 29 novembre 1947, la Palestine a été divisée en deux États indépendants : juif avec une superficie de 14,1 mille kilomètres carrés, soit 56 % de la superficie totale de la Palestine, et arabe, avec une superficie de 11,1 kilomètres carrés, soit 43% de la superficie totale de la Palestine, et Jérusalem - la zone internationale - 1% du territoire total.
Avant le 1er août 1948, les troupes britanniques durent se retirer du pays. Dès que la décision de créer un État juif indépendant d’Israël a été proclamée, les sionistes ont déclenché une véritable guerre non déclarée. Et avant même la déclaration officielle de l'indépendance israélienne, 250 000 Arabes ont simplement été contraints de quitter la Palestine. Dans le même temps, de nombreux pays arabes n’ont pas reconnu l’indépendance d’Israël et ont déclaré le « jihad » – une guerre sainte – contre le nouvel État. En mai 1948, un conflit militaire éclate en Israël.
La nouvelle de l’indépendance israélienne en Palestine s’est immédiatement répandue dans le monde entier. Les pays de la Ligue arabe, immédiatement après que le Premier ministre israélien Ben Gourion a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, ont lancé des opérations militaires. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite et le Yémen, ayant uni tous leurs efforts, ont déclaré à l'unanimité la guerre au nouvel État d'Israël. C’est ici que commence l’histoire du conflit entre Israël et la Palestine.
Les troupes de la Ligue arabe comptaient 40 000 soldats, tandis que les troupes israéliennes en comptaient 30 000. Les troupes de la Ligue arabe étaient alors commandées par le roi de Jordanie. En 1948, les Nations Unies ont appelé les parties en conflit à une trêve, mais le plan de trêve proposé a été rejeté par les parties comme étant inacceptable pour les deux parties.
Au début, le conflit militaire entre Israël et la Palestine s’est développé en faveur de la Ligue arabe, mais le cours de la guerre a radicalement changé au cours de l’été 1948. En dix jours, l’armée juive, confrontée à l’armée plus nombreuse et mieux armée de la Ligue arabe, lança une offensive décisive et neutralisa l’offensive arabe. Lors de l’offensive finale de l’armée juive, qui eut lieu en 1949, les Israéliens occupèrent l’ensemble du territoire palestinien, repoussant l’ennemi jusqu’aux frontières.
À cette époque, plus de 900 000 Arabes ont été expulsés du territoire palestinien conquis par Israël. Ils se sont installés dans différents pays arabes. Dans le même temps, plus d’un demi-million de Juifs furent expulsés des pays arabes et commencèrent à vivre en Israël.
L’histoire du conflit israélo-palestinien est assez profonde. Les deux parties doivent comprendre cette question, car comme le dit l’histoire d’Israël et de la Palestine, deux peuples peuvent vivre à l’amiable sur le même territoire.