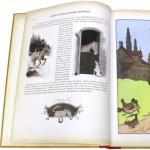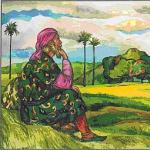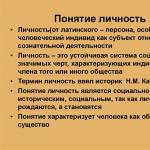Histoire naturelle de Buffon. "Buffon illustré, ou histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons et de quelques reptiles" Autres livres sur des sujets similaires
Buffon Georges Louis Leclerc : Buffon illustré, ou Histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons et de quelques reptiles.
Ce livre unique (dont on ne pouvait même pas rêver de publication) comprend des articles sur les animaux de l'«Histoire naturelle» en plusieurs volumes du comte de Buffon, remarquable naturaliste et écrivain français du XVIIIe siècle.
Les illustrations du célèbre peintre animalier Benjamin Rabier ont été réalisées pour une publication publiée à Paris en 1913.
Les dessins dynamiques et nets de Rabier se sont avérés étonnamment en accord avec les discussions tranquilles de Buffon sur l'impudence des chacals, la douceur des lézards gris ou la vie pitoyable et misérable d'un héron ordinaire. Le XVIIIe siècle aristocratique et approfondi et le XXe siècle rapide et alors encore très jeune se sont réunis sous un même couvert. 
Des descriptions vivantes et sincères d'animaux (qui ont l'air étonnants aujourd'hui), des dessins émotionnels, du matériel de référence volumineux, un travail éditorial délicat et une excellente impression.
Il s'agit d'une histoire visuelle du développement de la science, d'un livre de collection étonnant, d'un cadeau pour les enfants et les adultes. Un livre incroyable, qui ne ressemble à aucun autre aujourd'hui. Sur le dévouement et l'affection des chiens et des chats, la froideur et la tromperie des animaux. Les animaux acquièrent ici des caractéristiques humaines, un merveilleux exemple de belles lettres. La valeur du livre ne réside pas dans l’exactitude des descriptions biologiques, qui évoluent avec le temps, mais dans l’approche. Vous pouvez voir où la science a commencé. 
Le livre est très cher - une option pour un cadeau mémorable.
Le livre est grand, format 300x230, 176 pages, couverture rigide, illustrations en couleurs.
« Buffon illustré, ou Histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons et de quelques reptiles » est avant tout une occasion unique de toucher aux origines des sciences naturelles modernes et de regarder le monde qui nous entoure à travers les yeux d'un Européen des Lumières. .
Ce livre diffère des atlas zoologiques modernes auxquels nous sommes habitués. Bien que les éditeurs aient fait un excellent travail en essayant de rapprocher le texte de Buffon des connaissances actuelles sur le monde qui nous entoure. Ceci est assuré par des notes très délicates qui ne détournent pas l'attention, mais permettent aux parents d'éviter les situations embarrassantes et de répondre à toutes les questions qui se posent lors de la lecture du livre. 
Pendant de nombreuses années consécutives, Joseph, serviteur de Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, propriétaire de Montbard, marquis de Rougemont, vicomte de Reines, propriétaire de Mairia, Garance, Berg et autres terres, directeur du Jardin Botanique de Paris, membre de l'Académie française, de l'Académie royale des sciences, etc. et ainsi de suite, a réveillé son propriétaire à 5 heures précises du matin, sans prêter attention aux abus et à la résistance désespérée de ce dernier. Pour cela, Joseph avait droit à une récompense distincte. Au réveil, Georges Louis Leclerc comte de Buffon revêtit ses plus beaux atours, se coiffa comme s'il se rendait à une cérémonie et se rendit à son bureau pour créer face à l'Univers et à ses descendants.
Pendant plus de quarante ans, il a travaillé sur la monumentale « Histoire Naturelle », qui était censée contenir «... tout ce que l'on trouve dans l'Univers... une monstrueuse variété de quadrupèdes, d'oiseaux, de poissons, d'insectes, de plantes, de minéraux. " Il relut plusieurs fois ce qu'il avait écrit et le mit de côté. « Il ne faut pas se précipiter, répétait Buffon à sa secrétaire, dans quelques jours vos yeux seront rafraîchis, vous verrez tout mieux et vous trouverez toujours quelque chose à améliorer. » Le célèbre naturaliste, membre de nombreuses académies, se souciait non seulement de l'exactitude des faits, mais aussi du style de ses travaux. C'est peut-être pour cette raison que les recherches de Buffon ont suscité un grand intérêt non seulement parmi ses collègues, mais aussi parmi le grand public. 
Au début du XXe siècle, l'éditeur français Garnier décide de publier les articles les plus intéressants de l'immense « Histoire naturelle ». Il a invité Benjamin Rabier, un artiste animalier de premier plan, à illustrer le livre. Rabier collabore avec des magazines pour enfants, publie les fables de La Fontaine et dessine ses propres livres.
Rabier a consacré plusieurs années à travailler sur ce projet grandiose. Il a passé des heures à observer les animaux du Jardin Botanique de Paris et du Zoo de Vincennes - car désormais sa tâche était d'avoir un maximum d'authenticité ! Les animaux de ce livre ne pleurent pas, ne rient pas et ne peuvent certainement pas parler, et pourtant les dessins de Rabier sont infiniment loin des illustrations « de référence » qui enregistrent indifféremment la longueur de leurs pattes, la structure de leur corps et la couleur de leur pelage - bien plus sobres que dans les livres ou les fables pour enfants, les images traduisent le tempérament et les traits individuels, mais pas de chaque animal – de chaque espèce. 
Ce livre atteint le lecteur russe depuis plus d'un siècle. Nous avons essayé de le traduire comme cela aurait été fait au tournant des XIXe-XXe siècles, pour transmettre le charme du style de Buffon. Après avoir passé au crible des montagnes d'ouvrages de référence et de manuels de zoologie, d'innombrables « Images de la vie des animaux », et même des livres sur la chasse, nous avons compilé quelque chose comme un dictionnaire « russe-russe » : quelles expressions étaient alors utilisées pour parler des habitudes ou mode de vie des animaux ? À propos de leur voix ? Apparence? Nous avons appris qu'à cette époque, les oiseaux et les animaux avaient des « caprices de goût gastronomiques », que la dorade « est d'un caractère calme et très doux », le blaireau « garde son terrier dans un ordre inhabituel », les pies de mer « maintiennent strictement la politesse entre elles. et pour le non-respect de la décence, ils provoquent un combat désespéré », les moineaux peuvent être grands, « la gourmandise des jeunes apporte beaucoup de problèmes à leurs parents », et le lièvre est « remarquablement sensible, rusé, colérique et fertile ». De temps en temps, nous faisions appel au Corpus national de la langue russe, nous demandant si telle ou telle expression aurait pu être utilisée à la fin du XIXe siècle. En général, c'était difficile, mais intéressant. Et nous espérons vraiment que lire ce livre ne sera pas moins excitant que d'y travailler.
dans le labyrinthe« Buffon illustré, ou Histoire naturelle des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons et de quelques reptiles » est avant tout une occasion unique de toucher aux origines des sciences naturelles modernes et de regarder le monde qui nous entoure à travers les yeux d'un Européen des Lumières. .
Ce livre diffère des atlas zoologiques modernes auxquels nous sommes habitués. Bien que les éditeurs aient fait un excellent travail en essayant de rapprocher le texte de Buffon des connaissances actuelles sur le monde qui nous entoure. Ceci est assuré par des notes très délicates qui ne détournent pas l'attention, mais permettent aux parents d'éviter les situations embarrassantes et de répondre à toutes les questions qui se posent lors de la lecture du livre.
L’essentiel, c’est le charme suranné des textes de Buffon et des illustrations de Rabier, qui nous rappelle d’autres livres, apparemment eux aussi dépassés : par exemple, "ABC Benoît" ou "Plaisir scientifique" de Tom Titus. Mais ce sont précisément ces publications sur lesquelles je souhaite revenir encore et encore, car l'air du temps et l'enfance heureuse des époques passées y vivent. De tels livres sont littéralement créés pour la bibliothèque familiale : ils seront soigneusement retirés des étagères, regardés ensemble et étonnés de voir à quel point le monde qui nous entoure évolue.
Ceci est également facilité par l'apparence du livre : une couverture en carton noble, un dos en tissu et des pages vieillies. Il est difficile d'imaginer que nous tenons l'édition 2014 entre nos mains.



Un étranger ou un noble provincial venu à Paris à la fin du XVIIIe siècle et désirant en connaître les curiosités, cherchait d'abord à voir le comte Buffon. Je le ferais toujours ! Après tout, ce nom est connu dans toute l’Europe, et comment visiter Paris sans voir celui dont les livres sont lus comme les romans les plus populaires ?
Cependant, tout le monde n’a pas pu voir Buffon. Le monument est le bienvenu, regardez-le tant que vous voulez (un monument lui a été érigé de son vivant - est-ce une blague ?!), mais Buffon lui-même ne l'est pas : le comte est déjà vieux, il apprécie toutes les heures, il écrit... Buffon écrit depuis près de quarante ans maintenant, et le public des lecteurs en Europe est captivé par ses livres depuis près de quatre décennies. Quel heureux hasard l'a amené sur cette voie, qui l'a inspiré à prendre la plume ? Après tout, il n'a jamais rêvé de devenir ce qu'il est finalement devenu : un célèbre écrivain naturaliste, l'une des personnalités les plus populaires non seulement en France, mais aussi à l'étranger.
Pendant la majeure partie de sa vie, Buffon s'appelait Georges Louis Leclerc. Ce n'est que lorsqu'il fut déjà célèbre que le roi lui accorda le titre de comte et qu'il devint comte de Buffon.
Il n’a écrit ni romans ni poèmes et n’avait pas l’intention d’en écrire. Il était attiré par la science. Il est fermement décidé à écrire des ouvrages scientifiques. À propos de quoi? Pour le jeune Leclerc, cela n'avait pas d'importance : il se souvenait de ses études de mathématiques et écrivait de nombreux traités de mathématiques, se souvenait de la médecine et du droit - il écrivait sur ces sujets, et décrivait ses observations de la nature faites au cours de ses voyages. Et Leclerc a soigneusement envoyé tout cela à l'Académie des sciences.
Soit les académiciens ne lisaient pas les ouvrages envoyés et étaient étonnés par le nombre d'articles, d'études et de mémoires de Leclerc, soit ces ouvrages avaient réellement une certaine valeur scientifique (leur auteur était après tout une personne loin d'être ordinaire), mais D'une manière ou d'une autre, très vite les académiciens acceptèrent Leclerc, vingt-six ans, dans leurs rangs, l'élisant membre correspondant de l'Académie française des sciences.
Maintenant, commençons à faire quelque chose de sérieux. Mais c’est ce que Leclerc ne savait pas.
Le hasard a aidé : une connaissance de la famille Leclerc, ancien médecin du roi, était alors responsable du Jardin Royal. En fait, le nom ne reflétait pas pleinement l'essence de ce jardin : il y avait une grande variété de plantes, et il serait plus correct de l'appeler le Jardin Botanique (plus tard, il s'est transformé en Jardin Botanique de Paris). Le chef, ou, comme on l'appelait alors, l'intendant, était malade et invita Georges (heureusement, il était membre correspondant de l'académie) à le remplacer. Le futur comte accepta et le rendez-vous eut bientôt lieu. Cela se passait en 1739, Leclerc avait alors trente-deux ans.
L'année où Leclerc accède au poste d'intendant du Jardin Royal, qui, outre le jardin botanique, possédait également une bonne ménagerie, peut être considérée comme l'année de naissance du naturaliste Buffon. De plus, outre l’intendant du jardin, il était également à la tête du « bureau du roi » – le musée-cabinet de curiosités. Leclerc-Buffon, en plus d'un ardent amour du savoir, était naturellement doté de capacités brillantes - un esprit curieux et vif, une mémoire phénoménale, une capacité de travail colossale, la capacité de comparer les faits, de les sélectionner, de faire des généralisations, et il a également écrit magnifiquement. Tout cela, combiné au riche matériel factuel dont Buffon disposait, a donné d'excellents résultats. Cependant, les résultats ne sont pas devenus visibles immédiatement: dix ans se sont écoulés avant que l'intendant du Jardin Royal et du Musée d'Etudes publie son premier livre. Il fut publié en 1749 et s’intitulait « Histoire naturelle générale et particulière, accompagnée d’une description du cabinet du roi ».
Au XVIIIe siècle, la science n'a pas encore échappé à la toile du clergé, mais elle fait déjà de grands progrès. Buffon pouvait choisir n'importe quelle direction scientifique, d'autant plus qu'il y avait déjà des scientifiques comme l'Anglais Harvey et l'Italien Redi, le Néerlandais Swammerdam et le Suisse Gesner... Il était possible d'étudier l'anatomie ou la physiologie, le microscope ou la systématique. Mais non, tout cela n'intéressait pas Buffon. Il aimait Gesner. Ou plutôt, pas ce qu'il a fait, mais il aimait le chemin parcouru par les Suisses. Et le futur comte décide de poursuivre et d'approfondir le travail commencé par Gesner. D’ailleurs, beaucoup de choses ont changé en deux siècles !
Buffon a laissé un immense héritage littéraire et scientifique - il a écrit 44 volumes (environ 2 000 pages grand format). 36 volumes ont été publiés de son vivant, le reste après sa mort. En plus des livres d'histoire naturelle, il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la géologie, une science qui commençait tout juste à émerger, et y exprimait de nombreuses pensées très intéressantes et audacieuses. Par exemple, Buffon croyait que la terre est une « gouttelette » refroidie du soleil et que dans son histoire il y a sept périodes, dont chacune dure à son tour plusieurs siècles.
Il s'intéressait au problème de l'origine de la vie et y prêta également beaucoup d'attention, faisant encore une fois preuve de suffisamment de courage et de perspicacité pour son époque.
Enfin, il s’intéresse à la psychologie animale, et c’est là qu’il se montre à la hauteur.
Sans aucun doute, l'œuvre de Buffon a été influencée par la situation générale en France à cette époque. Après tout, il était contemporain de personnages aussi brillants que Montesquieu, Voltaire et Rousseau. Leurs pensées, leurs idées dominaient alors l'esprit des peuples progressistes d'Europe, l'air de la France était électrifié - la révolution bourgeoise de 1789 approchait, et derrière elle se profilaient déjà les terribles jours de 1793.
Buffon était un homme apolitique ; les idées révolutionnaires, aussi bien que contre-révolutionnaires, ne l'intéressaient pas. Mais la situation générale, les idées progressistes qui flottaient dans l'air, ne pouvaient qu'affecter son travail.
Buffon, bien entendu, était un amateur. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune formation spéciale et n'avait pas suivi de cours de sciences naturelles à l'université. Mais il n’en était pas moins un homme profondément instruit, instruit et réfléchi. Et les erreurs dans ses œuvres ne sont pas dues à l'analphabétisme : il aurait tout aussi bien pu les commettre avec une formation spéciale. Certes, de nombreuses erreurs dans les œuvres de Buffon sont apparues en raison d'une crédulité excessive - Buffon croyait trop aux autorités et répétait leurs erreurs. Et si Buffon avait été plus exigeant, il aurait pu les éviter. Oui, il y a eu des erreurs. Mais il ne s'agit pas d'erreurs, mais de pensées et d'idées correctes qu'il a exprimées, qui étaient en avance sur leur temps et auxquelles les scientifiques d'une époque ultérieure pouvaient souscrire en toute sécurité.
Cependant, ce ne sont pas ses travaux sur la géologie et la philosophie qui lui ont valu une telle renommée. Buffon a acquis sa renommée grâce à ses livres sur les animaux.
Il décrivait les animaux avec passion, les décrivait magnifiquement, avec exaltation. Et le public a apprécié. J'ai aimé la vérité, pas les blagues et les miracles. Certes, le public des lecteurs a changé - après tout, c'était déjà l'époque des philosophes matérialistes, l'ère des Lumières. Le terme « physiologiste » ne pouvait plus être répertorié. Et pourtant, c’est le mérite considérable de Buffon que le public soit tombé amoureux des histoires vraies sur les animaux.
Ses livres se succèdent : quinze volumes consacrés aux mammifères, dix aux oiseaux. Il aurait pu publier plus de livres - il aimait écrire, il savait comment, il le voulait et était prêt à le faire 24 heures sur 24. Mais Buffon a compris que ce sont des époques différentes, des exigences différentes, et qu'il n'est plus possible de simplement décrire les animaux, il faut parler de structure anatomique. Mais Buffon n’aimait pas terriblement décortiquer. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même - peut-être que le travail se déroulera encore plus efficacement si vous disposez d'un assistant fiable. Buffon avait un tel assistant : il anatomisait les animaux, décrivait leur structure, tandis que Buffon collectait et résumait les faits.
En décrivant les animaux, Buffon n'adhère à aucun système, et s'il le fait, il est très conditionnel : il décrit séparément les animaux domestiques et sauvages et les répartit entre les pays. Cependant, ce caractère non systématique n'a pas dérangé les lecteurs de Buffon - ils ont accueilli chacun de ses nouveaux livres avec plaisir. Ces livres ont été instantanément épuisés non seulement par les naturalistes et les amoureux de la nature. Les livres furent réimprimés, traduits dans de nombreuses langues, et avec chaque nouveau volume, la renommée de Buffon grandit.
Certes, cela ne veut pas du tout dire que la vie du naturaliste Buffon était totalement sans nuages. Par exemple, Linné, ou plutôt le système de Linné, lui a causé beaucoup de chagrin.
En tant qu'artiste, Buffon ne supporte aucun projet, surtout s'il essaie d'intégrer la nature vivante dans ces projets. Buffon croyait que la nature en était humiliée. Il n’a donc pas reconnu le classement. Et comme, sans fausse modestie, il se considérait comme le premier naturaliste du monde, il était convaincu que personne ne pouvait contester son opinion. Il n’y a pas de classification et il ne devrait pas y en avoir. Et soudain, il s'avère qu'il existe une classification - elle a été inventée par un Suédois Linnaeus. Buffon ne put supporter cela et se précipita au combat. Cependant, il n'a pas pu combattre Linné - le Suédois était déjà reconnu par tous les scientifiques, son système était en train d'être mis en pratique.
Linnaeus n'a pas jugé nécessaire d'entrer dans une dispute scientifique avec son collègue français. Mais il n'ignora pas ses attaques : donnant un nom à une plante très vénéneuse, il l'appela buffonia.
Mais si la dispute avec Linné, une dispute perdue, n’avait fait que blesser l’orgueil de Buffon, alors la dispute avec le clergé aurait pu lui coûter bien plus cher.
Cependant, il n'y a eu aucune contestation - il y a eu un scandale provoqué par la parution des livres «Histoire de la Terre» et «Âges de la nature».
Après la lecture de ces livres, la faculté de théologie de la Sorbonne est devenue furieuse : qui a osé prétendre que la terre est un morceau de soleil ? L’Écriture ne dit-elle pas : Dieu l’a créée à partir de rien ? Quelles sont ces sept périodes de la Terre qui durent des milliers d’années ? Ne sait-on pas que Dieu a créé la terre en six jours ?
Et Buffon a donné bien d'autres raisons de l'indignation des théologiens avec ses livres. L'affaire aurait pu mal se terminer - les théologiens ne l'ont pas pardonné ! Mais d’un autre côté, on ne peut pas mettre en prison l’un des personnages les plus populaires de France, un homme respecté à l’étranger et apprécié à la cour !
Le clergé a trouvé une issue : ils ont déclaré que les livres de Buffon étaient des absurdités séniles. Eh bien, Buffon ne s’y est pas opposé : si c’est plus pratique pour eux, qu’il en soit ainsi.
Il n'a pas discuté avec ses collègues, qui n'ont pas reconnu ses livres parce qu'ils étaient écrits dans un langage trop populaire, brillant, léger et non sec, comme il sied aux travaux scientifiques. Pourquoi discuter, perdre du temps là-dessus, alors qu'il y a encore tant de choses à dire aux gens ?!
Et Buffon a travaillé, travaillé sans relâche, surmontant la fatigue, a travaillé presque jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais Buffon a vécu une belle vie : il est décédé à l'âge de 81 ans.
Buffon a fait beaucoup de choses en tant que scientifique. Mais il a fait bien plus en tant que vulgarisateur scientifique. Et il méritait un monument de son vivant précisément en tant que vulgarisateur. Certains scientifiques – contemporains de Buffon et plus tard aussi – méprisaient de telles activités ; ils pensaient qu'un scientifique devait servir la « science pure ». Buffon pensait différemment : plus les gens en savent sur les animaux, plus ils seront spirituellement riches, plus ils verront le monde plus brillant et plus coloré. Mais ce n’est pas tout : les animaux et les humains sont inséparables. Et une personne doit connaître ceux dont elle ne peut se passer, qui l'ont servi pendant des milliers d'années. Savoir pour mieux les soigner, pour mieux les protéger et les protéger.
C'est ce qu'était « Pline du XVIIIe siècle », comme on appelait Buffon : un scientifique, un vulgarisateur, un humaniste.
|
Le livre comprend des articles sur les animaux tirés de l'Histoire naturelle en plusieurs volumes du comte de Buffon, un remarquable naturaliste et écrivain français du XVIIIe siècle. Les illustrations du célèbre peintre animalier Benjamin Rabier ont été réalisées pour une publication publiée à Paris en 1913. Les dessins dynamiques et nets de Rabier se sont avérés étonnamment en accord avec les discussions tranquilles de Buffon sur l'impudence des chacals, la douceur des lézards gris ou la vie pitoyable et misérable d'un héron ordinaire. Le XVIIIe siècle aristocratique et approfondi et le XXe siècle rapide et alors encore très jeune se sont réunis sous un même couvert. Des descriptions vivantes et sincères d'animaux, des dessins émotionnels, des documents de référence volumineux, un travail éditorial délicat et d'excellentes performances d'impression. |
BUFFON Georges Louis Leclerc
(Buffon, Georges-Louis Leclerc)
(1707-1788), naturaliste français, vulgarisateur scientifique. Né le 7 septembre 1707 à Montbard (Bourgogne). Il étudie la jurisprudence d'abord au Collège des Jésuites de Dijon, puis à l'Université de Dijon. Il étudie ensuite à la Faculté de médecine de l'Université d'Angers. A beaucoup voyagé en France et en Italie, parfois en compagnie du duc anglais de Kingston et de son mentor N. Hickman. C'est cette dernière qui suscite l'intérêt de Buffon pour l'histoire naturelle. En 1735, sous les auspices de l'Académie des sciences, la traduction de Buffon des travaux du chercheur anglais S. Geils Vegetal Staticks est publiée. Cet ouvrage important, résumant les résultats des nombreuses expériences de l’auteur dans le domaine de la physiologie végétale, constituait une exception rare dans le contexte de l’écrasante majorité des recherches botaniques de l’époque, qui se résumaient à des tentatives de systématisation des plantes. Buffon, dans la préface qu'il a écrite à la traduction du livre de Geils, a vivement critiqué l'étroitesse de cette approche. En 1738, Buffon achève la traduction des travaux de Newton sur la méthode de fluxion (calcul différentiel et intégral). Cet ouvrage fut publié par l'Académie en 1740. La même année, Buffon fut élu membre de la Royal Society de Londres et jusqu'à la fin de ses jours il entretint des contacts étroits avec la science britannique. De 1739 à 1788, il fut directeur du Jardin Botanique de Paris. Buffon mourut à Paris le 16 avril 1788. L'ouvrage principal de Buffon est l'Histoire Naturelle, générale et particulière ; 36 de ses volumes ont été publiés du vivant du scientifique (le premier d’entre eux a commencé à paraître en 1749) et 8 ont été publiés à titre posthume. Cet ouvrage s'ouvre sur la théorie de l'évolution de la Terre, qui était alors intensément discutée. La Terre, selon Buffon, s'est formée à partir de la partie du Soleil qui s'en est détachée après la collision du Soleil avec une comète. Tout d’abord, le nuage gazeux s’est condensé, puis des continents ont commencé à se former, et ce processus se poursuit encore aujourd’hui. Les idées de Buffon furent si sévèrement condamnées par les théologiens qu'il fut contraint par la suite de présenter ses théories avec plus de soin. Le deuxième volume, consacré à l'homme, revient en détail sur les observations de nombreux voyageurs et explorateurs, indiquant que la diversité des coutumes, des croyances, des caractéristiques physiques des hommes et de la couleur de leur peau est due avant tout à l'action naturelle du « climat ». Dans le même temps, le « climat » signifiait non seulement les conditions déterminées par la latitude géographique d'une zone donnée et son altitude au-dessus du niveau de la mer, mais aussi son ouverture aux vents, sa proximité avec de grandes étendues d'eau, sans parler de la température moyenne, des précipitations et de l'humidité. . Les plusieurs centaines de pages consacrées à ce sujet, accompagnées d'une annexe détaillée, fournissent un bon aperçu de l'anthropologie du XVIIIe siècle. La nature de l'ensemble de la publication entreprise par Buffon se reflète le plus pleinement dans les volumes consacrés au monde animal et végétal. Il a non seulement décrit de nombreux animaux et plantes, mais a également exprimé l'idée dela variabilité des espèces (par opposition aux vues de K. Linnaeus), sur l'unité des mondes animal et végétal. Cet ouvrage place Buffon au premier rang des prédécesseurs de Charles Darwin. Selon Buffon, les organismes qui ont des ancêtres communs subissent des changements à long terme sous l'influence de l'environnement et deviennent de moins en moins semblables les uns aux autres. En 1778, le livre de Buffon Sur les âges de la nature (Les poques de la nature) est publié, couvrant un large éventail de problèmes - de la cosmologie et de l'anthropologie à l'histoire du monde ; il s'adressait au grand public. Le souci de Buffon pour la forme de présentation des questions scientifiques se reflète dans son ouvrage Discours sur le style (1753), consacré à son élection à l'Académie française. Buffon a fait une critique audacieuse du langage alors adopté dans la science et a plaidé pour une forme simple et compréhensible, la plus adaptée à une présentation claire des pensées. Le style, selon la définition de Buffon, est « l'homme lui-même » et non une sorte de décoration extérieure. Dans ses passions scientifiques, Buffon suit son époque : des mathématiques et de la physique aux sciences naturelles. Cependant, la sphère d'intérêt de Buffon n'inclut pas la chimie, qui connaît à cette époque une période de développement rapide, principalement grâce aux travaux de Priestley et de Lavoisier. À propos de l'attitude de Buffon à l'égard de la chimie, T. Jefferson écrivait dans sa lettre à Madison en 1788 : « Il a tendance à la considérer comme une simple concoction. » Cette remarque caractérise bien à sa manière Buffon : il pouvait écrire une œuvre impressionnante dans le cadre de ce qui était déjà bien connu à l'époque, mais il n'a pas toujours su apprécier les succès de ses contemporains. Du vivant de Buffon, les érudits le considéraient avec respect et les théologiens conservateurs avec suspicion. Le grand public lit ses œuvres. Plus tard, la préférence commença à être donnée à d’autres auteurs, mais l’autorité de Buffon parmi les amateurs d’histoire naturelle resta longtemps incontestée.
LITTÉRATURE
Buffon J. Histoire naturelle générale et privée, parties 1-10. Saint-Pétersbourg, 1802-1827 Kanaev I.I. Georges Louis Leclerc de Buffon. M.-L., 1966
|
Le livre comprend des articles sur les animaux tirés de l'Histoire naturelle en plusieurs volumes du comte de Buffon, un remarquable naturaliste et écrivain français du XVIIIe siècle. Les illustrations du célèbre peintre animalier Benjamin Rabier ont été réalisées pour une publication publiée à Paris en 1913. Les dessins dynamiques et nets de Rabier se sont avérés étonnamment en accord avec les discussions tranquilles de Buffon sur l'impudence des chacals, la douceur des lézards gris ou la vie pitoyable et misérable d'un héron ordinaire. Le XVIIIe siècle aristocratique et approfondi et le XXe siècle rapide et alors encore très jeune se sont réunis sous un même couvert. Des descriptions vivantes et sincères d'animaux, des dessins émotionnels, des documents de référence volumineux, un travail éditorial délicat et d'excellentes performances d'impression. Editeur : "Labyrinthe" (2014) |
Autres livres sur des sujets similaires :
BUFFON Georges Louis Leclerc
(Buffon, Georges-Louis Leclerc)
(1707-1788), naturaliste français, vulgarisateur scientifique. Né le 7 septembre 1707 à Montbard (Bourgogne). Il étudie la jurisprudence d'abord au Collège des Jésuites de Dijon, puis à l'Université de Dijon. Il étudie ensuite à la Faculté de médecine de l'Université d'Angers. A beaucoup voyagé en France et en Italie, parfois en compagnie du duc anglais de Kingston et de son mentor N. Hickman. C'est cette dernière qui suscite l'intérêt de Buffon pour l'histoire naturelle. En 1735, sous les auspices de l'Académie des sciences, la traduction de Buffon des travaux du chercheur anglais S. Geils Vegetal Staticks est publiée. Cet ouvrage important, résumant les résultats des nombreuses expériences de l’auteur dans le domaine de la physiologie végétale, constituait une exception rare dans le contexte de l’écrasante majorité des recherches botaniques de l’époque, qui se résumaient à des tentatives de systématisation des plantes. Buffon, dans la préface qu'il a écrite à la traduction du livre de Geils, a vivement critiqué l'étroitesse de cette approche. En 1738, Buffon achève la traduction des travaux de Newton sur la méthode de fluxion (calcul différentiel et intégral). Cet ouvrage fut publié par l'Académie en 1740. La même année, Buffon fut élu membre de la Royal Society de Londres et jusqu'à la fin de ses jours il entretint des contacts étroits avec la science britannique. De 1739 à 1788, il fut directeur du Jardin Botanique de Paris. Buffon mourut à Paris le 16 avril 1788. L'ouvrage principal de Buffon est l'Histoire Naturelle, générale et particulière ; 36 de ses volumes ont été publiés du vivant du scientifique (le premier d’entre eux a commencé à paraître en 1749) et 8 ont été publiés à titre posthume. Cet ouvrage s'ouvre sur la théorie de l'évolution de la Terre, qui était alors intensément discutée. La Terre, selon Buffon, s'est formée à partir de la partie du Soleil qui s'en est détachée après la collision du Soleil avec une comète. Tout d’abord, le nuage gazeux s’est condensé, puis des continents ont commencé à se former, et ce processus se poursuit encore aujourd’hui. Les idées de Buffon furent si sévèrement condamnées par les théologiens qu'il fut contraint par la suite de présenter ses théories avec plus de soin. Le deuxième volume, consacré à l'homme, revient en détail sur les observations de nombreux voyageurs et explorateurs, indiquant que la diversité des coutumes, des croyances, des caractéristiques physiques des hommes et de la couleur de leur peau est due avant tout à l'action naturelle du « climat ». Dans le même temps, le « climat » signifiait non seulement les conditions déterminées par la latitude géographique d'une zone donnée et son altitude au-dessus du niveau de la mer, mais aussi son ouverture aux vents, sa proximité avec de grandes étendues d'eau, sans parler de la température moyenne, des précipitations et de l'humidité. . Les plusieurs centaines de pages consacrées à ce sujet, accompagnées d'une annexe détaillée, fournissent un bon aperçu de l'anthropologie du XVIIIe siècle. La nature de l'ensemble de la publication entreprise par Buffon se reflète le plus pleinement dans les volumes consacrés au monde animal et végétal. Il a non seulement décrit de nombreux animaux et plantes, mais a également exprimé l'idée dela variabilité des espèces (par opposition aux vues de K. Linnaeus), sur l'unité des mondes animal et végétal. Cet ouvrage place Buffon au premier rang des prédécesseurs de Charles Darwin. Selon Buffon, les organismes qui ont des ancêtres communs subissent des changements à long terme sous l'influence de l'environnement et deviennent de moins en moins semblables les uns aux autres. En 1778, le livre de Buffon Sur les âges de la nature (Les poques de la nature) est publié, couvrant un large éventail de problèmes - de la cosmologie et de l'anthropologie à l'histoire du monde ; il s'adressait au grand public. Le souci de Buffon pour la forme de présentation des questions scientifiques se reflète dans son ouvrage Discours sur le style (1753), consacré à son élection à l'Académie française. Buffon a fait une critique audacieuse du langage alors adopté dans la science et a plaidé pour une forme simple et compréhensible, la plus adaptée à une présentation claire des pensées. Le style, selon la définition de Buffon, est « l'homme lui-même » et non une sorte de décoration extérieure. Dans ses passions scientifiques, Buffon suit son époque : des mathématiques et de la physique aux sciences naturelles. Cependant, la sphère d'intérêt de Buffon n'inclut pas la chimie, qui connaît à cette époque une période de développement rapide, principalement grâce aux travaux de Priestley et de Lavoisier. À propos de l'attitude de Buffon à l'égard de la chimie, T. Jefferson écrivait dans sa lettre à Madison en 1788 : « Il a tendance à la considérer comme une simple concoction. » Cette remarque caractérise bien à sa manière Buffon : il pouvait écrire une œuvre impressionnante dans le cadre de ce qui était déjà bien connu à l'époque, mais il n'a pas toujours su apprécier les succès de ses contemporains. Du vivant de Buffon, les érudits le considéraient avec respect et les théologiens conservateurs avec suspicion. Le grand public lit ses œuvres. Plus tard, la préférence commença à être donnée à d’autres auteurs, mais l’autorité de Buffon parmi les amateurs d’histoire naturelle resta longtemps incontestée.
LITTÉRATURE
Buffon J. Histoire naturelle générale et privée, parties 1-10. Saint-Pétersbourg, 1802-1827 Kanaev I.I. Georges Louis Leclerc de Buffon. M.-L., 1966