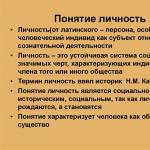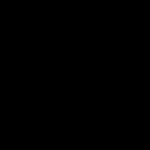Bilan des morts de la guerre du Vietnam américaine de 1964 à 1973. La guerre du Vietnam
Dans le contexte des nombreuses guerres américaines de la dernière décennie, la guerre du Vietnam, perdue pour Washington, disparaît progressivement dans l’ombre. Cependant, elle constitue un brillant exemple de la manière dont l’identité nationale et le patriotisme peuvent vaincre n’importe quel ennemi, même armé d’armes modernes.
La guerre du Vietnam a été le plus long conflit militaire de l’histoire militaire moderne. Le conflit dura environ 20 ans : du 1er novembre 1955 jusqu'à la chute de Saigon le 30 avril 1975.
L'image la plus caractéristique de la guerre du Vietnam
En 1940, le président américain Franklin Roosevelt annonça officiellement l'aide de son pays à Hô Chi Minh et à son mouvement Vietnam Minh. Les documents les qualifiaient de « patriotes », de « nationalistes », de « combattants de la liberté » et d'« alliés ».
 Roosevelt et Hô Chi Minh
Roosevelt et Hô Chi Minh
[Wikipédia]
58 200 Américains sont morts dans les combats et 304 000 autres ont été blessés. Au total, environ 2,5 millions de militaires sont passés par le Vietnam. Ainsi, une personne sur dix a été tuée ou blessée. Environ les deux tiers des militaires américains pendant la guerre étaient des volontaires. L’année la plus sanglante pour les Américains fut mai 1968, avec 2 415 morts.
 Moments de guerre
Moments de guerre
L'âge moyen d'un soldat américain mort était de 23 ans et 11 mois. 11 465 décès avaient moins de 20 ans, et 5 sont décédés avant d'atteindre 16 ans ! La personne la plus âgée tuée pendant la guerre était un Américain de 62 ans.
 La guerre est une affaire de jeunes...
La guerre est une affaire de jeunes...
[http://www.warhistoryonline.com/]
À ce jour, le nombre de victimes civiles est inconnu : environ 5 millions de personnes seraient mortes, plus dans le Nord que dans le Sud. De plus, les pertes de la population civile du Cambodge et du Laos ne sont prises en compte nulle part - apparemment, elles se comptent également par milliers ici.
 Images de crimes de guerre
Images de crimes de guerre
De 1957 à 1973, environ 37 000 Sud-Vietnamiens ont été abattus par les guérilleros du Viet Cong pour avoir collaboré avec les Américains, dont la plupart étaient des employés mineurs du gouvernement.
 Une image typique des villes vietnamiennes...
Une image typique des villes vietnamiennes...
En moyenne, un soldat américain combattait 240 jours par an au Vietnam ! A titre de comparaison, un soldat américain a combattu dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale en moyenne 40 jours sur 4 ans.
 Opération militaire dans la jungle
Opération militaire dans la jungle
En janvier 2004, 1 875 soldats américains étaient portés disparus au combat au Vietnam. En août 1995, il y avait 1 713 823 anciens combattants de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Seulement 0,5 pour cent des anciens combattants de la guerre du Vietnam ont été incarcérés après la fin de la guerre, et leur taux de suicide était de 1,7 pour cent supérieur à la moyenne.
 Pilote américain abattu
Pilote américain abattu
Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé l’agent chimique Orange, dont l’usage militaire a été interdit à Genève en 1925. En conséquence, au moins 400 000 Vietnamiens sont morts. L'explication traditionnelle de ce fait est son utilisation exclusivement contre la végétation.
 Pulvériser des défoliants sur la jungle.
Pulvériser des défoliants sur la jungle.
[Wikipédia]
Le 16 mars 1968, des soldats américains détruisirent complètement un village vietnamien, tuant 504 hommes, femmes et enfants innocents. Une seule personne a été reconnue coupable de ce crime de guerre et, trois jours plus tard, elle a été « graciée » par décret personnel de Richard Nixon.
 Village vietnamien détruit
Village vietnamien détruit
Encore une fois, après le conflit dans la péninsule coréenne, Les militaires américains et soviétiques se sont rencontrés au combat pendant Guerre du Vietnam 1964-1973 La division du Vietnam entre le Nord pro-soviétique et le Sud pro-américain a été réalisée en 1954 après le départ des colonialistes français. L'affrontement entre les partis se limitait initialement à la lutte des guérilleros pro-communistes du Sud-Vietnam - les Viet Cong - contre les troupes américaines et leurs alliés locaux. Afin de justifier le bombardement nécessaire, de l'avis du commandement américain, du Nord-Vietnam en août 1964, les Américains ont annoncé que leurs navires dans le golfe du Tonkin avaient été attaqués par des bateaux nord-vietnamiens (le soi-disant « incident du Tonkin »). .
Ayant trouvé la raison souhaitée, les Américains ont soumis le territoire du Nord-Vietnam et d’autres régions de l’Indochine à des bombardements « en tapis ».
L'US Air Force a largué 7,8 millions de tonnes de bombes, de napalm et d'agents chimiques. 80 % des villes et centres provinciaux vietnamiens ont été rayés de la surface de la Terre. Afin de contrer les raids de l'URSS, les derniers systèmes anti-aériens ont été fournis au Vietnam, dont les équipages de combat étaient principalement des soldats et des officiers soviétiques. L'Union soviétique a également fourni des avions de combat. En 1969, le nombre d'Américains ayant combattu au Vietnam atteignait 500 000 personnes. Mais tout cela fut en vain. Le Viet Cong a reçu le soutien actif du Nord-Vietnam. Ils connaissaient très bien la jungle et, alimentés par la haine générée par les actions punitives de l'armée américaine et de leur armée sud-coréenne satellites, a causé de graves dégâts à l'ennemi.
Peu glorieux La guerre du Vietnam a conduit à une scission de la société américaine et à la croissance du sentiment anti-américain dans le monde entier. Dans ces circonstances, R. Nixon, vainqueur de l'élection présidentielle de 1968, s'empresse d'annoncer le retrait progressif des troupes américaines du Vietnam. La « vietnamisation » de la guerre, c’est-à-dire le transfert des principales fonctions de lutte contre la guérilla à l’armée sud-vietnamienne, a finalement conduit à la défaite honteuse des États-Unis et au déclin de leur prestige. Selon les Accords de Paris de 1973, les Américains furent contraints de retirer toutes leurs troupes du Vietnam et, en 1975, le régime sud-vietnamien s’effondra.
Des armes ont été fournies à l'URSS et aux États-Unis ainsi qu'à des participants à d'autres conflits régionaux. Les champs de bataille servaient de terrains d’essais militaires pour tester de nouveaux systèmes d’armes. Souvent, à la suite de la chute des régimes pro-soviétiques ou pro-américains, les dépenses des superpuissances en matière d'approvisionnement en armes sont devenues irrévocables : les vainqueurs ne se sont pas du tout efforcés de payer les factures des vaincus. Cependant, pour l'économie soviétique, la participation du pays aux conflits régionaux était beaucoup plus lourde. Matériel du site
Dans la littérature scientifique moderne, trois points de vue sont courants sur la question des causes de la guerre froide. Certains chercheurs considèrent les États-Unis comme coupables, d'autres l'URSS et d'autres encore parlent d'une responsabilité égale des superpuissances. Quel point de vue vous paraît le plus convaincant ?
1. Raisons : 1.1 Confrontation entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide. 1.2 Lutte de libération nationale du peuple vietnamien. Année de lutte pour l'unification du pays - Réunion à Genève sur la question de la fin de la guerre en Indochine. Division du Vietnam en nord et sud


2. Étapes (1964 - Incident dans le golfe du Tonkin. Les Vietnamiens attaquent un navire de la marine américaine) - 1973. (escalade de la guerre, résultats - signature d'un accord de paix en janvier 1973) - 1975 (prise du sud par le Nord Vietnam)



Opération Têt 1968 Offensive vietnamienne sur tout le pays. Ils contrôlent la majeure partie du territoire du pays. Des combats sanglants ont lieu. Opération Têt 1968 Offensive vietnamienne sur tout le pays. Ils contrôlent la majeure partie du territoire du pays. Des combats sanglants ont lieu.

1969 Nixon devient président des États-Unis. M. Nixon a annoncé un retrait progressif des troupes américaines et est devenu président des États-Unis. Annonce d'un retrait progressif des troupes américaines. Le nombre de troupes a été réduit de à un an. Le nombre de troupes a été réduit de à. L'accent a été mis sur l'aviation sur le bombardement massif du Nord-Vietnam. Le pari sur l’aviation est un bombardement massif du Nord-Vietnam.

3. Résultats de la guerre - Accord de Paris sur le Vietnam. Les troupes américaines se sont retirées du pays. La division du pays a été préservée (le long du 17e parallèle) - Opération Ho Chi Minh, prise du Sud Vietnam par le Nord. Le Vietnam est devenu un pays socialiste unifié. 3.3 Pertes américaines en guerre. 3.4 Pertes vietnamiennes - plus de 2 millions de personnes.

Conflit armé dans les années 60-70. XXe siècle sur le territoire du Vietnam, du Laos et du Cambodge avec la participation des États-Unis et de leurs alliés. Cette guerre fut l’un des principaux conflits de la guerre froide.
Division du Vietnam.
Après la défaite de la France et le retrait de ses troupes dans le cadre des Accords de Genève au printemps 1954, le Vietnam est temporairement divisé en deux parties par une ligne de démarcation longeant le 17e parallèle : au nord, où se trouve la République démocratique du Vietnam, pro-communiste. Le Vietnam (DRV) existait, et au sud, où en 1955 la République du Vietnam fut proclamée avec sa capitale à Saigon. Le Sud-Vietnam passa bientôt sous contrôle américain. Le nouveau gouvernement de Ngo Dinh Diem s'est appuyé sur le soutien d'une couche restreinte de citoyens associés aux pays occidentaux et a reçu l'aide financière américaine. En 1956, le Sud-Vietnam, avec le soutien tacite des États-Unis, refuse d’organiser un référendum national sur la question de la réunification du pays. La constitution adoptée comprenait une disposition selon laquelle toute action visant à propager les idées communistes dans le pays était poursuivie. La persécution des opposants politiques au régime a commencé. L’Église catholique constitue, avec l’armée, le principal soutien du régime sud-vietnamien.
Dans le même temps, le régime communiste dirigé par Hô Chi Minh, populaire auprès d'une large partie de la population et cherchant à libérer et à unifier l'ensemble du pays sur une base anticoloniale, s'est renforcé dans le nord du Vietnam.
Viet-Cong.
Les communistes de la DRV ont organisé l'envoi d'armes et de « volontaires » vers le sud le long de la « piste Ho Chi Minh » - des routes tracées dans la jungle depuis le Nord-Vietnam en passant par le Laos et le Cambodge. Les autorités de ces deux pays n'ont pas pu résister aux actions des communistes. En décembre 1960, le Front de libération nationale du Sud-Vietnam est créé, menant la guérilla contre le régime sud-vietnamien. Le gouvernement sud-vietnamien a appelé ces forces le Viet Cong (utilisant ce terme pour désigner tous les communistes vietnamiens). Bientôt, il comptait déjà 30 000 combattants. Leur lutte bénéficiait du soutien militaire du Nord-Vietnam.
L'idée d'une réforme agraire menée au Nord-Vietnam est devenue extrêmement populaire parmi les pauvres, ce qui a conduit de nombreux Sud-Vietnamiens à rejoindre les rangs des partisans.
Intervention américaine.
Pour les États-Unis, l’offensive communiste en Indochine constituait un défi, car elle pourrait conduire l’Occident à perdre le contrôle de l’Asie du Sud-Est. Le concept du « domino » était alors populaire à Washington, selon lequel la chute d’un régime pro-américain entraînait inévitablement un changement de la situation politique dans l’ensemble de la région. À la fin de 1963, 17 000 conseillers militaires américains opéraient déjà au Sud-Vietnam. Depuis janvier 1964, le régime de Saigon était dirigé par Nguyen Khanh, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire et proclamant comme objectif la défaite des partisans et l'unification de l'ensemble du territoire du pays sous son règne. Mais la popularité du Viet Cong n’a fait que croître, et le mécontentement à l’égard du régime au pouvoir, incapable de faire face à la situation dans le pays, s’est également accru. De nombreux sudistes ont partagé des informations avec les partisans. La situation devenait menaçante.
Les États-Unis ont utilisé le bombardement vietnamien du destroyer Maddox de la marine américaine comme prétexte pour une intervention à grande échelle. Le 2 août 1964, le Maddox, patrouillant dans le golfe du Tonkin, s'approcha de la côte du Nord-Vietnam et aurait été attaqué par des torpilleurs nord-vietnamiens. Deux jours plus tard, une autre attaque a été menée dans les eaux internationales dans des circonstances peu claires. A l'initiative du président américain L. Johnson, le Congrès américain a adopté une résolution visant à protéger les États-Unis en Indochine.
Bombardement du Vietnam par des avions américains.
En février 1965, des bombardements massifs aériens et maritimes du DRV ont commencé. Johnson cherchait à « bombarder le Vietnam jusqu’à l’âge de pierre ». Pour 1965-1968 Plus de 2,5 millions de bombes aériennes ont été larguées sur le Vietnam. Rien qu’à la fin de 1965, 700 000 personnes ont quitté les zones rurales du Sud-Vietnam et sont devenues des réfugiés. En mars, 3 500 Marines américains ont débarqué au Sud-Vietnam pour protéger la base aérienne de Da Nang. Trois ans plus tard, le nombre de soldats atteignait 550 000 personnes. L’opération militaire américaine a également été soutenue par des contingents de Corée du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. L’Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon étaient solidaires des États-Unis, mais ne participaient pas directement à la guerre.
Les Américains n’ont pas réussi à affaiblir le moral de l’ennemi, à couper les routes de transfert de l’aide du Nord au Sud ou à vaincre les forces partisanes au Sud-Vietnam. Pour briser la résistance, les troupes américaines ont entrepris des opérations punitives, accompagnées d'incendies de colonies pacifiques et d'exterminations massives d'habitants. En mars 1968, la compagnie du lieutenant W. Kelly tua presque tous les habitants du village vietnamien de Song My, y compris les femmes et les enfants. Ce massacre a provoqué une explosion d’indignation aux États-Unis. De plus en plus d’Américains pensaient que leur armée n’était pas meilleure que celle des nazis. Bientôt, les Américains durent se mettre à la défense de leurs bases, se limitant à ratisser et à bombarder la jungle. Les avions américains arrosaient la jungle avec des pesticides, ce qui asséchait la végétation recouvrant les partisans et rendait les gens malades. Le napalm était souvent utilisé lors des bombardements. Les bombardiers américains ont attaqué non seulement des cibles militaires, mais également des entreprises industrielles et diverses infrastructures : centrales électriques, voies ferrées, ponts, communications fluviales et installations de stockage de pétrole. Mais les partisans vietnamiens ont contré la « guerre des hélicoptères » américaine avec une mobilité de troupes sans précédent grâce à la « guerre des tunnels ». Leurs catacombes ramifiées couvraient la majeure partie du Vietnam - et sous un seul village, la longueur des tunnels avec des entrepôts, des chambres et des chambres pour les blessés pouvait dépasser un kilomètre et demi. Mais cette guerre environnementale n’a pas aidé.
Contre-offensive du Viet Cong.
En janvier-février 1968, les guérilleros attaquent toutes les bases et routes du Sud-Vietnam, s'emparent de la grande ville de Hué, l'ancienne capitale impériale, et combattent dans les rues de Saigon. Des événements dramatiques se sont déroulés autour de la prise de l'ambassade américaine : une bataille acharnée a duré six heures avant que les troupes américaines, avec l'aide de renforts arrivés à temps, ne parviennent à repousser les Viet Cong. C’est ce fait qui a eu un effet choquant sur la société américaine, démontrant la faiblesse du régime de Saigon, des forces américaines et de la détermination des communistes. Au prix d’efforts incroyables, les forces américaines repoussèrent les forces ennemies grâce à des bombardements intensifiés, mais à la fin de 1968, environ les deux tiers du Sud-Vietnam étaient aux mains des communistes.
Aide de l'URSS et de la Chine.
L’assistance politique, économique et militaire de l’Union soviétique a joué un rôle majeur dans la situation actuelle. Les approvisionnements soviétiques au Nord-Vietnam s'effectuaient via le port de Haiphong, que les États-Unis s'abstenaient de bombarder et d'exploiter, craignant les conséquences de la destruction des navires soviétiques. À partir de 1965, l’URSS a fourni du matériel et des munitions pour la défense aérienne, des chars et des armes lourdes. Les spécialistes soviétiques étaient largement impliqués dans la formation du Viet Cong.
La Chine, à son tour, a envoyé des troupes de 30 000 à 50 000 personnes au Nord-Vietnam pour restaurer les routes et les voies ferrées, et a également fourni de la nourriture, des armes légères et des camions. Dans le même temps, les deux alliés les plus importants du Nord-Vietnam avaient des points de vue différents sur la stratégie de guerre. Les Chinois, s’appuyant sur leur propre expérience, prônaient une « guerre prolongée », mettant l’accent sur les actions de guérilla menées dans le Sud principalement par les Viet Cong. L'Union soviétique a poussé le Vietnam à négocier et a ainsi indirectement soutenu l'idée d'opérations militaires à grande échelle avec les principales forces du Nord-Vietnam, capables de créer des conditions favorables à la conclusion d'accords.
Changer la stratégie américaine.
La guerre du Vietnam devient de plus en plus impopulaire aux États-Unis. Des rassemblements contre la guerre ont eu lieu dans tout le pays, dégénérant en affrontements entre étudiants et policiers. Le président L. Johnson a été contraint de poursuivre les négociations avec le DRV, mais celles-ci ont été retardées en raison de la position de principe du DRV et du Front national, qui exigeaient l'évacuation des troupes américaines et un changement de gouvernement à Saigon. L'échec des négociations et la poursuite de la guerre ont conduit le président Johnson à se retirer de sa candidature à un nouveau mandat.
Prenant en compte les « leçons du Vietnam », le gouvernement républicain dirigé par R. Nixon à la fin des années 60. fixer le cap pour modifier la stratégie asiatique des États-Unis. La proclamation de la « Doctrine Guam » ou « Doctrine Nixon » reflétait l’intention des nouveaux dirigeants américains de maintenir leur influence prédominante au Vietnam, tout en utilisant des méthodes adaptées aux conditions changeantes.
Concernant le Sud-Vietnam, la révision de la stratégie américaine s'est traduite par la mise en œuvre de la stratégie dite de « vietnamisation », associée à une réduction progressive du nombre de forces américaines participant aux hostilités. La principale responsabilité politique et militaire dans la lutte contre les forces de libération révolutionnaires a été transférée aux dirigeants de Saigon. Dans le même temps, comme le croyait Washington, l'objectif principal était atteint : maintenir l'influence américaine au Vietnam. La stratégie de « vietnamisation » visait à réduire le nombre de victimes parmi les troupes américaines et ainsi à protéger les États-Unis des critiques de l’opinion publique américaine et internationale.
L’un des éléments les plus importants de cette stratégie était la « pacification » des paysans sud-vietnamiens, dont les rebelles tiraient leur force. Les Américains ont tenté de frapper à l’arrière de la révolution et de détruire les racines de la lutte de libération de la population sud-vietnamienne. Pour atteindre ces objectifs, les États-Unis ont utilisé à plus grande échelle la quasi-totalité de leur arsenal militaire, y compris les bombardiers B-52 et les produits chimiques toxiques. Sous la direction d'instructeurs américains, l'armée du Sud-Vietnam, à qui était confiée la principale charge de la guerre, fut renforcée. Dans le même temps, les négociations de paix de Paris se poursuivaient. Pour faire pression, R. Nixon ordonna en mai 1972 de miner les ports nord-vietnamiens. Washington espérait ainsi empêcher complètement l’acheminement de l’aide militaire et économique soviétique au Nord-Vietnam.
Les bombardements du territoire de la République démocratique du Vietnam se sont également intensifiés. En réponse, les opérations militaires rebelles contre les troupes américaines et sud-vietnamiennes se sont intensifiées. Le 27 janvier 1973, des accords visant à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix au Vietnam sont paraphés à Paris. Selon les termes de l'accord, les États-Unis et la République démocratique du Vietnam ont retiré leurs troupes du Sud-Vietnam. La DRV a promis de ne pas envoyer d’armes ni de « volontaires » au Sud-Vietnam, au Cambodge et au Laos. La démarcation entre le Nord et le Sud Vietnam continue de suivre le 17e parallèle et son caractère temporaire est souligné. Ces pays auraient dû organiser des élections libres. Mais après la démission du président Nixon en 1974, les États-Unis réduisirent fortement leur aide aux régimes alliés d’Indochine, ce qui entraîna la chute du gouvernement du Sud-Vietnam.
Offensive viet-cong décisive.
Au printemps 1975, les communistes locaux, qui, contrairement aux accords, recevaient une aide importante de l'URSS, de la Chine et de la République démocratique du Vietnam, lancèrent une offensive rapide au Laos, au Cambodge et au Sud-Vietnam. Au Cambodge, le groupe communiste extrémiste « Khemor Reds » est arrivé au pouvoir. En décembre, la République démocratique populaire lao, dirigée par les communistes, a été proclamée. Le 30 avril, les forces du Front national s'emparent de Saigon. Un an plus tard, des élections à l'Assemblée nationale ont eu lieu dans tout le Vietnam, qui ont proclamé le 2 juillet 1976 la réunification du Nord et du Sud en une seule République socialiste du Vietnam avec sa capitale à Hanoï. La ville de Saigon fut bientôt rebaptisée Ho Chi Minh, en mémoire du fondateur et président de la République démocratique du Vietnam.
La défaite américaine au Vietnam a été le plus grand échec américain pendant la guerre froide. Plus de 50 000 soldats américains sont morts pendant la guerre. Le mouvement anti-guerre massif a conduit à l’émergence de ce qu’on appelle. « Syndrome vietnamien », c'est-à-dire diffusion de l'idée du renoncement à la guerre comme moyen de résoudre les conflits. Dans la littérature et le cinéma également, une large attention a été accordée au « syndrome » qui hantait des dizaines de milliers de soldats et d'officiers qui avaient été au Vietnam et éprouvaient des difficultés psychologiques pour retourner à la vie civile. Pour le Nord-Vietnam, les pertes militaires se sont élevées à plus d'un million de personnes et pour le Sud-Vietnam, à environ 250 000 personnes.
«Je tremble pour mon pays quand je pense que Dieu est juste»
Le président américain Thomas Jefferson
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Vietnam devient une colonie française. La montée de la conscience nationale après la Première Guerre mondiale conduit à la création en 1941 en Chine de la Ligue pour l'indépendance du Vietnam ou Viet Minh, une organisation militaro-politique qui fédère tous les opposants au pouvoir français.
Les principaux postes étaient occupés par des partisans des vues communistes sous la direction de Ho Chi Minh. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il collabore activement avec les États-Unis, qui aident le Viet Minh en lui fournissant des armes et des munitions pour combattre les Japonais. Après la capitulation du Japon, Hô Chi Minh s'empare de Hanoï et d'autres grandes villes du pays, proclamant la formation de la République démocratique indépendante du Vietnam. Cependant, la France n'était pas d'accord avec cela et transféra un corps expéditionnaire en Indochine, déclenchant une guerre coloniale en décembre 1946. L'armée française ne pouvait pas faire face seule aux partisans et, dès 1950, les États-Unis leur vinrent en aide. La principale raison de leur intervention était l'importance stratégique de la région, gardant les îles japonaises et les Philippines depuis le sud-ouest. Les Américains estimaient qu’il serait plus facile de contrôler ces territoires s’ils étaient sous la domination des alliés français.
La guerre se poursuivit pendant les quatre années suivantes et en 1954, après la défaite des Français à la bataille de Dien Bien Phu, la situation devint presque désespérée. À cette époque, les États-Unis avaient déjà payé plus de 80 % des coûts de cette guerre. Le vice-président Richard Nixon a recommandé le recours au bombardement nucléaire tactique. Mais en juillet 1954, l'Accord de Genève fut conclu, selon lequel le territoire du Vietnam était temporairement divisé le long du 17e parallèle (où se trouvait une zone démilitarisée) en Nord-Vietnam (sous le contrôle du Viet Minh) et Sud-Vietnam (sous la domination des Français, qui lui accordèrent presque immédiatement l'indépendance).
En 1960, John Kennedy et Richard Nixon participent à la bataille pour la Maison Blanche aux États-Unis. A cette époque, la lutte contre le communisme était considérée comme une bonne forme et c'est pourquoi le candidat dont le programme de lutte contre la « menace rouge » était le plus décisif a gagné. Après l’adoption du communisme en Chine, le gouvernement américain a considéré tout développement au Vietnam comme faisant partie de l’expansion communiste. Cela ne pouvait pas être autorisé et c'est pourquoi, après les accords de Genève, les États-Unis ont décidé de remplacer complètement la France au Vietnam. Avec le soutien américain, le Premier ministre sud-vietnamien Ngo Dinh Diem s'est proclamé premier président de la République du Vietnam. Son règne représentait la tyrannie sous l’une de ses pires formes. Seuls des proches ont été nommés à des postes gouvernementaux, que le peuple détestait encore plus que le président lui-même. Ceux qui s'opposaient au régime étaient emprisonnés et la liberté d'expression était interdite. Il est peu probable que l’Amérique ait apprécié cela, mais vous ne pouvez pas fermer les yeux sur quoi que ce soit pour le bien de votre seul allié au Vietnam.
Comme l’a dit un diplomate américain : « Ngo Dinh Diem est certes un fils de pute, mais il est NOTRE fils de pute ! »
Ce n’était qu’une question de temps avant que des unités de résistance clandestines, même celles non soutenues par le Nord, n’apparaissent sur le territoire du Sud-Vietnam. Cependant, les États-Unis ne voyaient partout que les machinations des communistes. Un renforcement supplémentaire des mesures n'a conduit qu'en décembre 1960 à ce que tous les groupes clandestins sud-vietnamiens se soient unis au sein du Front de libération nationale du Sud-Vietnam, appelé Viet Cong en Occident. Le Nord-Vietnam commença alors à soutenir les partisans. En réponse, les États-Unis ont accru leur aide militaire à Diem. En décembre 1961, les premières unités régulières des forces armées américaines sont arrivées dans le pays : deux compagnies d'hélicoptères conçues pour accroître la mobilité des troupes gouvernementales. Les conseillers américains ont formé des soldats sud-vietnamiens et planifié des opérations de combat. L’administration de John Kennedy voulait démontrer à Khrouchtchev sa détermination à détruire « l’infection communiste » et sa volonté de protéger ses alliés. Le conflit s’est amplifié et est rapidement devenu l’un des points chauds les plus brûlants de la guerre froide entre les deux puissances. Pour les États-Unis, la perte du Sud-Vietnam signifiait la perte du Laos, de la Thaïlande et du Cambodge, ce qui constituait une menace pour l’Australie. Lorsqu'il est devenu clair que Diem n'était pas en mesure de combattre efficacement les partisans, les services de renseignement américains, avec l'aide de généraux sud-vietnamiens, ont organisé un coup d'État. Le 2 novembre 1963, Ngo Dinh Diem est tué avec son frère. Au cours des deux années suivantes, à la suite de la lutte pour le pouvoir, un nouveau coup d'État a eu lieu tous les quelques mois, ce qui a permis aux partisans d'étendre les territoires capturés. Au même moment, le président américain John Kennedy a été assassiné, et de nombreux partisans des « théories du complot » y voient son désir de mettre fin pacifiquement à la guerre du Vietnam, ce que quelqu’un n’a vraiment pas aimé. Cette version est plausible, à la lumière du fait que le premier document signé par Lyndon Johnson en tant que nouveau président prévoyait l’envoi de troupes supplémentaires au Vietnam. Bien qu’à la veille des élections présidentielles, il ait été nommé « candidat de la paix », ce qui a influencé sa victoire écrasante. Le nombre de soldats américains au Sud-Vietnam est passé de 760 en 1959 à 23 300 en 1964.

Le 2 août 1964, deux destroyers américains, le Maddox et le Turner Joy, sont attaqués par les forces nord-vietnamiennes dans le golfe du Tonkin. Quelques jours plus tard, au milieu de la confusion au sein du commandement yankee, le destroyer Maddox annonça une deuxième attaque. Et bien que l'équipage du navire ait rapidement démenti l'information, les services de renseignement ont annoncé l'interception de messages dans lesquels les Nord-Vietnamiens reconnaissaient l'attaque. Le Congrès américain, avec 466 voix pour et aucune voix contre, a adopté la résolution Tonkin, donnant au président le droit de répondre à cette attaque par tous les moyens. Cela marqua le début de la guerre. Lyndon Johnson a ordonné des frappes aériennes contre les installations navales nord-vietnamiennes (opération Pierce Arrow). Étonnamment, la décision d’envahir le Vietnam a été prise uniquement par les dirigeants civils : le Congrès, le président, le secrétaire à la Défense Robert McNamara et le secrétaire d’État Dean Rusk. Le Pentagone a réagi avec peu d’enthousiasme à la décision de « résoudre le conflit » en Asie du Sud-Est.
Colin Powell, un jeune officier de l’époque, a déclaré : « Nos militaires avaient peur de dire aux dirigeants civils que cette méthode de guerre conduisait à une perte garantie. »
L'analyste américain Michael Desch a écrit : « L'obéissance inconditionnelle des militaires aux autorités civiles conduit, d'une part, à la perte de leur autorité, et d'autre part, elle libère les mains des autorités officielles de Washington pour de nouvelles aventures, similaires à celle du Vietnam. »
Plus récemment, une déclaration a été rendue publique aux États-Unis par le chercheur indépendant Matthew Eid, spécialiste de la National Security Agency (l'agence américaine de renseignement pour le renseignement électronique et le contre-espionnage), selon laquelle des informations clés sur l'incident du golfe du Tonkin en 1964 , qui a servi de raison à l’invasion américaine du Vietnam, a été falsifié. La base était un rapport de l'historien de la NSA, Robert Hayniock, compilé en 2001 et déclassifié en vertu de la Freedom of Information Act (adoptée par le Congrès en 1966). Le rapport suggère que les agents de la NSA ont commis une erreur involontaire en traduisant les informations obtenues à la suite d'une interception radio. Les officiers supérieurs, qui ont découvert presque immédiatement l'erreur, ont décidé de la cacher en corrigeant tous les documents nécessaires afin qu'ils indiquent la réalité de l'attaque contre les Américains. De hauts responsables ont évoqué à plusieurs reprises ces fausses données dans leurs discours.

Robert McNamara a déclaré : « Je pense qu’il est faux de penser que Johnson voulait la guerre. Cependant, nous pensions avoir la preuve que le Nord-Vietnam était en train d’intensifier le conflit.»
Et ce n’est pas la dernière falsification de données de renseignement par la direction de la NSA. La guerre en Irak reposait sur des informations non confirmées sur le « dossier de l’uranium ». Cependant, de nombreux historiens estiment que même sans l'incident du golfe du Tonkin, les États-Unis auraient quand même trouvé une raison d'entreprendre une action militaire. Lyndon Johnson pensait que l'Amérique était obligée de défendre son honneur, d'imposer à notre pays une nouvelle course aux armements, d'unir la nation et de détourner ses citoyens des problèmes internes.
Lors de nouvelles élections présidentielles aux États-Unis en 1969, Richard Nixon déclara que la politique étrangère des États-Unis allait changer radicalement. Les États-Unis ne prétendront plus jouer le rôle de surveillant et tenteront de résoudre les problèmes aux quatre coins de la planète. Il a fait état d'un plan secret visant à mettre fin aux combats au Vietnam. Cela a été bien accueilli par le public américain fatigué par la guerre, et Nixon a remporté les élections. Cependant, en réalité, le plan secret consistait en un recours massif à l’aviation et à la marine. Rien qu’en 1970, les bombardiers américains ont largué plus de bombes sur le Vietnam qu’au cours des cinq dernières années réunies.
Et ici, nous devrions mentionner une autre partie intéressée par la guerre : les sociétés américaines qui fabriquent des munitions. Plus de 14 millions de tonnes d'explosifs ont explosé pendant la guerre du Vietnam, soit plusieurs fois plus que pendant la Seconde Guerre mondiale sur tous les théâtres de combat. Les bombes, y compris les bombes à fragmentation de fort tonnage et désormais interdites, ont rasé des villages entiers et les incendies de napalm et de phosphore ont brûlé des hectares de forêt. La dioxine, la substance la plus toxique jamais créée par l'homme, a été pulvérisée sur le Vietnam à raison de plus de 400 kilogrammes. Les chimistes estiment que 80 grammes ajoutés à l'approvisionnement en eau de New York suffisent à la transformer en une ville morte. Ces armes ont continué à tuer pendant quarante ans, affectant la génération moderne des Vietnamiens. Les bénéfices des sociétés militaires américaines s’élèvent à plusieurs milliards de dollars. Et ils n’étaient pas du tout intéressés par une victoire rapide de l’armée américaine. Ce n'est pas un hasard si l'État le plus développé du monde, utilisant les dernières technologies, de grandes masses de soldats, remportant toutes ses batailles, n'a toujours pas pu gagner la guerre.

Le candidat républicain à la présidentielle, Ron Paul, a déclaré ceci : « Nous nous dirigeons vers un fascisme plus doux, et non vers un fascisme de type hitlérien – une perte des libertés civiles où les entreprises sont aux commandes et le gouvernement est aux côtés du grand capital. »
En 1967, le Tribunal international pour les crimes de guerre a tenu deux sessions pour entendre des témoignages sur la conduite de la guerre du Vietnam. Il ressort de leur verdict que les États-Unis portent l'entière responsabilité de l'usage de la force et du crime contre la paix, en violation des dispositions établies du droit international.
« Devant les cabanes, se souvient un ancien soldat américain, des vieillards se tenaient ou étaient accroupis dans la poussière au seuil. Leur vie était si simple, ils se passaient tous dans ce village et les champs qui l'entouraient. Que pensent-ils des étrangers qui envahissent leur village ? Comment peuvent-ils comprendre le mouvement constant des hélicoptères qui traversent leur ciel bleu ? des chars et des half-tracks, des patrouilles armées parcourant leurs rizières où ils labourent le sol ?

Guerre du Vietnam des forces armées américaines
La « guerre du Vietnam » ou « guerre du Vietnam » est la deuxième guerre d'Indochine entre le Vietnam et les États-Unis. Elle a commencé vers 1961 et s'est terminée le 30 avril 1975. Au Vietnam même, cette guerre est appelée guerre de libération, et parfois guerre américaine. La guerre du Vietnam est souvent considérée comme l’apogée de la guerre froide entre le bloc soviétique et la Chine, d’une part, et les États-Unis et certains de leurs alliés, de l’autre. Aux États-Unis, la guerre du Vietnam est considérée comme le moment le plus sombre. Dans l’histoire du Vietnam, cette guerre est peut-être la page la plus héroïque et la plus tragique.
La guerre du Vietnam était à la fois une guerre civile entre diverses forces politiques vietnamiennes et une lutte armée contre l'occupation américaine.
Ctrl Entrer
Remarqué Y bku Sélectionnez le texte et cliquez Ctrl+Entrée