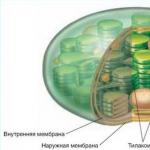La structure et le mouvement des cils et des flagelles. Microtubules
CORPS BASAL(syn. : kinétosomes, granules basaux ou grains) - les structures situées sous la membrane cellulaire à la base des cils ou des flagelles, participant à leur formation et faisant partie des organites du mouvement cellulaire. Dans les organismes eucaryotes (voir) T. b. représentent des centrioles compliqués (voir Cellule) et se composent de 9 triplets de microtubules longitudinaux de diamètre. 15-20 nm, situé autour de l’axe T.b. (Fig.1,2). Les tubules interne et moyen du triplet se prolongent dans les complexes de microtubules périphériques ;
Le tube externe se termine par la plaque basale (terminale) d'une épaisseur de 30 nm, les bords sont séparés par T. b. de la base du kinocil (c'est-à-dire des cils ou des flagelles). Les tubes internes des triplés sont unis entre eux par un système de microfilaments, ainsi qu'avec la capsule centrale située dans la partie proximale du tubule. Ainsi, sur une coupe transversale à ce niveau, T. b. ressemble à une roue à rayons. Au centre de T. b. passe le diamètre du canal longitudinal. D'ACCORD. 6 nm, assurant apparemment l'apport de monomères protéiques à l'extrémité distale du kinocil et l'élongation des microtubules de cette manière. Chez la bactérie T. b. ne contiennent qu’un seul microtubule.

De la base de T. b. De fines fibrilles, qui sont les racines des kinocils, s'étendent dans un certain nombre de cellules. Dans les cellules ciliées des vertébrés, ces fibrilles forment un cône filamenteux dont le sommet fait face au noyau. Chez certains ciliés, T. b. reliés par des faisceaux de filaments. La présence de liaisons similaires et de molécules d'ATP dans la composition de T. b. indique leur rôle important dans la fourniture d’énergie et la coordination du mouvement des kinocils.
En plus des cils et des flagelles, de T. b. des structures sensorielles peuvent se développer (par exemple, poils de cellules réceptrices et photorécepteurs de nombreux invertébrés, segments externes de bâtonnets et cônes de la rétine des vertébrés, etc.).
Le développement de T. b., en règle générale, est associé aux centrioles (voir Cellule). En particulier, dans les spermatozoïdes de mammifères de T. b. le centriole distal (fille) du dplosome se transforme. Dans les cellules de l'épithélium cilié, T. b. se développent à partir d’un matériau fibrogranulaire (« forme de condensation ») qui s’accumule dans la partie apicale de la cellule autour du centriole. Les procentrioles filles séparés de cette masse sont disposés en rangées sous la membrane plasmique de la cellule, se formant ainsi. corps basaux.
Avec T. b. Les blépharoplastes des protozoaires et de certains organismes végétaux, ainsi que les kinétoplastes des flagellés (voir), sont étroitement liés. Parfois, le terme « blépharoplaste » est même utilisé comme synonyme de T. b.
Bibliographie: Welsh U. et Storch F., Introduction à la cytologie et à l'histologie animales, trans. avec l'allemand, p. 37, M., 1976 ; D e R o b r t i s E., Novinsky V. et S a e s F. Biologie cellulaire, trans. de l'anglais, p. 412, M., 1973 ; M e c l e r D. Biochimie, Réactions chimiques dans une cellule vivante, trans. de l'anglais, tome 1, p. 37, M., 1980 ; F p e y - V i s l i n g A. Organographie comparée du cytoplasme, trans. de l'anglais, p. 94, M., 1976.
CORPS BASAL(syn. : kinétosomes, granules basaux ou grains) - les structures situées sous la membrane cellulaire à la base des cils ou des flagelles, participant à leur formation et faisant partie des organites du mouvement cellulaire. Dans les organismes eucaryotes (voir) T. b. représentent des centrioles compliqués (voir Cellule) et se composent de 9 triplets de microtubules longitudinaux de diamètre. 15-20 nm, situé autour de l’axe T.b. (Fig.1,2). Les tubules interne et moyen du triplet se prolongent dans les complexes de microtubules périphériques ;
le tube externe se termine par la plaque basale (terminale) d'une épaisseur de 30 nm, les bords sont séparés par T. b. de la base du kinocil (c'est-à-dire des cils ou des flagelles). Les tubes internes des triplés sont unis entre eux par un système de microfilaments, ainsi qu'avec la capsule centrale située dans la partie proximale du tubule. Ainsi, sur une coupe transversale à ce niveau, T. b. ressemble à une roue à rayons. Au centre de T. b. passe le diamètre du canal longitudinal. D'ACCORD. 6 nm, assurant apparemment l'apport de monomères protéiques à l'extrémité distale du kinocil et l'élongation des microtubules de cette manière. Chez la bactérie T. b. ne contiennent qu’un seul microtubule.
De la base de T. b. De fines fibrilles, qui sont les racines des kinocils, s'étendent dans un certain nombre de cellules. Dans les cellules ciliées des vertébrés, ces fibrilles forment un cône filamenteux dont le sommet fait face au noyau. Chez certains ciliés, T. b. reliés par des faisceaux de filaments. La présence de liaisons similaires et de molécules d'ATP dans la composition de T. b. indique leur rôle important dans la fourniture d’énergie et la coordination du mouvement des kinocils.
En plus des cils et des flagelles, de T. b. des structures sensorielles peuvent se développer (par exemple, poils de cellules réceptrices et photorécepteurs de nombreux invertébrés, segments externes de bâtonnets et cônes de la rétine des vertébrés, etc.).
Le développement de T. b., en règle générale, est associé aux centrioles (voir Cellule). En particulier, dans les spermatozoïdes de mammifères de T. b. le centriole distal (fille) du dplosome se transforme. Dans les cellules de l'épithélium cilié, T. b. se développent à partir d’un matériau fibrogranulaire (« forme de condensation ») qui s’accumule dans la partie apicale de la cellule autour du centriole. Les procentrioles filles séparés de cette masse sont disposés en rangées sous la membrane plasmique de la cellule, se formant ainsi. corps basaux.
Avec T. b. Les blépharoplastes des protozoaires et de certains organismes végétaux, ainsi que les kinétoplastes des flagellés (voir), sont étroitement liés. Parfois, le terme « blépharoplaste » est même utilisé comme synonyme de T. b.
Voir également Flagelles bactériens.
Bibliographie: Welsh U. et Storch F., Introduction à la cytologie et à l'histologie animales, trans. avec l'allemand, p. 37, M., 1976 ; D e R o b r t i s E., Novinsky V. et S a e s F. Biologie cellulaire, trans. de l'anglais, p. 412, M., 1973 ; M e c l e r D. Biochimie, Réactions chimiques dans une cellule vivante, trans. de l'anglais, tome 1, p. 37, M., 1980 ; F p e y - V i s l i n g A. Organographie comparée du cytoplasme, trans. de l'anglais, p. 94, M., 1976.
Ya.E. Khesin.
Riz. 1. Représentation schématique de la structure du corps basal : a - coupe longitudinale (I - base du kinocil, II - partie distale du corps basal, III - partie proximale du corps basal) ; b - les coupes transversales aux niveaux appropriés ; 1 - plaque basale (terminale); 2 - triplés de microtubules ; 3 - canal central ; 4 - capsule centrale ; 5 - structure en forme de roue.  Riz. 2. Diagramme de diffraction électronique d'une section transversale du corps basal au niveau de sa partie proximale : 1 - triplets de microtubules ; 2 - microfilaments ; 3 - capsule centrale ; X5000.
Riz. 2. Diagramme de diffraction électronique d'une section transversale du corps basal au niveau de sa partie proximale : 1 - triplets de microtubules ; 2 - microfilaments ; 3 - capsule centrale ; X5000.
Le centriole est un organite de cellules animales (sauf certains protozoaires) et de plantes inférieures (certaines algues et mousses).
Contrairement aux autres organites cellulaires, le centriole a une structure clairement symétrique radialement, presque la même pour tous les organismes.
Le diamètre du centriole est de 0,2 µm et sa longueur est de 0,2 à 0,6 µm. Son composant le plus visible est constitué de 9 microtubules disposés, situés de manière strictement ordonnée le long de la périphérie. Les microtubules sont reliés les uns aux autres par un système de ligaments et, à l'extérieur, ils sont recouverts d'un revêtement constitué d'un matériau sans structure - une matrice.
La structure ajourée des centrioles est transmise d'une cellule à deux cellules filles d'une manière unique, appelée réplication (doublement). Contrairement à la réplication de l'ADN, où les moitiés de la molécule d'origine servent de modèles pour la formation de deux nouvelles molécules, les anciens centrioles ne servent pas de modèles pour les nouvelles.
Il n’y a que 2 centrioles dans une cellule normale. Ils se répliquent lorsque la cellule se prépare à se diviser lors de la synthèse de l'ADN (voir Cycle cellulaire). Près de chacun de ces centrioles, un petit centriole fille apparaît, situé soit perpendiculairement aux centrioles mères, soit bout à bout. Les centrioles filles grandissent et, après la division cellulaire, s'éloignent de la mère et mûrissent tout au long du cycle cellulaire. Ainsi, comme établi, après division, un centriole mature et un centriole immature entrent dans la cellule.
Dans les cellules, les centrioles font partie du centre cellulaire, la région du cytoplasme d'où proviennent la plupart, sinon la totalité, des microtubules de la cellule. Pendant la mitose, les centrioles déterminent l'emplacement des pôles du fuseau. Dans le même temps, les centrioles eux-mêmes ne contactent pas les microtubules, mais autour des centrioles se trouve une certaine substance qui induit la croissance des microtubules : pendant la mitose - les microtubules du fuseau et en interphase - les microtubules cytoplasmiques. Dans certains cas, les centrioles peuvent former un cil (voir Flagelles et cils), puis leurs microtubules, en s'accumulant, donnent naissance à des microtubules d'axonème. Dans les cellules de l'épithélium cilié, les centrioles, se répliquant de manière répétée, donnent naissance à des corps basaux. On pense que les centrioles coordonnent le comportement de la cellule entière, en particulier de son cytosquelette.
Les corps basaux ont une structure proche des centrioles, mais ils sont généralement un peu plus longs (0,5-0,7 µm, peuvent atteindre 8 µm). Ce sont des organites hautement spécialisés qui ne sont présents que dans les cellules dotées de cils (flagelles). De par leur origine, les corps basaux ne sont pas toujours associés aux centrioles (par exemple, ils sont présents dans les cellules ciliées sans centrioles) et se forment de diverses manières. La fonction principale du corps basal est la formation du cil (flagellum). Les corps basaux, attachés à la membrane cellulaire, déterminent l'emplacement des cils, et les axonèmes des cils proviennent de leurs microtubules.
La composition biochimique des centrioles et des corps basaux n'est pas entièrement claire. Ils ne contiennent pas d’ADN, quelques ARN et diverses protéines (dont la tubuline).
Les corps basaux se trouvent dans le cytoplasme à la base des cils et des flagelles et leur servent de support. Chaque corps basal est un cylindre formé de neuf triplets de microtubules (9+0).
Les corps basaux sont capables de restaurer les cils et les flagelles après leur perte.
Les cils et les flagelles peuvent être classés comme organites à usage spécial. On les retrouve dans les cellules de l'épithélium cilié, dans les spermatozoïdes, chez les protozoaires, dans les zoospores d'algues, de mousses, de fougères, etc.
Les cellules qui ont des cils ou des flagelles sont capables de se déplacer ou de permettre au liquide de s'écouler le long de leur surface.

Schéma d'une coupe transversale d'un cil.
Les cils et les flagelles sont de fines excroissances cylindriques du cytoplasme recouvertes d'une membrane plasmique. A la base se trouvent les corps basaux. Une coupe transversale d'un cil ou d'un flagelle montre qu'il y a 9 paires de microtubules le long du périmètre et une paire au centre (9+2). Il y a des cavaliers entre les paires de périphériques adjacentes.
Les fils radiaux (rayons) sont dirigés de chaque paire périphérique vers la paire centrale.
Plus près de la base du cil et du flagelle, la paire centrale de microtubules se brise et est remplacée par un axe creux. Les paires périphériques, pénétrant dans le cytoplasme, acquièrent un troisième microtubule. Le résultat est une structure caractéristique d’un corps basal.
Les flagelles diffèrent des cils par leur longueur.
Les organites à usage spécial comprennent également les myofibrilles des fibres musculaires et les neurofibrilles des cellules nerveuses.
Précédent12345678910111213Suivant
VOIR PLUS :
Kinétosome, ou corps basal, ou granules basaux, ou blépharoplaste- un organite d'une cellule eucaryote, une structure cylindrique de microtubules située à la base des undulipodes - flagelles et cils. En tant que type de centre organisateur de microtubules (MTOC), les kinétosomes sont formés à partir de centrioles et servent de base à la formation de l'axonème flagellaire.
 Schéma d'un flagelle eucaryote. 1 - axonème, 2 - membrane cellulaire, 3 - transport intraflagellaire, 4 - kinétosome (corps basal), 5 - coupe transversale du flagelle, 6 - triplets de microtubules du corps basal.
Schéma d'un flagelle eucaryote. 1 - axonème, 2 - membrane cellulaire, 3 - transport intraflagellaire, 4 - kinétosome (corps basal), 5 - coupe transversale du flagelle, 6 - triplets de microtubules du corps basal.  Coupe longitudinale du flagelle Chlamydomonas reinhardtii dans la zone de fixation du flagelle. Dans la partie inférieure de l'image, deux kinétosomes sont visibles : le principal et celui accessoire (situé perpendiculairement au plan de coupe).
Coupe longitudinale du flagelle Chlamydomonas reinhardtii dans la zone de fixation du flagelle. Dans la partie inférieure de l'image, deux kinétosomes sont visibles : le principal et celui accessoire (situé perpendiculairement au plan de coupe).
Structure
Le kinétosome est constitué de neuf triplets de microtubules composés de γ-tubuline et reliés par des poignées en dynéine. Deux microtubules de chaque triplet passent directement dans les doublets de l'axonème. Le domaine de liaison aux nucléotides de la γ-tubuline joue un rôle clé dans la formation et l'organisation spatiale des microtubules dans le kinétosome. Souvent, les kinétosomes sont ancrés dans le cytoplasme à l'aide d'un appareil racinaire constitué de microtubules ou de racines fibrillaires striées transversalement.
Notes
- 1
2
3
4
5
Ruppert E.E., Fox R.S., Barnes R.D. Protistes et organismes multicellulaires inférieurs // Zoologie des invertébrés. Aspects fonctionnels et évolutifs = Zoologie des invertébrés : une approche évolutive fonctionnelle / trans. de l'anglais T.A. Ganf, N.V. Lenzman, E.V. Sabaneeva ; édité par Les AA
Dobrovolsky et A.I. Granovitch. - 7ème édition. - M. : Académie, 2008. - T. 1. - P. 31-34. - 496 s. - 3000 exemplaires. - ISBN978-5-7695-3493-5.
- Shang, Y., Tsao, CC, Gorovsky, MA (2005). Les analyses mutationnelles révèlent une nouvelle fonction du domaine de liaison aux nucléotides de la gamma-tubuline dans la régulation de la biogenèse du corps basal. Journal de biologie cellulaire171 (6): 1035-1044.
Un flagelle est la structure de surface d’une cellule bactérienne, qui lui sert à se déplacer dans des environnements liquides.
Selon l'emplacement des flagelles, les bactéries sont divisées en (Fig. 1) :
Péritrichial
Mixte
Pôle
Subpolaire
Flagelles du pôle– un ou plusieurs flagelles sont situés à l’un des pôles (monopolaires) ou aux deux (bipolaires) de la cellule et la base est parallèle au grand axe de la cellule.
Flagelles subpolaires(subpolaire) - un ou plusieurs flagelles sont situés à la jonction de la surface latérale avec le pôle de la cellule à une ou deux extrémités. A la base il y a un angle droit avec le grand axe de la cellule.
Flagelles latéraux(latéral) - un ou plusieurs flagelles en forme de faisceau sont situés au milieu de l'une des moitiés de la cellule.
Flagelles péritrichiaux– situés sur toute la surface de la cellule, un à un ou en grappes, les pôles en sont généralement dépourvus.
Flagelles mixtes– deux ou plusieurs flagelles sont situés à différents points de la cellule.
Selon le nombre de flagelles, on distingue :
Monotriches - un flagelle
Polytrichs - un paquet de flagelles
Ils soulignent également :
Lophotrichs– arrangement polytrichial monoplaaire des flagelles.
Amphitrichie– arrangement polytrichial bipolaire des flagelles.
La structure du flagelle bactérien et du corps basal. Flagelle.
La structure du flagelle elle-même est assez simple : un filament attaché au corps basal. Parfois, une section incurvée du tube, appelée crochet, peut être insérée entre le corps basal et le filament ; elle est plus épaisse que le filament et participe à la fixation flexible du filament au corps basal.
Selon la composition chimique, le flagelle est constitué à 98% de protéine flagelline (flagellum - flagelle), il contient 16 acides aminés, les acides aminés glutamiques et aspartiques prédominent, une petite quantité d'acides aminés aromatiques est absente du tryptophane, de la cystéine et de la cystine. La flagelline a une spécificité antigénique et est appelée antigène H. Les flagelles bactériens n'ont pas d'activité ATPase.
L'épaisseur du flagelle est de 10 à 12 nm et sa longueur de 3 à 15 µm.
C'est une spirale rigide tordue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le flagelle tourne également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une fréquence de 40 rps à 60 rps, ce qui fait tourner la cellule dans le sens opposé, mais parce que La cellule étant beaucoup plus lourde que le flagelle, sa rotation est plus lente de 12 à 14 tr/min.
Le flagelle se développe à partir de l'extrémité distale, où les sous-unités entrent par le canal interne. Chez certaines espèces, l'extérieur du flagelle est en outre recouvert d'une gaine, qui prolonge la paroi cellulaire et a probablement la même structure.
Corps basal
Le corps basal est composé de 4 parties :
Tige se connectant au filament ou au crochet
Deux disques enfilés sur une tige. (M et S)
Groupe de complexes protéiques (stators)
Bouchon protéique
Les bactéries qui ont une membrane interne et externe ont 2 disques supplémentaires (P et L) et des structures protéiques situées sur la membrane externe près du corps basal, elles ne jouent donc pas un rôle important dans le mouvement.
La particularité de la structure du corps basal est déterminée par la structure de la paroi cellulaire : son intégrité est nécessaire au mouvement des flagelles. Le traitement des cellules avec du lysozyme entraîne l'élimination de la couche de peptidoglycane de la paroi cellulaire, ce qui entraîne une perte de mouvement, bien que la structure du flagelle n'ait pas été perturbée.
Le centriole est un organite de cellules animales (sauf certains protozoaires) et de plantes inférieures (certaines algues et mousses). Contrairement aux autres organites cellulaires, le centriole a une structure clairement symétrique radialement, presque la même pour tous les organismes.
Le diamètre du centriole est de 0,2 µm et sa longueur est de 0,2 à 0,6 µm. Son composant le plus visible est constitué de 9 microtubules disposés, situés de manière strictement ordonnée le long de la périphérie. Les microtubules sont reliés les uns aux autres par un système de ligaments et, à l'extérieur, ils sont recouverts d'une couverture constituée d'un matériau sans structure - une matrice. La structure ajourée des centrioles est transmise d'une cellule à deux cellules filles d'une manière unique, appelée réplication (doublement). Contrairement à la réplication de l'ADN, où les moitiés de la molécule d'origine servent de modèles pour la formation de deux nouvelles molécules, les anciens centrioles ne servent pas de modèles pour les nouvelles.
Il n’y a que 2 centrioles dans une cellule normale. Ils se répliquent lorsque la cellule se prépare à se diviser lors de la synthèse de l'ADN (voir Cycle cellulaire). Près de chacun de ces centrioles, un petit centriole fille apparaît, situé soit perpendiculairement aux centrioles mères, soit bout à bout. Les centrioles filles grandissent et, après la division cellulaire, s'éloignent de la mère et mûrissent tout au long du cycle cellulaire. Ainsi, comme établi, après division, un centriole mature et un centriole immature entrent dans la cellule.
Dans les cellules, les centrioles font partie du centre cellulaire, la région du cytoplasme d'où proviennent la plupart, sinon la totalité, des microtubules de la cellule. Pendant la mitose, les centrioles déterminent l'emplacement des pôles du fuseau. Dans le même temps, les centrioles eux-mêmes ne contactent pas les microtubules, mais autour des centrioles se trouve une certaine substance qui induit la croissance des microtubules : pendant la mitose - les microtubules du fuseau et en interphase - les microtubules cytoplasmiques. Dans certains cas, les centrioles peuvent former un cil (voir Flagelles et cils), puis leurs microtubules, en s'accumulant, donnent naissance à des microtubules d'axonème. Dans les cellules de l'épithélium cilié, les centrioles, se répliquant de manière répétée, donnent naissance à des corps basaux. On pense que les centrioles coordonnent le comportement de la cellule entière, en particulier de son cytosquelette.
Les corps basaux ont une structure proche des centrioles, mais ils sont généralement un peu plus longs (0,5 à 0,7 µm, peuvent atteindre 8 µm). Ce sont des organites hautement spécialisés qui ne sont présents que dans les cellules dotées de cils (flagelles). De par leur origine, les corps basaux ne sont pas toujours associés aux centrioles (par exemple, ils sont présents dans les cellules ciliées sans centrioles) et se forment de diverses manières. La fonction principale du corps basal est la formation du cil (flagellum). Les corps basaux, attachés à la membrane cellulaire, déterminent l'emplacement des cils, et les axonèmes des cils proviennent de leurs microtubules.
La composition biochimique des centrioles et des corps basaux n'est pas entièrement claire. Ils ne contiennent pas d’ADN, quelques ARN et diverses protéines (dont la tubuline).
Corps basal une formation intracellulaire située à la base de chaque flagelle ou cil chez les organismes unicellulaires, ainsi que dans les cellules tissulaires des organismes multicellulaires et dans les spermatozoïdes. Généralement cylindrique, longueur environ 0,5 µm, diamètre 0,1-0,2 µm. Apparemment, le B. t. est d'origine centriolaire (par exemple, chez les spermatides, il est possible de retracer la transformation du centriole en B. t., et chez un certain nombre de flagellés, le même B. t. peut porter un flagelle et, comme le centriole, participent à la formation de la division cellulaire fusiforme). Parfois, B. t. est appelé blépharoplaste.
Grande Encyclopédie soviétique. - M. : Encyclopédie soviétique. 1969-1978 .
Voyez ce qu'est « Corps basal » dans d'autres dictionnaires :
Kinétosome (corpusculum basale), structure intracellulaire des eucaryotes qui se trouve à la base des cils et des flagelles et leur sert de support. L'ultrastructure de B. t. est similaire à l'ultrastructure du centriole. La longueur de B. t. est supérieure à la longueur des centrioles dans les cellules de celui-ci... ...
L'organite d'où émanent les flagelles des bactéries et des protozoaires. Situé dans le cytoplasme. Il se présente sous la forme de disques constitués des extrémités proximales des fibrilles de flagelles, des molécules d'ADN et des structures membranaires. Voir flagelles. (Source : « Glossaire des termes... ... Dictionnaire de microbiologie
Kinétosome kinétosome, corps basal. Forme centriole
- (corpusculum basale, LNH ; synonyme granule basal) un organite en forme de petit corps à la base des cils ou flagelles de la cellule ; en termes d'ultrastructure, de rapport aux colorants, de modes de reproduction et de fonctions, c'est un homologue du centriole... Grand dictionnaire médical
Une coupe transversale des cils, dans laquelle la structure « 9+2 » est clairement visible... Wikipédia
Coupe transversale des cils, dans laquelle la structure « 9+2 » est clairement visible. Schéma de la structure de l'axonème du flagelle. 1A et 1B Microtubules A et B du doublet périphérique, 2 paires centrales de microtubules et capsule centrale, 3 anses en dynéine, 4... ... Wikipédia
- (Trypanosoma), genre de flagellés nég. kinétoplastide. Les dimensions sont généralement de 1,4 2,4 X 15 40 microns. Le corps est fusiforme. Un noyau. Contrairement aux autres flagellés, le flagelle part du corps basal, situé dans le tiers postérieur du corps à côté de... ... Dictionnaire encyclopédique biologique