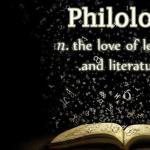Miam des années de vie. Biographie
Ce dont parlait le philosophe écossais David Hume au XVIIIe siècle est devenu aujourd’hui une réalité. Le désir de démontrer la liberté, et non sa véritable compréhension, a fait évoluer la conscience humaine dans une direction complètement différente de la liberté. Pour moi, Hume est un homme qui a consacré toute sa vie à l’étude de la conscience, de l’esprit, qui le définit en fait comme une personne réelle. Tant que notre conscience ne sera pas identique à nos efforts, nous ne réaliserons jamais notre nature, puisque la conscience n'obéira qu'aux affects.
David Hume (1711-1776) - philosophe, historien, fondateur des Lumières écossaises. Des idées où le développement humain est élevé à un statut sensoriel particulier. Il s’agit essentiellement d’un passage de l’état de la culture celtique, qui a suivi l’expérience sensorielle, à l’analyse de cette expérience.
Dire que Hume s'est donné pour tâche de comprendre l'esprit humain à travers le prisme de l'expérience ne serait pas tout à fait correct ; cela diminuerait l'ampleur des sujets qu'il a abordés. Un traité sur la nature humaine, où l’on trouve plus de questions que de réponses, propose un modèle d’engagement dans la connaissance plutôt que la possibilité de trouver des réponses. Après tout, la réponse est un état affectif, et donc souhaité. Et ce que l’on souhaite ne peut pas être connu, car cela empêche émotionnellement une personne de se concentrer sur le sujet. Autrement dit, dans ce cas, il ne faut pas résoudre les questions de l'être et de l'esprit, mais rester dans cette question, être la question elle-même, si l'on veut. Exprimez-le avec votre existence. Sinon, nous ne serons jamais libres, limités par le désir du résultat final.
Les activités de David Hume, tant à son époque qu’aujourd’hui, n’ont pas été suffisamment étudiées. Mais, en fait, son traité sur la nature humaine devrait devenir fondamental dans la compréhension et la compréhension de son corps par une personne. C'est du point de vue de la compréhension, et non de la connaissance, puisque ce traité nous pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Aujourd’hui, alors que l’humanité a oublié comment poser des questions, l’expérience de David Hume est particulièrement significative. Après tout, lorsque nous apprenons quelque chose, nous nous éloignons souvent de l’idée même de connaissance. Où est l’état des connaissances ? Où est le rythme ? David Hume a écrit : « La victoire n’est pas remportée par des hommes armés de lances et d’épées, mais par les trompettistes, les tambours et les musiciens d’une armée. »
La cognition n'est pas seulement l'état de nos pensées, mais aussi l'état de nos sentiments, de notre esprit. Même en lisant la même chose, nous différons tous par l’état dans lequel nous nous trouvons, et donc par l’expérience. Et lorsqu'une personne, incapable d'expérimenter le savoir ou l'expérimentant mal, nous dicte sa pensée (possédant par exemple un statut étatique), nous entendons ses paroles, mais n'analysons pas ses expériences. Par conséquent, ce qui est important pour nous, c’est la réaction au mot, pas son essence !
Nous avons besoin d’un schéma, d’une identité dans chaque acte de cognition. Sinon, comme l'écrit David, nous ne prêtons pas attention aux réflexions provenant des idées, mais au désir d'explication, c'est-à-dire que nous laissons la méthode sans impression, sans plénitude.
La discussion de Hume sur les schémas et leurs connexions montre l'importance fondamentale de la conscience, qui doit d'abord être formée et non assentiée. Il n'y a pas de temps pour dire « je sais » - il est plus important d'être dans l'état de « je sais ». « Je sais » peut avoir une couleur et une odeur complètement différentes, différentes de la connaissance elle-même. Et avec notre « je sais », nous appauvrissons non seulement le savoir, mais aussi nous-mêmes.
Selon Hume, il faudrait établir la règle selon laquelle le lien entre toutes les causes et tous les effets est également nécessaire. Et si quelque chose n’est pas défini, il y a alors une raison à laquelle il faut prêter attention. Ensuite, nous approfondissons nos connaissances, et ne les laissons pas de côté. Il est dangereux de s’appuyer sur un format d’imagination massif et arbitraire. Autrement dit, selon Hume, nous ne procédons pas de notre expérience, mais d'une image, qui sera encore temporaire, puisqu'elle n'est pas dotée d'expérience, et donc d'effort de connaissance dans le temps.
Tout irait bien, mais nous développons des habitudes de perception qui ne sont pas dotées de connaissances. Il est plus important pour nous de vivre un phénomène que de nous manifester, c'est-à-dire d'être le phénomène lui-même. Ainsi, nous nous privons des impressions de la vie que nous vivons, tout en exprimant diverses idées et en dépendant d'elles.
En conséquence, nous nous privons d’un instrument humain (nous ne développons pas de conscience) et d’un instrument spirituel (la foi est de nature affective). Ici mûrit également le caractère comportemental, que nous adaptons aux affects et non aux jugements. En conséquence, toutes nos actions et toute notre vie deviennent aléatoires. Après tout, on ne peut pas apprendre à une personne à s’exprimer ! Seule une personne elle-même peut s'apprendre cela. Les instruments d’expression doivent être enseignés.
Mais ici, nous rencontrons un autre modèle principal de Hume - l'idée du naturalisme, c'est-à-dire la question de savoir dans quelle mesure une personne connaît sa nature et dans quelle mesure elle y correspond généralement. Du point de vue de Hume, il faut d’abord accepter une certaine objectivité, dans laquelle il faut introduire ses perceptions subjectives, et ensuite seulement les objectiver. Les tentatives pour prouver que nous avons raison ne sont pas nécessaires en premier lieu pour nous-mêmes. Quoi qu’il en soit, il y aura ceux qui seront plus préoccupés par nos torts que par les leurs, parce que le processus de l’affect de non-acceptation est plus rapide et plus simple que le processus de cognition et d’acceptation.
En fait, tout ce que David Hume a décrit, il l'a vécu lui-même. La confrontation avec l’Église (contre laquelle il ne s’est d’ailleurs jamais prononcé) ne lui a pas donné l’opportunité de faire carrière. Mais cela lui a permis d'écrire « Dialogues concernant la religion naturelle », dans lesquels il aborde le thème de la foi d'une manière très intéressante. Essentiellement, il définit la foi comme une science empirique dont la base est l’expérience sensorielle.
David Hume occupe une telle position dans l’espace de son temps qu’écrire sur lui dans les catégories « né, vécu, mort » signifie plutôt ne pas respecter ce grand homme à l’esprit essentiellement immortel. Travaillant toute sa vie sur la causalité, il a souligné la nocivité de suivre aveuglément les conséquences sans en comprendre la cause. Après tout, tant que la volonté d’une personne est guidée par les sensations, et non par la raison, de quoi peut-on parler ! Il doit y avoir une raison partout, même si elle est la plus élevée, et il faut se laisser guider par sa compréhension, et non par la répétition.
En général, David Hume a non seulement créé les conditions nécessaires au développement d'une pensée correcte, mais a également formulé les idées de la forme d'existence celtique, dans laquelle les modèles et les nœuds ne sont pas des images, mais des causes.
Envoie cette page par e-mail à un ami
DAVID HUMÉ ET ÉPILOGUE IRRATIONALISTE DE L'EMPIRISME.
Siècle des Lumières
Le XVIIIe siècle de l’histoire de l’Europe occidentale est appelé le siècle des Lumières. Dans la philosophie anglaise, les idées de cette époque ont été plus clairement exprimées dans les travaux de J. Locke, J. Toland et d'autres, en France - dans les travaux de F. Voltaire, J.-J. Rousseau, D. Diderot, P. Holbach, en Allemagne - dans les travaux de G. Lessing, I. Herder, le jeune Kant et G. Fichte.
À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, le mode de production capitaliste est apparu dans les pays avancés d'Europe occidentale. La désintégration des relations féodales et l'émergence des relations capitalistes changent toute la vie spirituelle de la société. Regilia perd son influence dominante sur le développement de la science et de la philosophie. Une nouvelle vision du monde émerge qui répond aux intérêts du développement des sciences naturelles. I. Newton formule les lois fondamentales de la mécanique classique et découvre la loi de la gravitation universelle. W. Harvey fait la découverte de la circulation sanguine et explore son rôle. Les philosophes exceptionnels R. Descartes et G. Leibniz apportent une contribution significative au développement de la mécanique, de la physique et des mathématiques. Les philosophes et les naturalistes considèrent que leur tâche principale consiste à accroître le pouvoir de l’homme sur la nature et à améliorer l’homme lui-même.
Tout d'abord, il convient de noter que le siècle des Lumières est une période de décomposition des relations féodales et de développement intensif du capitalisme, de profonds changements dans la vie économique, socio-politique et spirituelle des peuples d'Europe occidentale. Les besoins du mode de production capitaliste ont stimulé le développement de la science, de la technologie, de la culture et de l’éducation. Les changements dans les relations sociales et la conscience publique ont servi de condition préalable à l'émancipation des esprits, à la libération de la pensée humaine de l'idéologie religieuse féodale et à la formation d'une nouvelle vision du monde.
La pseudoscience scolastique infructueuse, fondée sur l'autorité de l'Église et des généralisations spéculatives, a progressivement cédé la place à une nouvelle science, fondée principalement sur la pratique. Le développement rapide des sciences naturelles, en particulier des sciences mécaniques et mathématiques, a eu une forte influence sur le développement de la philosophie. La philosophie a pris l'une des premières places avec la tâche de créer et de justifier une méthode de connaissance scientifique.
Un trait distinctif de la philosophie des Lumières par rapport à la scolastique traditionnelle peut être appelé innovation . Les philosophes, avec toute la passion de leur esprit et de leur âme, ont cherché à réviser et à tester la vérité et la force des connaissances héritées.
SCOLASTIQUE(du latin scholastique, scole - conversation savante, école) - philosophie théologique latine médiévale ; représente une vision chrétienne unie du monde et la langue commune de la science et de l’éducation – le latin.
Recherche de vérités philosophiques rationnellement justifiées et prouvables, comparables aux vérités scientifiques , est une autre caractéristique de la philosophie des Lumières. La difficulté, cependant, était que les vérités philosophiques, comme on l'a découvert plus tard, ne peuvent pas être de nature axiomatique et ne peuvent pas être prouvées par des méthodes acceptées en mathématiques. Par la suite, ce passe-temps a disparu, mais le désir orienter la philosophie vers les sciences exactes est resté dominant tout au long des temps modernes. Même au XIXe et surtout au XXe siècle, l'opinion a commencé à se répandre selon laquelle la philosophie classique des Lumières exagérait l'importance des principes scientifiques, rationnels et logiques dans la vie humaine et, par conséquent, dans la pensée philosophique. et en effet, pour l'essentiel, la philosophie du XVIIIe siècle était rationaliste. Ici, le mot « rationalisme » est utilisé dans un sens large, unissant à la fois « l'empirisme », qui élève toute connaissance au rang d'expérience, la connaissance sensorielle, et le « rationalisme » au sens étroit, qui cherche les fondements à la fois de l'expérience et de la connaissance extra-expérimentale. dans des principes rationnels. Les philosophes du XVIIIe siècle, en même temps, s'intéressaient non seulement à la connaissance rationnelle, mais aussi à la connaissance par les sens - les éclaireurs - les partisans de l'empirisme (par exemple, Locke, Hume) y étaient particulièrement attentifs.
RATIONALISME(lat. rationalis - raisonnable) - En épistémologie, le rationalisme est compris dans un sens large et étroit.
Largement – s'oppose à l'irrationalisme. Ici le rationalisme - une doctrine selon laquelle la cognition et la conscience peuvent aussi être représentées comme un système. Dans la conscience, les éléments et connexions stables et reproductibles sont des mots et des normes de langage et de logique. Dans la cognition, le rationalisme se révèle à travers les normes de rationalité. Le rationalisme est le plus clairement représenté dans la science.
Dans un étroit sens du rationalisme s'oppose à l'empirisme et au sensationnalisme. Ici, le rationalisme affirme que dans notre conscience, il existe des connaissances qui ne peuvent être dérivées, déduites, à partir de données empiriques. De plus, pour pouvoir naviguer dans le monde, il faut avoir une certaine pré-connaissance, qui est universelle, universelle, nécessaire.
Les rationalistes au sens étroit du terme comprennent Descartes(théorie des idées innées) et Kant(formes de connaissance a priori).
EMPIRISME(du grec empeiria - expérience) - une direction dans la théorie de la connaissance, considère l'expérience sensorielle comme la principale source de connaissances. Dans l'histoire de la philosophie, l'empirisme a toujours été étroitement associé au sensationnalisme. Dans la philosophie européenne des temps modernes, l'empirisme est devenu l'un des principaux concepts de la théorie de la connaissance, axé sur la pratique de la recherche scientifique sur le monde extérieur. Le fondateur et le plus grand champion de l'empirisme était F. Bacon. Différents éléments de l'empirisme se sont ensuite développés Locke, de nombreux éclaireurs des XVIIe-XVIIIe siècles, notamment Condillac. L’empirisme s’oppose souvent au rationalisme (au sens étroit), qui met l’accent sur le rôle prédominant de l’esprit dans l’origine et le fonctionnement de la connaissance.
SENSUALISME(du latin sensus - perception, sentiment, sensation) - l'une des principales directions pour comprendre l'origine et l'essence connaissances dont la fiabilité est déterminée par la sphère des sentiments. Le sensualisme est une composante essentielle de l'empirisme.
En tant que partie intégrante de l'empirisme, les principes du sensationnalisme ont été développés Gassendi, Hobbes et Locke, en prenant comme base la formule traditionnelle « il n'y a rien dans l'esprit qui n'était auparavant dans le ressenti" En revanche, dans le système de croyance Berkeley et Yuma le sensationnalisme a été interprété comme un phénomène d'expérience uniquement interne, ce qui ne permet pas de conclure sur les propriétés des choses extérieures. Cette position dans la tradition marxiste est appelée idéalisme subjectif.
IRRATIONNELSZM – l'antithèse du rationalisme. En épistémologie - la doctrine de l'inconnaissabilité du monde irrationnel utilisant la logique, la pensée conceptuelle, la science. L'irrationalisme doit être distingué de l'agnosticisme. Les irrationnels suggèrent quelque chose comme ceci : ensemble d'outils pédagogiques: extase(néoplatoniciens) , apophatisme(Pseudo-Denys l'Aréopagite, M. Eckhart, etc.) , révélation(Christianisme) , perspicacité, nirvana(Bouddhistes, A. Schopenhauer) , intuition mystique, amour(Christianisme, existentialisme) , empathie(psychologie humaniste).
Le rationalisme au sens large s’oppose à l’irrationalisme. Il faut souligner que David Hume, développant son concept, est venu à déni du statut ontologique du principe de causalité , Hume a opposé l'esprit sceptique problématique à l'instinct et à l'élément d'illogisme associé aux passions et aux sentiments. Même la raison philosophique elle-même, dont la nécessité de recherche était reconnue comme une tâche primordiale, était à certains moments présentée par Hume comme une sorte d'instinct. En conséquence, Hume a le dernier mot voilà pour l'instinct, c'est-à-dire phénomène irrationnel (!) . C'est pourquoi Bertrand Russell, dans son Histoire de la philosophie occidentale, affirme que la philosophie de Hume représente l'effondrement du rationalisme du XVIIIe siècle. Bertrand Russell. Histoire de la philosophie occidentale et ses liens avec les conditions politiques et sociales de l'Antiquité à nos jours : En trois livres. 3e édition, stéréotypée. Moscou, Projet académique, 2000, p. 616.
La philosophie du début des Lumières préservait encore les traditions scepticisme . Le penseur français Pierre Bayle est convaincu que les dogmes religieux ne peuvent être rationnellement justifiés et qu'en philosophie et en science, il est inacceptable de revendiquer une connaissance absolument vraie et incontestable. Au milieu du XVIIIe siècle. le scepticisme philosophique se transformera en agnosticisme (D. Hume, I. Kant). Les doutes restent un compagnon de connaissance. Mais aujourd’hui, ils ne sont plus reconnus comme un obstacle insurmontable à l’acquisition de la véritable connaissance. Toute connaissance est limitée, incomplète et donc incomplète, mais le processus de cognition est illimité, prouvent les éclaireurs. Il devient clair qu’il y a toujours quelque chose qui échappe à notre compréhension.
Introduction
David Hume (1711-1776) - Philosophe écossais, représentant de l'empirisme et de l'agnosticisme, l'une des plus grandes figures des Lumières écossaises, dénonçant le refus de continuité dans les théories et les concepts lorsque les scientifiques, « prétendant révéler au monde quelque chose de nouveau dans le la philosophie et les sciences de terrain, en condamnant tous les systèmes proposés par leurs prédécesseurs, ajoutent de la valeur au leur », cherchaient à surmonter l'opposition traditionnellement vive (dans l'esprit du rationalisme) entre expérience et raison, à s'éloigner des extrêmes dans les interprétations philosophiques de homme.
Estimant que « toutes les sciences ont à voir avec la nature humaine dans une plus ou moins grande mesure », Hume a tenté d’appliquer la méthode scientifique expérimentale propre à la « nature humaine ». en cours d'analyse arguments avancés par le scientifique, il convient de noter que la mission éducative de Hume, selon son projet, était d'ouvrir la voie à toutes les autres sciences avec ses recherches : « Il est impossible de dire quels changements et améliorations nous pourrions produire V ces sciences, si nous connaissions parfaitement l'étendue et la puissance de la connaissance humaine, et pourrait également expliquer la nature tel que nous l'utilisons idées, Donc et opérations produit par nos soins dans notre raisonnement"À cet égard, Hume arrive au développement d'un concept philosophique de l'homme, dont la base fondamentale était censée être la théorie de la connaissance. Lorsqu'on considère la nature des perceptions (perceptions) de l'esprit humain, pour la cohérence et l'harmonie du raisonnement , Hume en identifie deux types principaux : les impressions et les idées, - qui deviennent une sorte de base pour d'autres travaux théoriques. Il faut reconnaître que D. Hume a créé son concept original de connaissance, qui a eu une grande influence sur l'ensemble du processus de développement de la pensée philosophique.
Dans ses écrits, D. Hume a formulé les principes de base agnosticisme(enseignements en épistémologie, nier la possibilité d'une connaissance fiable de l'essence matériel systèmes, lois de la nature et de la société). Hume a posé le problème de l’objectivité des relations de cause à effet, soulignant sa difficulté car non prouvable. En effet, l’effet n’est pas contenu « dans » la cause, ni physiquement ni logiquement. Cela ne peut pas provenir d’elle et ne lui ressemble pas. Il convient de noter qu'ici, en substance, une question importante se pose sur le statut des catégories ou des concepts universels : sont-ils déductibles de l'expérience ? Hume ne le pense pas.
Hume a élevé l'empirisme au rang, comme on dit, de piliers d'Hercule, après avoir épuisé toutes les possibilités de son développement. Il abandonna les prémisses ontologiques qui occupaient une place importante chez Hobbes, l’influence notable du rationalisme chez Locke, les intérêts religieux qui absorbaient la pensée de Berkeley et bon nombre des principes résiduels de la tradition métaphysique.
David Hume est né à Édimbourg dans la famille d'un pauvre noble-propriétaire écossais en 1711. Même dans sa jeunesse, il est devenu accro à l'étude de la philosophie, et cette passion était si profonde qu'il s'est résolument opposé au désir de ses parents de le faire un avocat (comme son père). Le futur scientifique a étudié à l'Université d'Édimbourg.
Déjà en 1729, à l’âge de dix-huit ans, Hume, doté d’une intuition puissante qui, de son propre aveu, lui ouvrait « une nouvelle scène de pensée », concevait une nouvelle « science de la nature humaine ».
Parallèlement au « nouveau champ de pensée », est née l'idée « Traité sur la nature humaine "(1734-1737) - le premier ouvrage de Hume ; après de nombreuses améliorations, corrections et ajouts, le traité devint chef-d'œuvre son héritage créatif. Cependant, Hume n’a pas réussi à entrer dans le milieu universitaire en raison de ses opinions manifestement athées et sceptiques. Mais dans d’autres domaines d’activité, Hume a réussi. En 1745, il fut précepteur-compagnon du marquis d'Anendal. En 1746, devenu secrétaire du général Saint-Clair, Hume participe à une mission diplomatique à Vienne et Turin. De 1763 à 1766, en tant que secrétaire de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, il fait la connaissance de D'Alembert, Helvétius, Diderot et d'autres figures des Lumières françaises.
En 1766, Hume, de retour en Angleterre, invita Rousseau et lui offrit aide et protection, mais bientôt Rousseau malade accusa Hume d'avoir organisé un complot pour le détruire. Cet incident a suscité beaucoup de ragots et a forcé Hume à publier ses propres arguments et considérations à ce sujet. Depuis 1767, Hume était secrétaire d'État adjoint. Ayant pris sa retraite avec une belle pension en 1769, il s'installe dans son pays natal, Édimbourg, où il passe les dernières années de sa vie en paix, se consacrant exclusivement à ses sujets de prédilection.
Bien que le Traité soit resté pratiquement inconnu des contemporains de Hume, l'originalité du « nouveau champ de pensée » est évidente.

Hume, David (1711-1776) - philosophe, historien, économiste et écrivain écossais. Né à Édimbourg le 7 mai 1711. Son père, Joseph Hume, était avocat et appartenait à l'ancienne maison de Hume ; Le domaine Ninewells, adjacent au village de Chernside près de Berwick-upon-Tweed, appartient à la famille depuis le début du XVIe siècle.
La mère de Hume, Catherine, « une femme d'un rare mérite » (toutes les citations dans la partie biographique de l'article sont tirées, sauf indication contraire, de l'ouvrage autobiographique de Hume, The Life of David Hume, Esquire, Written by Himself, 1777), était la fille de Sir David Falconer, chef du jury. Bien que la famille soit plus ou moins aisée, David, en tant que plus jeune fils, héritait de moins de 50 £ par an ; Malgré cela, il était déterminé à défendre l’indépendance, choisissant la voie de l’amélioration de son « talent littéraire ».
Un bon objectif ne peut conférer de la valeur qu'aux moyens qui sont suffisants et qui conduisent réellement à l'objectif.
Après la mort de son mari, Katherine « s'est entièrement consacrée à l'éducation et à l'éducation de ses enfants » - John, Katherine et David. La religion (presbytérianisme écossais) occupait une grande place dans l'enseignement à domicile, et David se souviendra plus tard qu'il croyait en Dieu quand il était petit.
Cependant, les Ninewell Humes, étant une famille de personnes instruites et d'orientation juridique, avaient chez eux des livres consacrés non seulement à la religion, mais aussi aux sciences laïques. Les garçons entrèrent à l'Université d'Édimbourg en 1723. Plusieurs professeurs d'université étaient des disciples de Newton et des membres de ce qu'on appelle. le Ranken Club, où ils ont discuté des principes de la nouvelle science et philosophie ; ils correspondirent également avec J. Berkeley. En 1726, Hume, sur l'insistance de sa famille, qui le considérait comme appelé au métier d'avocat, quitta l'université. Cependant, il poursuit ses études en secret - "J'éprouvais une profonde aversion pour toute autre activité que l'étude de la philosophie et la lecture générale" - ce qui pose les bases de son développement rapide en tant que philosophe.
Une diligence excessive conduisit Hume à une dépression nerveuse en 1729. En 1734, il décide de « tenter sa chance dans un autre domaine, plus pratique » : comme commis dans le bureau d'un certain marchand de Bristol. Cependant, cela n'aboutit à rien et Hume partit pour la France, vivant en 1734-1737 à Reims et à La Flèche (où se trouvait le collège des Jésuites, où furent formés Descartes et Mersenne). Il y écrivit A Treatise of Human Nature, dont les deux premiers volumes furent publiés à Londres en 1739 et le troisième en 1740. L'œuvre de Hume resta pratiquement inaperçue - le monde n'était pas encore prêt à accepter les idées de ce « Newton de la morale ». philosophie."
Son ouvrage, Un résumé d'un livre récemment publié : intitulé Un traité sur la nature humaine, etc., dans lequel l'argument principal de ce livre est illustré et expliqué plus loin, 1740, n'a pas non plus suscité d'intérêt. Déçu, mais ne perdant pas espoir, Hume retourna à Ninevals et publia deux parties de ses Essais, Moraux et Politiques, 1741-1742, qui rencontrèrent un intérêt modéré. Cependant, la réputation d'hérétique et même d'athée du Traité empêcha son élection comme professeur d'éthique à l'Université d'Édimbourg en 1744-1745. En 1745 (l'année de l'échec de la rébellion), Hume fut l'élève du faible d'esprit marquis d'Annandale. En 1746, en tant que secrétaire, il accompagna le général James St. Clair (son parent éloigné) lors d'un raid farfelu sur les côtes de France, puis, en 1748-1749, comme aide de camp du général lors d'une mission militaire secrète à les tribunaux de Vienne et de Turin. Grâce à ces voyages, il assura son indépendance, devenant « propriétaire d'environ mille livres ».
En 1748, Hume commença à signer ses œuvres de son propre nom. Peu de temps après, sa réputation commença à croître rapidement. Hume retravaille le Traité : Livre I en Essais philosophiques concernant la compréhension humaine, plus tard Une enquête concernant la compréhension humaine (1748), qui comprenait l'essai « Sur les miracles » ; livre II - dans l'Etude des Affects (Des Passions), inclus un peu plus tard dans les Quatre Dissertations (Quatre Dissertations, 1757) ; Le livre III a été réécrit sous le titre Enquête sur les principes de la morale, 1751. D'autres publications comprennent des essais moraux et politiques (Trois essais, moraux et politiques, 1748) ; Conversations politiques (Discours politiques, 1752) et Histoire de l'Angleterre (Histoire de l'Angleterre, en 6 vols., 1754-1762). En 1753, Hume commença à publier Essays and Treatises, un recueil de ses œuvres non consacré à des questions historiques, à l'exception du Traité ; en 1762, le même sort fut réservé aux travaux d'histoire. Son nom commença à attirer l’attention.
« Au bout d’un an, deux ou trois réponses parurent d’ecclésiastiques, parfois de très haut rang, et les injures du Dr Warburton me montrèrent que mes écrits commençaient à être appréciés dans la bonne société. » Le jeune Edward Gibbon l’appelait « le grand David Hume », le jeune James Boswell le qualifiait de « le plus grand écrivain d’Angleterre ». Montesquieu fut le premier penseur célèbre en Europe à reconnaître son génie ; après la mort de Montesquieu, l'abbé Leblanc qualifia Hume de « seul en Europe » capable de remplacer le grand Français. Déjà en 1751, la renommée littéraire de Hume était reconnue à Édimbourg. En 1752, la Law Society l'élu conservateur de la bibliothèque des avocats (aujourd'hui la Bibliothèque nationale d'Écosse). Il y eut aussi de nouvelles déceptions : l'échec des élections à l'Université de Glasgow et une tentative d'excommunication de l'Église d'Écosse.
(7 mai (26 avril style ancien) 1711, Édimbourg, Écosse - 25 août 1776, ibid.)
fr.wikipedia.org
Biographie
Né en 1711 à Édimbourg (Écosse) dans la famille d'un avocat, propriétaire d'un petit domaine. Hume a reçu une bonne éducation à l'Université d'Édimbourg. Il a travaillé dans les missions diplomatiques de l'Angleterre en Europe.
Il débute sa carrière philosophique en 1739, en publiant les deux premières parties de son Traité sur la nature humaine. Un an plus tard, la deuxième partie du traité est publiée. La première partie était consacrée à la cognition humaine. Puis il a finalisé ces idées et les a publiées dans un livre séparé - «Essai sur la cognition humaine».
Il a écrit de nombreux ouvrages sur divers sujets, dont l'histoire de l'Angleterre en huit volumes.
Philosophie
Les historiens de la philosophie conviennent généralement que la philosophie de Hume a le caractère d’un scepticisme radical, cependant, de nombreux chercheurs [qui ?] croient que les idées du naturalisme jouent également un rôle extrêmement important dans l’enseignement de Hume [source non précisée 307 jours].
Hume a été grandement influencé par les idées des empiristes John Locke et George Berkeley, ainsi que de Pierre Bayle, Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson et Joseph Butler.
Hume croyait que notre connaissance commence par l'expérience et se termine par l'expérience, sans connaissance innée (a priori). Nous ne connaissons donc pas la raison de notre expérience. Puisque l’expérience est toujours limitée par le passé, nous ne pouvons pas comprendre l’avenir. Pour de tels jugements, Hume était considéré comme un grand sceptique quant à la possibilité de connaître le monde par l’expérience.
L'expérience est constituée de perceptions, et les perceptions sont divisées en impressions (sensations et émotions) et idées (souvenirs et imagination). Après avoir perçu le matériel, l’apprenant commence à traiter ces idées. Décomposition par similitude et différence, loin les uns des autres ou proches (espace), et par cause et effet. Tout est constitué d'impressions. Quelle est la source de la sensation de perception ? Hume répond qu’il existe au moins trois hypothèses :
Il existe des images d'objets objectifs (théorie de la réflexion, matérialisme).
Le monde est un complexe de sensations perceptuelles (idéalisme subjectif).
Le sentiment de perception est provoqué dans notre esprit par Dieu, l'esprit le plus élevé (idéalisme objectif).

Hume demande laquelle de ces hypothèses est correcte. Pour ce faire, nous devons comparer ces types de perceptions. Mais nous sommes enchaînés aux limites de notre perception et ne saurons jamais ce qu’il y a au-delà. Cela signifie que la question de savoir quelle est la source de la sensation est une question fondamentalement insoluble. Tout est possible, mais nous ne pourrons jamais le vérifier. Il n'y a aucune preuve de l'existence du monde. Cela ne peut être ni prouvé ni infirmé.
En 1876, Thomas Henry Huxley a inventé le terme agnosticisme pour décrire cette position. On donne parfois la fausse impression que Hume affirme l’impossibilité absolue de la connaissance, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Nous connaissons le contenu de la conscience, ce qui signifie que le monde dans la conscience est connu. Autrement dit, nous connaissons le monde qui apparaît dans notre conscience, mais nous ne connaîtrons jamais l'essence du monde, nous ne pouvons connaître que les phénomènes. Cette direction s'appelle le phénoménisme. Sur cette base, la plupart des théories de la philosophie occidentale moderne sont construites, affirmant l'insolvabilité de la question principale de la philosophie. Les relations de cause à effet dans la théorie de Hume sont le résultat de nos habitudes. Et une personne est un ensemble de perceptions.
Hume voyait le fondement de la moralité dans le sentiment moral, mais il niait le libre arbitre, estimant que toutes nos actions sont déterminées par les affects.
Essais
Oeuvre en deux volumes. Tome 1. - M., 1965, 847 pp. (Patrimoine philosophique, Vol. 9)
Oeuvre en deux volumes. Tome 2. - M., 1965, 927 pp. (Patrimoine Philosophique, T. 10).
"Traité sur la nature humaine" (1739)
« Sur l'étendard du goût » (1739-1740)
"Essais moraux et politiques" (1741-1742)
"Sur l'immortalité de l'âme"
"Une enquête sur la compréhension humaine" (1748)
"Dialogues concernant la religion naturelle" (1751)
"Histoire de la Grande-Bretagne"
Littérature
Batin V.N. La catégorie du bonheur dans l'éthique de Hume //XXV Herzen Readings. Athéisme scientifique, éthique, esthétique. L., 1972.
Mikhalenko Yu. P. La philosophie de David Hume est la base théorique du positivisme anglais du 20e siècle. M., 1962.
Narsky I. S. Philosophie de David Hume. M., 1967.
Biographie

(Hume, David) (1711-1776), philosophe, historien, économiste et écrivain écossais. Né à Édimbourg le 7 mai 1711. Son père, Joseph Hume, était avocat et appartenait à l'ancienne maison de Hume ; Le domaine Ninewells, adjacent au village de Chernside près de Berwick-upon-Tweed, appartient à la famille depuis le début du XVIe siècle. La mère de Hume, Catherine, « une femme d'un rare mérite » (toutes les citations dans la partie biographique de l'article sont données, sauf indication contraire, de l'ouvrage autobiographique de Hume, The Life of David Hume, Esquire, Written by Himself, 1777), était la fille de Sir David Falconer, chef du jury. Bien que la famille soit plus ou moins aisée, David, en tant que plus jeune fils, héritait de moins de 50 £ par an ; Malgré cela, il était déterminé à défendre l’indépendance, choisissant la voie de l’amélioration de son « talent littéraire ».
Après la mort de son mari, Katherine « s'est entièrement consacrée à l'éducation et à l'éducation de ses enfants » - John, Katherine et David. La religion (presbytérianisme écossais) occupait une grande place dans l'enseignement à domicile, et David se souviendra plus tard qu'il croyait en Dieu quand il était petit. Cependant, les Ninewell Humes, étant une famille de personnes instruites et d'orientation juridique, avaient chez eux des livres consacrés non seulement à la religion, mais aussi aux sciences laïques. Les garçons entrèrent à l'Université d'Édimbourg en 1723. Plusieurs professeurs d'université étaient des disciples de Newton et des membres de ce qu'on appelle. "Ranken Club", où ils ont discuté des principes de la nouvelle science et de la philosophie ; ils correspondirent également avec J. Berkeley. En 1726, Hume, sur l'insistance de sa famille, qui le considérait comme appelé au métier d'avocat, quitta l'université. Cependant, il poursuit ses études en secret - "J'éprouvais une profonde aversion pour toute autre activité que l'étude de la philosophie et la lecture générale" - ce qui pose les bases de son développement rapide en tant que philosophe.
Une diligence excessive conduisit Hume à une dépression nerveuse en 1729. En 1734, il décide de « tenter sa chance dans un autre domaine, plus pratique » : comme commis dans le bureau d'un certain marchand de Bristol. Cependant, cela n'aboutit à rien et Hume partit pour la France, vivant en 1734-1737 à Reims et à La Flèche (où se trouvait le collège des Jésuites, où furent formés Descartes et Mersenne). Il y écrivit A Treatise of Human Nature, dont les deux premiers volumes furent publiés à Londres en 1739 et le troisième en 1740. L'œuvre de Hume resta pratiquement inaperçue - le monde n'était pas encore prêt à accepter les idées de ce « Newton moral ». " philosophie." Son ouvrage, Un résumé d'un livre récemment publié : intitulé Un traité sur la nature humaine, etc., dans lequel l'argument principal de ce livre est illustré et expliqué plus loin, 1740, n'a pas non plus suscité d'intérêt. Déçu, mais ne perdant pas espoir, Hume retourna à Ninevals et publia deux parties de ses Essais, Moraux et Politiques, 1741-1742, qui rencontrèrent un intérêt modéré. Cependant, la réputation d'hérétique et même d'athée du Traité empêcha son élection comme professeur d'éthique à l'Université d'Édimbourg en 1744-1745. En 1745 (l'année de l'échec de la rébellion), Hume fut l'élève du faible d'esprit marquis d'Annandale. En 1746, en tant que secrétaire, il accompagna le général James St. Clair (son parent éloigné) lors d'un raid farfelu sur les côtes de France, puis, en 1748-1749, comme aide de camp du général lors d'une mission militaire secrète à les tribunaux de Vienne et de Turin. Grâce à ces voyages, il assure son indépendance, devenant « propriétaire d'environ mille livres ».
En 1748, Hume commença à signer ses œuvres de son propre nom. Peu de temps après, sa réputation commença à croître rapidement. Hume retravaille le Traité : Livre I en Essais philosophiques concernant la compréhension humaine, plus tard Une enquête concernant la compréhension humaine (1748), qui comprenait l'essai « Sur les miracles » ; livre II - dans l'Etude des Affects (Des Passions), inclus un peu plus tard dans les Quatre Dissertations (Quatre Dissertations, 1757) ; Le livre III a été réécrit sous le titre Enquête sur les principes de la morale, 1751. D'autres publications comprennent des essais moraux et politiques (Trois essais, moraux et politiques, 1748) ; Conversations politiques (Discours politiques, 1752) et Histoire de l'Angleterre (Histoire de l'Angleterre, en 6 vols., 1754-1762). En 1753, Hume commença à publier Essays and Treatises, un recueil de ses œuvres non consacré à des questions historiques, à l'exception du Traité ; en 1762, le même sort fut réservé aux travaux d'histoire. Son nom commença à attirer l’attention. "Au bout d'un an, deux ou trois réponses parurent d'ecclésiastiques, parfois de très haut rang, et les injures du Dr Warburton me montrèrent que mes écrits commençaient à être appréciés dans la bonne société." Le jeune Edward Gibbon l’appelait « le grand David Hume », le jeune James Boswell le qualifiait de « le plus grand écrivain d’Angleterre ». Montesquieu fut le premier penseur célèbre en Europe à reconnaître son génie ; Après la mort de Montesquieu, l'abbé Leblanc qualifie Hume de « seul en Europe » capable de remplacer le grand Français. Déjà en 1751, la renommée littéraire de Hume était reconnue à Édimbourg. En 1752, la Law Society l'élu conservateur de la bibliothèque des avocats (aujourd'hui la Bibliothèque nationale d'Écosse). Il y eut aussi de nouvelles déceptions : l'échec des élections à l'Université de Glasgow et une tentative d'excommunication de l'Église d'Écosse.
L'invitation en 1763 du pieux Lord Hertford au poste de secrétaire par intérim de l'ambassade à Paris s'est avérée étonnamment flatteuse et agréable - « ceux qui ne connaissent pas le pouvoir de la mode et la variété de ses manifestations peuvent difficilement imaginer l'accueil donné à Paris par des hommes et des femmes de tout rang et de toutes dispositions. » Que valait une relation avec la comtesse de Bouffler seule ! En 1766, Hume fit venir en Angleterre Jean-Jacques Rousseau, persécuté, à qui George III était prêt à fournir refuge et moyens de subsistance. Souffrant de paranoïa, Rousseau inventa bientôt l'histoire d'une « conspiration » entre Hume et les philosophes parisiens qui auraient décidé de le déshonorer, et commença à envoyer des lettres contenant ces accusations dans toute l'Europe. Forcé de se défendre, Hume publia Un récit concis et authentique du différend entre M. Hume et M. Rousseau (1766). L'année suivante, Rousseau, pris d'un accès de folie, fuit l'Angleterre. En 1767, le frère de Lord Hertford, le général Conway, nomma Hume secrétaire d'État adjoint pour les Territoires du Nord, poste que Hume occupa pendant moins d'un an.
"En 1768, je revins à Édimbourg très riche (j'avais un revenu annuel de 1 000 livres), en bonne santé et, bien que quelque peu accablé par les années, mais espérant pendant longtemps jouir de la paix et assister à l'expansion de ma renommée." Cette période heureuse de la vie de Hume se termina lorsqu'on lui diagnostiqua des maladies qui lui enlevaient des forces et étaient douloureuses (dysenterie et colite). Un voyage à Londres et à Bath pour établir un diagnostic et prescrire un traitement n'a rien donné, et Hume est retourné à Édimbourg. Il mourut à son domicile de St David's Street, New Town, le 25 août 1776. L'une de ses dernières volontés était de publier Dialogues concernant la religion naturelle (1779). Sur son lit de mort, il argumenta contre l'immortalité de l'âme, ce qui choqua Boswell ; lu et parlé favorablement de Decline and Fall de Gibbon et de Wealth of Nations d'Adam Smith. En 1777, Smith publie l'autobiographie de Hume, ainsi que sa lettre à l'éditeur, dans laquelle il écrit à propos de son ami proche : « Dans l'ensemble, je l'ai toujours considéré, de son vivant et après sa mort, comme un homme proche de l'idéal de un homme sage et vertueux – à tel point que dans la mesure du possible pour la nature humaine mortelle. »

Dans le chef-d'œuvre philosophique Un traité sur la nature humaine : tentative d'introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans des sujets moraux, la thèse est avancée selon laquelle « presque toute la science est couverte et dépend de la science de la nature humaine ». Cette science emprunte sa méthode à la nouvelle science de Newton, qui la formula dans Optics (1704) : « Si la philosophie naturelle est destinée à être améliorée par l'application de la méthode inductive, alors les frontières de la philosophie morale seront également élargies. » Hume cite Locke, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson et Butler comme ses prédécesseurs dans l'étude de la nature humaine. Si l’on exclut de la considération les sciences a priori qui traitent uniquement des relations entre les idées (c’est-à-dire la logique et les mathématiques pures), alors nous verrons que la vraie connaissance, c’est-à-dire une connaissance absolument et irréfutablement fiable, est impossible. De quelle fiabilité peut-on parler lorsque la négation d’un jugement n’entraîne pas de contradiction ? Mais il n’y a aucune contradiction à nier l’existence d’un état de choses, car « tout ce qui existe peut aussi ne pas exister ». Par conséquent, à partir des faits, nous ne arrivons pas à la certitude, mais au mieux à la probabilité, non à la connaissance, mais à la foi. La foi est « une nouvelle question à laquelle les philosophes n’ont pas encore réfléchi » ; c'est une idée vivante, corrélée ou associée à une impression présente. La foi ne peut pas être un sujet de preuve ; elle surgit lorsque nous percevons dans l'expérience le processus de formation de relations de cause à effet.
Selon Hume, il n’y a pas de lien logique entre cause et effet ; un lien causal ne se trouve que dans l’expérience. Avant l'expérience, tout peut être cause de tout, mais l'expérience révèle trois circonstances qui relient invariablement une cause donnée à un effet donné : la contiguïté dans le temps et l'espace, la primauté dans le temps, la constance de la connexion. La croyance en l’ordre uniforme de la nature, le processus de cause à effet, ne peut être prouvée, mais grâce à elle, la pensée rationnelle elle-même devient possible. Ainsi, ce n’est pas la raison, mais l’habitude qui devient notre guide dans la vie : « La raison est l’esclave des affects et doit l’être, et elle ne peut prétendre à aucune autre position que celle d’être au service et à la subordination des affects. » Malgré ce renversement antirationaliste conscient de la tradition platonicienne, Hume reconnaît le rôle nécessaire de la raison dans la formulation d’hypothèses provisoires, sans lesquelles la méthode scientifique est impossible. Appliquant systématiquement cette méthode à l’étude de la nature humaine, Hume aborde les questions de religion, de moralité, d’esthétique, d’histoire, de science politique, d’économie et de critique littéraire. L'approche de Hume est sceptique car elle déplace ces questions de la sphère de l'absolu à la sphère de l'expérience, de la sphère de la connaissance à la sphère de la foi. Tous reçoivent une norme commune sous la forme de preuves les confirmant, et les preuves elles-mêmes doivent être évaluées conformément à certaines règles. Et aucune autorité ne peut éviter la procédure d’une telle vérification. Cependant, le scepticisme de Hume ne prouve pas que tous les efforts humains sont inutiles. La nature prend toujours le dessus : « Je ressens une envie absolue et nécessaire de vivre, de parler et d’agir comme tout le monde dans la vie quotidienne. »
Le scepticisme de Hume présente des aspects à la fois destructeurs et constructifs. En fait, il est de nature créative. Le meilleur des mondes de Hume est plus proche de la nature que du domaine surnaturel ; c’est le monde d’un empiriste et non d’un rationaliste. L’existence du Divin, comme tous les autres états de choses factuels, est indémontrable. Le supranaturalisme (« hypothèse religieuse ») doit être étudié de manière empirique, du point de vue de la structure de l’Univers ou de la structure de l’homme. Un miracle, ou « violation des lois de la nature », bien que théoriquement possible, n'a jamais été attesté de manière si convaincante dans l'histoire qu'il constitue la base d'un système religieux. Les phénomènes miraculeux sont toujours associés à des preuves humaines et, comme on le sait, les gens sont plus enclins à la crédulité et aux préjugés qu'au scepticisme et à l'impartialité (section « Sur les miracles » de l'étude). Les attributs naturels et moraux de Dieu, déduits par analogie, ne sont pas suffisamment évidents pour être utilisés dans la pratique religieuse. « D’une hypothèse religieuse, il est impossible d’extraire un seul fait nouveau, pas une seule prévision ou prédiction, pas une seule récompense attendue ou une seule punition redoutée qui ne nous soit déjà connue dans la pratique et par l’observation » (section « De la Providence et de la Future Life »Recherche ; Dialogues sur la religion naturelle). En raison de l’irrationalité fondamentale de la nature humaine, la religion naît non de la philosophie, mais de l’espoir et de la peur humains. Le polythéisme précède le monothéisme et est toujours vivant dans la conscience populaire (Histoire naturelle des religions). Ayant privé la religion de sa base métaphysique et même rationnelle, Hume - quelles que soient ses motivations - fut l'ancêtre de la « philosophie de la religion » moderne.
Puisque l’homme est un être qui ressent plutôt qu’il raisonne, ses jugements de valeur sont irrationnels. En éthique, Hume reconnaît la primauté de l’amour-propre, mais souligne l’origine naturelle du sentiment d’affection envers autrui. Cette sympathie (ou bienveillance) est à la morale ce que la foi est à la connaissance. Même si la distinction entre le bien et le mal s'établit à travers les émotions, la raison, dans son rôle de servante des affects et des instincts, est nécessaire pour déterminer la mesure de l'utilité sociale, source des sanctions juridiques. La loi naturelle, au sens d’un code éthique contraignant qui existe en dehors de l’expérience, ne peut prétendre à la vérité scientifique ; les concepts connexes d’état de nature, de contrat originel et de contrat social sont des fictions, parfois utiles, mais souvent de nature purement « poétique ». L'esthétique de Hume, bien qu'elle ne soit pas systématiquement exprimée, a influencé les penseurs ultérieurs. L’universalisme rationaliste classique (et néoclassique) est remplacé par le goût ou l’émotion inclus dans la structure interne de l’âme. Il existe une tendance à l'individualisme romantique (ou au pluralisme), mais Hume n'atteint pas l'idée d'autonomie personnelle (essai « Sur la norme du goût »).
Hume est toujours resté un écrivain qui rêvait de la plus grande renommée. "J'ai toujours pensé, en publiant Un Traité sur la Nature Humaine, que le succès dépendait du style et non du contenu." Son Histoire de l'Angleterre fut la première histoire véritablement nationale et resta un modèle de recherche historique tout au long du siècle suivant. Décrivant non seulement les processus politiques, mais aussi culturels, Hume partage avec Voltaire l’honneur d’être le « père de la nouvelle historiographie ». Dans l'essai « Sur les caractères nationaux », il explique les différences nationales en termes de causes morales (ou institutionnelles) plutôt que physiques. Dans son essai « Sur les nombreuses nations de l’Antiquité », il prouve que la population du monde moderne est plus élevée que celle de l’ancien. Dans le domaine de la théorie politique, le scepticisme créatif de Hume n'a négligé aucun des dogmes centraux du parti Whig (sur le traité original) et du parti conservateur (sur l'obéissance passive), et a évalué la méthode de gouvernement uniquement du point de vue de vue des bénéfices qu’elle apporte. En économie, Hume était considéré comme le penseur anglais le plus compétent et le plus influent jusqu'à l'apparition des travaux d'A. Smith. Il a discuté des idées des physiocrates avant même l'émergence de l'école elle-même, ses concepts anticipaient les idées de D. Ricardo. Hume a été le premier à développer systématiquement les théories du travail, de la monnaie, du profit, de la fiscalité, du commerce international et de la balance commerciale.
Les lettres de Hume sont excellentes. Le raisonnement froid et perspicace du philosophe y est entrecoupé de bavardages cordiaux et bon enfant ; Partout nous trouvons d’abondantes manifestations d’ironie et d’humour. Dans ses œuvres critiques littéraires, Hume restait sur les positions classiques traditionnelles et souhaitait l'épanouissement de la littérature nationale écossaise. Dans le même temps, sa liste d'expressions d'argot qui devraient être exclues du discours écossais était une étape vers un style de prose anglaise plus simple et plus clair, sur le modèle de la clart française. Cependant, Hume fut plus tard accusé d’écrire trop simplement et trop clairement et ne pouvait donc pas être considéré comme un philosophe sérieux.
Pour David Hume, la philosophie était l'œuvre de sa vie. Cela peut être constaté en comparant deux sections du Traité (« De l'amour de la bonne renommée » et « De la curiosité ou de l'amour de la vérité ») avec une autobiographie ou toute biographie complète d'un penseur.
David (David) Hume. Né le 26 avril (7 mai) 1711 à Édimbourg - décédé le 25 août 1776 à Édimbourg. Philosophe écossais, représentant de l'empirisme et de l'agnosticisme, prédécesseur du deuxième positivisme (empirio-critique, Machisme), économiste et historien, publiciste, l'une des plus grandes figures des Lumières écossaises.
David Hume est né le 26 avril (7 mai) 1711 dans la famille d'un noble pauvre qui pratiquait le droit et possédait un petit domaine. Hume a fréquenté l'Université d'Édimbourg, où il a reçu une bonne formation juridique. Il a travaillé dans les missions diplomatiques de l'Angleterre en Europe. Dès sa jeunesse, il montra un intérêt particulier pour la philosophie et la littérature. Après avoir visité Bristol à des fins commerciales, sans succès, il se rend en France en 1734.
Hume a commencé sa carrière philosophique en 1738, en publiant les deux premières parties de A Treatise of Human Nature, dans lesquelles il tentait de définir les principes fondamentaux de la connaissance humaine. Hume examine les questions visant à déterminer la fiabilité de toute connaissance et croyance en celle-ci. Hume croyait que la connaissance est basée sur l'expérience, qui consiste en des perceptions (impressions, c'est-à-dire sensations humaines, affects, émotions). Les idées signifient des images faibles de ces impressions dans la pensée et le raisonnement.
Un an plus tard, la troisième partie du traité est publiée. La première partie était consacrée à la cognition humaine. Puis il affina ces idées et les publia dans un ouvrage séparé "Études sur la cognition humaine".
De 1741 à 1742, Hume publie son livre "Essais moraux et politiques". Le livre était consacré à des sujets politiques et politico-économiques et a fait la renommée de l'auteur. Dans les années 50, Hume était engagé dans l'écriture de l'histoire de l'Angleterre, même si cela suscitait la haine des Britanniques, des Écossais, des Irlandais, des ecclésiastiques, des patriotes et bien d'autres. Mais après la sortie du deuxième volume de l'Histoire d'Angleterre en 1756, l'opinion publique changea radicalement et avec la parution des volumes suivants, la publication trouva un public important non seulement en Angleterre mais aussi sur le continent.
En 1763, après la fin de la guerre entre l'Angleterre et la France, Hume, en tant que secrétaire de l'ambassade britannique à la cour de Versailles, fut invité dans la capitale de la France, où il fut reconnu pour son travail sur l'histoire de l'Angleterre. Helvétius approuvait également les critiques de Hume à l'égard des fanatiques religieux. Cependant, les éloges d’autres philosophes étaient dus à leur correspondance intensive avec Hume, car leurs intérêts et leurs points de vue convergeaient à bien des égards. Helvétius, Turgot et d'autres éducateurs furent particulièrement impressionnés par « L'Histoire naturelle des religions », publiée en 1757 dans le recueil « Quatre Dissertations ».
En 1769, Hume créa la Philosophical Society à Édimbourg, dont il fut le secrétaire. Ce cercle comprenait : Adam Ferguson, Alexander Monroe, William Cullen, Joseph Black, Huge Blair et d'autres.
Peu avant sa mort, Hume écrivit son Autobiographie. Il s'y décrit comme une personne douce, ouverte, sociable et enjouée, qui avait un faible pour la renommée littéraire, ce qui cependant "n'a jamais endurci mon caractère, malgré tous les échecs fréquents".
Hume est décédé en août 1776 à l'âge de 65 ans.
Philosophie de David Hume :
Les historiens de la philosophie conviennent généralement que la philosophie de Hume se caractérise par un scepticisme radical ou modéré.
Hume croyait que notre connaissance commence par l'expérience. Cependant, Hume n'a pas nié la possibilité d'une connaissance a priori (ici - non expérimentale), dont un exemple, de son point de vue, est les mathématiques, malgré le fait que toutes les idées, à son avis, ont une origine expérimentale - à partir d'impressions. L'expérience est constituée d'impressions, les impressions sont divisées en internes (affects ou émotions) et externes (perceptions ou sensations). Les idées (souvenirs de mémoire et images de l’imagination) sont de « pâles copies » d’impressions. Tout est constitué d'impressions - c'est-à-dire que les impressions (et les idées comme leurs dérivées) sont ce qui constitue le contenu de notre monde intérieur, si l'on veut - l'âme ou la conscience (dans le cadre de sa théorie originale de la connaissance, Hume remettra en question l'existence des deux derniers dans le plan substantiel). Après avoir perçu le matériel, l’apprenant commence à traiter ces idées. Décomposition par similitude et différence, loin les uns des autres ou proches (espace), et par cause et effet. Quelle est la source de la sensation de perception ? Hume répond qu’il existe au moins trois hypothèses :
1.Les perceptions sont des images d’objets objectifs.
2. Le monde est un complexe de sensations perceptuelles.
3. Le sentiment de perception est provoqué dans notre esprit par Dieu, l'esprit suprême.
Hume demande laquelle de ces hypothèses est correcte. Pour ce faire, nous devons comparer ces types de perceptions. Mais nous sommes enchaînés à la ligne de notre perception et ne saurons jamais ce qu’il y a au-delà. Cela signifie que la question de savoir quelle est la source de la sensation est une question fondamentalement insoluble. Tout est possible, mais nous ne pourrons jamais le vérifier. Il n'y a aucune preuve de l'existence du monde. Cela ne peut être ni prouvé ni infirmé.
En 1876, Thomas Henry Huxley a inventé le terme agnosticisme pour décrire cette position. On donne parfois la fausse impression que Hume affirme l’impossibilité absolue de la connaissance, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Nous connaissons le contenu de la conscience, ce qui signifie que le monde dans la conscience est connu. Autrement dit, nous connaissons le monde qui apparaît dans notre conscience, mais nous ne connaîtrons jamais l'essence du monde, nous ne pouvons connaître que les phénomènes. Cette direction s'appelle le phénoménisme. Sur cette base, la plupart des théories de la philosophie occidentale moderne sont construites, affirmant l'insolvabilité de la question principale de la philosophie. Les relations de cause à effet dans la théorie de Hume sont le résultat de nos habitudes. Et une personne est un ensemble de perceptions.
Hume voyait le fondement de la moralité dans le sentiment moral, mais il niait le libre arbitre, estimant que toutes nos actions sont déterminées par les affects.
Il a écrit que Hume n'était pas compris. Il existe un point de vue selon lequel ses idées dans le domaine de la philosophie du droit ne commencent à se concrétiser pleinement qu'au 21e siècle.