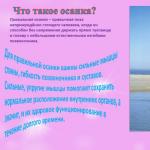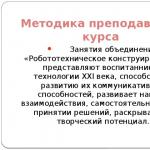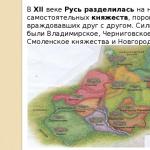Formes et méthodes du niveau empirique des connaissances scientifiques. Connaissance empirique du monde - fonctions et méthodes
Il y a un mouvement de l'ignorance vers la connaissance. Ainsi, la première étape du processus cognitif est la définition de ce que nous ne savons pas. Il est important de définir clairement et rigoureusement le problème, en séparant ce que nous savons déjà de ce que nous ne savons pas encore. problème(du grec. problema - tâche) est une question complexe et controversée qui doit être résolue.
La deuxième étape est le développement d'une hypothèse (du grec. Hypothèse - hypothèse). Hypothèse - il s'agit d'une hypothèse scientifiquement fondée qui doit être testée.
Si une hypothèse est prouvée par un grand nombre de faits, elle devient une théorie (du grec theoria - observation, recherche). La théorie est un système de connaissances qui décrit et explique certains phénomènes ; telles sont, par exemple, la théorie de l'évolution, la théorie de la relativité, la théorie quantique, etc.
Lors du choix de la meilleure théorie, le degré de sa testabilité joue un rôle important. Une théorie est fiable si elle est confirmée par des faits objectifs (y compris ceux qui viennent d'être découverts) et si elle se distingue par sa clarté, sa netteté et sa rigueur logique.
Faits scientifiques
Distinguer objectif et scientifique réalités. fait objectif est un objet, un processus ou un événement réel. Par exemple, la mort de Mikhail Yurievich Lermontov (1814-1841) dans un duel est un fait. fait scientifique est une connaissance qui est confirmée et interprétée dans le cadre d'un système de connaissances généralement accepté.
Les estimations s'opposent aux faits et reflètent l'importance des objets ou des phénomènes pour une personne, son attitude approbatrice ou désapprobatrice à leur égard. Les faits scientifiques fixent généralement le monde objectif tel qu'il est et les évaluations reflètent la position subjective d'une personne, ses intérêts, son niveau de conscience morale et esthétique.
La plupart des difficultés rencontrées par la science surviennent lors du passage de l'hypothèse à la théorie. Il existe des méthodes et des procédures qui vous permettent de tester une hypothèse et de la prouver ou de la rejeter comme incorrecte.
méthode(du grec methodos - le chemin vers le but) est la règle, la méthode, la méthode de connaissance. En général, une méthode est un système de règles et de règlements qui vous permet d'explorer un objet. F. Bacon a appelé la méthode "une lampe entre les mains d'un voyageur marchant dans l'obscurité".
Méthodologie est un concept plus large et peut être défini comme :
- un ensemble de méthodes utilisées dans n'importe quelle science;
- doctrine générale de la méthode.
Étant donné que les critères de vérité dans sa compréhension scientifique classique sont, d'une part, l'expérience et la pratique sensorielles, et d'autre part, la clarté et la distinction logique, toutes les méthodes connues peuvent être divisées en empiriques (méthodes cognitives expérimentales et pratiques) et théorique (procédures logiques).
Méthodes empiriques de connaissance
base méthodes empiriques sont la cognition sensorielle (sensation, perception, représentation) et les données instrumentales. Ces méthodes comprennent :
- observation- perception intentionnelle des phénomènes sans interférence avec eux;
- expérience— étude des phénomènes dans des conditions contrôlées et contrôlées ;
- la mesure - détermination du rapport entre la valeur mesurée et
- standard (par exemple, un mètre);
- comparaison- identifier les similitudes ou les différences d'objets ou de leurs caractéristiques.
Il n'y a pas de méthodes empiriques pures dans la connaissance scientifique, car même pour une simple observation, des fondements théoriques préalables sont nécessaires - le choix d'un objet d'observation, la formulation d'une hypothèse, etc.
Méthodes théoriques de la cognition
Réellement méthodes théoriques basée sur des connaissances rationnelles (concept, jugement, conclusion) et des procédures d'inférence logique. Ces méthodes comprennent :
- une analyse- le processus de démembrement mental ou réel d'un objet, phénomène en parties (signes, propriétés, relations) ;
- synthèse - connexion des côtés du sujet identifiés lors de l'analyse en un seul tout;
- - combiner divers objets en groupes basés sur des caractéristiques communes (classification des animaux, des plantes, etc.);
- abstraction - distraction dans le processus de cognition de certaines propriétés d'un objet dans le but d'étudier en profondeur un côté spécifique de celui-ci (le résultat de l'abstraction est des concepts abstraits tels que la couleur, la courbure, la beauté, etc.);
- formalisation - afficher les connaissances sous forme de signe, symbolique (formules mathématiques, symboles chimiques, etc.);
- analogie - inférence sur la similitude d'objets à un certain égard sur la base de leur similitude à un certain nombre d'autres égards ;
- la modélisation— création et étude d'un substitut (modèle) d'un objet (par exemple, modélisation informatique du génome humain) ;
- idéalisation- création de concepts pour des objets qui n'existent pas dans la réalité, mais qui contiennent un prototype (point géométrique, boule, gaz parfait);
- déduction - passer du général au particulier ;
- induction- le passage du particulier (faits) à l'énoncé général.
Les méthodes théoriques exigent des faits empiriques. Ainsi, bien que l'induction elle-même soit une opération logique théorique, elle nécessite toujours une vérification expérimentale de chaque fait particulier, et est donc basée sur des connaissances empiriques et non sur des connaissances théoriques. Ainsi, les méthodes théoriques et empiriques existent dans l'unité, se complétant. Toutes les méthodes listées ci-dessus sont des méthodes-techniques (règles spécifiques, algorithmes d'action).
Plus large méthodes-approches indiquent seulement la direction et la manière générale de résoudre les problèmes. Les méthodes-approches peuvent inclure de nombreuses techniques différentes. Ce sont la méthode structuralo-fonctionnelle, l'herméneutique, etc. Les méthodes-approches les plus courantes sont les méthodes philosophiques :
- métaphysique- prise en compte de l'objet en tonte, statique, hors connexion avec d'autres objets ;
- dialectique- révélation des lois du développement et du changement des choses dans leur interconnexion, leur incohérence interne et leur unité.
L'absolutisation d'une méthode car la seule vraie est appelée dogme(par exemple, le matérialisme dialectique dans la philosophie soviétique). Un empilement non critique de diverses méthodes non liées est appelé éclectisme.
Le processus de cognition comprend la réception d'informations par les sens (cognition sensorielle), le traitement de ces informations par la pensée (cognition rationnelle) et le développement matériel de fragments connaissables de la réalité (pratique sociale).
Cognition sensorielle Il se réalise sous la forme d'une réception directe d'informations à l'aide des organes sensoriels, qui nous relient directement au monde extérieur. Les principales formes de connaissances sensorielles sont : la sensation, la perception et la représentation.
Les sensations surviennent dans le cerveau humain à la suite de l'influence de facteurs environnementaux sur ses organes sensoriels. Les sensations sont des processus mentaux qui se produisent dans le cerveau lorsque les centres nerveux qui contrôlent les récepteurs sont excités. Les sentiments sont spécialisés. La sensation peut être considérée comme l'élément le plus simple et initial de la cognition sensorielle et de la conscience humaine en général.
Perception - c'est une image sensorielle holistique d'un objet, formée par le cerveau à partir des sensations directement reçues de cet objet. La perception est basée sur des combinaisons de différents types de sensations. Mais ce n'est pas seulement une somme mécanique d'entre eux. Les sensations reçues de divers organes sensoriels fusionnent en un seul ensemble dans la perception, formant une image sensuelle d'un objet.
Sur la base des sensations et des perceptions du cerveau humain, représentation. Si les sensations et les perceptions n'existent qu'avec le contact direct d'une personne avec un objet (sans cela, il n'y a ni sensation ni perception), alors la représentation survient sans impact direct de l'objet sur les sens.
La représentation est un grand pas en avant par rapport à la perception, car elle contient une nouveauté telle que généralisation. Ce dernier a déjà lieu dans les idées sur des objets concrets et uniques. Mais dans une plus large mesure encore, cela se manifeste dans les idées générales. Dans les idées générales, les moments de généralisation deviennent beaucoup plus significatifs que dans toute idée sur un objet spécifique et unique.
Ainsi, au niveau empirique, la contemplation vivante (cognition sensorielle) prévaut, le moment rationnel et ses formes (jugements, concepts, etc.) sont ici présents, mais ont un sens subordonné.
L'élément le plus important de la recherche empirique est fait. Toute recherche scientifique commence par la collecte, la systématisation et la généralisation des faits. Fait : 1. un fragment de réalité, un événement objectif ; 2. véritable connaissance de tout événement; 3. proposition reçue au cours d'observations et d'expérimentations. La deuxième et la troisième de ces significations sont résumées dans le concept de "fait scientifique". Celle-ci le devient lorsqu'elle est un élément de la structure logique d'un système particulier de connaissances scientifiques et qu'elle est incluse dans ce système.
Dans la compréhension de la nature d'un fait dans la méthodologie moderne de la science, deux tendances extrêmes se dégagent : le factualisme et le théorisme. Si le premier met l'accent sur l'indépendance et l'autonomie des faits par rapport à diverses théories, le second, au contraire, soutient que les faits sont complètement dépendants de la théorie, et lorsque les théories sont modifiées, toute la base factuelle de la science change. La solution correcte du problème réside dans le fait qu'un fait scientifique, ayant une charge théorique, est relativement indépendant de la théorie, puisqu'il est fondamentalement déterminé par la réalité matérielle.
Les faits scientifiques constituent le contenu principal des connaissances scientifiques et des travaux scientifiques. Ils sont incontestables et obligatoires. Parallèlement à eux, des systèmes de certains faits scientifiques peuvent être distingués, dont la forme principale est généralisations empiriques.
C'est le fonds principal de la science, les faits scientifiques, leurs classifications et leurs généralisations empiriques, qui, dans leur fiabilité, ne peuvent pas susciter de doutes et distinguent nettement la science de la philosophie et de la religion. Ni la philosophie ni la religion ne créent de tels faits et généralisations.
Ainsi, l'expérience empirique n'est jamais aveugle : elle est planifiée, construite par la théorie, et les faits sont toujours théoriquement chargés d'une manière ou d'une autre.
Le niveau empirique de connaissance comprend les éléments suivants : observation, description, expérience, mesure.
L'observation est une étude ciblée d'objets, basée principalement sur des capacités sensorielles d'une personne telles que la sensation, la perception, la représentation; au cours de l'observation, nous acquérons des connaissances sur les aspects extérieurs, les propriétés et les caractéristiques de l'objet en question. observation scientifique volontairement; systématiquement ; activement. Les observations scientifiques sont toujours accompagnées la description objet de connaissance. Une description empirique est une fixation au moyen d'un langage naturel ou artificiel d'informations sur des objets donnés dans une observation. À l'aide d'une description, les informations sensorielles sont traduites dans le langage des concepts, des signes, des diagrammes, des dessins, des graphiques et des chiffres, prenant ainsi une forme propice à un traitement rationnel ultérieur.
Expérience implique une influence active, délibérée et strictement contrôlée du chercheur sur l'objet à l'étude afin d'identifier et d'étudier certains aspects, propriétés, relations. Dans le même temps, l'expérimentateur peut transformer l'objet étudié, créer des conditions artificielles pour son étude et interférer avec le cours naturel des processus.
Au cours de l'expérience, l'objet peut être placé dans certaines conditions créées artificiellement. En étudiant n'importe quel processus, l'expérimentateur peut interférer avec lui, influencer activement son cours. Les expériences sont reproductibles, c'est-à-dire mb répété autant de fois que nécessaire pour obtenir des résultats fiables.
La plupart des expériences et observations scientifiques impliquent la réalisation de diverses mesures.
Spécificités de l'observation et de la comparaison comme méthodes de recherche empirique.
L'expérimentation comme méthode de connaissance empirique.
Fonction gnoséologique des instruments dans la recherche empirique.
1. Le niveau empirique comprend l'observation, la comparaison, l'expérimentation. Le niveau empirique implique une interaction directe avec des objets, un contact sensuel. A l'acceptation de l'empirisme, c'est-à-dire Le rôle décisif de l'expérience a conduit à prendre conscience de la futilité de la méthodologie scolastique.
F. Bacon a joué un rôle important dans le développement des méthodes empiriques. Ses principales thèses "La connaissance est le pouvoir", "L'homme est le serviteur et l'interprète de la nature" obligeaient les scientifiques à étudier la nature à l'aide d'expériences bien organisées, appelées expériences. La doctrine des méthodes, exposée dans l'ouvrage "Le Nouvel Organon, ou Vraies Instructions pour l'Interprétation de la Nature", était la principale dans la philosophie de F. Bacon. La base de l'enseignement était l'induction, qui offrait la possibilité de généralisation et de perspectives de recherche. La première exigence de la doctrine des méthodes était la nécessité de la décomposition et de la division de la nature par le moyen de la raison. Ensuite, vous devez mettre en évidence le plus simple et le plus facile. Vient ensuite la découverte de la loi, qui servira de base à la connaissance et à l'activité. En conséquence, vous devez résumer toutes les idées et conclusions et obtenir une véritable interprétation de la nature. Il y a une opinion que l'histoire des sciences inductives est l'histoire des découvertes, et la philosophie des sciences inductives est l'histoire des idées et des concepts. En observant l'uniformité dans la nature, nous arrivons par induction à l'affirmation des lois naturelles.
L'observation est un aspect relativement indépendant de l'activité scientifique, caractérisé par une perception délibérée des propriétés et des caractéristiques d'un objet. Les résultats de l'observation sont cohérents avec les données des organes sensoriels - vision, audition, tactile (perception tactile). Parfois, l'observation de l'objet à l'étude nécessite un équipement - un microscope, un télescope, etc. L'observation vise une réflexion objective de la réalité, c'est une justification empirique de la théorie, reflétant et fixant les connaissances sur les propriétés de l'objet.
L'observation est une étude et un enregistrement ciblés de données sur un objet pris dans son environnement naturel ; données basées principalement sur les capacités sensorielles d'une personne telles que les sensations, les perceptions et les idées.
Les résultats d'observation sont des données expérimentales, et éventuellement, compte tenu du traitement primaire (automatique) des informations primaires, - schémas, graphiques, schémas, etc. instruments de mesure, ainsi que la terminologie technique en plus du langage naturel).
A première vue, il peut sembler que le chercheur dans l'acte d'observation est passif et ne s'occupe que de contemplation, fût-il consciencieux. Mais ce n'est pas. L'activité de l'observateur se manifeste dans la finalité et la sélectivité de l'observation, en présence d'un certain réglage d'objectif : « quoi observer ? », « à quels phénomènes dois-je faire attention en premier lieu ? ».
Bien sûr, un chercheur qualifié n'ignore pas les phénomènes qui ne sont pas inclus dans son cadre comme ses propres buts de cette observation : ils sont aussi fixés par lui et peuvent bien s'avérer utiles pour comprendre les choses qu'il étudie.
L'activité du chercheur dans l'acte d'observation est liée à la conditionnalité théorique du contenu des résultats d'observation. L'observation implique non seulement une capacité sensuelle, mais aussi rationnelle sous la forme d'attitudes théoriques et de normes scientifiques. Comme le dit le dicton, "un scientifique regarde avec ses yeux, mais voit avec sa tête".
L'activité d'observation se manifeste également dans le choix et la conception des moyens d'observation.
Enfin, prêtons attention au fait que l'observation vise à ne pas introduire de perturbations dans les conditions naturelles d'existence de l'objet étudié. Mais l'action associée à la limitation par le sujet de lui-même et au contrôle de ses actes est évidemment une activité, quoique d'une nature particulière. Ainsi, par exemple, un chercheur menant une enquête sociologique doit réfléchir attentivement (activement !) à l'ensemble des questions et à la manière dont elles sont présentées afin de s'assurer de l'adéquation du matériel collecté par rapport à l'absence de perturbations éventuelles. dans le cours naturel du phénomène social étudié.
Il existe deux principaux types d'observation : qualitative et quantitative. L'observation qualitative est connue des gens et utilisée par eux depuis l'Antiquité - bien avant l'avènement de la science dans son sens actuel. L'utilisation d'observations quantitatives coïncide avec la formation même de la science à l'époque moderne. Les observations quantitatives sont naturellement liées aux progrès du développement de la théorie des mesures et des techniques de mesure. Le passage aux mesures et l'apparition des observations quantitatives signifiaient la préparation de la mathématisation de la science.
À la suite de l'observation, les faits empiriques sont fixés. Un fait est un fragment de réalité et de connaissance d'un objet dont la fiabilité ne fait aucun doute. L'accumulation de faits est la base des activités de recherche. En méthodologie scientifique, c'est une exigence généralement acceptée de s'appuyer sur des faits, sans lesquels les théories sont vides et spéculatives. Ce sont les faits qui appuient telle ou telle théorie ou qui témoignent contre elle. Les faits sont compris comme des phénomènes réels de la réalité, ainsi que les déclarations des scientifiques sur ces phénomènes, leurs descriptions. Des données dispersées sans interprétation ne sont pas des faits scientifiques. Un fait scientifique n'est pas une observation séparée, mais invariante, dans l'ensemble des observations. Un scientifique extrait des faits dans le processus de connaissance empirique, de communication avec la nature. Les faits obtenus ne complètent pas, mais ne font que commencer le processus de recherche scientifique, ils sont soumis à une classification, une généralisation, une systématisation et une analyse.
La comparaison consiste à identifier les similitudes (identités) et les différences d'objets, leurs propriétés et caractéristiques, est basée sur l'évidence des sens et sert de base pour distinguer les classes et les ensembles ayant des propriétés similaires. La comparaison était très appréciée en science, ce n'est pas un hasard s'il existe une anatomie comparée, une linguistique comparée, une paléontologie comparée, etc. La comparaison conduit à la conclusion sur la diversité initiale du monde.
2. Une expérience est une étude et un enregistrement actifs délibérés et clairement exprimés de données sur un objet situé dans des conditions spécialement créées et précisément fixées et contrôlées par le chercheur.
Une expérience est une création artificielle des conditions de la recherche scientifique, une expérience intentionnelle construite selon un programme proposé par le chercheur. La base de l'expérience est l'appareil. Le but de l'expérience est de révéler les propriétés souhaitées de l'objet. L'expérience consiste en des parties préparatoires, de travail et d'enregistrement et, en règle générale, n'est pas "pure", car elle ne tient pas compte de l'influence de facteurs étrangers. Parfois, ils parlent d'une expérience décisive, dont dépendent la réfutation d'une théorie existante et la création d'une nouvelle. Pour l'expérience, la procédure d'interprétation est importante, ainsi que les règles de correspondance des concepts théoriques avec leurs valeurs empiriques et leurs équivalents.
Les composantes structurelles de l'expérience sont : a) une certaine zone spatio-temporelle ("laboratoire"), dont les limites peuvent être à la fois réelles et mentales ; b) le système à l'étude qui, conformément au protocole de préparation de l'expérience, comprend, outre l'objet lui-même, également des composants tels que des dispositifs, des catalyseurs de réactions chimiques, des sources d'énergie, etc. ; c) le protocole de l'expérience, selon lequel des perturbations sont produites dans le système en y envoyant une certaine quantité de matière et/ou d'énergie à partir de sources contrôlées sous certaines formes et à une certaine vitesse ; d) réactions du système enregistrées à l'aide d'instruments, dont les types et la position par rapport à la zone de l'expérience sont également enregistrés dans son protocole.
Selon les buts cognitifs, les moyens utilisés et les objets réels de cognition, on peut distinguer : une recherche ou une expérience de recherche ; expérience de vérification ou de contrôle ; reproduire l'expérience ; expérience d'isolement; expérience qualitative et quantitative; expérience physique, chimique, biologique, sociale.
La formation de l'expérience comme méthode indépendante de connaissance scientifique au XVIIe siècle. (G. Galileo) signifiait également l'émergence de la science moderne, bien que remontant au XIIIe siècle. R. Bacon a exprimé l'opinion qu'un scientifique ne devrait pas faire confiance inconditionnellement à aucune autorité et que la connaissance scientifique devrait être basée sur la méthode expérimentale. S'étant imposée en sciences physiques, la méthode expérimentale a trouvé une diffusion en chimie, biologie, physiologie, et au milieu du XIXe siècle. et en psychologie (W. Wundt). Actuellement, l'expérience est de plus en plus utilisée en sociologie.
L'expérience a des avantages sur l'observation :
1) les phénomènes étudiés peuvent être reproduits à la demande du chercheur ;
2) dans des conditions expérimentales, il est possible de détecter de telles caractéristiques des phénomènes étudiés qui ne peuvent pas être observées dans des conditions naturelles ; par exemple, de cette manière au début des années 1940. en physique a commencé (avec le neptunium) l'étude des éléments transuraniens ;
3) la variation des conditions permet d'isoler significativement le phénomène étudié de toute circonstance incidente et aggravante et de se rapprocher de son étude « à l'état pur » dans le respect du principe « ceteris paribus » ;
4) la possibilité d'utiliser des instruments et, par conséquent, l'automatisation et l'informatisation de l'expérience se développent considérablement.
Dans la structure générale de la recherche scientifique, l'expérience occupe une place particulière. Premièrement, l'expérience sert de lien entre les étapes et les niveaux empiriques et théoriques de la recherche scientifique. De par sa conception, l'expérience est médiatisée par la recherche théorique antérieure et ses résultats : elle est conçue sur la base de certaines connaissances théoriques et vise à recueillir de nouvelles données ou à tester (confirmer ou infirmer) une certaine hypothèse (ou théorie) scientifique. Les résultats d'une expérience sont toujours interprétés en fonction d'une théorie particulière. Et en même temps, par la nature des moyens cognitifs utilisés, l'expérience appartient au niveau empirique de la cognition, et ses résultats sont des faits établis et des dépendances empiriques.
Deuxièmement, l'expérience appartient à la fois aux activités cognitives et pratiques : son but est d'accroître les connaissances, mais elle est également associée à la transformation de la réalité environnante, même si elle est éprouvante et limitée par l'espace et le contenu d'une expérience particulière. Dans le cas où il s'agit d'une production à grande échelle ou d'une expérience sociale, il s'avère être une forme de pratique à part entière.
3. L'observation et l'expérimentation, et, peut-être, en général, toutes les méthodes de la connaissance scientifique moderne sont associées à l'utilisation d'instruments. Le fait est que nos capacités cognitives naturelles, incarnées à la fois sous une forme sensuelle et rationnelle, sont limitées et, par conséquent, pour résoudre de nombreux problèmes scientifiques, elles sont totalement insuffisantes. La capacité permissive, la constance de la perception (intensité, taille, forme, luminosité, couleur), le volume de la perception, l'acuité visuelle, la gamme de stimuli perçus, la réactivité et d'autres caractéristiques de l'activité de nos organes sensoriels, comme le montrent les études psychophysiologiques, sont assez spécifique et fini. De même, nos capacités d'élocution, notre mémoire et nos capacités de réflexion sont finies. Dans ce cas, nous pouvons étayer cette affirmation au moyen de données quoique grossières, approximatives, mais néanmoins empiriques obtenues à l'aide de tests pour déterminer le soi-disant quotient intellectuel (QI). Ainsi, pour reprendre les mots de l'un des fondateurs de la cybernétique, le scientifique anglais W. R. Ashby, nous avons également besoin d'amplificateurs de capacités mentales.
C'est ainsi que l'on peut définir le rôle des instruments dans la connaissance scientifique. Les appareils, d'une part, amplifient - au sens le plus général du terme - nos organes sensoriels, élargissant le champ de leur action à divers égards (sensibilité, réactivité, précision, etc.). Deuxièmement, ils complètent nos sens avec de nouvelles modalités, permettant de percevoir des phénomènes que nous ne percevons pas consciemment sans eux, par exemple les champs magnétiques. Enfin, les ordinateurs, qui sont un type d'instrument particulier, permettent, par leur utilisation en conjonction avec d'autres instruments, d'enrichir et d'augmenter considérablement l'efficacité de ces deux fonctions. De plus, ils permettent également d'introduire une toute nouvelle fonction liée au gain de temps dans l'obtention, la sélection, le stockage et le traitement des informations et à l'automatisation de certaines opérations mentales.
Ainsi, à l'heure actuelle, le rôle des instruments dans la cognition ne peut être sous-estimé, les considérant, pour ainsi dire, comme quelque chose "d'auxiliaire". De plus, cela s'applique aux niveaux empirique et théorique des connaissances scientifiques. Et si nous clarifions le rôle des appareils, alors nous pouvons dire ceci : les appareils sont une méthode matérialisée de cognition. En fait, chaque appareil est basé sur un certain principe de fonctionnement, et ce n'est rien de plus qu'une méthode, c'est-à-dire une technique éprouvée et systématisée (ou un ensemble de techniques), qui, grâce aux efforts des développeurs - concepteurs et technologues, réussi à traduire en un dispositif spécial . Et lorsque certains appareils sont utilisés à l'un ou l'autre stade de la connaissance scientifique, il s'agit alors de l'utilisation d'une expérience pratique et cognitive accumulée. Dans le même temps, les appareils élargissent les frontières de cette partie de la réalité accessible à notre connaissance - ils s'étendent au sens le plus général du terme, et pas seulement au sens de la région spatio-temporelle appelée "laboratoire".
Mais, bien sûr, le rôle des instruments dans la cognition ne peut être surestimé - dans le sens où leur utilisation élimine généralement toute limitation de la cognition ou évite au chercheur des erreurs. Ce n'est pas vrai. D'abord, puisque le dispositif sert de méthode matérialisée, et qu'aucune méthode ne peut être "impeccable", idéale, infaillible, tel est tout dispositif, même le meilleur. Il contient toujours une erreur instrumentale, et ici il convient de prendre en compte non seulement les erreurs de la méthode correspondante incorporée dans le principe de fonctionnement de l'appareil, mais également les erreurs de technologie de fabrication. De plus, le chercheur utilise l'appareil, de sorte que la possibilité de faire toutes ces erreurs dont il est seulement «capable» sans être armé d'appareils est, en principe, préservée, bien que sous une forme légèrement différente.
De plus, lors de l'utilisation d'appareils cognitifs, des complications spécifiques surviennent. En effet, les instruments introduisent inévitablement certaines « perturbations » dans les phénomènes étudiés. Par exemple, il se présente souvent une situation dans laquelle la possibilité d'enregistrer et de mesurer simultanément plusieurs caractéristiques du phénomène étudié est perdue. À cet égard, le "principe d'incertitude" de Heisenberg dans la théorie de l'atome est particulièrement révélateur : plus la coordonnée de la particule est mesurée avec précision, moins il est possible de prédire avec précision le résultat de la mesure de son impulsion. Il est possible, par exemple, de déterminer avec précision la quantité de mouvement d'un électron (et donc son niveau d'énergie) dans certaines de ses orbites, mais dans ce cas, son emplacement sera complètement indéfini. Et notez que le point ici n'est pas du tout dans l'esprit, la patience ou la technique. Mentalement, on peut imaginer qu'on a réussi à construire un "supermicroscope" pour observer l'électron. Y aura-t-il alors confiance que les coordonnées et la quantité de mouvement de l'électron sont simultanément mesurables ? Non. Dans un tel "supermicroscope", telle ou telle "lumière" doit être utilisée : pour que nous puissions "voir" un électron dans un tel "supermicroscope", au moins un quantum de "lumière" doit être diffusé par l'électron. Cependant, la collision d'un électron avec ce quantum conduirait à un changement dans le mouvement de l'électron, provoquant un changement imprévisible de sa quantité de mouvement (ce que l'on appelle l'effet Compton).
Le même genre de complications se produit dans les phénomènes étudiés par d'autres sciences. Ainsi, par exemple, une image précise d'un tissu obtenue à l'aide d'un microscope électronique tue simultanément ce tissu. Un zoologiste qui mène des expériences avec des organismes vivants ne traite jamais avec un spécimen absolument sain et normal, car l'acte même d'expérimentation et l'utilisation d'équipements entraînent des changements dans l'organisme et dans le comportement de la créature étudiée. Les mêmes complications s'appliquent à l'ethnographe venu étudier la « pensée primitive » et à l'observation effectuée en sociologie au moyen d'enquêtes sur des groupes de population.
FORMES DE CONNAISSANCE EMPIRIQUE (FORMES DE SUJET, CONCEPTS, JUGEMENTS, LOIS)
La cognition est un type spécifique d'activité humaine visant à comprendre le monde environnant et soi-même dans ce monde. L'un des niveaux de la connaissance scientifique est empirique. Le niveau empirique des connaissances scientifiques se caractérise par une étude directe d'objets réels perçus sensuellement. Le rôle particulier de l'empirisme dans la science réside dans le fait que ce n'est qu'à ce niveau de recherche que nous traitons de l'interaction directe d'une personne avec les objets naturels ou sociaux étudiés.
Ici la contemplation vivante (cognition sensorielle) prévaut, le moment rationnel et ses formes (jugements, concepts, etc.) sont ici présents, mais ont un sens subordonné. Ainsi, l'objet étudié se réfléchit principalement du côté de ses connexions et manifestations externes, accessibles à la contemplation vivante et exprimant des relations internes. À ce niveau, le processus d'accumulation d'informations sur les objets et les phénomènes à l'étude s'effectue en effectuant des observations, en effectuant diverses mesures et en livrant des expériences. Ici, la systématisation primaire des données factuelles obtenues est également réalisée sous forme de tableaux, diagrammes, graphiques, etc. De plus, déjà au niveau empirique, le niveau des connaissances scientifiques - à la suite de la généralisation des faits scientifiques - il est possible de formuler quelques modèles empiriques.
Il existe les types suivants de formes de connaissances scientifiques: logique générale. Ceux-ci incluent des concepts, des jugements, des conclusions; local-logique. Ceux-ci incluent des idées scientifiques, des hypothèses, des théories, des lois.
concept- c'est une pensée qui reflète la propriété et les caractéristiques nécessaires d'un objet ou d'un phénomène. Les concepts sont: généraux, singuliers, concrets, abstraits, relatifs, absolus, etc. Les concepts généraux sont associés à un certain ensemble d'objets ou de phénomènes, les singuliers ne se réfèrent qu'à un seul, spécifique - à des objets ou phénomènes spécifiques, abstrait - à leur individu caractéristiques, les concepts relatifs sont toujours présentés par paires et les concepts absolus ne contiennent pas de relations par paires.
Jugement- c'est une pensée qui contient l'affirmation ou la négation de quelque chose à travers la connexion de concepts. Les jugements sont affirmatifs et négatifs, généraux et particuliers, conditionnels et disjonctifs, etc.
inférence est un processus de réflexion qui relie une séquence de deux propositions ou plus, aboutissant à une nouvelle proposition. Par essence, une conclusion est une conclusion qui permet de passer de la réflexion aux actions pratiques. Les inférences sont de deux types :
Un degré supérieur de connaissance scientifique trouve son expression, comme on l'a noté, dans des formes logiques locales. En même temps, le processus de cognition passe d'une idée scientifique à une hypothèse, se transformant ensuite en une loi ou une théorie.
Droit- ce sont des relations nécessaires, essentielles, stables, récurrentes entre les phénomènes de la nature et de la société. La loi reflète les connexions générales et les relations inhérentes à tous les phénomènes d'un genre, d'une classe donnés.
La loi est objective et existe indépendamment de la conscience des gens. La connaissance des lois est la tâche principale de la science et constitue la base de la transformation de la nature et de la société par les personnes.
Page 40 sur 60
40. Formes des niveaux empiriques et théoriques des connaissances scientifiques.
La connaissance théorique étant sa forme la plus élevée et la plus développée, il convient d'abord de déterminer ses composantes structurelles. Parmi les principaux figurent le problème, l'hypothèse, la théorie et la loi, qui agissent en même temps comme des formes, des "points clés" de la construction et du développement des connaissances à son niveau théorique.
Un problème est une forme de connaissance théorique dont le contenu est ce qui n'est pas encore connu de l'homme, mais qui a besoin d'être connu. En d'autres termes, il s'agit de connaissances sur l'ignorance, une question qui s'est posée au cours de la cognition et qui nécessite une réponse. Le problème n'est pas une forme de connaissance figée, mais un processus qui comprend deux points principaux (étapes du mouvement de la connaissance) - sa formulation et sa solution. La dérivation correcte des connaissances problématiques à partir de faits et de généralisations antérieurs, la capacité de poser correctement le problème est une condition préalable nécessaire à sa solution réussie.
Ainsi, le problème scientifique s'exprime en présence d'une situation contradictoire (agissant sous la forme de positions opposées), qui nécessite une résolution appropriée. L'influence décisive sur la manière de poser et de résoudre le problème est, premièrement, la nature de la pensée de l'époque à laquelle le problème est formulé et, deuxièmement, le niveau de connaissance des objets concernés par le problème. Chaque époque historique a ses propres formes caractéristiques de situations problématiques.
Une hypothèse est une forme de connaissance théorique contenant une hypothèse formulée sur la base d'un certain nombre de faits, dont la véritable signification est incertaine et doit être prouvée. Les connaissances hypothétiques sont probables, non fiables et nécessitent une vérification, une justification. Au cours de la démonstration des hypothèses avancées : a) certaines d'entre elles deviennent une véritable théorie, b) d'autres sont modifiées, clarifiées et concrétisées, c) d'autres sont écartées, se transforment en erreurs si le test donne un résultat négatif. L'avancement d'une nouvelle hypothèse, en règle générale, est basé sur les résultats du test de l'ancienne, même si ces résultats étaient négatifs.
La théorie est la forme la plus développée de la connaissance scientifique, qui donne un affichage holistique des connexions régulières et essentielles d'un certain domaine de la réalité. Des exemples de cette forme de connaissance sont la mécanique classique de Newton, la théorie de l'évolution de Ch. Darwin, la théorie de la relativité d'A. Einstein, la théorie des systèmes intégraux auto-organisés (synergétique), etc.
La loi peut être définie comme une connexion (relation) entre des phénomènes, des processus, qui est :
a) objectif, puisqu'il est inhérent principalement au monde réel, l'activité sensuelle-objective des personnes, exprime les relations réelles des choses;
b) essentiel, concret-universel. Étant un reflet de l'essentiel dans le mouvement de l'univers, toute loi est inhérente à tous les processus d'une classe donnée, d'un certain type (genre) sans exception, et agit toujours et partout où se déroulent les processus et conditions correspondants ;
c) nécessaire, car étant étroitement liée à l'essence, la loi agit et s'exécute avec une "nécessité de fer" dans des conditions appropriées ;
d) interne, car il reflète les connexions et les dépendances les plus profondes d'un domaine donné dans l'unité de tous ses moments et relations au sein d'un certain système intégral ;
e) répétitif, stable, puisque "la loi est un solide (restant) dans le phénomène", "identique dans le phénomène",
leur "réflexion calme" (Hegel). C'est l'expression d'une certaine constance d'un certain processus, de la régularité de son cours, de l'uniformité de son action dans des conditions similaires.
La cognition empirique, ou contemplation sensuelle ou vivante, est le processus de cognition lui-même, qui comprend trois formes interdépendantes :
1. sensation - un reflet dans l'esprit d'une personne d'aspects individuels, de propriétés d'objets, de leur impact direct sur les sens;
2. perception - une image holistique d'un objet, directement donnée dans une contemplation vivante de la totalité de tous ses côtés, une synthèse de ces sensations;
3. représentation - une image sensorielle-visuelle généralisée d'un objet qui a agi sur les sens dans le passé, mais qui n'est pas perçu pour le moment.