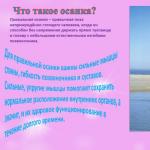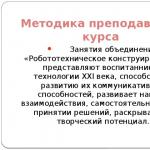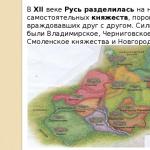Culture européenne et début du Moyen Âge. Résumé : Haut Moyen Âge en Europe occidentale
En 455, les Vandales s'emparèrent et pillèrent Rome, qui en 408 était déjà approchée par les Wisigoths menés par Alaric. En 476, l'empereur romain nominal, dont la résidence était à Ravenne, fut déposé par Odoacer, qui avait assumé une position de premier plan parmi les mercenaires allemands en Italie. Odoacer, qui a reçu le titre de patricien, a gouverné l'Italie jusqu'en 493, lorsque Théodoric, roi des Ostrogoths, a pris le pouvoir dans le pays. La domination ostrogothique a duré en Italie jusqu'au moment où le commandant de l'empereur byzantin Justinien Bélisaire a conquis Rome (536) et Ravenne (540). Dans la seconde moitié du VIe siècle. les Lombards ont capturé et occupé le nord de l'Italie, et les gouverneurs de l'empereur byzantin se sont installés à Ravenne. Rome passa sous le contrôle temporaire du pape.
On ne peut guère s'attendre, bien sûr, à ce que la philosophie ait prospéré pendant les années turbulentes de la chute de l'Empire romain et des invasions barbares qui ont suivi. Il serait toutefois exagéré de décrire
Haut Moyen Âge
la période qui suit l'effondrement de l'empire, comme une période de barbarie complète Comme nous l'avons vu, Boèce a vécu dans le royaume Ostrogoth ; est également mentionné Isidore de Séville, mort vers 636 dans le royaume wisigoth d'Espagne. Dans le même temps, le système éducatif de l'Empire romain tombait en décadence et toute l'éducation restante brillait principalement dans les monastères. Saint Benoît a vécu en 480-543, et les monastères, qui devaient leur esprit et leur ordre à sa domination, sont devenus le lien où les vestiges de l'ancienne culture ont été préservés puis transférés aux peuples "barbares"90.
En Angleterre, la situation commença à s'améliorer à partir de 669 environ, lorsque le moine grec Théodore de Tarse, nommé archevêque de Cantorbéry, avec ses associés, organisa ici une école monastique. Bède le Vénérable (674-735), interprète de Pi-
90 Il y avait aussi l'influence culturelle de l'ancien monachisme celtique, qui s'est répandu de l'Irlande à l'Écosse et au nord de l'Angleterre.

Haut Moyen Âge
sania et historien (ou en tout cas chroniqueur), était moine à Jarrow. Et l'étudiant de Bede, Egberg, a apporté la plus grande contribution au développement de York en tant que centre d'éducation.
Le renouveau littéraire en Europe a eu lieu sous le règne de Charlemagne. En 496, le roi Clovis des Francs se convertit au christianisme. Sous son règne et celui de ses successeurs, toutes les terres franques sont réunies sous le règne de la dynastie mérovingienne. Après la mort de Dagoberg 1 (638), les Mérovingiens se transformèrent en souverains purement nominaux, tandis que le pouvoir réel passa entre les mains des maires. Cependant, en 751, avec la proclamation de Pépin le Bref comme roi des Francs, la dynastie mérovingienne prend fin. Pépin laisse le royaume à ses deux fils, Charles et Carloman. Ce dernier mourut en 771 et Charles, devenu célèbre sous le nom de Charlemagne, devint le seul
91 Ainsi, Charles Martell, qui vainquit les Sarrasins à Poitiers en 732 et empêcha l'invasion musulmane de l'Occident, déjà possible à cette époque, n'était pas formellement le roi des Francs, même s'il régnait en fait sur eux.
Haut Moyen Âge
nouveau monarque. Après la conquête de l'État lombard, plusieurs campagnes réussies contre les Saxons, l'annexion de la Bavière, l'assujettissement de la Bohême et la conquête de certaines terres en Espagne, Charlemagne est devenu le plus grand souverain chrétien d'Europe occidentale. A Noël 800 à Rome, le pape oint Charles comme empereur, et cet acte marque une rupture décisive entre Rome et Byzance, et souligne également les devoirs chrétiens du monarque et la nature théocratique de l'État.Charlemagne n'est pas seulement un conquérant, mais aussi un réformateur qui a cherché à développer l'illumination et le renouveau culturel de la société. A cette fin, il réunit autour de lui de nombreux scientifiques. L'ancienne culture romaine de la Gaule étant tombée à un niveau extrêmement bas aux VIe et VIIe siècles, l'empereur devait s'appuyer principalement sur des savants étrangers. À son invitation vinrent des savants d'Italie et d'Espagne, et son principal conseiller, Alcuin, était originaire d'York. En 782, Alcuin a organisé l'école palatine - alias
Haut Moyen Âge
demiyu à la cour impériale, où il enseigna à ses élèves les Écritures, la littérature ancienne, la logique, la grammaire et l'astronomie. Alcuin était également un auteur de manuels et un copiste assidu de manuscrits, principalement des Écritures. Parmi ses élèves se trouvait Raban Maurus, connu comme le "mentor de l'Allemagne", qui devint l'abbé du monastère de Fulda et plus tard l'archevêque de Mayence.On ne peut pas dire que le travail d'Alcuin et de ses associés ait été original et créatif. Leur tâche était plutôt de diffuser l'érudition existante. Cela se faisait à la fois par des écoles monastiques, comme celles créées dans les monastères de Saint-Gall et de Fulda, et par des écoles épiscopales ou capitulaires. Ces établissements existaient principalement, mais pas exclusivement, pour ceux qui se préparaient à devenir moine ou prêtre. L'école palatine, cependant, a été clairement conçue par l'empereur comme un lieu d'éducation de la bureaucratie civile.

Haut Moyen Âge
wa, nécessaire au contrôle de l'empire carolingien92.
La formation s'est déroulée en latin. Même si l'usage du latin ne découlait pas naturellement du caractère majoritairement ecclésiastique de l'enseignement, il était dicté par des considérations administratives compte tenu de la diversité des peuples peuplant l'Empire. Le contenu de l'éducation était les sept arts libéraux mentionnés dans le chapitre précédent, et les études théologiques, à savoir l'étude de l'Écriture. Outre le développement de l'enseignement dans ce sens, le résultat de la réforme culturelle de Charlemagne fut la multiplication des manuscrits et l'enrichissement des bibliothèques.
A l'époque des Carolingiens, la philosophie se réduisait essentiellement à la dialectique et à la logique qui, comme nous l'avons noté, faisaient partie du trivium. A une grande exception près, dont il sera question plus loin,

Haut Moyen Âge
En général, la philosophie spéculative n'existait que sous des formes rudimentaires. Par exemple, les Dites de Candide sur l'Image de Dieu, attribuées au moine de Fulda, qui vécut au début du IX a, contiennent la preuve de l'existence de Dieu, fondée sur l'idée que la hiérarchie des êtres exige l'existence d'une infinité intelligence divine. De plus, dans cette période, nous pouvons également voir les débuts d'un différend sur les termes universels, qui seront examinés plus loin, dont le contenu principal est le salut et la transmission, on ne peut guère s'attendre à une philosophie originale.
La grande exception mentionnée ci-dessus est Jean Scot Érigène93, le premier éminent philosophe du Moyen Âge. Né en Irlande, John Scot a fait ses études en Irlande.
93 Combinaison d'épithètes Scott [Scot. – I.B.] et Eriugena (née en Irlande) peuvent sembler contradictoires. Cependant, au IXe siècle L'Irlande s'appelait Great Scotland et les Irlandais - "bétail".

Haut Moyen Âge
monastère de terre, où il apprit la langue grecque94.
À 850 il est apparu à la cour de Charles le Chauve
et a commencé à enseigner à l'école palatine. Charles était le roi de la partie occidentale de l'empire, la Neustrie(843-875), et en 875 il fut couronné empereur. Il mourut en 877, à peu près à la même époque, Jean Scot mourut probablement aussi, bien que la date et le lieu exacts de sa mort soient inconnus95. Avec son essai "Sur la prédestination" (De praedestinatione), Jean Scot est intervenu dans le débat théologique qui se déroulait à cette époque, prenant la défense de la liberté humaine. En récompense de ses efforts, il
94 Il serait assez téméraire de penser que tous les moines irlandais savaient le grec. En même temps, au IXe siècle la connaissance de cette langue était plus ou moins caractéristique des monastères irlandais, et dans d'autres lieux, par exemple dans un monastère Saint-Gall, généralement en raison de l'influence des moines irlandais.
95 Apparemment, l'histoire selon laquelle Jean Scot est devenu abbé du monastère d'Athelney et a été tué par les moines est soit une légende, soit fait référence au philosophe par erreur et parle d'un autre Jean.

Haut Moyen Âge
attiré le soupçon d'hérésie et tourna prudemment son attention vers d'autres sujets. En 858, il commença à traduire en latin les écrits du Pseudo-Denys, qu'il accompagna d'un commentaire96. En outre, il a traduit certains des écrits de Grégoire de Nysse et de Maxime le Confesseur, et semble avoir écrit des commentaires sur l'Évangile de Jean et sur certaines des œuvres de Boèce. Sa renommée lui fut apportée principalement par l'ouvrage "Sur le partage de la nature" (De cuvisione naturae), probablement créé entre 862 et 866. Cet ouvrage se compose de cinq livres et prend la forme d'un dialogue auquel participent l'enseignant, ou l'enseignant, et l'élève. Elle révèle la dépendance importante d'Érigène vis-à-vis des écrits de Pseudo-Denys et de Pères de l'Église tels que Grégoire de Nysse. Néanmoins, la composition de l'Erigène est une réussite remarquable, car
96 En 827, l'empereur Michel Shepelyaviy offrit à Louis le Pieux les œuvres de Pseudo-Denys. Les commentaires de Jean Scot ne couvraient pas la "théologie mystique".
Haut Moyen Âge
contient tout un système, ou vision du monde, et démontre un esprit puissant et exceptionnel, limité, cependant, par le cadre de la vie intellectuelle de l'époque et la rareté du matériel philosophique disponible pour la réflexion, mais dépassant de loin l'esprit des penseurs contemporains ordinaires.
Le mot « nature » dans le titre de l'œuvre de Jean Scot signifie la plénitude de la réalité, incluant à la fois Dieu et la création. L'auteur tente de montrer comment Dieu en lui-même, caractérisé par lui comme "nature créatrice et incréée", donne naissance au Verbe divin, ou Logos, et - dans ce Verbe - aux idées divines éternelles. Ces idées sont créées, parce que logiquement, mais pas dans le temps, elles suivent le Verbe né dans l'éternité, et créatrices - au moins dans le sens où elles servent de modèles ou d'archétypes des choses finies ; ensemble, ils forment donc « la nature créée et créatrice ». Les choses finies, créées conformément à leurs modèles éternels, constituent « la nature créée et non créative ». Ce sont l'auto-manifestation divine, la théophanie ou Dieu-
Haut Moyen Âge
phénomène. Enfin, Jean Scot parle de « nature ni créatrice ni créée » : tel est l'achèvement du processus cosmique, le résultat du retour de toutes choses à leur source, lorsque Dieu sera tout en tous.
Apparemment, il n'y a aucune raison convaincante de douter que Jean Scot ait eu l'intention de présenter la vision chrétienne du monde, l'interprétation globale de l'univers à la lumière de la foi chrétienne. Son attitude initiale semble avoir été la foi en quête de compréhension.
L'instrument de compréhension est la philosophie spéculative, qui remonte finalement au néoplatonisme. Le lecteur moderne peut difficilement éviter l'impression que, entre les mains de Jean Scot, le christianisme se modifie, prenant la forme d'un système métaphysique. Certes, ce n'est pas du tout comme si le philosophe lui-même pensait à la transformation du christianisme.
Il cherchait plutôt à comprendre - pour ainsi dire, à comprendre par la raison - la vision chrétienne de la réalité. Cependant, en conséquence
Haut Moyen Âge
des ambiguïtés ou des décalages subsistaient entre ce qui est habituellement considéré comme un enseignement chrétien et l'interprétation philosophique de cet enseignement donnée par Erigène. Donnons deux ou trois exemples.
La Bible parle de la sagesse divine et d'un Dieu sage. Cependant, la voie de la négation, qui semble à Jean Scot d'une importance fondamentale, nécessite de ne pas attribuer la sagesse à Dieu, puisqu'elle est un attribut de certaines créations, le philosophe tente de trouver une harmonie dialectique entre les énoncés bibliques correspondants et la voie de la négation , interprétant la déclaration sur la sagesse de Dieu dans le sens qu'il faut attribuer à Dieu une super-sagesse. Cela ne contredit pas la déclaration biblique sur la sagesse de Dieu; mais le préfixe "sur" indique que la sagesse divine dépasse la compréhension humaine.
Et puisque la sagesse créée - la sagesse que nous connaissons par expérience - est niée par rapport à Dieu, la voie de la négation conserve sa position dominante. De toute évidence, Jean Scot s'appuie sur les idées de Pseudo-Denys. Son raisonnement n'est pas
Haut Moyen Âge
sont d'une nouveauté sans pareille. Le point principal, cependant, est qu'il commence par le concept biblique de Dieu, puis se déplace dans une direction qui conduit logiquement (et peut être prouvée) à l'agnosticisme. Premièrement, il est affirmé que Dieu est X. Ensuite, il est nié que Dieu est X. Ensuite, il est affirmé que Dieu est super-X. Une question naturelle se pose : comprenons-nous ce que nous attribuons à Dieu lorsque nous disons qu'il est super-X ?
Deuxième exemple. Dans le premier livre de l'essai "Sur la division de la nature", Jean Scot explique qu'il croit en la libre création divine du monde "à partir de rien". De plus, il prouve que l'affirmation sur la création du monde par Dieu implique un changement en Dieu et une idée insoutenable sur l'existence de Dieu "avant" le monde. Bien sûr, Augustin devait déjà prouver que la création du monde ne doit pas être comprise dans le sens que Dieu a une priorité temporelle (c'est-à-dire existe dans le temps) ou subit une métamorphose dans l'acte de création. Cependant, John Scot estime que la croyance en la création doit être comprise dans le sens que
Haut Moyen Âge
Dieu est l'essence de toutes choses et même, chose assez surprenante, il est présent dans les choses dont il est considéré comme le créateur. Ici l'idée néoplatonicienne d'émanation, l'expiration des choses de l'Un, est clairement visible ; mais certaines des déclarations de Jean Scot elles-mêmes donnent l'impression qu'il considère le monde comme l'objectivation de Dieu, ou, pour reprendre l'expression de Hegel, Dieu-dans-son-altérité. En même temps, Jean Scot dit que Dieu en lui-même demeure transcendant, immuable et impérissable. Et bien qu'il soit clair qu'il essaie d'interpréter la croyance judéo-chrétienne en la création divine à l'aide d'outils philosophiques, il n'est pas tout à fait clair comment se rapporter aux résultats de cette tentative.
Et le dernier exemple. Jean Scot partage la croyance chrétienne selon laquelle l'homme revient à Dieu par le Christ, le Fils de Dieu incarné ; il dit clairement que les personnalités individuelles seront transformées plutôt qu'abolies ou dissoutes. De plus, il partage la croyance en la récompense et la punition dans l'au-delà. En même temps, il affirme que les créations sont à nouveau
Haut Moyen Âge
retournent à leurs fondements éternels en Dieu (idées archétypales) et cessent d'être appelés créatures. De plus, il comprend l'idée du châtiment éternel des pécheurs impénitents dans le sens où Dieu empêchera à jamais la volonté pervertie et obstinée de se concentrer sur les images stockées dans la mémoire de ces choses qui étaient l'objet des désirs terrestres du pécheur.
Ce problème, qui occupait Jean Scot, est en grande partie un problème interne au christianisme ; Origène et St. Grégory Nyssky.
Comment peut-on, par exemple, concilier le dogme de l'enfer avec l'affirmation de S. Paul que Dieu sera tout en tous, et avec foi en la volonté salvifique universelle de Dieu ? En même temps, le philosophe cherche manifestement à comprendre l'eschatologie chrétienne à la lumière et à l'aide de la croyance néoplatonicienne à l'émanation cosmique et au retour à Dieu. Sa problématique est déterminée par l'étude des Ecritures et des traités du Pseudo-Denys, de Grégoire de Nysse et d'autres penseurs.
Haut Moyen Âge
Il peut sembler que la mention du nom de Hegel soit en rapport avec le penseur du IXe siècle. est un anachronisme monstrueux. Et à certains égards importants, c'est vrai. Cependant, malgré les différences énormes et évidentes dans les fondements intellectuels d'origine, le contexte historique, l'approche et les croyances philosophiques, nous trouvons chez ces deux personnes un désir d'explorer la signification philosophique ou spéculative des croyances chrétiennes. Quant au débat des historiens sur la question de savoir si Jean Scot doit être qualifié de théiste, de panenthéiste ou de panthéiste, cela n'a guère de sens d'aborder ce sujet sans avoir une définition précise de ces termes. Certes, nous pouvons dire que Jean Scot se tient sur les positions du théisme chrétien, essaie de le comprendre et, dans le processus de le comprendre, développe un système que l'on peut à juste titre appeler panenthéiste. Cependant, si le théisme n'est pas considéré comme équivalent au déisme, alors il doit probablement s'agir de panenthéisme dans un certain sens.

Haut Moyen Âge
Les réalisations remarquables de Jean Scot semblent n'avoir attiré presque aucun intérêt de la part de ses contemporains. Bien sûr, cela est dû dans une certaine mesure aux conditions qui prévalaient après l'effondrement de l'empire carolingien. Certes, plusieurs écrivains du haut Moyen Âge se sont tournés vers l'ouvrage De dmsione naturae, mais il n'était pas largement connu jusqu'à ce qu'Amalric de Vienne (Amaury de Bene), mort au début du XIIIe siècle, s'y soit tourné. et s'attira clairement l'accusation de panthéisme. Grâce aux efforts d'Amalric, le magnum opus de Jean Scot, dans lequel ils voyaient la racine du mal, fut condamné en 1225 par le pape Honorius III.
L'empire de Charlemagne subit un effondrement politique.
Après la mort de l'empereur, ses biens furent divisés. Puis vint la vague des conquêtes étrangères. L'année 845 voit l'incendie de Hambourg et le sac de Paris par les Normands,
97 Nous savons très peu de choses sur les idées d'Amalrik. Il semble cependant que ses écrits aient été interprétés, à juste titre ou non, comme identifiant Dieu aux créatures.
Haut Moyen Âge
ou les Vikings, en 847 le même sort s'abattit sur Bordeaux. L'empire franc s'est finalement divisé en cinq royaumes, souvent en guerre les uns avec les autres. Pendant ce temps, les Sarrasins ont envahi l'Italie et ont presque pris Rome. L'Europe, à l'exception d'une culture musulmane florissante en Espagne, a été plongée dans l'âge des ténèbres pour la deuxième fois. L'église fut victime de l'exploitation par la nouvelle noblesse féodale.
Abbayes et diocèses furent distribués en récompense aux laïcs et aux prélats indignes, et ce au Xe siècle. même la papauté elle-même était sous le contrôle de la noblesse et des partis locaux. Dans de telles circonstances, il n'y avait aucune raison d'espérer que le mouvement des Lumières, initié par Charlemagne, serait fructueux.
On ne peut pas dire, bien sûr, que l'éducation en Europe a tout simplement disparu. En 910 l'abbaye de Cluny est fondée ; et des monastères d'orientation clunisienne, dont le premier chef d'orchestre en Angleterre fut St. Dunstan, a contribué au maintien de la culture écrite. Par exemple, un moine

Haut Moyen Âge
Abbon, mort en 1004, dirigeait une école monastique sur la Loire, où l'on étudiait non seulement l'Écriture et les Pères de l'Église, mais aussi la grammaire, la logique98 et les mathématiques. Une figure plus importante, cependant, est Herbert d'Aurillac. Herbert (né vers 938) est devenu un moine clunisien réformé et a étudié en Espagne, où il s'est apparemment familiarisé avec la science arabe. Par la suite, il dirige l'école de Reims. Puis il occupe successivement les postes d'abbé du monastère de Bobbio, d'archevêque de Reims et d'archevêque de Ravenne, et en 999 il est élu pape sous le nom de Sylvestre II. Alors qu'il enseignait à Reims, Herbert a donné des conférences sur la logique, mais était plus remarquable pour ses recherches sur la littérature latine classique et les mathématiques alors disponibles. Il mourut en 1003.
L'un des élèves d'Herbert à Reims fut le célèbre Fulber, considéré comme le fondateur de
98 La logique comprenait les "Catégories" et le De Interpretatiom d'Aristote (la soi-disant "ancienne logique") et les traités de Boèce sur les Premier et Second Analystes.
Haut Moyen Âge
lem school à Chartres et était l'évêque de cette ville. L'école cathédrale de Chartres existait depuis longtemps, mais en 990 Fulber jeta les bases d'un centre d'humanités et d'études philosophiques et théologiques, centre célèbre au XIIe siècle, jusqu'à ce que le prestige des écoles régionales s'efface devant la gloire. de l'Université de Paris.
Nous avons noté que la dialectique, ou la logique, était l'un des sujets du trivium. Par conséquent, en tant qu'art libre, il a longtemps été étudié dans les écoles. Cependant, au XIe siècle. la logique, pour ainsi dire, prend une vie propre et est utilisée comme un outil pour affirmer la supériorité de la raison, même dans le domaine de la foi. En d'autres termes, sont apparus des dialecticiens qui ne se sont pas contentés de l'étude de l'Introduction de Porphyre, de plusieurs écrits logiques d'Aristote, des commentaires et traités de Boèce. Il semble qu'il y ait bien là une part d'acrobatie verbale, car les dialecticiens cherchaient à éblouir et à émerveiller. Mais il y avait aussi des gens qui utilisaient
Haut Moyen Âge
logique dans cette science, qui était considérée comme la principale et la plus exaltée - en théologie.
Il est vrai que dire la chose de cette manière, c'est induire en erreur. Après tout, la théologie n'a jamais été considérée à l'abri des normes logiques et les théologiens n'ont pas non plus négligé la déduction logique. Le point ici est le suivant. Les théologiens croyaient que certaines prémisses ou doctrines (dont des conclusions pouvaient être déduites) étaient révélées par Dieu et devaient être acceptées sur la base de la foi en l'autorité, tandis que certains dialecticiens du XIe siècle. n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'idée d'autorité et a essayé de présenter les "mystères" révélés comme les conclusions de la raison. Au moins parfois, leur raisonnement a conduit à des changements de doctrine. C'est cette attitude rationaliste qui suscita l'hostilité d'un certain nombre de théologiens et suscita de vives querelles. Le sujet de discussion était la portée et les limites de l'esprit humain. Puisque la philosophie à cette époque était pratiquement identique à la logique

Haut Moyen Âge
ke99, on peut dire que la dispute portait sur la relation entre philosophie et théologie.
L'un des principaux pécheurs (du point de vue des théologiens) était le moine Bérenger de Tours (vers 1000-1088), élève de Fulbert de Chartres. Berengariy semblait nier (sur la base de prémisses logiques) que le pain et le vin consommés en communion "sont transsubstantiés" (transsubstantiés) dans le corps et le sang du Christ. L'archevêque Lanfranc de Cantorbéry (mort en 1089) accusa Bérengère de manquer de respect à l'autorité et à la foi et d'essayer de comprendre « des choses qui ne peuvent être comprises » 100 . Il n'est pas facile de comprendre exactement ce que prétendait Bérenger ; cependant, dans son ouvrage Sur la Sainte Communion, v. Lanfranc, il a sans aucun doute exalté la dialectique, ou la logique, comme «l'art des arts» et a soutenu que «se tourner vers la dialectique
99 Nous nous éloignons ici de la question de savoir si la logique doit être considérée comme une partie de la philosophie, comme une propédeutique à la philosophie, ou comme une science indépendante et purement formelle. À l'époque, cela faisait partie de la philosophie.
100 "Sur le corps et le sang du Seigneur" (De sogrote et sanguine
Donmii), Migne, PL, 150, col. 427.

Haut Moyen Âge
ke signifie se tourner vers la raison »101, estimant que toute personne éclairée doit y être prête. Quant à l'application de la dialectique à l'Eucharistie, il croyait qu'il était inutile de parler d'accidents qui existent séparément de la substance. Dans la formule perfective "ceci est Mon Corps" (hoc est corpus teite) le pronom "ceci" doit faire référence au pain, qui reste donc du pain. Le sujet de l'énoncé est le pain, et bien que le pain devienne un signe sacré du corps du Christ par la consécration, il ne peut pas être identifié avec le corps réel du Christ, né de la Vierge Marie. La véritable conversion ou le changement a lieu dans l'âme de ceux qui communient.
Apparemment, Bérenger a étayé sa théorie à l'aide des travaux de Rathramnus de Corby (mort en 868), qu'il a attribués à Jean Scot Erigène. Cette doctrine, formulée par Beren-
101 De sacra coena adversus Lanfrancum, éd. A.P. et F.Th. Vischer (Berlin, 1834), p. 101. Il s'agit d'une édition d'un manuscrit découvert en 1770.
Haut Moyen Âge
gary, fut condamné par le Concile de Rome (1050). Il semble cependant que la condamnation n'ait pas fait une forte impression sur Bérengère, car en 1079 on lui demanda de signer un document par lequel il devait confirmer sa croyance en la transformation essentielle du pain et du vin en corps et sang du Christ. . D'autres exigences, à l'exception de l'obligation de réviser l'ancien enseignement dans ce sens, ne lui ont pas été présentées.
L'épisode avec Bérengère aide à expliquer l'hostilité de certains théologiens à la dialectique, et si vous vous rappelez de quelle époque nous parlons, alors à la philosophie. En même temps, ce serait une erreur de penser que toute la dialectique du XIe siècle. a commencé à rationaliser les dogmes chrétiens. Une raison plus courante de traiter la philosophie était "la conviction qu'elle n'a pas la même valeur que l'étude de l'Écriture et des Pères de l'Église, et qu'elle ne joue aucun rôle dans le salut de l'âme humaine". Ainsi, saint Pierre Damiani ( 1007-1072) n'a franchement pas reconnu la valeur particulière des arts libres, et bien qu'il n'ait pas dit, comme Manegold de Lautenbach (d. 1103), que la logique n'est pas nécessaire, mais

Haut Moyen Âge
se tenait sur le rôle purement subalterne de la dialectique, voyant en elle le "serviteur" de la théologie.
Bien sûr, ce point de vue n'a pas fait exception. Elle fut partagée, par exemple, par Gérard de Canada, natif de Venise, devenu évêque du Canada en Hongrie (mort en 1046). Et ce n'était pas si étrange en soi. Car, comme on l'a déjà noté, jusqu'à ce que la logique devienne une science indépendante, il était naturel de la considérer comme un instrument pour le développement des autres sciences. Cependant, St. Pierre Damiani est allé plus loin que d'affirmer le rôle subordonné ou auxiliaire de la dialectique par rapport à la théologie. Il a fait valoir qu'on ne peut tenir pour acquise l'applicabilité universelle des principes de raison dans le domaine de la théologie. Certains autres penseurs, comme Manegold de Lautenbach, croyaient que les affirmations de l'esprit humain étaient réfutées par des vérités telles que la naissance virginale et la résurrection du Christ. Mais dans ce cas, il s'agissait plutôt d'événements exceptionnels.
102 "De l'omnipotence divine" (De dmna omnipotentia), Migne, PL, 145, col. 63.

Haut Moyen Âge
yakh que sur l'incohérence des principes logiques. Peter Damiani est allé plus loin, arguant, par exemple, que Dieu dans sa toute-puissance peut changer le passé. Ainsi, bien qu'il soit effectivement vrai aujourd'hui que Jules César a franchi le Rubicon, Dieu pourrait en principe rendre cette affirmation fausse demain s'il veut défaire le passé. Si cette pensée s'écarte des exigences de l'esprit, tant pis pour l'esprit.
Le nombre de théologiens qui considéraient la philosophie comme un excès inutile était, bien sûr, limité. Lanfranc, qui, on le sait, critiquait Bérengère, a observé que le problème n'était pas la dialectique elle-même, mais son abus. Il a reconnu que les théologiens eux-mêmes utilisent la dialectique pour développer la théologie. Un exemple est les écrits de son élève
103 Bien sûr, cette thèse est différente de l'affirmation selon laquelle Dieu aurait pu empêcher Jules César de franchir le Rubicon. Cette thèse présuppose des événements historiques et affirme ensuite que Dieu pourrait en principe faire en sorte qu'ils ne soient plus des événements historiques.

Haut Moyen Âge
St. Anselme, dont il sera question dans le chapitre suivant. De manière générale, ce serait une erreur de succomber à l'hypnose des rationalisations de certains dialecticiens d'une part, et des déclarations exagérées de certains théologiens d'autre part, et de considérer la situation du XIe siècle. simplement comme une lutte entre la raison, représentée par les dialecticiens, et l'obscurantisme, représenté par les théologiens. Cependant, si nous adoptons une vision plus large et considérons des théologiens tels que, par exemple, St. Anselme, nous verrons que tant les théologiens que les dialecticiens ont joué leur rôle dans le développement de la vie intellectuelle du haut Moyen Âge. Par exemple, les vues de Berengaria, bien sûr, peuvent être considérées du point de vue de l'orthodoxie théologique. Cependant, nous pouvons
104 Il est bien sûr tentant de voir en Bérengère le précurseur spirituel des réformateurs protestants. Cependant, il ne pensait pas à réformer l'Église, ni à opposer l'autorité de l'Écriture à l'autorité de l'Église. Il essaya d'appliquer les exigences de la raison, telles qu'il les comprenait, à la compréhension de ce que ses adversaires considéraient comme un « mystère » au-delà de l'entendement humain.
Haut Moyen Âge
y voir un symptôme de l'éveil de la vie intellectuelle.
La déclaration ci-dessus qu'au XIe siècle. la philosophie était plus ou moins équivalente à la logique, nécessite quelques réserves. Elle néglige, par exemple, les éléments métaphysiques de la pensée d'un théologien comme Anselme. Et en nous tournant vers la dispute sur les universaux, nous verrons que l'aspect ontologique du problème occupait une place prépondérante dans les discussions médiévales sur ce sujet.
Considérez la phrase "John Bel". Le mot "Jean" est utilisé ici, comme on le dirait dans les dictionnaires, comme un nom propre. Il fait référence à un individu.
Il est cependant possible de formuler les conditions que tout mot doit remplir pour qu'on l'appelle par son nom propre, et que le mot « Jean » ne remplit pas.
Si l'on exigeait, par exemple, qu'un nom propre désigne en principe une et une seule chose individuelle, alors le mot "Jean" ne pourrait être classé comme

Haut Moyen Âge
nom propre. Après tout, le nom "John" est appelé par beaucoup de gens. Et même s'il n'y avait vraiment qu'une seule personne nommée John, il serait toujours possible d'appeler d'autres personnes par ce nom. En d'autres termes, si nous le voulions, nous pourrions priver les noms propres de leur droit d'exister. Cependant, dans les circonstances, le mot "John" est sans aucun doute un nom propre.
Il est utilisé pour nommer plutôt que pour décrire les personnes105. Cependant, le mot "blanc" dans la phrase "John white" n'est pas un nom, mais un terme générique qui a une signification descriptive. Dire que John est blanc, c'est dire qu'il a une certaine qualité. Mais la même qualité peut être attribuée à d'autres individus, disons Tom, Dick et Harry. Et puisque le sens du mot "blanc" dans chacun de ces cas est le même (ou peut être le même
105 Il me semble clair que des noms propres tels que "John" ne sont pas descriptifs, bien que ce point de vue ait été mis en doute.

Haut Moyen Âge
même), on peut se demander si tous - John, Tom, Dick et Harry - ne sont pas impliqués dans une certaine réalité appelée blancheur. Si oui, quel est le statut ontologique de cette réalité ? Cette question est peut-être le résultat d'une confusion logique. Cependant, formulée de cette façon, c'est une question ontologique.
L'une des sources de la dispute sur les universaux au début du Moyen Âge était le texte du deuxième commentaire de Boèce sur l' Isagoge de Porphyre . Boèce cite Porphyre, qui demande si les espèces et les genres (comme le chien et l'animal) existent vraiment ou ne sont réels que dans les concepts, et s'ils sont réellement des réalités existantes, s'ils existent séparément des choses matérielles ou seulement dans ces dernières. Comme le note Boèce, dans ce texte Porphyre ne répond pas
106 Voir par exemple : Migne, PL, 64, col. 82, ou : Sélections du médiéval. Philosophes, éd. R. McKeon (Londres, 1930), I, p. 91.

Haut Moyen Âge
vos questions. Boèce lui-même, cependant, discute ce problème et le résout dans un esprit aristotélicien, non pas parce que, comme il le dit, il reconnaît cette solution comme vraie, mais parce que l'Isagoge de Porphyre est une introduction aux "Catégories" d'Aristote. Les penseurs du haut Moyen Age, attirant l'attention sur ces questions, n'ont pas bien apprécié la discussion de Boèce à ce sujet. Ajoutons que la difficulté vient de la remarque de Boèce (dans son commentaire des Catégories d'Aristote) selon laquelle il s'agit d'un ouvrage sur les mots et non sur les choses. Car cet énoncé supposait une simple dichotomie. Les universels sont-ils des mots ou des choses ?
Déjà au IXe siècle. nous trouvons des signes d'ultra-réalisme, qui était une expression de l'hypothèse illégitime selon laquelle chaque nom doit correspondre à une entité réelle. Par exemple, Fredegisius de Tours (d. 834), un élève d'Alcuin, a écrit une "Lettre sur le néant et les ténèbres", où, en particulier, il a soutenu qu'il devrait y avoir
107 Voir Migne, PL, 64, col. 162.
Haut Moyen Âge
quelque chose correspondant au mot "rien". Il ne s'ensuit pas, cependant, que Fredegisius considérait le néant absolu comme une sorte particulière de quelque chose. Il voulait prouver que puisque Dieu a créé le monde « à partir de rien » et que tout nom doit désigner une réalité correspondante, Dieu devait créer le monde à partir d'une matière ou d'une substance indifférenciée préexistante, philosopher ainsi, c'est philosopher comme un grammairien. On peut dire la même chose de Remigius d'Auxerre (d. 908), qui a déclaré explicitement que puisque «l'homme» est le prédicat de toutes les personnes concrètes, elles doivent toutes avoir la même substance.
Lorsque l'on considère l'ultra-réalisme médiéval, il faut tenir compte de l'influence des facteurs théologiques. Par exemple, quand Odon de Tournai (m. 1113) a soutenu qu'il n'y a qu'une seule substance dans tous les gens et que l'émergence d'un nouvel individu signifie que cette seule et unique substance a commencé à exister dans une nouvelle modification, il n'était pas seulement dans la emprise de la théorie naïve "un nom - une chose".

Haut Moyen Âge
A cet égard, il ne s'est pas préoccupé d'exposer le spinozisme avant Spinoza, bien que sa thèse présuppose logiquement un développement en ce sens. Odon ne pouvait comprendre comment on pouvait s'en tenir au dogme du péché originel passant d'Adam à ses descendants, si l'on n'affirmait qu'une seule substance, souillée en Adam, se transmettait de génération en génération. Par conséquent, pour convaincre Odon de l'absurdité de sa position, il fallait compléter l'analyse logique par une explication théologique du péché originel, qui ne serait pas fondée sur l'ultra-réalisme qu'il défendait.
Si l'ultraréalisme remonte au IXe siècle, son contraire aussi. Oui, gay
109 La théorie théologique qui a supplanté le "traditionnisme" a été réduite au fait que le péché originel consiste en l'absence de grâce sanctifiante, c'est-à-dire qu'à chaque génération de personnes, Dieu crée de nouvelles âmes individuelles, qui, en raison du péché d'Adam, sont privées de la grâce sanctifiante dans leur état originel.
Comment les théologiens modernes comprennent le péché originel n'est pas clair pour moi.
Haut Moyen Âge
Rick d'Auxerre semblait dire que si nous voulons clarifier ce que l'on entend par "blancheur", "homme" ou "animal", nous devons citer des exemples individuels de choses blanches, de personnes ou d'animaux. En dehors de l'esprit, il n'y a pas de réalités générales correspondant aux noms de qualités, d'espèces et de genres. Il n'y a que des particuliers. L'esprit ne fait que "rassembler", par exemple, des personnes individuelles et, à des fins d'économie, forme une idée particulière d'une personne.
Revenant à une époque beaucoup plus tardive, disons que la position antiréaliste a été clairement articulée par Roscelinus, un chanoine de Compiègne, qui a enseigné dans diverses écoles
et mort vers 1120. Certes, il est très difficile d'établir exactement ce qu'il prétendait, puisque ses écrits, à l'exception des lettres à Abélard, ont disparu ou, en tout cas, ont été perdus. On est obligé de s'appuyer sur les témoignages d'autres écrivains, comme Anselme, Abélard
et Jean de Salisbury. C'est Anselme qui attribue à Roscelin l'affirmation (qui est toujours associée à son nom) que l'universel

Haut Moyen Âge
lii ne sont que des mots110. Puisqu'Anselme connaissait clairement mieux que nous les enseignements de Roscelin, nous ne pouvons guère douter de son témoignage. En même temps, on ne sait pas tout à fait ce que voulait dire Roscelinus lorsqu'il a dit que les universaux ne sont que des mots. Peut-être voulait-il que sa déclaration soit prise au pied de la lettre ; cependant, nous n'avons pas besoin de l'interpréter comme s'il niait les concepts universels et identifiait les universaux avec des mots considérés simplement comme des entités parlées ou écrites. Selon Abelard, Roscelinus a fait valoir que lorsque nous parlons de substance composée de parties, «partie» n'est qu'un mot. Cela pourrait signifier que dans le cas d'une chose particulière, comme une pomme non divisée, nous imaginons et nommons nous-mêmes ses parties. Puisque la pomme est indivise ex bypothesi, ces parties n'existent pas vraiment, comme elles le feraient si
110 Littéralement - flatulences était, fluctuation de la voix. Migne, P.L.
111 Ibid., 178, col. 358V.
Haut Moyen Âge
nous avons partagé une pomme. L'affirmation selon laquelle "partie" n'est qu'un mot ne signifie pas nécessairement que Roscelin identifie les parties présentées ou nommées d'une pomme non coupée avec le mot "partie". Il est possible qu'avec sa déclaration sur les universaux, il ait simplement voulu souligner qu'il n'y a pas d'entités générales en dehors et en dehors de l'esprit.
Quoi qu'il en soit, Roscelinus, en appliquant sa théorie au dogme de la Trinité, s'attira l'hostilité. Il soutenait, par exemple, que si la nature divine, ou essence, ou substance, est réellement la même dans les trois Personnes divines, alors nous devons dire que les trois Personnes se sont incarnées en Christ. Cependant, la théologie enseigne le contraire. N'admettrons-nous donc pas que la nature divine n'est pas la même dans les trois Personnes, et que les Personnes sont des êtres individuels séparés ? Roscelinus, qui a attiré l'attention sur cette difficulté, a été accusé de trithéisme et a rejeté cette accusation de lui-même. En tout cas, les attentats ne semblent pas avoir nui à sa carrière.
Haut Moyen Âge
À l'époque du début du Moyen Âge, l'ultraréalisme était considéré comme une «ancienne» doctrine, tandis que la doctrine opposée, basée sur le slogan de l'existence de seules choses individuelles, était appelée «nouvelle». Le point culminant de la dispute entre les deux parties fut la discussion bien connue entre Guillaume de Champeau et Abélard, à la suite de laquelle Guillaume, adepte de la "vieille" doctrine, fut mis sous un jour très stupide. Cependant, il vaut mieux laisser d'autres remarques sur leur dispute jusqu'à notre discussion sur Abélard.
On se souvient d'eux pour divers événements et changements. Ensuite, nous examinons plus en détail les caractéristiques du Moyen Âge.
informations générales
Le Moyen Âge est une période assez longue. Dans son cadre, l'origine et la formation ultérieure de la civilisation européenne ont eu lieu, sa transformation - la transition vers le Moyen Âge remonte à la chute de la Rome occidentale (476), cependant, selon les chercheurs modernes, il serait plus juste d'étendre la frontière jusqu'au début du 6 - la fin du 8 siècle, après l'invasion des Lombards en Italie. L'ère du Moyen Âge s'achève au milieu du XVIIe siècle. Il est traditionnellement considéré comme la fin de la période, mais il convient de noter que les derniers siècles étaient loin d'avoir un caractère médiéval. Les chercheurs ont tendance à séparer la période du milieu du XVIe au début du XVIIe siècle. Cette période "indépendante" représente l'ère du haut Moyen Âge. Néanmoins, ceci, que la périodisation précédente est très conditionnelle.
Caractéristiques du Moyen Âge
Pendant cette période, la formation a eu lieu.A cette époque, une série de découvertes scientifiques et géographiques commence, les premiers signes de la démocratie moderne - le parlementarisme apparaissent. Les chercheurs nationaux, refusant d'interpréter la période médiévale comme une ère "d'obscurantisme" et d'"âge sombre", cherchent à mettre en évidence les phénomènes et événements qui ont transformé l'Europe en une civilisation complètement nouvelle, le plus objectivement possible. Ils se fixent plusieurs tâches. L'un d'eux est la définition des caractéristiques sociales et économiques fondamentales de cette civilisation féodale. De plus, les chercheurs tentent de représenter au mieux le monde chrétien du Moyen Âge.
structure publique
C'était une époque où dominaient le mode de production féodal et l'élément agraire. Cela est particulièrement vrai pour la première période. La société était représentée sous des formes spécifiques :
- Domaine. Ici, le propriétaire, par le travail de personnes dépendantes, satisfait la plupart de ses propres besoins matériels.
- Monastère. Il différait du domaine en ce qu'il y avait périodiquement des personnes alphabétisées qui savaient écrire des livres et avaient du temps pour cela.
- Cour royale. Il se déplace d'un endroit à l'autre et organise la gestion et la vie à l'exemple d'un domaine ordinaire.

Structure de l'État
Il s'est formé en deux temps. La première se caractérisait par la coexistence d'institutions publiques modifiées romaines et allemandes, ainsi que de structures politiques sous forme de « royaumes barbares ». Au 2ème stade, l'état et représentent un système spécial. Au cours de la stratification sociale et du renforcement de l'influence de l'aristocratie terrienne, des relations de subordination et de domination s'établissent entre les propriétaires terriens - la population et les personnes âgées. L'ère du Moyen Âge se distinguait par la présence d'une structure de classe corporative, résultant du besoin de groupes sociaux séparés. Le rôle le plus important appartenait à l'institution de l'État. Il a assuré la protection de la population contre les hommes libres féodaux et les menaces extérieures. En même temps, l'État agissait comme l'un des principaux exploiteurs du peuple, puisqu'il représentait les intérêts, avant tout, des classes dirigeantes.
Deuxième période
Après la fin du haut Moyen Âge, on assiste à une accélération significative de l'évolution de la société. Cette activité était due au développement des relations monétaires et à l'échange de la production marchande. L'importance de la ville ne cesse de croître, restant d'abord dans la subordination politique et administrative à la seigneurie - le domaine, et idéologiquement - au monastère. Par la suite, la formation du système juridique politique dans le Nouveau Temps est liée à son développement. Ce processus sera perçu comme le résultat de la création de communes urbaines qui ont défendu les libertés dans la lutte contre le seigneur au pouvoir. C'est à cette époque que les premiers éléments d'une conscience juridique démocratique ont commencé à se dessiner. Cependant, les historiens estiment qu'il ne serait pas tout à fait correct de rechercher les origines des idées juridiques de la modernité exclusivement dans l'environnement urbain. Les représentants des autres classes étaient également d'une grande importance. Par exemple, la formation des idées sur la dignité personnelle a eu lieu dans la conscience féodale de classe et était à l'origine de nature aristocratique. De cela, nous pouvons conclure que les libertés démocratiques se sont développées à partir de l'amour de la liberté des classes supérieures.

Le rôle de l'église
La philosophie religieuse du Moyen Âge avait un sens global. L'Église et la foi ont complètement rempli la vie humaine - de la naissance à la mort. La religion prétendait contrôler la société, elle remplissait pas mal de fonctions, qui passaient plus tard à l'État. L'église de cette période était organisée selon des canons hiérarchiques stricts. À la tête se trouvait le pape - le grand prêtre romain. Il avait son propre état en Italie centrale. Dans tous les pays européens, les évêques et les archevêques étaient subordonnés au pape. Tous étaient les plus grands seigneurs féodaux et possédaient des principautés entières. C'était le sommet de la société féodale. Sous l'influence de la religion se trouvaient diverses sphères de l'activité humaine : science, éducation, culture du Moyen Âge. Un grand pouvoir était concentré entre les mains de l'église. Les aînés et les rois, qui avaient besoin de son aide et de son soutien, l'ont comblée de cadeaux, de privilèges, essayant d'acheter son aide et ses faveurs. Dans le même temps, le Moyen Âge a eu un effet calmant sur les gens. L'Église cherchait à apaiser les conflits sociaux, appelait à la miséricorde pour les défavorisés et les opprimés, à la distribution d'aumônes aux pauvres et à la suppression de l'anarchie.

L'influence de la religion sur le développement de la civilisation
L'église contrôlait la production de livres et l'éducation. En raison de l'influence du christianisme, au IXe siècle, une attitude et une compréhension fondamentalement nouvelles du mariage et de la famille se sont développées dans la société. Au début du Moyen Âge, les unions entre parents proches étaient assez courantes et les mariages nombreux étaient assez fréquents. C'est contre cela que l'église s'est battue. Le problème du mariage, qui était l'un des sacrements chrétiens, devint pratiquement le thème principal d'un grand nombre d'écrits théologiques. L'une des réalisations fondamentales de l'église au cours de cette période historique est considérée comme la formation d'une cellule conjugale - une forme normale de vie familiale qui existe à ce jour.

Développement économique
Selon de nombreux chercheurs, le progrès technologique était également associé à la large diffusion de la doctrine chrétienne. Le résultat a été un changement dans l'attitude des gens envers la nature. Il s'agit notamment du rejet des tabous et des interdits qui entravaient le développement de l'agriculture. La nature a cessé d'être une source de peurs et un objet de culte. La situation économique, les améliorations techniques et les inventions ont contribué à une augmentation significative du niveau de vie, qui s'est maintenu assez régulièrement pendant plusieurs siècles de la période féodale. Le Moyen Âge est ainsi devenu une étape nécessaire et très naturelle dans la formation de la civilisation chrétienne.

Formation d'une nouvelle perception
Dans la société, la personne humaine est devenue plus valorisée que dans l'Antiquité. Cela était principalement dû au fait que la civilisation médiévale, imprégnée de l'esprit du christianisme, ne cherchait pas à isoler une personne de son environnement en raison de la tendance à une perception holistique du monde. À cet égard, il serait faux de parler de la dictature de l'Église qui aurait empêché la formation de traits individuels sur une personne ayant vécu au Moyen Âge. Dans les territoires d'Europe occidentale, la religion, en règle générale, remplissait une tâche conservatrice et stabilisatrice, offrant des conditions favorables au développement de l'individu. Il est impossible d'imaginer la quête spirituelle d'un homme de cette époque en dehors de l'église. C'est la connaissance des conditions environnantes et de Dieu, inspirée par les idéaux de l'Église, qui a donné naissance à une culture médiévale diversifiée, colorée et vibrante. L'église a formé des écoles et des universités, a encouragé l'impression et diverses disputes théologiques.
Pour terminer
L'ensemble du système de la société du Moyen Âge est généralement appelé féodalisme (selon le terme «fief» - une récompense à un vassal). Et cela malgré le fait que ce terme ne donne pas une description exhaustive de la structure sociale de l'époque. Les principales caractéristiques de cette époque devraient inclure :

Le christianisme est devenu le facteur le plus important de la communauté culturelle de l'Europe. C'est au cours de la période sous revue qu'elle est devenue l'une des religions du monde. L'Église chrétienne était basée sur la civilisation ancienne, non seulement en niant les anciennes valeurs, mais aussi en les repensant. La religion, sa richesse et sa hiérarchie, la centralisation et la vision du monde, la moralité, la loi et l'éthique - tout cela formait une seule idéologie du féodalisme. C'est le christianisme qui a largement déterminé la différence entre la société médiévale de l'Europe et d'autres structures sociales sur d'autres continents à cette époque.
Résumé sur la discipline : « Histoire mondiale » sur le thème : « Début du Moyen Âge en Europe occidentale »
Introduction
Le terme « Moyen Âge » - « me im aeuim » - a été utilisé pour la première fois par les humanistes italiens au XVe siècle : c'est ainsi qu'ils désignaient la période entre l'Antiquité classique et leur époque. Dans l'historiographie russe, la limite inférieure du Moyen Âge est aussi traditionnellement considérée comme le Ve siècle. UN D - la chute de l'Empire romain d'Occident, et la partie supérieure - la fin du XVIe - le début du XVIIe siècle, lorsque la société capitaliste a commencé à se former de manière intensive en Europe occidentale.
La période du Moyen Âge est extrêmement importante pour la civilisation de l'Europe occidentale. Les processus et les événements de cette époque déterminent encore largement le développement politique, économique et culturel des pays d'Europe occidentale. Ainsi, c'est durant cette période que la communauté religieuse d'Europe s'est formée et qu'une nouvelle tendance du christianisme a émergé, qui était la plus propice à la formation de relations bourgeoises - le protestantisme ; une culture urbaine se dessine, qui a largement déterminé la culture moderne de masse de l'Europe occidentale ; les premiers parlements surgissent et le principe de la séparation des pouvoirs est mis en pratique, les bases de la science moderne et du système éducatif sont posées ; le terrain est en train d'être préparé pour la révolution industrielle et la transition vers une société industrielle.
caractéristiques générales
Au début du Moyen Âge, le territoire sur lequel se déroule la formation de la civilisation de l'Europe occidentale s'étend considérablement : si la civilisation antique s'est développée principalement sur le territoire de la Grèce et de la Rome antiques, alors la civilisation médiévale couvrira la quasi-totalité de l'Europe. L'installation de tribus germaniques dans les territoires de l'ouest et du nord du continent se poursuivait activement. La communauté culturelle, économique, religieuse et par la suite politique de l'Europe occidentale sera largement basée sur la communauté ethnique des peuples d'Europe occidentale.
Le processus de formation des États-nations a commencé. Ainsi, au IXe siècle. des États se sont formés en Angleterre, en Allemagne, en France. Cependant, leurs frontières changeaient constamment: les États ont soit fusionné en associations d'État plus grandes, soit se sont scindés en plus petites. Cette mobilité politique a contribué à la formation d'une civilisation paneuropéenne. Le processus d'intégration paneuropéenne était contradictoire : parallèlement au rapprochement dans le domaine ethnique et culturel, il y a un désir d'isolement national en termes de développement de l'État. Le système politique des premiers États féodaux est une monarchie.
Au début du Moyen Âge, les principales classes de la société féodale se sont formées: la noblesse, le clergé et le peuple - le soi-disant tiers état, il comprenait des paysans, des marchands et des artisans. Les successions ont des droits et des obligations différents, des rôles sociopolitiques et économiques différents. La société du début du Moyen Âge de l'Europe occidentale était agraire : la base de l'économie était l'agriculture et la grande majorité de la population travaillait dans ce domaine. Plus de 90% des Européens de l'Ouest vivaient en dehors de la ville. Si les villes étaient très importantes pour l'Europe antique - elles étaient des centres de vie indépendants et de premier plan, dont la nature était principalement municipale, et l'appartenance d'une personne à une ville donnée déterminait ses droits civils, alors dans l'Europe du début du Moyen Âge, les villes ne jouaient pas un grand rôle rôle.
Le travail dans l'agriculture était manuel, ce qui prédéterminait sa faible efficacité et la lenteur de la révolution technique et économique. Le rendement habituel était sam-3, bien que le trois champs ait remplacé le deux champs partout. Ils élevaient principalement du petit bétail - chèvres, moutons, porcs, et il y avait peu de chevaux et de vaches. Le niveau de spécialisation est faible, chaque domaine regroupe la quasi-totalité des branches vitales de l'économie : grandes cultures, élevage, artisanat divers. L'économie était naturelle et les produits agricoles n'étaient pas spécialement produits pour le marché. Le commerce intérieur s'est développé lentement et, en général, les relations marchandises-monnaie étaient peu développées. Ce type d'économie - l'agriculture de subsistance - a ainsi dicté le développement prédominant du commerce de longue distance plutôt que de proximité. Le commerce lointain (étranger) se concentrait exclusivement sur les couches supérieures de la population et les produits de luxe constituaient le principal article des importations d'Europe occidentale. De la soie, du brocart, du velours, des vins fins et des fruits exotiques, des épices diverses, des tapis, des armes, des pierres précieuses, des perles, de l'ivoire ont été apportés en Europe depuis l'Orient.
L'industrie existait sous forme d'industrie domestique et d'artisanat : les artisans travaillaient sur commande, le marché intérieur étant très limité.
Royaume des Francs. Empire de Charlemagne
Au Ve siècle UN D dans une partie importante de l'Europe occidentale, anciennement partie de l'Empire romain, vivaient les Francs - tribus germaniques guerrières, alors divisées en deux grandes branches - côtières et côtières.
L'un des chefs des Francs était le légendaire Merovei, qui a combattu avec Attila et est devenu l'ancêtre de la dynastie royale mérovingienne. Cependant, le représentant le plus éminent de cette famille n'était pas Merovei lui-même, mais le roi des Francs Saliques Clovis, connu comme un guerrier courageux qui a réussi à conquérir de vastes régions en Gaule, ainsi qu'un homme politique prudent et clairvoyant. En 496, Clovis accepta le rite du baptême, et avec lui trois mille de ses guerriers se convertirent à la foi chrétienne. La conversion au christianisme, ayant fourni à Clovis le soutien du clergé et d'une partie importante de la population galo-romaine, a grandement facilité ses conquêtes ultérieures. À la suite des nombreuses campagnes de Clovis, au tout début du VIe siècle, le royaume franc est créé, couvrant la quasi-totalité de l'ancienne Gaule romaine.
C'est sous le règne du roi Clovis, au début du VIe siècle, que remonte le début de l'enregistrement de la vérité salique, l'ancienne coutume judiciaire des Francs. Cet ancien livre de codes est la source historique fiable la plus précieuse sur la vie et les coutumes des Francs. La vérité salique était divisée en titres (chapitres), et chaque titre en paragraphes. Il énumère en détail les différents cas et sanctions pour violation des lois et règlements.
Les niveaux sociaux inférieurs étaient occupés par des paysans semi-libres et des affranchis - des esclaves libérés; au-dessous d'eux n'étaient que des esclaves, cependant peu nombreux. Le gros de la population était composé de paysans communaux, personnellement libres et jouissant de droits assez larges. Au-dessus d'eux se tenaient les serviteurs de la noblesse, qui étaient au service du roi - comtes, combattants. Cette élite dirigeante s'est formée au début du Moyen Âge à partir de la noblesse tribale, ainsi que de l'environnement des paysans riches et libres. En plus d'eux, les ministres de l'église chrétienne occupaient une position privilégiée, car Chlodkig était extrêmement intéressé par leur soutien au renforcement du pouvoir royal et donc de sa propre position.
Clovis, selon ses contemporains, est un homme rusé, résolu, vengeur et traître, capable de garder rancune pendant des années, puis de réprimer rapidement et cruellement ses ennemis. À la fin de son règne, il a obtenu le pouvoir complet, détruisant tous ses rivaux, dont nombre de ses proches parents.
Ses descendants, à la tête du royaume franc aux VIe-début VIIIe siècles, ont vu leur tâche dans la continuité de la lignée de Clovis. Essayant, afin de renforcer leurs propres positions, d'obtenir le soutien de la noblesse émergente et se renforçant rapidement, ils ont activement distribué des terres à leurs proches pour le service. Cela a conduit au renforcement de nombreuses familles aristocratiques, et parallèlement il y a eu un affaiblissement du pouvoir réel des Mérovingiens. Certaines régions de l'État ont ouvertement déclaré leur indépendance et leur refus de se soumettre davantage aux Mérovingiens. À cet égard, les Mérovingiens ont reçu le surnom de "rois paresseux", et des représentants de la riche, célèbre et puissante famille des Carolingiens se sont fait remarquer. Au début du VIIIe siècle La dynastie carolingienne a remplacé la dynastie mérovingienne sur le trône.
Le premier de la nouvelle dynastie fut Karl Martell (Hammer), connu pour ses brillantes victoires militaires sur les Arabes, notamment à la bataille de Poitiers (732). À la suite de campagnes agressives, il a élargi le territoire de l'État et les tribus des Saxons et des Bavarois lui ont rendu hommage. Il fut remplacé par son fils, Pépin le Bref, qui, après avoir emprisonné le dernier des Mérovingiens dans son monastère, se tourna vers le pape avec la question, est-il bon que des rois sans couronne règnent dans le royaume ? A quoi le Pape répondit qu'il valait mieux appeler le roi de celui qui a le pouvoir, plutôt que celui qui vit en roi, n'ayant pas de réel pouvoir royal, et bientôt couronné Pépin le Bref. Pépin sut être reconnaissant : il conquit la région de Ravenne en Italie et la livra au pape, ce qui fut le début du pouvoir séculier de la papauté.
Après la mort de Pépin le Bref en 768, la couronne passa à son fils Charles, appelé plus tard le Grand - il était si actif dans les affaires militaires et administratives et habile dans la diplomatie. Il organisa 50 campagnes militaires, à la suite desquelles il conquit et convertit au christianisme les Saxons qui vivaient du Rhin à l'Elbe, ainsi que les Lombards, les Avars, et créa un vaste État qui, en 800, fut déclaré empire par Pape Léon III.
La cour impériale devient le centre administratif de l'empire de Charlemagne. Deux fois par an, les grands propriétaires terriens étaient invités au palais royal pour discuter et résoudre ensemble les problèmes actuels les plus importants. L'empire était divisé en régions dirigées par des comtes (gouverneurs). Le comte percevait des fonctions royales, commandait la milice. Pour contrôler leurs activités, Karl envoyait de temps en temps des fonctionnaires spéciaux dans la région. Tel était le contenu de la réforme administrative.
Charlemagne a également procédé à une réforme judiciaire, au cours de laquelle les postes électifs de juges du peuple ont été abolis et les juges sont devenus des fonctionnaires de l'État qui recevaient des salaires de l'État et étaient subordonnés au comte - le chef de la région.
Une autre réforme majeure a été l'armée. En conséquence, ses paysans ont été complètement exemptés du service militaire, et depuis lors, les bénéficiaires royaux ont été la principale force militaire. L'armée du roi devient ainsi professionnelle.
Charlemagne est devenu célèbre en tant que mécène des arts et des sciences. L'épanouissement culturel du royaume sous son règne est qualifié de « Renaissance carolingienne ». À la cour du roi, une académie a été créée - un cercle de théologiens, d'historiens, de poètes qui, dans leurs écrits, ont ravivé les anciens canons latins. L'influence de l'Antiquité se manifeste tant dans les arts plastiques que dans l'architecture. Des écoles ont été créées dans le royaume, où l'on enseignait le latin, l'alphabétisation, la théologie et la littérature.
L'empire de Charlemagne se caractérise par l'extrême diversité de la composition ethnique de la population. De plus, ses différentes zones se sont développées différemment économiquement, politiquement, socialement et culturellement. Les plus développés étaient la Provence, l'Aquitaine, la Septimanie ; La Bavière, la Saxe et la Thuringe étaient loin derrière eux. Il n'y avait pas de liens économiques significatifs entre les régions, ce qui est devenu la principale raison de l'effondrement de l'empire peu après la mort de Charlemagne en 814.
Les petits-enfants de Charlemagne signèrent en 843 le traité de Verdun, selon lequel Lothaire reçut une bande de terre le long de la rive gauche du Rhin (future Lorraine) et de l'Italie du Nord, terres à l'est du Rhin (future Allemagne) - Louis le Allemand, débarque à l'ouest du Rhin (future France) - Charles le Chauve. Le traité de Verdun a marqué le début de la formation de la France en tant qu'État indépendant.
France en IX-XI siècles
La France de cette période était une série de possessions politiques indépendantes - comtés et duchés, dans les conditions d'une économie de subsistance, presque non interconnectées ni économiquement ni politiquement. Une hiérarchie complexe de querelles s'établit, des liens de vassalité se dessinent. Une nouvelle structure politique a été formée - la fragmentation féodale. Les seigneurs féodaux, maîtres à part entière de leurs biens, veillaient à leur expansion et à leur renforcement par tous les moyens, étaient hostiles les uns aux autres, se livrant des guerres intestines sans fin. Les fiefs les plus puissants étaient les duchés de Bretagne, de Normandie, de Bourgogne et d'Aquitaine, ainsi que les comtés de Toulouse, de Flandre, d'Anjou, de Champagne et de Poitou.
Si formellement les rois de la dynastie carolingienne étaient à la tête de la France, en réalité leur pouvoir était très faible. Le dernier des Carolingiens n'avait presque aucune influence. En 987, il y eut un changement de dynastie royale, et le comte Hugues Capet fut élu roi de France, donnant naissance à la dynastie royale des Capet.
Tout au long du siècle suivant, les Capétiens, cependant, tout comme leurs prédécesseurs immédiats - les derniers des Carolingiens - n'accédèrent pas au pouvoir. Leur pouvoir réel se limitait aux limites de leurs possessions ancestrales - le domaine royal, qui portait le nom d'Ile-de-France. Ses dimensions n'étaient pas très grandes, mais c'est ici que se trouvaient de grands centres comme Orléans et Paris, ce qui a contribué au renforcement du pouvoir des Capétiens. Pour atteindre cet objectif, les premiers Capétiens n'en dédaignaient pas beaucoup : l'un d'eux engagea pour de l'argent un riche baron normand, et vola aussi en quelque sorte les marchands italiens de passage dans ses possessions. Les Capétiens croyaient que tous les moyens étaient bons s'ils entraînaient une augmentation de leur richesse, de leur pouvoir et de leur influence. Tout comme d'autres seigneurs féodaux qui habitaient l'Ile-de-France et d'autres régions du royaume. Ceux-ci, ne voulant se soumettre à l'autorité de personne, multiplient les détachements armés et volent sur les grands chemins.
Formellement, les vassaux du roi sont tenus d'accomplir le service militaire, de lui verser une contribution monétaire lors de la conclusion d'un héritage et d'obéir également aux décisions du roi en tant qu'arbitre suprême dans les conflits interféodaux. En fait, l'accomplissement de toutes ces circonstances aux IXe - Xe siècles. dépend entièrement de la volonté de puissants seigneurs féodaux.
La place centrale dans l'économie durant cette période était occupée par le domaine féodal. La communauté paysanne était subordonnée au seigneur féodal, est devenue dépendante. La principale forme de rente féodale était la rente de travail. Le paysan, qui tenait sa propre maison sur les terres du seigneur féodal, devait élaborer la corvée. Les paysans payaient des cotisations en nature. Le seigneur féodal pouvait prélever annuellement sur chaque famille un impôt appelé talya. Une plus petite partie de la paysannerie était constituée de méchants - des paysans personnellement libres qui dépendaient de la terre du seigneur féodal. A la fin du Xe siècle, les seigneurs reçoivent des droits qui portent le nom de banalités, c'est-à-dire le monopole du seigneur féodal sur la mouture du grain, la cuisson du pain et le pressage du raisin. Le paysan était obligé de cuire le pain uniquement dans le four du maître, de moudre le grain uniquement dans le moulin du maître, etc. Et pour tout cela, le paysan devait payer un supplément.
Ainsi, à la fin du haut Moyen Âge, le morcellement féodal s'installe en France, et c'est un seul royaume de nom.
L'Allemagne en IX-XI siècles
Au IXe siècle, l'Allemagne comprenait les duchés de Saxe, de Thuringe, de Franconie, de Souabe et de Bavière, au début du Xe siècle la Lorraine leur fut annexée, au début du XIe siècle - le royaume de Bourgogne et de Frise. Toutes ces terres étaient très différentes les unes des autres par leur composition ethnique, leur langue et leur niveau de développement.
Cependant, en général, les relations féodales dans ce pays se sont développées beaucoup plus lentement qu'en France, par exemple. C'était une conséquence du fait que le territoire de l'Allemagne ne faisait pas partie de l'Empire romain et que l'influence de l'ordre romain, la culture romaine sur le développement de son système social était insignifiante. Le processus d'attachement des paysans à la terre a été lent, ce qui a marqué l'organisation de la classe dirigeante. Même au début du Xe siècle, la propriété féodale de la terre n'était pas pleinement formée ici, et le pouvoir judiciaire et militaire des seigneurs féodaux en était au premier stade de son développement. Ainsi, les seigneurs féodaux n'avaient pas le droit de juger personnellement les paysans libres et ne pouvaient pas traiter les affaires criminelles majeures, telles que le meurtre et l'incendie criminel. En Allemagne à cette époque, une hiérarchie féodale claire ne s'était pas encore développée, tout comme le système d'héritage des postes supérieurs, y compris les comtes, ne s'était pas encore développé.
Le pouvoir central en Allemagne était plutôt faible, mais quelque peu renforcé dans les moments où le roi menait l'agression militaire des seigneurs féodaux contre les pays voisins. Ce fut le cas, par exemple, au début du Xe siècle, sous le règne d'Henri Ier l'Oiseleur (919 - 936), premier représentant de la dynastie saxonne, qui régna de 919 à 1024. Les terres allemandes constituaient alors un royaume qui, à partir du début du Xe siècle, commença à être appelé teutonique d'après l'une des tribus germaniques - les Teutons.
Henri Ier a commencé à mener des guerres de conquête contre les Slaves polabiens et a forcé le prince tchèque Wenceslas I à reconnaître la dépendance vassale de l'Allemagne en 933. Il a vaincu les Hongrois.
Le successeur d'Henri l'Oiseleur Otto I (936 - 973) poursuivit cette politique. Les habitants des régions conquises devaient se convertir au christianisme et rendre hommage aux vainqueurs. L'Italie riche a particulièrement attiré Otto I et ses chevaliers - et au milieu du Xe siècle, ils ont réussi à capturer le nord et partiellement le centre de l'Italie (Lombardie et Toscane).
La capture des terres italiennes a permis à Otto I d'être couronné à Rome, où le pape lui a placé la couronne impériale. Le nouvel empire d'Otton Ier n'avait pas de centre politique et les nombreuses nationalités qui l'habitaient étaient à différents stades de développement socio-économique et socio-politique. Les plus développés étaient les terres italiennes. La domination des empereurs allemands ici était plus nominale que réelle, mais néanmoins les seigneurs féodaux allemands ont reçu des propriétés foncières importantes et de nouveaux revenus.
Otto I a également essayé d'obtenir le soutien des seigneurs féodaux de l'église - les évêques et les abbés, en leur donnant des droits d'immunité, qui sont entrés dans l'histoire comme la distribution des "privilèges ottoniens". Une telle politique a inévitablement conduit au renforcement des positions de nombreux seigneurs féodaux.
La puissance des seigneurs féodaux s'est pleinement manifestée sous Henri III (1039 - 1056), représentant de la nouvelle dynastie franconienne (salique), et surtout sous son successeur, Henri IV (1054 - 1106).
Le jeune roi Henri IV, soutenu par ses courtisans - les ministériels royaux, décide de faire de la Saxe un domaine royal - sa possession privée. Les seigneurs féodaux saxons qui y résidaient, mécontents de l'expansion du domaine royal (et celle-ci fut réalisée en confisquant leurs
terres), conspira contre Henri IV. Il en résulta le soulèvement saxon de 1073-1075, auquel participèrent également des paysans, à la fois personnellement libres et personnellement dépendants. Henri IV a pu réprimer ce soulèvement, mais le pouvoir royal en a été considérablement affaibli.
Le pape Grégoire VII en profita. Il a exigé qu'Henri IV mette fin à la pratique de la nomination non autorisée d'évêques à des chaires épiscopales, accompagnée de concessions de terres au fief, arguant que les évêques et les abbés de toute l'Europe occidentale, y compris l'Allemagne, ne peuvent être nommés que par le pape lui-même ou son envoyés - légats. Henri IV a refusé de satisfaire les demandes du pape, après quoi le synode, dirigé par le pape, a excommunié l'empereur de l'église. À son tour, Henri IV déclare le pape destitué.
Les seigneurs féodaux allemands ont été entraînés dans le conflit entre la papauté et l'empereur; la plupart d'entre eux s'opposent à l'empereur. Henri IV a été contraint de subir une procédure publique et humiliante de repentance devant le pape. Il arrive à la résidence de Grégoire VII sans armée en janvier 1077. Selon les chroniqueurs, pendant trois jours, debout devant tout le monde dans les vêtements d'un pécheur pénitent, pieds nus et la tête découverte, ne prenant pas de nourriture, il a supplié le pape de lui pardonner et de lever son excommunication de l'église. L'excommunication est levée, mais la lutte continue. L'équilibre des pouvoirs changeait rapidement en faveur du pape et l'empereur perdait son ancien droit illimité de nommer des évêques et des abbés à sa discrétion.
l'Angleterre en 7e-11e siècles
Aux premiers siècles de notre ère (jusqu'au IVe siècle), l'Angleterre, à l'exception de la partie nord, était une province de l'Empire romain, habitée principalement par les Bretons - tribus celtiques ; au Ve siècle, les tribus germaniques des Angles, des Saxons et des Jutes commencent à envahir son territoire depuis le nord du continent européen. Malgré une résistance acharnée - les Britanniques se sont battus pour leur terre pendant plus de 150 ans - la victoire était principalement du côté des envahisseurs. Seules les régions de l'ouest (Pays de Galles) et du nord (Écosse) de la Grande-Bretagne ont pu défendre leur indépendance. En conséquence, au début du VIIe siècle, plusieurs états se forment sur l'île : le Kent, fondé par les Jutes, le Wessex, le Sessex et l'Essex, fondés par les Saxons, et l'East Anglia, Northumbria Mercia, fondée par les Angles.
Ce sont les premières monarchies féodales dirigées par des rois, à la tête desquelles se groupe la noblesse terrienne. La formation des structures étatiques s'accompagne de la christianisation des Anglo-Saxons, qui débute en 597 et ne s'achève que dans la seconde moitié du VIIe siècle.
La nature de l'administration publique dans les royaumes anglo-saxons a considérablement changé au début du Moyen Âge. Si au début de cette période toutes sortes d'affaires économiques, les différends entre voisins, les litiges étaient résolus lors d'une assemblée générale de tous les résidents libres de la communauté sous la direction d'un chef élu, alors avec le développement des relations féodales, les dirigeants élus sont remplacés par des fonctionnaires royaux - représentants du gouvernement central; des prêtres et de riches paysans participent également à l'administration. Les assemblées populaires des Anglo-Saxons, à partir du IXe siècle, deviennent les assemblées des comtés. A la tête des comtés - grands districts administratifs - se trouvaient des dirigeants spéciaux - gerefs; à côté d'eux, les personnes les plus nobles et les plus puissantes du comté, qui possédaient de grands domaines, ainsi que des évêques et des abbés, participaient à l'administration.
De nouveaux changements dans l'organisation et la gestion de la société ont été associés à l'unification des premiers royaumes féodaux et à la formation en 829 d'un seul État anglo-saxon, qui s'appelait désormais l'Angleterre.
Au royaume-uni, sous le roi, un organe consultatif spécial a été formé - le Conseil des sages - Witenagemot. Ses membres participaient à la discussion de tous les problèmes de l'État, et toutes les questions importantes n'étaient désormais décidées par le roi qu'avec son consentement. Le Witenagemot limitait ainsi le pouvoir du roi. Les assemblées populaires ne se réunissaient plus.
La nécessité de l'unification et de la création d'un État unique était dictée par le fait que déjà à partir de la fin du VIIIe siècle, le territoire de l'Angleterre était soumis à des raids constants par des Scandinaves guerriers, qui ravageaient le vieillissement des insulaires et tentaient d'établir les leurs. Les Scandinaves (qui sont entrés dans l'histoire anglaise sous le nom de "Danois" parce qu'ils attaquaient principalement depuis le Danemark) ont pu conquérir le nord-est et y établir leurs propres règles : ce territoire, appelé Danlo, est connu comme la zone de \u200b\u200b "Loi danoise".
Le roi anglais Alfred le Grand, au pouvoir en 871 - 899, après une série d'échecs militaires, réussit à renforcer l'armée anglaise, érigea des fortifications frontalières et construisit une grande flotte. En 875 et 878 il a arrêté l'assaut des Normands et a conclu un accord avec eux, à la suite duquel tout le pays a été divisé en deux parties: les terres du nord-est sont allées aux conquérants et celles du sud-ouest sont restées aux Britanniques. Cependant, en réalité, il n'y avait pas de division stricte : les Scandinaves, ethniquement proches de la population de l'Angleterre, se mêlaient facilement aux locaux à la suite de mariages.
Alfred a réorganisé l'administration, introduisant une comptabilité et une répartition des ressources strictes, ouvert des écoles pour les enfants, sous lui le début de l'écriture en anglais a été posé - la compilation de la Chronique anglo-saxonne.
Une nouvelle étape des conquêtes danoises s'est produite au tournant des Xe et XIe siècles, lorsque les rois danois ont soumis l'ensemble du territoire de l'île. L'un des rois, Knut le Grand (1017 - 1035) fut même à la fois roi d'Angleterre, du Danemark et de Norvège, une partie de la Suède lui obéit également. Knut considérait l'Angleterre, et non le Danemark, comme le centre de son pouvoir, et adopta donc les coutumes anglaises et respecta les lois locales. Mais cette association étatique était fragile et s'est effondrée immédiatement après sa mort.
Depuis 1042, l'ancienne dynastie anglo-saxonne règne à nouveau sur le trône d'Angleterre, et Edouard le Confesseur (1042 - 1066) devient roi d'Angleterre. La période de son règne a été relativement calme pour l'Angleterre en termes de danger extérieur et instable en termes de politique intérieure. Cela était dû au fait qu'Edouard le Confesseur était lié à l'un des ducs normands, ce qui lui offrait une protection contre les raids dévastateurs des Scandinaves et même leur soutien. Cependant, son désir de s'appuyer sur les seigneurs féodaux normands irrite la noblesse anglo-saxonne locale. Un soulèvement s'organisa contre lui, auquel participèrent également les paysans. Le résultat fut le retrait effectif en 1053 d'Edouard le Confesseur du gouvernement. En 1066, il mourut.
Selon sa volonté, le trône d'Angleterre devait passer au duc de Normandie Guillaume, son parent. Cependant, Witenagemot, qui, décidant de la question de la succession, devait approuver la volonté du roi, s'y opposa. Il choisit comme roi non pas le Normand Guillaume, mais Harold, l'Anglo-Saxon. La prétention de William au trône d'Angleterre servit de prétexte à une nouvelle campagne scandinave en Angleterre. La conquête de l'Angleterre par les seigneurs féodaux normands dans la seconde moitié du XIe siècle sera un tournant dans son histoire médiévale.
Byzance
Aux V - VI siècles. L'Empire romain d'Orient - Byzance - était une puissance majeure, riche et forte, jouant un rôle important dans les affaires internationales, ce qui se reflète dans son nom - l'Empire byzantin.
Ses relations commerciales et diplomatiques avec l'Iran, l'Arabie, l'Éthiopie, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays étaient actives. Les routes commerciales les plus importantes entre l'Est et l'Ouest passaient par Byzance, mais Byzance ne se limitait pas à remplir uniquement les fonctions d'un pays de transit international. Déjà au début du Moyen Âge, la production marchande s'est développée ici à grande échelle. Les centres de l'artisanat textile étaient la Phénicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte. Les artisans fabriquaient de magnifiques tissus de soie, de laine et de lin, ces lieux étaient également réputés pour la fabrication de verrerie exquise et de bijoux insolites, de hautes techniques de travail du métal.
Byzance comptait de nombreuses villes prospères. Outre Constantinople - la capitale de Byzance - les principaux centres étaient Antioche en Syrie, Alexandrie en Égypte, Nicée en Asie Mineure, Corinthe et Thessalonique dans la partie européenne de l'Empire romain.
Les terres byzantines les plus riches ont également servi de bouchée savoureuse aux conquérants. Au milieu du 7ème siècle, le territoire de Byzance a été considérablement réduit: près de deux fois par rapport au 6ème siècle. Un certain nombre de provinces orientales - Syrie, Égypte, Palestine, Haute Mésopotamie ont été capturées par les Arabes, l'Espagne - par les Wisigoths, l'Arménie, la Bulgarie, la Croatie, la Serbie sont devenues indépendantes. Byzance n'a laissé que de petits territoires en Asie Mineure, une partie de la péninsule balkanique, quelques terres dans le sud de l'Italie (Ravenne) et la Sicile. La composition ethnique de l'empire a également changé de manière significative et les Slaves ont joué un rôle de plus en plus important dans l'ethnogenèse.
La perte de provinces riches, en particulier la Syrie, la Palestine et l'Égypte, a eu l'impact le plus négatif sur l'économie de Byzance, ce qui a entraîné une réduction significative des relations commerciales extérieures avec les peuples de l'Est. Le commerce avec les peuples d'Europe est venu au premier plan, en particulier avec les pays slaves - Bulgarie, terres serbes, Russie. Une bourse de marchandises active a également été établie entre Byzance et les pays de Transcaucasie - la Géorgie et l'Arménie.
En général, pendant toute la période du début du Moyen Âge, la position de politique étrangère de l'empire n'a jamais été stable. A la fin des VIIe - IXe siècles. Byzance a mené de lourdes guerres défensives, parmi ses adversaires les plus dangereux se trouvaient les Arabes.
Dans les années 70. Au 7ème siècle, lorsque les Arabes ont assiégé Constantinople, les Byzantins ont utilisé pour la première fois une nouvelle arme très efficace - le "feu grec" - une composition combustible d'huile, qui a la capacité de chauffer sur l'eau. Le secret de sa fabrication a été soigneusement gardé et son utilisation a apporté la victoire aux troupes byzantines pendant de nombreux siècles. Les Arabes furent alors repoussés de la capitale, mais purent conquérir toutes les possessions byzantines en Afrique. Au IXe siècle ils ont capturé l'île de Crète et une partie de la Sicile.
La Bulgarie, formée en tant qu'État à la fin du VIIe siècle, au IXe siècle. devient un dangereux rival de Byzance dans les Balkans. La situation a été aggravée par la confrontation constante entre Byzance et les Slaves, dont, cependant, Byzance est souvent sortie victorieuse. A la fin du Xe siècle. L'empereur byzantin Basile II le Bulgare-Slayer (963 - 1025) a pris le dessus dans une guerre prolongée de 40 ans et a conquis la Bulgarie pendant un certain temps. Cependant, après sa mort, à partir du deuxième quart du XIe siècle, la position de politique étrangère de Byzance est de nouveau ébranlée. Un nouvel ennemi redoutable est apparu à l'Est - les râpes seldjoukides. Les Russes ont intensifié leur pression. Le résultat inévitable des guerres était la ruine des terres, l'affaiblissement du commerce et de l'artisanat et la naturalisation de l'économie. Cependant, les villes et les villages progressivement ruinés ont été reconstruits et la vie économique s'est améliorée.
Aux IX - X siècles. Byzance connaît un boom économique. Il y avait de nombreux centres de production artisanale. L'artisanat s'est développé de manière particulièrement intensive en Grèce et en Asie Mineure. Ainsi, Corinthe et Thèbes étaient célèbres pour la production de tissus de soie, de produits en céramique et en verre. Dans les villes côtières d'Asie Mineure, la fabrication des armes atteint la perfection. La riche Constantinople était le centre de la production de produits de luxe.
La vie économique des artisans était réglementée et contrôlée par l'État. Il fixait les prix, réglementait le volume de la production, des fonctionnaires spéciaux du gouvernement surveillaient la qualité des produits.
En plus des artisans professionnels, certains métiers, comme le tissage, le cuir et la poterie, étaient également pratiqués par les paysans.
Les paysans constituaient la majorité de la population de l'empire. Aux V - IX siècles. c'étaient pour la plupart des gens libres. A partir du 8ème siècle leur position était déterminée par la «loi sur les propriétaires fonciers», un ensemble de décrets législatifs.
Les propriétaires fonciers libres étaient unis dans les communautés voisines, les terres de la communauté étaient la propriété privée des membres de la communauté. Cependant, les droits des paysans à leurs terres n'étaient pas complets. Ainsi, ils ne pouvaient que louer ou échanger leurs parcelles, mais pas les vendre, puisque la communauté paysanne devenait le propriétaire suprême de la terre sur eux.
Les paysans assumaient diverses fonctions d'État. Les devoirs de certains villages comprenaient l'approvisionnement en nourriture du palais impérial, d'autres étaient censés récolter du bois et du charbon. Tous les paysans payaient des frais de justice.
Peu à peu, une couche de paysans aisés se forme au sein de la communauté. Ils ont réussi à étendre leurs possessions au détriment des terres des pauvres. Les pauvres sans terre sont de plus en plus employés par des familles aisées comme domestiques et bergers. Leur position était très proche de celle des esclaves.
L'aggravation de la situation des paysans entraîne de nombreux troubles populaires, dont le plus massif est le mouvement en Asie Mineure en 932, dirigé par le guerrier Basile la Main de Cuivre (il perd son bras et une prothèse en cuivre lui est fabriquée). Les troupes de l'empereur romain Lecapen ont réussi à vaincre les rebelles et Basile la Main de cuivre a été brûlé sur l'une des places de la capitale.
Ainsi, l'État, en distribuant la terre aux seigneurs féodaux, a contribué à l'accroissement du pouvoir de la noblesse foncière. Les magnats de la terre, ayant reçu l'indépendance économique, ont commencé à lutter pour l'indépendance politique. Aux X - XI siècles. les empereurs de la dynastie macédonienne, régnant à Byzance de 867 à 1056, Roman Lécapin et Basile II (976 - 1025) adoptèrent une série de lois visant à limiter le pouvoir des grands seigneurs féodaux. Cependant, ces lois n'ont pas eu beaucoup de succès.
Byzance au début du Moyen Âge se caractérisait par la préservation d'un système centralisé d'administration de l'État. La particularité de la structure administrative-territoriale de l'empire était que le pays était divisé en districts militaires - thèmes. À la tête du thème se trouvait un stratège - le commandant de l'armée du thème. Stratig réunissait entre ses mains les militaires et le plus haut pouvoir civil.
Le système thématique a contribué au renforcement de l'armée et de la marine de l'empire et, en général, a augmenté la capacité de défense du pays. L'armée thématique était principalement composée de guerriers stratiotes - d'anciens paysans libres qui ont reçu des parcelles de terrain supplémentaires de l'État et ont dû faire leur service militaire pour cela.
Au début du 8ème siècle, lorsqu'en raison de la situation difficile de la politique étrangère de l'empire, le gouvernement a de nouveau été confronté à la tâche urgente d'augmenter le nombre de soldats, ses yeux se sont tournés vers les immenses propriétés foncières des églises et des monastères.
La lutte pour la terre s'est reflétée dans le soi-disant mouvement iconoclaste, qui a duré tout au long des VIIIe-IXe siècles. Son début remonte à 726, lorsque l'empereur Léon III publia un édit interdisant la vénération des icônes. L'iconoclasme de l'empereur visait la réforme du christianisme, en partie causée par les lourdes défaites subies par Byzance dans la lutte contre les "infidèles", les conquérants arabes. L'empereur a vu les raisons de la défaite dans le fait que les paysans, honorant les saintes icônes, se sont détournés de l'interdiction de Moïse d'adorer des images artificielles. Le parti des iconoclastes, dirigé par les empereurs eux-mêmes, était composé de représentants de la noblesse du service militaire, de guerriers stratiotes et d'une partie importante de la population paysanne et artisanale du pays.
Leurs adversaires formaient le parti des iconodules. Au fond, c'était le monachisme et le plus haut clergé du pays, soutenu par une partie du peuple, principalement dans les régions européennes de l'empire.
Le chef des adorateurs d'icônes, Jean de Damas, a enseigné que l'icône sacrée, qui est regardée pendant la prière, crée un lien mystérieux entre la personne qui prie et celle qui y est représentée.
La lutte entre iconoclastes et iconodules éclata avec une force particulière sous le règne de l'empereur Constantin V (741-755). Sous lui, la spéculation sur les terres des églises et des monastères a commencé, dans un certain nombre d'endroits, les monastères, masculins et féminins, ont été vendus avec des ustensiles, et les moines ont même été forcés de se marier. En 753, un concile convoqué à l'initiative de Constantin V condamna la vénération des icônes. Cependant, sous l'impératrice Théodora en 843, la vénération des icônes a été restaurée, mais la plupart des terres confisquées sont restées entre les mains de la noblesse militaire.
L'Église de Byzance était donc, dans une plus large mesure qu'en Occident, subordonnée à l'État. Le bien-être des prêtres dépendait de la disposition des empereurs. Ce n'est qu'à la fin du haut Moyen Âge que les dons volontaires à l'église se sont transformés en un impôt permanent et approuvé par l'État, imposé à l'ensemble de la population.
Conclusion
Le Moyen Âge d'Europe occidentale a toujours attiré l'attention des scientifiques, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule évaluation pour cette période. Ainsi, certains historiens la considèrent comme une époque de déclin, de régression par rapport à la période de l'Antiquité ; d'autres, au contraire, croient que le Moyen Age a été une nouvelle étape supérieure dans le développement de la société humaine. Cependant, tous les chercheurs s'accordent également à dire que le Moyen Âge, qui couvrait une période de plus de mille ans, était hétérogène quant aux principaux processus socio-économiques, socio-politiques et culturels qui s'y déroulaient alors. Conformément à leur spécificité, trois étapes se distinguent dans le Moyen Âge occidental européen. Le premier est le début du Moyen Âge (Ve - Xe siècles), lorsque les structures de base de la société féodale primitive se sont formées. La deuxième étape - le Moyen Âge classique (XI - XV siècles), l'époque du développement maximal des institutions féodales médiévales. La troisième étape - la fin du Moyen Âge (XVI - XVII siècles) - la période où la société capitaliste commence à prendre forme dans le cadre de la société féodale.
Besoin d'aide pour apprendre un sujet ?
Nos experts vous conseilleront ou vous fourniront des services de tutorat sur des sujets qui vous intéressent.
Soumettre une candidature indiquant le sujet dès maintenant pour connaître la possibilité d'obtenir une consultation.
Les penseurs de la Renaissance ont appelé le "Moyen Âge" dans le développement de la culture européenne le temps du déclin général, qui est tombé sur la période entre la brillante Antiquité et la talentueuse Renaissance. En fait, la culture du haut Moyen Âge (V-IX siècles) était un phénomène complexe et multiforme. Elle est devenue une nouvelle étape dans le développement de la conscience et de la vie spirituelle européennes.
La transition vers le Moyen Âge depuis l'Antiquité était due à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et à l'effondrement de la culture ancienne, et la formation d'une nouvelle culture a eu lieu dans le contexte d'un choc dramatique de deux cultures complètement différentes - l'ancienne (romaine ) et barbare (germanique). Un facteur non moins important que les deux précédents était l'influence croissante du christianisme, qui est devenu le principe intégrateur d'une culture unique et intégrale d'un nouveau niveau.
La culture au début du Moyen Âge est un mélange unique de différentes cultures, qui s'est produit à la suite d'une synthèse très controversée de l'héritage antique avec de jeunes idées barbares, qui s'est produite sous l'influence du christianisme. C'est elle qui est devenue la culture dominante de cette période, la base d'une nouvelle vision du monde, de l'attitude et de la vision du monde des gens.
La vie spirituelle est toujours basée sur la vie matérielle. Au début du Moyen Âge, la base sociale de la culture se composait des caractéristiques suivantes :
- aliénation du paysan de la terre;
- conditionnalité des droits des seigneurs féodaux à la propriété foncière (système vassal);
- hiérarchie féodale, excluant l'existence de la pleine propriété privée.
Dans ces conditions, deux pôles socioculturels se sont formés : les seigneurs féodaux et les paysans qui en dépendent. Cela a conduit à l'émergence d'une élite intellectuelle et spirituelle diamétralement différente de la "majorité silencieuse" du peuple analphabète. Les caractéristiques de la vie économique que le haut Moyen Âge avait eu un impact significatif sur la formation de la culture.
Cette période pour l'Europe est particulière. C'est à cette époque que furent résolues les tâches qui déterminèrent l'avenir de la civilisation européenne. Dans les temps anciens, "l'Europe" n'existait pas en tant que communauté culturelle et historique. Il a commencé à se former seulement à ce moment.
Le début du Moyen Âge n'a pas donné au monde de grandes réalisations, mais c'est cette période qui a jeté les bases de la culture de l'Europe proprement dite. Par conséquent, sa valeur peut être comparée aux hauteurs de la culture ancienne.
Les phénomènes les plus marquants de la vie culturelle des Ve-VIIe siècles sont liés à l'assimilation de l'héritage antique, particulièrement vivace en Italie et en Espagne. La théologie et la culture rhétorique se développent rapidement. Mais déjà à partir de la seconde moitié du VIIe siècle, la culture d'Europe occidentale était en déclin. Elle se blottit dans des monastères, gardés uniquement par des moines.
Le haut Moyen Âge est l'époque de la création des premières « Histoires » écrites des barbares. L'abolition de l'esclavage a contribué au développement plus rapide des inventions techniques. Déjà au 6ème siècle, l'utilisation de l'énergie de l'eau a commencé.
Il est presque impossible de recréer la vie culturelle des tribus barbares. Il est généralement admis qu'à l'époque de la Grande Migration, les Barbares avaient déjà commencé à prendre forme, ils ont apporté une nouvelle vision de la perception du monde, fondée sur le pouvoir primitif, les liens ancestraux, l'énergie militante, l'unité avec la nature et la inséparabilité des gens des dieux.
Le haut Moyen Âge a été le début de la croissance de la conscience de soi des peuples barbares. La philosophie de cette époque gravite vers l'universalisme. L'Esprit l'emporte sur la matière, Dieu - sur le monde.
La poésie orale se développe, notamment en Angleterre.
Un phénomène particulier de la culture agissait. Glory appréciait les troubadours - des poètes qui interprétaient leurs propres poèmes avec un accompagnement musical.
Le rythme de la société favorise la paysannerie, qui, bien qu'ignorée par la classe dirigeante, dominait dans un certain sens l'Église n'était pas hostile aux paysans, considérant la pauvreté comme un état idéal. Les écoles d'Europe étaient entre les mains de l'église, mais le niveau d'éducation était minime.
L'Europe surgit au Moyen Âge, dont le compte à rebours commence avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et la formation des royaumes dits « barbares » sur son territoire.
Il y a trois périodes du Moyen Âge :
1. Haut Moyen Âge (V-XI siècles) - la période de formation de la civilisation européenne en tant que synthèse des structures sociales antiques et barbares tardives.
2. Moyen Âge classique (XI-XV siècles) - la période où l'Europe devient le centre de la culture et se démarque de l'Orient en termes de niveau et de rythme de développement socio-économique et politique.
3. La fin du Moyen Âge (XVI-XVII siècles) - la période de la crise du féodalisme et de la formation de la société bourgeoise.
La période de la charité publique couvre deux périodes du Moyen Âge - ancienne et classique.
L'Occident médiéval est né sur des ruines Rome antique , qui connaît depuis le IIe siècle. crise politique intérieure aiguë, dont les caractéristiques sont :
1. Décomposition du système social esclavagiste.
2. Crise d'idéologie.
3. Refus de nouvelles campagnes militaires afin d'étendre le territoire de l'État et l'effondrement d'un seul empire en 395 dans les empires romains d'Occident (centré à Rome) et d'Orient (centré à Constantinople).
La conséquence de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et des invasions des barbares fut le début de ce que l'on appelle "l'âge des ténèbres" (V-VII siècles):
· Régression quantitative et qualitative générale tant en termes économiques que politiques ;
l'oubli des acquis du droit classique romain ; le déclin du système de gouvernement et de pouvoir ;
Perte des compétences de traitement de la pierre en tant que matériau de construction.
Aux VIII-IX siècles. le processus de formation de la civilisation de l'Europe occidentale commence avec la naissance d'un nouvel ordre féodal :
· Établissement de relations de vassalité entre la classe dirigeante des seigneurs féodaux. Formation d'une querelle foncière (seigneuries - pour les comtes; domaines - pour les chevaliers).
· Asservissement de la paysannerie.
· Croissance de l'influence et du rôle de l'église chrétienne. Dès la fin du IVe siècle l'église chrétienne renforce progressivement sa position, se transformant en un « État dans l'État ».
Les principales fonctions de l'église:
1) religieux ;
2) politique (négociations avec les barbares) ;
3) économique (distribution de nourriture et d'aumônes) ;
4) social (protection des faibles et défavorisés) ;
5) militaire (organisation de la résistance aux raids barbares) ;
6) culturel et éducatif (préservation de l'héritage romain, alphabétisation latine, droit romain, etc.).
C'est l'église qui devient le centre principal de la charité et de la charité dans la période des premiers et. médiéval classique. Un rôle important dans la vie de l'Église chrétienne a été joué par les ordres monastiques - des communautés de personnes qui se sont volontairement vouées au célibat. et le renoncement à toutes les bénédictions du monde. En tant qu'institution spéciale, le monachisme chrétien n'est apparu qu'au IVe siècle.
Moyen Âge classique (XI-XV siècles)
Un trait caractéristique de cette période était la soi-disant révolution agraire et la formation d'États européens nationaux.
La glorification de la pauvreté est devenue la base des monuments littéraires religieux du haut Moyen Âge.
Le programme de l'église à cet égard se réduisait en fait à la demande d'aumônes en faveur des pauvres. Ils n'ont même pas pensé aux moyens de mettre fin à la pauvreté - l'aumône était censée la perpétuer, car elle inclinait les pauvres à rester dans la position de dépendants, se nourrissant des miettes données aux riches.
Le mendiant a agi comme un moyen d '«auto-purification».
Organismes d'aide :
· un refuge pour personnes âgées, un hôpital, un hospice et des hospices pour les faibles et les infirmes.
· Les premiers hôpitaux monastiques se distinguaient par un niveau extrêmement bas de traitement et de prise en charge des malades : la formation médicale des moines était insuffisante, et le traitement « jeûne et prière » atteignait rarement son but. Pendant les périodes d'épidémies, les hôpitaux construits en l'absence de connaissances sanitaires et hygiéniques, avec des patients surpeuplés, se sont transformés en foyers de maladies contagieuses.
· Les sans-abri sont également devenus un objet de préoccupation pour l'Église catholique. Un refuge spécial a été ouvert, appelé la "Maison du Seigneur", où travaillaient à la fois des moines et des volontaires des habitants de la ville.
Ainsi, au haut Moyen Âge, l'église avait pour fonction sociale de maintenir la paix et l'équilibre dans la société, en retenant les pauvres dans les églises pour demander l'aumône en faveur des pauvres, le besoin d'expiation des péchés.
L'économie de l'Occident médiéval était destinée à fournir aux gens un moyen de subsistance, acquérant le caractère de simple reproduction. Elle n'est pas allée au-delà.
Le but économique de l'Occident médiéval était de créer le nécessaire, la subsistance, et l'obligation de faire l'aumône aux pauvres est également incluse dans la catégorie du nécessaire. De la même manière, les paysans travaillent dur dans les champs afin d'acquérir de la nourriture, des vêtements et d'autres choses nécessaires, ils doivent donner des dîmes et des aumônes.
Créé; société dont les éléments constitutifs assumaient des fonctions strictement définies :
L'aristocratie laïque était obligée de maintenir un train de vie décent, dépensant ses surplus en cadeaux et aumônes;
Le clergé consacrait une partie de ses richesses au luxe, à la construction et à la décoration des églises, à l'organisation de magnifiques liturgies, employant le reste à l'entretien des pauvres pauvres ;
La paysannerie était réduite à un niveau de vie minimum du fait de la collecte d'une partie de son produit par les seigneurs sous forme de rente féodale et l'église sous forme de dîmes, mais aussi obligée de faire l'aumône au profit des pauvres .
L'Occident médiéval est avant tout un univers de la faim, tourmenté par la peur de la faim et trop souvent par la faim elle-même.
Jusqu'au XIIIe siècle. tous les 3 à 5 ans, les mauvaises récoltes provoquaient régulièrement la famine.
Raisons de la faim :
1. La faiblesse de la technologie et de l'économie médiévales.
2. Manque ou perte de compétences et de capacités pour stocker les produits pendant une longue période.
3. L'impuissance du pouvoir étatique.
4. Beaucoup de barrières douanières - frais et droits sur les moyens de transport des marchandises.
5. Sous-développement des infrastructures de transport.
A partir du XIe siècle, de grands seigneurs séculiers et surtout ecclésiastiques, des souverains, ainsi que des cités créèrent des réserves et, en période de disette ou de famine, procédèrent à une distribution extraordinaire de ces réserves ou même tentèrent d'importer des vivres.
Le système ouvert de charité comprend des mesures telles que la distribution d'aumônes aux pauvres et l'alimentation des pauvres, le système fermé - des mesures pour empêcher la spéculation céréalière, pour améliorer la rotation des cultures.
L'une des préoccupations strictes de l'église dans les années de vaches maigres était l'obligation de nourrir les affamés, de les vêtir et de leur fournir un abri temporaire. Chaque grande abbaye avait des services d'aumône et d'hospitalité, ainsi que deux officiers spéciaux qui exerçaient ces obédiences.
Ne restez pas étranger aux affaires de la charité et des particuliers.
Le monde médiéval est un monde constamment au bord de la famine, de la malnutrition et de la mauvaise alimentation. Celle-ci est à l'origine d'épidémies causées par la consommation d'aliments inadaptés.
La mortalité infantile et juvénile n'a pas épargné même les familles royales.
Parmi les maladies les plus courantes se distinguaient: la tuberculose, la gangrène, la gale, les tumeurs, l'eczéma, l'érysipèle. Maladies causées par le béribéri, ainsi que des malformations et des maladies nerveuses.
La maladie de la fièvre a été remplacée par une épidémie non moins terrible d'une autre maladie - la lèpre (ou la lèpre), dont la cause en Europe est considérée comme une communication avec des foyers d'infection en Orient qui a commencé à la suite des croisades. La lèpre condamnait une personne à une mort lente et douloureuse par la mort progressive des organes, la personne condamnée mourait sur plusieurs années. La conséquence de la propagation de la lèpre a été l'émergence de salles d'isolement spéciales pour les malades - colonies de lépreux, organisées par l'Église catholique spécialement créées pour le soin des lépreux par l'Ordre de Saint-Pierre. Lazare (d'où les infirmeries). Au total en Europe occidentale au XIIIe siècle. il y avait au moins 19 000 colonies de lépreux pour les patients atteints de lèpre.
Enfin, la IIIe cathédrale du Latran de 1179, ayant permis la construction de chapelles et de cimetières sur le territoire des léproseries, prédéterminait ainsi leur transformation en mondes clos, d'où les malades ne pouvaient que sortir, après s'être préalablement dégagés au bruit des râles. , des cornes ou des cloches. Chef de l'Ordre de St. Lazare ne pouvait également être élu qu'en tant que malade de la lèpre. Il était également interdit aux lépreux de visiter les moulins, les boulangeries, les boulangeries, les puits et les sources (c'est-à-dire les lieux où la nourriture est fabriquée et vendue et les sources d'eau potable).
La société médiévale avait besoin de ces gens : on les réprimait parce qu'ils étaient dangereux, mais en même temps on ne les perdait pas de vue ; jusque dans les soins qu'on leur témoignait, on sentait un désir conscient de leur transférer mystiquement tout le mal dont la société essayait en vain de se débarrasser. Des léproseries ont été aménagées, bien qu'en dehors des murs de la ville, mais non loin de là.
Les parias de la société médiévale sont facilement devenus des victimes dans les années d'épidémies et de catastrophes nationales. Les lépreux étaient persécutés dans toute la France, soupçonnés d'empoisonner les puits et les sources.
Les misérables et les estropiés faisaient également partie des parias. La difformité était un signe extérieur de péché, et ceux qui étaient frappés de maux physiques étaient maudits par Dieu, et donc par les gens. L'église pouvait temporairement les recevoir dans ses hôpitaux et les nourrir les jours fériés, et le reste du temps les pauvres ne pouvaient que mendier et errer. Ce n'est pas un hasard si les mots "pauvre", "malade", "errant" étaient synonymes. Les hôpitaux eux-mêmes étaient le plus souvent situés près des ponts, sur des cols, c'est-à-dire aux endroits où ces vagabonds étaient sûrs de passer.
Au milieu du XIVe siècle. une maladie épidémique encore plus terrible est arrivée en Europe, mettant le monde occidental au bord de la vie ou de la mort - la peste.
Dans les conditions d'épidémies récurrentes, ce sont les monastères qui se transforment en centres de distribution d'aumônes. La distribution de l'aumône se faisait à certains jours, qui étaient bien connus dans le district, de sorte que les mendiants parcouraient des distances considérables d'une ville à l'autre. Ce n'est pas un hasard si à ce propos on a noté l'émergence de confréries professionnelles de mendiants.
Charité ecclésiastique :
1) distribution d'aumônes ;
2) une assistance constante aux nécessiteux par la création d'hôpitaux monastiques ;
3) les hôpitaux monastiques hébergeaient les pèlerins nécessiteux ;
4) les "banques pieuses" assistaient les pauvres contre le harcèlement des usuriers ;
5) les confréries religieuses soutenaient les pauvres infirmes ;
6) les autorités paroissiales ont essayé de soutenir les personnes dans le besoin.
Au XVème siècle. la pratique consistant à concentrer l'aide dans les monastères s'est généralisée dans la plupart des États européens.
En même temps, la charité joue ici aussi un rôle négatif : les aumônes abondantes ont un effet démoralisant et poussent à l'oisiveté. Ce n'est pas un hasard si à ce propos, on note les premières tentatives d'instaurer un contrôle laïc sur les activités des hôpitaux, tout en s'associant aux autorités spirituelles. A la fin du XIVe siècle. Une commission spéciale a été créée, qui comprenait à la fois des membres du clergé et des laïcs, dont le but était d'étudier la situation dans la ville, de procéder à un recensement des pauvres et des pauvres "malades" et de leur aménager des chambres dans les hôpitaux.
Dans le même temps, de fréquentes épidémies, qui ont entraîné une catastrophe démographique, ont entraîné un changement progressif d'attitude envers les pauvres. Déjà dans la seconde moitié du XIIIe siècle. des écrits apparaissent avec les premières attaques contre des mendiants sains.
Il y a des tentatives pour réglementer l'assistance aux personnes dans le besoin. Des recensements périodiques des mendiants locaux sont introduits, les mendiants non permanents («étrangers») étaient censés rester dans la ville pas plus de trois jours. Ils devaient payer les mêmes impôts que le reste des travailleurs.
Les épidémies de peste ont également marqué le début de la formation de la législation sanitaire et de l'assainissement urbain.
Les personnes expulsées de la société ont reconstitué le nombre de vagabonds, devenant soit des mendiants professionnels, soit des bandits.
Le monde médiéval était loin de ces sentiments de miséricorde et de compassion pour le prochain, qui étaient prêchés par l'Église chrétienne. L'idéalisation de la mendicité n'impliquait nullement la philanthropie, et l'attitude envers les malades en phase terminale confinait à des sentiments de peur et de dégoût. Le monde occidental lui-même était au seuil de la vie et de la mort, et le progrès de la civilisation européenne était largement dicté par le besoin de survie.
Bas Moyen Âge (XVI-XVII siècles)
La crise du féodalisme et la formation de la société bourgeoise. La formation du système étatique de la charité.
Aux XIVe-XVIe siècles. La civilisation européenne entre dans une nouvelle phase de développement dont les principales caractéristiques sont :
1) la destruction de l'isolement local des États et l'établissement de relations interétatiques ;
2) l'affaiblissement des diktats des traditions et l'augmentation de l'activité d'un individu ;
3) le triomphe du rationalisme et la sécularisation de la conscience.
Moyen Âge classique. Aux XIVe-XVe siècles. compte pour Renaissance :
humanisation et individualisation de la conscience publique;
approbation des relations de marché ;
Activité sociale élevée et brouillage des frontières de classe ;
Le désir de comprendre et d'améliorer les principes de l'appareil.
Dès le début du XVIe siècle. au sein de l'Église catholique, il y a eu une "réforme", qui a donné naissance au protestantisme.
Le protestantisme était basé sur les idées suivantes :
libération de la sphère de production de la pression religieuse ;
· la sanction spirituelle du profit en tant que but de l'activité économique humaine ;
l'inutilité des intermédiaires entre l'homme et Dieu ;
Reconnaissance de la foi, et non de la stricte observance des rites, comme moyen de salut de l'âme.
Le protestantisme a gagné en Angleterre, au Danemark, en Suède, en Hollande, en Suisse, poussant ces pays sur la voie du développement bourgeois, tandis que le catholicisme a pris pied en Espagne, en Italie, en Pologne, en République tchèque, ralentissant finalement le rythme du développement économique et politique de ces pays.
Les résultats les plus importants du développement des pays d'Europe occidentale ont été:
1. Création de monarchies absolues.
2. Le processus d'accumulation initiale de capital et de modernisation.
3. La formation d'un nouveau type de personne avec de nouveaux critères de valeurs :
A la fin du Moyen Age, le système de charité ecclésiastique et monastique devient de moins en moins réglementé, des foules de mendiants professionnels apparaissent. La situation a été aggravée par des épidémies de peste bubonique, qui ont aggravé les problèmes sociaux. L'église ne pouvait plus s'engager de manière indépendante dans des œuvres caritatives. Il était nécessaire de créer un nouveau système de charité, légalement réglementé par l'État.
Bas Moyen Âge (XVI-XVII siècles)La crise de la charité communautaire en Europe et la "chasse aux sorcières". XVI-XVII siècles est devenue la période de la "chasse aux sorcières".
La base idéologique de la chasse aux sorcières était les attitudes qui prévalaient à l'époque du Moyen Âge ancien et classique, à propos de la lutte entre Dieu et le diable, les saints et les sorciers.
De nombreuses poursuites contre les sorcières ont commencé sous la pression de la population locale, qui a exigé des représailles contre les "coupables" des catastrophes qui l'ont frappée : perte de bétail, mauvaises récoltes, gelées soudaines, mort d'un enfant.
Les sources qui ont lancé la "chasse aux sorcières" sont les suivantes :
1) Incertitude de la paysannerie dans l'avenir.
2) Peur de la mort et des tourments de l'au-delà.
3) Transformation de l'image de Satan et de ses sbires.
4) Réforme de la justice et du droit pénal.
Bas Moyen Âge XVI-XVII siècles. La position des exclus de la société (malades vénériens, fous et mendiants).
La période du Moyen Âge classique a vu l'ampleur des épidémies de lèpre, qui ont frappé aux XIIe-XIVe siècles. au moins 300 à 400 000 personnes. Cependant, depuis le XVe siècle les colonies de lépreux tombent en ruine ; au 16ème siècle
Au début du XVIe siècle. les colonies de lépreux sont devenues les propriétaires les plus riches. Le pouvoir royal en France tout au long du XVIe siècle. ont essayé de prendre le contrôle de ces immenses richesses, qui étaient les propriétés foncières et immobilières des colonies de lépreux, et de les redistribuer :
· "tous les fonds reçus de cette recherche, pour l'entretien des nobles tombés dans le besoin et des soldats estropiés" ;
acheter de la nourriture pour les pauvres.
Le problème des léproseries ne sera réglé en France qu'à la fin du XVIIe siècle. En 1672, Ludwig XIV a donné l'Ordre de St. Lazare et les Carmélites sont la propriété de tous les ordres spirituels et chevaleresques et leur confient la gestion de toutes les colonies de lépreux du royaume.
Les biens des colonies de lépreux ont été repris par d'autres hôpitaux et institutions caritatives. A Paris, la propriété est transférée à l'Hôpital Général ; à Toulouse - un hôpital pour malades en phase terminale.
Les colonies de lépreux étaient également vides en Angleterre. Les fonds appartenant à ces institutions étaient transférés aux besoins des pauvres.
Le recul de la lèpre, seulement plus lent, s'observe aussi en Allemagne ; les fonctions des colonies de lépreux ont changé exactement de la même manière.
La disparition de la lèpre n'était pas le mérite de la médecine d'alors, elle s'est produite pour deux raisons principales:
en raison de l'isolement des patients ;
en raison de la fin des contacts avec les foyers orientaux d'infection après la fin des croisades.
Le rôle du lépreux sera assumé par les pauvres, les vagabonds, les vénériens, les criminels et les « blessés d'esprit ».
La lèpre a passé le relais aux maladies vénériennes, dont l'apparition est devenue l'une des conséquences négatives de l'âge des découvertes.
Venerikov est isolé de la société, mais en même temps, ils essaient de se soigner.
Les principaux distributeurs de maladies vénériennes étaient les prostituées et les hommes qui recouraient à leurs services.
Les attitudes envers la prostitution étaient souvent ambivalentes :
· l'église chrétienne, stigmatisant les prostituées, les accepte comme un mal nécessaire : « Détruisez les prostituées et la société se vautrera dans la débauche » ;
· de temps en temps, des mesures sont prises pour lutter contre la prostitution : "...expulser les prostituées de Paris, détruire tous les points chauds de la capitale..."
Le danger de la propagation des maladies vénériennes conduit au 16ème siècle. renforcer les mesures de lutte contre la prostitution de rue par l'organisation de bordels (bordels). Ces derniers étaient généralement situés à proximité ou de l'autre côté des portes de la ville (hors des limites de la ville).
Au début du XVIIe siècle, le problème des maladies vénériennes est passé au second plan, tant en raison de l'isolement des malades qu'en raison des méthodes utilisées pour leur traitement et leur prévention. Le problème principal devient bientôt un phénomène encore plus complexe - la folie.
D'une part, les fous étaient chassés des villes : les villes, à la première occasion, chassaient les fous de leurs murs ; et ils ont erré dans des villages reculés
Déjà au XIIIe siècle. les premières tentatives ont été faites pour distinguer différentes catégories de fous: "violents" ou "violents", qui avaient besoin de soins, ou plutôt d'emprisonnement dans des hôpitaux spéciaux; les « mélancoliques », dont les maux étaient aussi d'origine physique, qui avaient besoin d'un prêtre plutôt que d'un médecin ; « possédé », que seul un « exorciste » (spécialiste de l'exorcisme) pourrait libérer de la maladie. Au début du XIVe siècle. en droit anglais, le principe a été établi que "le faible d'esprit ou l'aliéné n'est pas responsable du crime".
Les aliénés étaient placés dans des hôpitaux spécialement conçus à cet effet. Dans certaines cités médiévales, on a même constaté l'existence de prélèvements spéciaux pour les besoins des aliénés ou de dons en leur faveur.
Pour "guérir" les aliénés, on utilisait les mêmes "grandes médecines" bien connues : saignées, lavages gastriques et émétiques. Des hôpitaux pour aliénés violents sont apparus dans d'autres villes d'Europe.
Aux XVIe et XVIIe siècles subit des changements majeurs et des attitudes vis-à-vis de la mendicité. Au XVème siècle. la pratique de vendre des indulgences - documents de rémission des péchés.
Dans de telles conditions, le mendiant acquit un nouveau visage en Europe, inconnu au Moyen Âge ancien et classique. La Renaissance l'a privé de l'auréole mystique de la justice : la Pauvreté a perdu son sens absolu, et la Miséricorde a perdu la valeur que lui donnait l'aide de la Pauvreté.
Le vagabondage et la mendicité violaient la répartition des rôles sociaux, créant des zones libres de tout contrôle policier, suscitant le mécontentement des citadins et menaçant l'ordre public.
Dans un édit papal de 1561, il était interdit de mendier dans les rues sous peine de châtiment, d'expulsion ou d'envoi aux galères. La politique de répression s'accompagne d'efforts de réorganisation de l'aide sociale destinée à soutenir les malades et les infirmes. Tous les mendiants, les vagabonds et les personnes sans occupation déterminée étaient regroupés en un même lieu et répartis en catégories : les malades étaient envoyés dans les hôpitaux, ceux qui étaient reconnus valides recevaient du travail. Il y avait une volonté d'isoler les pauvres de la société en créant une sorte de zones de pauvreté (comme des ghettos dans les zones de résidence isolée des Juifs).
La politique d'isolement des pauvres permit la création, sous l'égide de la Confrérie du Saint-Esprit, d'un hôpital spécial, qui joua à la fois le rôle de refuge et d'hospice pour les mendiants bien portants.
Sous Innocent XII (1691-1700), il était interdit à la fois de demander l'aumône et d'en donner. Un recensement a été effectué et une liste des pauvres a été dressée, les mendiants ont été escortés sous escorte armée jusqu'à un orphelinat. Elles y recevaient du travail selon leur état de santé : tissage, couture de chaussures et de vêtements, ou habillage du cuir. Sous les successeurs d'Innocent, des refuges similaires ont été créés pour les orphelins et les personnes âgées. Cependant, la mise en œuvre des projets a été constamment confrontée à un manque de fonds et à des difficultés administratives.