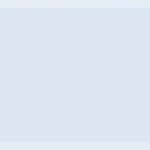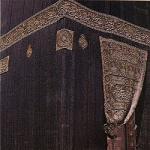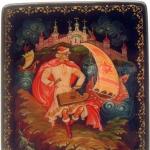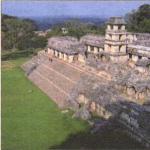L'univers à travers les yeux de la science et de la philosophie. Evolution des idées : L'Univers vu par l'Homme
La grandeur et la diversité du monde environnant peuvent surprendre toute imagination. Tous les objets et objets entourant les humains, d'autres personnes, divers types de plantes et d'animaux, les particules visibles uniquement au microscope, ainsi que les amas d'étoiles incompréhensibles : ils sont tous unis par le concept de « l'Univers ».
Les théories sur l'origine de l'Univers sont développées par l'homme depuis longtemps. Malgré l'absence d'un concept de base de religion ou de science, dans l'esprit curieux des peuples anciens, des questions surgissaient sur les principes de l'ordre mondial et sur la position de l'homme dans l'espace qui l'entoure. Il est difficile de compter combien de théories existent aujourd'hui sur l'origine de l'Univers : certaines d'entre elles sont étudiées par d'éminents scientifiques de renommée mondiale, d'autres sont carrément fantastiques.
La cosmologie et son sujet
La cosmologie moderne - la science de la structure et du développement de l'Univers - considère la question de son origine comme l'un des mystères les plus intéressants et encore insuffisamment étudiés. La nature des processus qui ont contribué à l'émergence des étoiles, des galaxies, des systèmes solaires et des planètes, leur développement, la source de l'apparition de l'Univers, ainsi que sa taille et ses limites : tout cela n'est qu'une courte liste des questions étudiées par les scientifiques modernes.

La recherche de réponses à l'énigme fondamentale de la formation du monde a conduit à l'existence aujourd'hui de diverses théories sur l'origine, l'existence et le développement de l'Univers. L'enthousiasme des spécialistes cherchant des réponses, construisant et testant des hypothèses est justifié, car une théorie fiable de la naissance de l'Univers révélera à toute l'humanité la probabilité de l'existence de la vie dans d'autres systèmes et planètes.
Les théories sur l'origine de l'Univers ont la nature de concepts scientifiques, d'hypothèses individuelles, d'enseignements religieux, d'idées philosophiques et de mythes. Ils sont tous conditionnellement divisés en deux catégories principales :
- Théories selon lesquelles l'Univers a été créé par un créateur. En d’autres termes, leur essence est que le processus de création de l’Univers était une action consciente et spirituelle, une manifestation de la volonté.
- Théories de l'origine de l'Univers, construites sur la base de facteurs scientifiques. Leurs postulats rejettent catégoriquement à la fois l'existence d'un créateur et la possibilité d'une création consciente du monde. De telles hypothèses reposent souvent sur ce que l’on appelle le principe de médiocrité. Ils suggèrent la possibilité de la vie non seulement sur notre planète, mais aussi sur d’autres.
Créationnisme - la théorie de la création du monde par le Créateur
Comme son nom l'indique, le créationnisme (création) est une théorie religieuse de l'origine de l'univers. Cette vision du monde est basée sur le concept de la création de l'univers, de la planète et de l'homme par Dieu ou le Créateur.
L'idée a longtemps dominé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, lorsque le processus d'accumulation de connaissances dans divers domaines scientifiques (biologie, astronomie, physique) s'est accéléré et que la théorie de l'évolution s'est généralisée. Le créationnisme est devenu une réaction particulière de chrétiens qui ont des opinions conservatrices sur les découvertes en cours. L’idée dominante à cette époque ne faisait que renforcer les contradictions qui existaient entre les théories religieuses et les autres.
Quelle est la différence entre les théories scientifiques et religieuses ?
Les principales différences entre les théories des différentes catégories résident principalement dans les termes utilisés par leurs adeptes. Ainsi, dans les hypothèses scientifiques, au lieu d’un créateur, il y a la nature, et au lieu de la création, il y a l’origine. Parallèlement à cela, certaines questions sont abordées de manière similaire par différentes théories, voire complètement dupliquées.
Les théories sur l’origine de l’Univers, appartenant à des catégories opposées, datent différemment son apparition. Par exemple, selon l’hypothèse la plus courante (la théorie du big bang), l’Univers s’est formé il y a environ 13 milliards d’années.
En revanche, la théorie religieuse de l’origine de l’Univers donne des chiffres complètement différents :
- Selon des sources chrétiennes, l'âge de l'Univers créé par Dieu au moment de la naissance de Jésus-Christ était de 3 483 à 6 984 ans.
- L’hindouisme suggère que notre monde a environ 155 000 milliards d’années.
Kant et son modèle cosmologique
Jusqu’au XXe siècle, la plupart des scientifiques pensaient que l’Univers était infini. Ils ont caractérisé le temps et l'espace avec cette qualité. De plus, selon eux, l’Univers était statique et homogène.
L'idée de l'infinité de l'Univers dans l'espace a été avancée par Isaac Newton. Cette hypothèse a été développée par quelqu’un qui a développé une théorie sur l’absence de limites temporelles. Poussant plus loin ses hypothèses théoriques, Kant étend l’infinité de l’Univers au nombre de produits biologiques possibles. Ce postulat signifiait que dans les conditions d'un monde ancien et vaste sans fin ni début, il pouvait y avoir un nombre incalculable d'options possibles, à la suite desquelles l'apparition de n'importe quelle espèce biologique pourrait effectivement se produire.

Basée sur l'émergence possible de formes de vie, la théorie de Darwin a ensuite été développée. Les observations du ciel étoilé et les résultats des calculs des astronomes ont confirmé le modèle cosmologique de Kant.
Les réflexions d'Einstein
Au début du XXe siècle, Albert Einstein publie son propre modèle de l'Univers. Selon sa théorie de la relativité, deux processus opposés se produisent simultanément dans l’Univers : l’expansion et la contraction. Cependant, il était d'accord avec l'opinion de la plupart des scientifiques sur la nature stationnaire de l'Univers, c'est pourquoi il a introduit le concept de force répulsive cosmique. Son effet est conçu pour équilibrer l'attraction des étoiles et arrêter le processus de mouvement de tous les corps célestes afin de maintenir la nature statique de l'Univers.
Le modèle de l'Univers - selon Einstein - a une certaine taille, mais il n'y a pas de frontières. Cette combinaison n’est réalisable que lorsque l’espace est courbé de la même manière que dans une sphère.

Les caractéristiques de l’espace d’un tel modèle sont :
- Tridimensionnalité.
- Se fermer.
- Homogénéité (absence de centre et de bord), dans laquelle les galaxies sont uniformément réparties.
A. A. Friedman : L’Univers est en expansion
Le créateur du modèle révolutionnaire en expansion de l'Univers, A. A. Friedman (URSS), a construit sa théorie sur la base d'équations caractérisant la théorie de la relativité générale. Certes, l'opinion généralement acceptée dans le monde scientifique de l'époque était que notre monde était statique et que son travail n'était donc pas dûment pris en compte.
Quelques années plus tard, l'astronome Edwin Hubble fit une découverte qui confirma les idées de Friedman. La distance des galaxies à la Voie Lactée voisine a été découverte. Dans le même temps, le fait que la vitesse de leur déplacement reste proportionnelle à la distance qui les sépare de notre galaxie est devenu incontestable.
Cette découverte explique la « diffusion » constante des étoiles et des galaxies les unes par rapport aux autres, ce qui conduit à la conclusion sur l'expansion de l'univers.
En fin de compte, les conclusions de Friedman ont été reconnues par Einstein, qui a ensuite mentionné les mérites du scientifique soviétique en tant que fondateur de l'hypothèse de l'expansion de l'Univers.
On ne peut pas dire qu'il existe des contradictions entre cette théorie et la théorie de la relativité générale, mais lors de l'expansion de l'Univers, il a dû y avoir une impulsion initiale qui a provoqué le retrait des étoiles. Par analogie avec une explosion, l’idée a été appelée le « Big Bang ».
Stephen Hawking et le principe anthropique
Le résultat des calculs et des découvertes de Stephen Hawking fut la théorie anthropocentrique de l'origine de l'Univers. Son créateur affirme que l’existence d’une planète si bien préparée à la vie humaine ne peut être fortuite.
La théorie de Stephen Hawking sur l'origine de l'Univers prévoit également l'évaporation progressive des trous noirs, leur perte d'énergie et l'émission de rayonnement Hawking.
À la suite de la recherche de preuves, plus de 40 caractéristiques ont été identifiées et testées, dont le respect est nécessaire au développement de la civilisation. L'astrophysicien américain Hugh Ross a évalué la probabilité d'une telle coïncidence involontaire. Le résultat fut le numéro 10 -53.
Notre Univers contient un billion de galaxies, chacune comptant 100 milliards d’étoiles. Selon les calculs effectués par les scientifiques, le nombre total de planètes devrait être de 10 à 20. Ce chiffre est inférieur de 33 ordres de grandeur à celui calculé précédemment. Par conséquent, aucune planète parmi toutes les galaxies ne peut réunir les conditions propices à l’émergence spontanée de la vie.
La théorie du Big Bang : l'origine de l'univers à partir d'une minuscule particule
Les scientifiques qui soutiennent la théorie du Big Bang partagent l’hypothèse selon laquelle l’univers est la conséquence d’une grande explosion. Le postulat principal de la théorie est l’affirmation selon laquelle avant cet événement, tous les éléments de l’Univers actuel étaient contenus dans une particule aux dimensions microscopiques. À l'intérieur, les éléments étaient caractérisés par un état singulier dans lequel des indicateurs tels que la température, la densité et la pression ne pouvaient pas être mesurés. Ils sont infinis. La matière et l’énergie dans cet état ne sont pas affectées par les lois de la physique.

Ce qui s'est produit il y a 15 milliards d'années s'appelle une instabilité apparue à l'intérieur de la particule. Les minuscules éléments dispersés ont jeté les bases du monde que nous connaissons aujourd’hui.
Au début, l’Univers était une nébuleuse formée de minuscules particules (plus petites qu’un atome). Puis, en se combinant, ils ont formé des atomes qui ont servi de base aux galaxies stellaires. Répondre aux questions sur ce qui s'est passé avant l'explosion, ainsi que sur ce qui l'a provoquée, sont les tâches les plus importantes de cette théorie de l'origine de l'Univers.
Le tableau représente schématiquement les étapes de formation de l'univers après le big bang.
| État de l'univers | Axe du temps | Température estimée |
| Expansion (inflation) | De 10 -45 à 10 -37 secondes | Plus de 10 26 K |
| Des quarks et des électrons apparaissent | 10 -6 s | Plus de 10 13 K |
| Des protons et des neutrons sont produits | 10 -5 s | 10 12 K |
| Des noyaux d'hélium, de deutérium et de lithium apparaissent | De 10 -4 s à 3 min | De 10h11 à 10h9K |
| Atomes formés | 400 mille ans | 4000K |
| Le nuage de gaz continue de s'étendre | 15 Ma | 300K |
| Les premières étoiles et galaxies sont nées | 1 milliard d'années | 20 000 |
| Les explosions d'étoiles déclenchent la formation de noyaux lourds | 3 milliards d'années | 10 000 |
| Le processus de naissance des étoiles s'arrête | 10-15 milliards d'années | 3K |
| L'énergie de toutes les étoiles est épuisée | 10 14 ans | 10-2K |
| Les trous noirs sont épuisés et des particules élémentaires naissent | 10 40 ans | -20K |
| L’évaporation de tous les trous noirs se termine | 10 100 ans | De 10 -60 à 10 -40 K |
Comme il ressort des données ci-dessus, l'Univers continue de s'étendre et de se refroidir.
L’augmentation constante de la distance entre les galaxies est le postulat principal : ce qui différencie la théorie du big bang. L'émergence de l'Univers de cette manière peut être confirmée par les preuves trouvées. Il y a aussi des raisons de le réfuter.
Problèmes de théorie
Étant donné que la théorie du Big Bang n’a pas été prouvée dans la pratique, il n’est pas surprenant qu’elle ne puisse répondre à plusieurs questions :
- Singularité. Ce mot désigne l'état de l'Univers, compressé en un point. Le problème de la théorie du Big Bang est l’impossibilité de décrire les processus se produisant dans la matière et dans l’espace dans un tel état. La loi de la relativité générale ne s'applique pas ici, il est donc impossible de créer une description mathématique et des équations pour la modélisation.
L’impossibilité fondamentale d’obtenir une réponse à la question sur l’état initial de l’Univers discrédite d’emblée la théorie. Ses exposés de vulgarisation scientifique préfèrent passer sous silence ou évoquer seulement en passant cette complexité. Cependant, pour les scientifiques qui cherchent à fournir une base mathématique à la théorie du Big Bang, cette difficulté est reconnue comme un obstacle majeur. - Astronomie. Dans ce domaine, la théorie du big bang se heurte au fait qu’elle ne peut pas décrire le processus d’origine des galaxies. Sur la base des versions actuelles des théories, il est possible de prédire comment apparaîtra un nuage de gaz homogène. De plus, sa densité devrait désormais être d’environ un atome par mètre cube. Pour obtenir quelque chose de plus, on ne peut pas se passer d'ajuster l'état initial de l'Univers. Le manque d’informations et d’expérience pratique dans ce domaine constitue de sérieux obstacles à la poursuite de la modélisation.
Il existe également un écart entre la masse calculée de notre galaxie et les données obtenues en étudiant la vitesse de son attraction. Apparemment, le poids de notre galaxie est dix fois plus important qu'on ne le pensait auparavant.

Cosmologie et physique quantique
Aujourd’hui, il n’existe aucune théorie cosmologique qui ne soit basée sur la mécanique quantique. Après tout, il s'agit de la description du comportement de l'atome et de la physique quantique. La différence entre la physique quantique et la physique classique (expliquée par Newton) est que la seconde observe et décrit les objets matériels, et la première suppose une description exclusivement mathématique de l'observation et de la mesure elle-même. . Pour la physique quantique, les valeurs matérielles ne font pas l’objet de recherches ; ici l’observateur lui-même fait partie de la situation étudiée.
Sur la base de ces caractéristiques, la mécanique quantique a du mal à décrire l’Univers, car l’observateur fait partie de l’Univers. Cependant, en parlant de l'émergence de l'Univers, il est impossible d'imaginer des observateurs extérieurs. Les tentatives visant à développer un modèle sans la participation d'un observateur extérieur ont été couronnées par la théorie quantique de l'origine de l'Univers de J. Wheeler.
Son essence est qu'à chaque instant, l'Univers se divise et un nombre infini de copies se forment. En conséquence, chacun des univers parallèles peut être observé et les observateurs peuvent voir toutes les alternatives quantiques. De plus, les mondes original et nouveau sont réels.
Modèle d'inflation
La tâche principale que la théorie de l’inflation est censée résoudre est la recherche de réponses aux questions laissées sans réponse par la théorie du big bang et la théorie de l’expansion. À savoir:
- Pour quelle raison l’Univers est-il en expansion ?
- Qu'est-ce qu'un big bang ?
À cette fin, la théorie inflationniste de l’origine de l’Univers consiste à extrapoler l’expansion jusqu’au temps zéro, confinant la masse entière de l’Univers en un point et formant une singularité cosmologique, souvent appelée le big bang.
L’inutilité de la théorie de la relativité générale, qui ne peut être appliquée à l’heure actuelle, devient évidente. De ce fait, seules des méthodes théoriques, des calculs et des déductions peuvent être appliqués pour développer une théorie plus générale (ou « nouvelle physique ») et résoudre le problème de la singularité cosmologique.
Nouvelles théories alternatives
Malgré le succès du modèle d’inflation cosmique, certains scientifiques s’y opposent, le qualifiant d’intenable. Leur principal argument est la critique des solutions proposées par la théorie. Les opposants soutiennent que les solutions obtenues laissent manquer certains détails, c'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème des valeurs initiales, la théorie ne fait que les draper habilement.
Une alternative est plusieurs théories exotiques dont l'idée est basée sur la formation de valeurs initiales avant le big bang. Les nouvelles théories sur l’origine de l’Univers peuvent être brièvement décrites comme suit :
- La théorie des cordes. Ses partisans proposent, en plus des quatre dimensions habituelles de l'espace et du temps, d'introduire des dimensions supplémentaires. Ils pourraient jouer un rôle dans les premiers stades de l’Univers et se trouver actuellement dans un état compacté. Répondant à la question sur la raison de leur compactification, les scientifiques proposent une réponse selon laquelle la propriété des supercordes est la T-dualité. Par conséquent, les cordes sont « enroulées » dans des dimensions supplémentaires et leur taille est limitée.
- Théorie des branes. On l'appelle également théorie M. Conformément à ses postulats, au début du processus de formation de l’Univers, il existe un espace-temps froid et statique à cinq dimensions. Quatre d'entre eux (spatiaux) ont des restrictions, ou des murs - à trois branes. Notre espace agit comme l'un des murs et le second est caché. La troisième tribrane est située dans un espace à quatre dimensions et est délimitée par deux branes limites. La théorie envisage une troisième brane entrant en collision avec la nôtre et libérant de grandes quantités d’énergie. Ce sont ces conditions qui deviennent favorables à l’apparition d’un big bang.
- Les théories cycliques nient le caractère unique du big bang, arguant que l’univers passe d’un état à un autre. Le problème de ces théories est l’augmentation de l’entropie, selon la deuxième loi de la thermodynamique. Par conséquent, la durée des cycles précédents était plus courte et la température de la substance était nettement plus élevée que lors de la grande explosion. La probabilité que cela se produise est extrêmement faible.
Peu importe le nombre de théories existantes sur l’origine de l’univers, seules deux ont résisté à l’épreuve du temps et surmonté le problème de l’entropie toujours croissante. Ils ont été développés par les scientifiques Steinhardt-Turok et Baum-Frampton.

Ces théories relativement nouvelles sur l'origine de l'Univers ont été avancées dans les années 80 du siècle dernier. Ils ont de nombreux adeptes qui développent des modèles basés sur ceux-ci, recherchent des preuves de fiabilité et s'efforcent d'éliminer les contradictions.
La théorie des cordes
L'une des théories les plus populaires sur l'origine de l'Univers - Avant de passer à une description de son idée, il est nécessaire de comprendre les concepts de l'un de ses plus proches concurrents, le modèle standard. Il suppose que la matière et les interactions peuvent être décrites comme un certain ensemble de particules, divisées en plusieurs groupes :
- Quarks.
- Leptons.
- Bosons.
Ces particules sont en fait les éléments constitutifs de l’univers, car elles sont si petites qu’elles ne peuvent pas être divisées en composants.
Une caractéristique distinctive de la théorie des cordes est l’affirmation selon laquelle ces briques ne sont pas des particules, mais des cordes ultramicroscopiques qui vibrent. En même temps, oscillant à différentes fréquences, les cordes deviennent des analogues de diverses particules décrites dans le modèle standard.
Pour comprendre la théorie, vous devez réaliser que les cordes ne sont pas une matière, elles sont de l’énergie. Par conséquent, la théorie des cordes conclut que tous les éléments de l’univers sont constitués d’énergie.
Une bonne analogie serait le feu. En le regardant, on a l’impression de sa matérialité, mais on ne peut pas le toucher.
Cosmologie pour les écoliers
Les théories sur l'origine de l'Univers sont brièvement étudiées dans les écoles lors des cours d'astronomie. Les étudiants apprennent les théories de base sur la façon dont notre monde s'est formé, ce qui lui arrive aujourd'hui et comment il se développera dans le futur.

Le but des cours est de familiariser les enfants avec la nature de la formation des particules élémentaires, des éléments chimiques et des corps célestes. Les théories sur l'origine de l'Univers pour les enfants se résument à une présentation de la théorie du Big Bang. Les enseignants utilisent du matériel visuel : diapositives, tableaux, affiches, illustrations. Leur tâche principale est d'éveiller l'intérêt des enfants pour le monde qui les entoure.
- 49,90 KoSous un autre aspect, la même difficulté prend la forme d’un autre doute. Le Dieu de la foi religieuse, source du salut personnel, doit nécessairement être une personne vivante. Mais, apparemment, de toutes les formes catégoriques dans lesquelles le concept philosophique central du principe fondamental de l'être peut être pensé, la moins appropriée est la forme d'une personnalité vivante. . Que Dieu soit conçu en philosophie comme la substance du monde ou comme sa cause première, comme l'éternité tout unie ou comme la force créatrice du développement, comme l'esprit du monde ou comme la vie, il est en tout cas quelque chose d'impersonnel, dans une certaine mesure toujours panthéiste, un principe global dans lequel la philosophie, sans changer sa tâche de compréhension et de compréhension logique de l'existence et sans s'adapter artificiellement aux exigences du sentiment religieux, ne peut discerner les traits anthropomorphiques d'un être vivant, punissant et aimant. personnalité nécessaire à une attitude religieuse envers Dieu. Fatalement, quel que soit le contenu d'un système philosophique particulier, le Dieu de la philosophie porte le sceau de sa dépendance à l'égard des besoins de la pensée abstraite et c'est pourquoi, pour le sentiment religieux, il n'y a qu'un substitut illusoire du vrai Dieu - une pierre morte à la place. de pain qui satisfait la faim de l'âme religieuse, ou, au mieux, une ombre inutile, brumeuse et éthérée de celle qui existe réellement, que la foi religieuse directe possède déjà dans toute la plénitude et la vitalité de sa réalité. La base de ces deux doutes réside en fin de compte, comme nous l’avons déjà indiqué, dans une difficulté ; et nous devons admettre qu'il s'agit d'une difficulté vraiment sérieuse - l'un des problèmes philosophiques les plus profonds et les plus importants - contrairement à la contradiction facilement résolue que nous avons traitée ci-dessus et qui ne résultait que d'idées banales superficielles et complètement fausses sur l'essence de la philosophie. et la religion. Cette difficulté se résume à la question : la philosophie, qui est la compréhension de l'être sous la forme logique d'un concept, peut-elle en même temps ne pas être du rationalisme ? Il est à noter que cette question est décisive non seulement pour l’harmonisation de la philosophie et de la religion, mais aussi pour la possibilité de la philosophie elle-même. En fait, la philosophie, d'une part, est la compréhension de l'être dans un système de concepts et, d'autre part, sa compréhension à partir de son principe fondamental absolu et global. Mais un concept est toujours quelque chose de relatif et de limité ; Comment exprimer l'absolu sous les formes du relatif, maîtriser l'infini, l'attraper dans le réseau du fini ? Comment peut-on - en termes simples - comprendre l'incompréhensible ? Il semblerait que nous soyons confrontés à un dilemme fatal : soit nous recherchons l'absolu lui-même, dépassant les limites de tout ce qui est fini et - par conséquent - logiquement exprimable, et alors nous ne pouvons pas vraiment comprendre et fixer logiquement ; ou bien nous recherchons uniquement un système logique de concepts et alors nous sommes toujours dans la sphère du seul relatif, particulier, dérivé, sans atteindre le véritable principe fondamental et l'unité intégrale de l'être. Dans les deux cas, la tâche de la philosophie reste inaccomplie.
De nombreux systèmes philosophiques se sont effondrés à cause de cette difficulté. Mais dans son essence, la philosophie a depuis longtemps pris en compte cette difficulté et l’a fondamentalement surmontée. La philosophie comprend - et exprime ainsi clairement et logiquement - l'absolu par la perception directe et la fixation logique de sa forme éminente, qui dépasse le concept logique. Nous sommes privés de la possibilité de donner ici une explication logique et détaillée de cette relation la plus profonde et en même temps axiomatiquement évidente ; Nous ne pouvons qu’en quelques mots guider la pensée du lecteur vers le lien révélé ici. La vision de la nature absolue et englobante de l'être, dépassant les limites et la relativité de tout ce qui est logiquement fixé, est précisément sa vision logiquement adéquate. Ou, en d'autres termes : c'est la pensée logiquement mûre qui a atteint la clarté finale, voyant l'inépuisabilité et l'infinité de l'absolu, sa différence fondamentale avec tout ce qui est rationnellement exprimable, reconnaissant donc humblement les limites des réalisations de la raison face à de l'être véritable, précisément dans la conscience ouverte et claire de cette relation et seulement en elle seule, surmonte les limitations de l'esprit et maîtrise un objet qui dépasse sa force. Là où une personne, se livrant à l'orgueil de la connaissance, s'imagine avoir épuisé le sujet avec sa connaissance, il n'y a pas précisément la première condition de la connaissance - une vision claire de son sujet ; car là où il y a cette vision, c'est-à-dire là où - par là - il y a la connaissance, il y a aussi une perception évidente de l'incomplétude et de l'incomplétude de la connaissance. La connaissance véritablement discernée s'accompagne toujours du sentiment classiquement exprimé par le brillant créateur du système mathématique de l'Univers, Newton, dans les mots qu'il se semble être un enfant ramassant des coquillages individuels sur les rives d'un monde sans limites et inexploré. océan. Et au contraire, cette vanité stupide, pour laquelle l'existence semble être une image limitée et pliée, facilement et complètement épuisée en quelques formules, contient non seulement une exagération illégale de la signification de toute connaissance acquise, mais est simplement un aveuglement complet. , dans lequel même le premier pas de la connaissance. Cette clarification des conditions de possibilité de la philosophie elle-même élimine immédiatement au moins le premier de ces deux doutes concernant le rapport entre la connaissance philosophique de Dieu et le sentiment religieux. Quels que soient les termes dans lesquels la pensée philosophique abstraite exprime sa connaissance de Dieu, son intuition fondamentale et par là son concept le plus élevé et suprême reste l'idée purement religieuse de l'immensité, de la profondeur inépuisable et du mystère de Dieu ; et, en substance, tout le reste du système de concepts a pour but final d’amener la pensée à saisir précisément cette nature super-finie et super-rationnelle de Dieu, constituant son absolu. Une idée fausse courante dans la compréhension de la relation entre philosophie et religion à ce stade est que le sens du mystère semble être une condition bloquant la pénétration cognitive et, à l'inverse, la passion pour la connaissance est une force qui détruit l'humble sens du mystère et favorise donc la vanité de l'athéisme. En réalité, au contraire, le sens religieux du mystère et de la profondeur de l'être est la condition première et nécessaire du développement de la philosophie, tandis que la vanité de l'athéisme tue radicalement l'instinct même de philosopher et est autant une négation de la philosophie qu'une négation de la philosophie. de religion. La possibilité et même des cas particuliers de formes intermédiaires - l'insuffisance de l'énergie philosophique à cause de laquelle la pensée, ne pénétrant pas jusqu'aux dernières profondeurs, s'arrête à mi-chemin, se fixe ici les dernières limites et, simplifiant l'être, favorise la semi-incrédulité ou la pauvreté et le schématique caractère de la conscience religieuse - bien sûr, ne réfute pas, mais confirme plutôt la relation fondamentale que nous avons expliquée. La bataille continue entre les esprits, pour ainsi dire. profond, c'est-à-dire ressentir la profondeur et l'infinie complexité de la vie, et les esprits plats, imaginant que la vie peut facilement être démontée, comme un château de cartes, et reconstituée à votre guise, il y a autant une lutte pour le religieux comme philosophique, vision du monde.
Cela ouvre également la voie à la résolution du deuxième doute. C'est vrai, puisque nous l'exprimons dans une formule grossière et logiquement solide, selon laquelle le Dieu de la foi est une personnalité humanoïde. Le Dieu de la philosophie est un absolu impersonnel ; il semble tout à fait irrésistible. Mais cela n’est dû qu’au caractère unilatéral et à la simplification logique de la formule elle-même. Ni le Dieu de la religion, ni le Dieu de la philosophie ne sont le contenu simple et sans ambiguïté auquel cette formule le réduit, précisément parce qu'il est avant tout profondeur insondable et richesse inépuisable. Il est la complétude de toutes les définitions, car il se situe au-dessus de chacune d'elles séparément ; et donc une définition n'en contredit pas une autre en Lui - à condition que chacune d'elles soit prise au sens propre, non pas comme une connaissance adéquate et exhaustive de Son essence même, mais seulement comme une compréhension d'un de Ses côtés, qui a - en raison à l'unité fondamentale de Son essence - seule signification symbolique pour définir le tout. Après tout, le Dieu de la foi religieuse contient aussi - dès la première tentative de définition unilatérale de Lui - de nombreuses contradictions, qui en réalité ne sont pas des contradictions, mais des antinomies, convenues dans une unité suprarationnelle supérieure. D’un autre côté, la connaissance philosophique de Dieu n’est liée qu’imaginairement au concept impersonnel et apparemment informe indiqué de Dieu comme une sorte de principe unique qui englobe tout. Le caractère apparemment inévitable de cette tendance découle uniquement de la limitation unilatérale de la tâche de la philosophie à la compréhension théorique du monde. Si nous rappelons et gardons à l'esprit que la tâche de la philosophie ne s'épuise pas là, mais nécessite une compréhension holistique de l'existence dans toute sa plénitude et sa profondeur vivantes, qui embrasse, comme l'un de ses moments principaux, la réalité de la vie spirituelle avec tous ses exigences et problèmes moraux et religieux, - si nous nous souvenons de la nécessité de problèmes philosophiques tels que le problème du bien et du mal, la théodicée, la relation entre l'idéal moral et la réalité, la liberté et la nécessité, la raison et l'aveuglement des forces naturelles, alors nous comprendrons que l’unité clarificatrice la plus élevée que recherche la philosophie n’est pas une seule unité impersonnelle. ordonnant l'image de l'existence objective du monde, mais véritablement l'unité holistique de la vie dans le sens le plus profond et le plus complet de ce concept. Le problème est qu'une véritable philosophie qui peut remplir son objectif doit procéder d'une unité réelle, c'est-à-dire absolument complète et concrète, et non d'une unité imaginaire, essentiellement partielle et abstraite, du système de l'être objectif. Et cela signifie que la dernière source et critère de la connaissance philosophique est seulement l'intuition impartiale et purement contemplative de l'existence objective, et l'expérience vivante et spirituelle holistique. - exploration expérientielle significative des dernières profondeurs de la vie. L'ensemble des doutes douloureux, des quêtes et des réalisations de l'expérience religieuse, réunis dans le thème « sur le sens de la vie » - le problème de la culpabilité, du châtiment et du pardon, de la responsabilité personnelle et de l'impuissance humaine, de la prédestination et de la liberté, de la réalité du mal et la bonté de l'Existant, la fragilité de l'existence empirique et l'indestructibilité de la personnalité - est incluse comme sujet légitime et nécessaire dans l'ontologie, qui mérite son nom de doctrine de l'être. Il suffit de se souvenir de cet être premier et fondamental, de se concentrer sur lui et de le considérer comme le critère final de la connaissance, pour que toute la relation, qui à première vue semble confuse et presque insoluble, devienne - du moins en principe - une évidence. clair. Il n'y a pas deux vérités, mais une seule - et c'est là qu'il y a le maximum d'exhaustivité et de spécificité. L’essentiel est d’avoir une expérience vivante de la réalité elle-même. Seulement là où la religion accepte les dogmes de la foi non comme des désignations symboliques et mystérieuses de la nature divine, mais comme des révélations complètes et exhaustives de Lui, les transformant en définitions logiques unilatérales, ou là où la philosophie imagine que dans un système abstrait de En formulant des formules, il est possible de déterminer complètement les profondeurs finales de la réalité, - seulement il existe des conflits possibles - et même inévitables - entre la philosophie et la religion. Le lien interne et l’affinité intime entre la philosophie et la religion ont été particulièrement obscurcis par des tentatives naïves et audacieuses de rationalisation des dogmes de la foi, qui compromettaient à la fois la philosophie et la religion. Des intuitions religieuses mystérieuses et significatives - fruits de l'expérience spirituelle des génies religieux et de la conscience religieuse conciliaire - presque inaccessibles dans leur profondeur à l'expérience inexpérimentée de l'homme moyen, sont parfois discutées - tant dans leur justification que dans leur réfutation - comme de simples vérités. , dont le sens est accessible au bon sens et peut être établi par une simple analyse logique. La connaissance philosophique dans ses réalisations est nécessairement en retard par rapport aux réalisations de pénétration religieuse directe dans les profondeurs de l'être. Il y a à cela des raisons importantes, ancrées dans la nature même des deux activités spirituelles. Tout d’abord, la foi religieuse, étant une sensation et une expérience vivante et directe du Divin, n’a pas besoin pour ses réalisations du dur travail mental d’explication rationnelle et de justification de ses vérités. En outre, même si la religion, comme indiqué ci-dessus, contient nécessairement, comme point d'appui principal, le moment du jugement personnel immédiat de la vérité, elle n'exige nullement que ce jugement direct s'étende à l'ensemble du contenu de la foi religieuse. Au contraire, il est caractéristique que ce moment d'évidence immédiate soit inhérent à la perception de la véracité, de la vérité inconditionnelle de la source de la révélation - s'il y aura cette même Divinité ou tel ou tel médiateur entre Dieu et l'homme, - grâce auquel le contenu de la révélation acquiert la fiabilité indirecte de la vérité, communiquée par un témoin évidemment fiable. Par conséquent, la propriété de la foi personnelle peut être - et arrive même nécessairement - le contenu de l'expérience religieuse conciliaire, avec toutes les réalisations des génies religieux incluses dans sa composition. Cela permet d'atteindre la possibilité d'une révélation religieuse complète, riche et profonde, totalement inaccessible à la connaissance philosophique. Car bien qu'il n'y ait ici aucune barrière fondamentale à la connaissance philosophique et que la possibilité de réalisations infinies soit ouverte, l'unité logique du contenu requise par la nature de la connaissance philosophique rend pratiquement impossible l'utilisation dans un seul système de l'intégralité de l'expérience religieuse de humanité. Seules l'exhaustivité et la diversité des réalisations philosophiques de la pensée humaine, en principe, peuvent devenir au niveau de ses réalisations religieuses - mais cette complétude ne peut être donnée qu'à l'intuition spirituelle et historique, mais n'est exprimée de manière adéquate dans aucun système unique. Un système philosophique qui tente d'exprimer et d'enregistrer logiquement toute l'expérience religieuse de l'humanité est une idée semblable à une tentative de dessiner une carte géographique sur laquelle serait marquée toute la diversité de la réalité géographique. Et ici, d'un autre côté, nous sommes à nouveau convaincus que la relation correcte entre religion et philosophie n'est possible que sur la base de cette « sage ignorance » qui est le fruit le plus mûr de la véritable Lumière. Un état d'esprit véritablement philosophique dans sa structure volitive coïncide avec un état d'esprit religieux : dans les deux cas - contrairement à une opinion superficielle, qui semble impossible - l'humilité se combine avec l'audace de la créativité, et, de plus, pas de telle manière que chacun L’une ou l’autre de ces tendances volontaires retient et limite l’autre, mais que chacune d’elles, au contraire, nourrit et fortifie l’autre.
3. Constructions scientifiques de l'Univers et idées philosophiques sur la place de l'homme dans le monde.
Le problème du commencement de l’univers est comme la vieille question : qui est venu en premier, la poule ou l’œuf. En d’autres termes, quelle force a créé l’univers. Et qu’est-ce qui a créé cette force. Ou peut-être que l’univers, ou la force qui a tout créé, a toujours existé et n’a pas eu de commencement.
L'univers est infini dans le temps et dans l'espace. Chaque particule de l'univers
a son début et sa fin, à la fois dans le temps et dans l'espace, mais l'Univers tout entier est infini et éternel, puisqu'il est éternellement une matière en mouvement.
L'univers est tout ce qui existe. Des plus petits grains de poussière et atomes aux énormes accumulations de matière des mondes et systèmes stellaires. Jusqu’à récemment, les scientifiques avaient tendance à ne pas aborder les questions liées à ces domaines parce qu’elles appartenaient à la métaphysique ou à la religion plutôt qu’à la science. Cependant, une doctrine a récemment émergé selon laquelle les lois de la science pourraient même exister au début de l’univers. Dans ce cas, l’univers pourrait être entièrement déterminé par les lois de la science.
Ainsi, les scientifiques ont été confrontés au problème du choix entre la foi en Dieu et la foi matérielle. Ils ne connaissaient pas encore les causes profondes de l’origine de l’univers, car ils ne disposaient pas à cette époque d’une base scientifique suffisante. La croyance en Dieu était préférable. Historiquement, le christianisme était plus ancien que la science et, naturellement, peu de gens prenaient la science au sérieux, mais avec le temps, il a gagné en force et de plus en plus de gens ont tourné la tête dans sa direction. Un mystère scientifique est quelque chose que la science ne peut pas expliquer, tout comme elle ne peut pas expliquer ce qui s’est passé avant le Big Bang. Après tout, tout ce qui s'est passé avant l'émergence de l'univers, le point de singularité, n'est pas discuté - c'est un dogme. Et l’inconnu en science est un mystère qui ne pourra être révélé dans un avenir proche.
À l'époque qu'on appelait le Big Bang, la densité de l'univers était égale à 1 000 000 g/m (cube) et la température était de 10 à 32 degrés C. Ce moment était appelé le point de singularité, c'est-à-dire il y eut un point, il y eut un début, une masse apparut, l'espace absolu et toutes les lois auxquelles l'univers obéit maintenant.
Dieu a créé le monde en six jours, mais d'après la théorie du Big Bang, l'âge de formation de l'univers est d'environ 15 à 20 milliards d'années. Aujourd'hui, les physiciens théoriciens tentent d'une manière ou d'une autre d'effondrer l'univers afin de déterminer plus précisément son âge. Mais pour nous, le fait même que l’univers ait eu un commencement est important.
Sur la base des faits, la théorie du Big Bang semble très convaincante, mais comme on ne sait toujours pas ce qui l'a précédée, elle jette un peu de brouillard sur la question. Mais la science a néanmoins progressé bien plus loin qu’avant et, comme toute théorie révolutionnaire, la théorie du Big Bang donne une bonne impulsion au développement de la pensée scientifique. Le modèle de l’Univers « chaud », couplé au concept du « Big Bang », est le plus répandu à l’heure actuelle et nécessite une attention et une compréhension particulières.
Selon le concept du Big Bang, l'univers est né d'un seul point
rayon égal à zéro, mais avec densité égale à l'infini. Qu'est-ce que ce point appelé singularité, comment l'Univers inépuisable tout entier apparaît-il à partir de rien et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la singularité - les partisans et les propagandistes de cette hypothèse restent silencieux à ce sujet. Le « Big Bang » s'est produit il y a 10 à 20 milliards d'années (l'âge exact dépend de la valeur de la constante de Hubble entrée dans la formule correspondante). Cette quantité, à son tour, peut avoir des valeurs différentes selon les méthodes utilisées pour mesurer la distance entre la Terre et les galaxies.
Il semble que dans le climat intellectuel actuel, le grand avantage de la cosmologie du Big Bang est qu’elle constitue un affront au bon sens. Lorsque les scientifiques luttent contre les absurdités astrologiques en dehors des murs des « temples de la science », il serait bon de se rappeler qu’à l’intérieur même de ces murs, les pires absurdités sont parfois cultivées. Dans le cadre de la théorie du « Big Bang », l’éternité et l’infinité de l’Univers sont niées, puisque l’Univers a eu un commencement dans le temps et, même après une période maximale de 20 milliards d’années, a réussi à s’étendre (gonfler) sur une période limitée. distance. Ce qui se trouve au-delà du rayon de l’Univers en expansion est également un sujet de discussion tabou. Habituellement, ils s’en sortent avec des déclarations qui n’expliquent rien, dont la signification ressemble à ceci : L’Univers est ainsi parce qu’il découle de formules mathématiques.
Ainsi, le modèle du « Big Bang » n’est qu’une des constructions imaginaires possibles, fruit d’un jeu de pensée théorique.
Idées philosophiques sur la place de l'homme dans le monde.
Les philosophes de l’Antiquité, en particulier les philosophes de la nature, considéraient l’homme comme une image du cosmos, comme un « petit monde », un microcosme. Ce point de vue, bien entendu, sur une base nouvelle, est reproduit aujourd'hui. L'homme fait véritablement partie du cosmos. Ce n’est pas un hasard si les orages magnétiques nous causent tant de problèmes. Nous sommes le peuple du Soleil, sans le Soleil nous nous sentons mal. Mais cela ne devrait pas être trop près de nous. Les scientifiques prédisent que le Soleil atteindra le stade de « géante rouge » dans son développement et engloutira la Terre. Qu'arrivera-t-il à la race humaine ?
Description du travail
Les enseignements philosophiques de George Berkeley visent à réfuter le matérialisme et à justifier la religion. Il utilisa à ces fins les principes nominalistes établis par Guillaume d'Occam : « Tout ce qui existe est singulier ». Ce principe nominaliste sert de point de départ à Berkeley, d'où il résulte que rien qui correspond à la réalité ne peut être non singulier et que les concepts abstraits sont des concepts faux. Mais selon Berkeley, ils sont non seulement faux, mais aussi impossibles, ce sont des fantômes philosophiques. Berkeley fait la distinction entre les idées générales et abstraites.
Introduction
Le monde qui nous entoure est vaste et diversifié. Tout ce qui nous entoure, qu'il s'agisse des autres personnes, des animaux, des plantes, des plus petites particules visibles uniquement au microscope et des amas géants d'étoiles, des atomes microscopiques et d'immenses nébuleuses, constitue ce qu'on appelle communément l'Univers.
L'Univers est un concept strictement indéfini en astronomie et en philosophie. Elle se divise en deux entités fondamentalement différentes : spéculative (philosophique) et matérielle, accessible à l'observation à l'heure actuelle ou dans un avenir prévisible. Si l'auteur fait la distinction entre ces entités, alors, selon la tradition, la première s'appelle l'Univers et la seconde s'appelle l'Univers astronomique, ou Métagalaxie (récemment, ce terme est pratiquement tombé en désuétude). L'Univers fait l'objet d'études en cosmologie.
L'origine de l'Univers est toute description ou explication des processus initiaux de l'origine de l'Univers existant, y compris la formation d'objets astronomiques (cosmogonie), l'émergence de la vie, de la planète Terre et de l'humanité. Il existe de nombreux points de vue sur la question de l'origine de l'Univers, à commencer par la théorie scientifique, de nombreuses hypothèses individuelles, et se terminant par des réflexions philosophiques, des croyances religieuses et des éléments du folklore.
Il existe un grand nombre de concepts sur l’origine de l’Univers.
Tel que:
· Le modèle cosmologique de Kant · Modèle d'univers en expansion (univers de Friedmann, univers non stationnaire) · La théorie du Big Bang · Gros rebond · Théorie des cordes et théorie M · Créationnisme Le but de cet essai est de considérer le concept d'« Univers » et d'étudier les concepts de base (théories) d'origine. Principaux objectifs du résumé : )Considérez les concepts et définitions de base de « l’Univers ». )Considérez la formation des objets dans l'Univers. )Explorez les concepts de base de l'origine de l'univers. 1. Évolution de « l’Univers »
L'Univers est l'ensemble du monde matériel qui nous entoure, y compris ce qui se trouve en dehors de la Terre : l'espace, les planètes, les étoiles. C'est une matière sans fin ni limite, prenant les formes les plus diverses de son existence. La partie de l'Univers couverte par les observations astronomiques est appelée la Métagalaxie, ou notre Univers. Les dimensions de la Métagalaxie sont très grandes : le rayon de l'horizon cosmologique est de 15 à 20 milliards d'années-lumière. L'Univers est le plus grand système matériel, c'est-à-dire un système d'objets constitué de matière. Parfois, le concept de « substance » est identifié au concept de « matière ». Une telle identification peut conduire à des conclusions erronées. La matière est le concept le plus général, tandis que la substance n'est qu'une des formes de son existence. Dans la compréhension moderne, on distingue trois formes de matière interconnectées : la matière, le champ et le vide physique. La matière est constituée de particules discrètes présentant des propriétés ondulatoires. Les microparticules sont caractérisées par une double nature d'onde de particule. Le vide physique et ses propriétés sont jusqu’à présent bien moins connus que de nombreux systèmes et structures matérielles. Selon la définition moderne, le vide physique est constitué de champs nuls et fluctuants auxquels les particules virtuelles sont associées. Le vide physique est découvert lors de l’interaction avec la matière à ses niveaux profonds. On suppose que le vide et la matière sont inséparables et qu’aucune particule matérielle ne peut être isolée de sa présence et de son influence. Conformément au concept d'auto-organisation, le vide physique agit comme un environnement extérieur pour l'Univers. La structure et l'évolution de l'Univers sont étudiées par la cosmologie. La cosmologie est l'une de ces branches des sciences naturelles qui, par essence, se situent toujours à l'intersection des sciences. La cosmologie utilise les acquis et les méthodes de la physique, des mathématiques et de la philosophie. Le sujet de la cosmologie est l'ensemble du mégamonde qui nous entoure, l'ensemble du « grand Univers », et la tâche est de décrire les propriétés, la structure et l'évolution les plus générales de l'Univers. Il est clair que les conclusions de la cosmologie ont une grande signification idéologique. L'astronomie moderne a non seulement découvert le monde grandiose des galaxies, mais a également découvert des phénomènes uniques : l'expansion de la métagalaxie, l'abondance cosmique d'éléments chimiques, des rayonnements reliques, indiquant que l'Univers est en constante évolution. L'évolution de la structure de l'Univers est associée à l'émergence d'amas de galaxies, à la séparation et à la formation d'étoiles et de galaxies, ainsi qu'à la formation de planètes et de leurs satellites. L’Univers lui-même est apparu il y a environ 20 milliards d’années à partir d’une protomatière dense et chaude. Aujourd’hui, nous ne pouvons que deviner à quoi ressemblait cette substance ancestrale de l’Univers, comment elle s’est formée, à quelles lois elle a obéi et quels processus l’ont conduite à son expansion. Il existe un point de vue selon lequel, dès le début, la protomatière a commencé à se développer à une vitesse gigantesque. Au stade initial, cette substance dense s'est dispersée, dispersée dans toutes les directions et était un mélange homogène et bouillonnant de particules instables qui se désintégraient constamment lors des collisions. En refroidissant et en interagissant pendant des millions d'années, toute cette masse de matière dispersée dans l'espace s'est concentrée en grandes et petites formations de gaz qui, au cours de centaines de millions d'années, se rapprochant et fusionnant, se sont transformées en d'énormes complexes. En eux, à leur tour, des zones plus denses sont apparues - des étoiles et même des galaxies entières s'y sont ensuite formées. En raison de l'instabilité gravitationnelle, des « formations protostellaires » denses avec des masses proches de la masse du Soleil peuvent se former dans différentes zones des galaxies formées. Le processus de compression qui a commencé va s'accélérer sous l'influence de son propre champ gravitationnel. Ce processus accompagne la chute libre des particules nuageuses vers son centre - une compression gravitationnelle se produit. Au centre du nuage se forme un compactage composé d’hydrogène moléculaire et d’hélium. Une augmentation de la densité et de la température au centre conduit à la désintégration des molécules en atomes, à l'ionisation des atomes et à la formation d'un noyau protostellaire dense. Il existe une hypothèse sur l'état cyclique de l'Univers. Ayant surgi d'un amas de matière extrêmement dense, l'Univers pourrait avoir donné naissance en lui-même à des milliards de systèmes stellaires et de planètes dès le premier cycle. Mais alors, inévitablement, l'Univers commence à tendre vers l'état à partir duquel l'histoire du cycle a commencé, le décalage vers le rouge cède la place au violet, le rayon de l'Univers diminue progressivement, et à la fin la matière de l'Univers revient à sa état d'origine super dense, détruisant sans pitié toute vie en cours de route. Et cela se répète à chaque fois, dans chaque cycle pour l’éternité ! Au début des années 1930, on pensait que les principales composantes de l’Univers étaient des galaxies, chacune composée en moyenne de 100 milliards d’étoiles. Le Soleil, avec le système planétaire, fait partie de notre Galaxie, dont nous observons la majeure partie des étoiles sous la forme de la Voie Lactée. En plus des étoiles et des planètes, la Galaxie contient une quantité importante de gaz raréfiés et de poussière cosmique. L'Univers est-il fini ou infini, quelle est sa géométrie - ces questions et bien d'autres sont liées à l'évolution de l'Univers, en particulier à l'expansion observée. Si, comme on le croit actuellement, la vitesse « d'expansion » des galaxies augmente de 75 km/s pour chaque million de parsecs, alors l'extrapolation vers le passé conduit à un résultat étonnant : il y a environ 10 à 20 milliards d'années, l'Univers entier était concentré. dans une très petite zone. De nombreux scientifiques pensent qu’à cette époque la densité de l’Univers était la même que celle d’un noyau atomique. En termes simples, l’Univers n’était alors qu’une « goutte nucléaire » géante. Pour une raison quelconque, cette « goutte » est devenue instable et a explosé. Ce processus s’appelle le big bang. Avec cette estimation du moment de la formation de l’Univers, on a supposé que l’image de l’expansion des galaxies que nous observons actuellement s’est produite à la même vitesse et dans un passé arbitrairement lointain. Et c'est précisément sur cette hypothèse que repose l'hypothèse de l'Univers primaire - une «goutte nucléaire» géante tombée dans un état d'instabilité. Actuellement, les cosmologistes suggèrent que l’Univers ne s’est pas étendu « d’un point à un autre », mais semblait osciller entre des limites finies de densité. Cela signifie que dans le passé, la vitesse d'expansion des galaxies était inférieure à celle d'aujourd'hui et que même avant, le système de galaxies était comprimé, c'est-à-dire Les galaxies se rapprochaient plus rapidement, plus la distance qui les séparait était grande. La cosmologie moderne dispose d'un certain nombre d'arguments en faveur de l'image d'un « Univers palpitant ». De tels arguments, cependant, sont purement mathématiques ; le plus important d’entre eux est la nécessité de prendre en compte l’hétérogénéité réellement existante de l’Univers. Nous ne pouvons pas désormais décider définitivement laquelle des deux hypothèses – la « chute nucléaire » ou « l’Univers pulsé » – est correcte. Il faudra encore beaucoup de travail pour résoudre cet un des problèmes les plus importants de la cosmologie. L’idée de l’évolution de l’Univers semble aujourd’hui tout à fait naturelle. Cela n'a pas toujours été comme ça. Comme toute grande idée scientifique, elle a parcouru un long chemin dans son développement, sa lutte et sa formation. Considérons par quelles étapes le développement de la science sur l'Univers est passé au cours de notre siècle. La cosmologie moderne est née au début du XXe siècle. après la création de la théorie relativiste de la gravité. Le premier modèle relativiste, basé sur une nouvelle théorie de la gravité et prétendant décrire l'Univers entier, a été construit par A. Einstein en 1917. Cependant, il décrivait un Univers statique et, comme l'ont montré les observations astrophysiques, il s'est avéré incorrect. En 1922-1924. Le mathématicien soviétique A.A. Friedman a proposé des équations générales pour décrire l’Univers entier à mesure qu’il évolue au fil du temps. Les systèmes stellaires ne peuvent pas être localisés, en moyenne, à des distances constantes les uns des autres. Ils doivent soit s'éloigner, soit se rapprocher. Ce résultat est une conséquence inévitable de la présence de forces gravitationnelles qui dominent à l’échelle cosmique. La conclusion de Friedman signifiait que l'Univers devait soit s'étendre, soit se contracter. Cela a abouti à une révision des idées générales sur l'Univers. En 1929, l'astronome américain E. Hubble (1889-1953), à l'aide d'observations astrophysiques, découvre l'expansion de l'Univers, confirmant ainsi l'exactitude des conclusions de Friedman. Depuis la fin des années 40 de notre siècle, la physique des processus à différents stades de l’expansion cosmologique a attiré une attention croissante en cosmologie. Dans l’AG proposée à ce moment-là. La théorie de Gamow sur l'Univers chaud considérait les réactions nucléaires qui se produisaient au tout début de l'expansion de l'Univers dans une matière très dense. On supposait que la température de la substance était élevée et diminuait avec l’expansion de l’Univers. La théorie prévoyait que le matériau à partir duquel les premières étoiles et galaxies se sont formées devrait être principalement constitué d'hydrogène (75 %) et d'hélium (25 %), avec un mélange insignifiant d'autres éléments chimiques. Une autre conclusion de la théorie est que dans l'Univers actuel, il devrait rester un faible rayonnement électromagnétique, héritage de l'ère de la matière à haute densité et à haute température. Un tel rayonnement lors de l’expansion de l’Univers était appelé rayonnement de fond cosmique micro-onde. Dans le même temps, des capacités d'observation fondamentalement nouvelles sont apparues en cosmologie : la radioastronomie est apparue et les capacités de l'astronomie optique se sont développées. En 1965, le rayonnement cosmique de fond micro-onde a été observé expérimentalement. Cette découverte a confirmé la validité de la théorie de l'Univers chaud. L'étape actuelle du développement de la cosmologie est caractérisée par des recherches intensives sur le problème du début de l'expansion cosmologique, lorsque les densités de matière et d'énergie des particules étaient énormes. Les idées directrices sont de nouvelles découvertes en physique de l'interaction des particules élémentaires à très hautes énergies. Dans ce cas, l’évolution globale de l’Univers est considérée. Aujourd’hui, l’évolution de l’Univers est largement étayée par de nombreuses observations astrophysiques, qui constituent une base théorique solide pour toute la physique. 2. Concepts de l'origine de l'Univers univers planète astronomique Le modèle cosmologique de Kant Jusqu’au début du XXe siècle, lorsque la théorie de la relativité d’Albert Einstein est née, la théorie généralement acceptée dans le monde scientifique était celle d’un Univers infini dans l’espace et dans le temps, homogène et statique. Isaac Newton ((1642-1726) - physicien, mathématicien, mécanicien et astronome anglais, l'un des fondateurs de la physique classique, a fait l'hypothèse de l'infinité de l'Univers), et Emmanuel Kant ((1724-1804) - philosophe allemand, fondateur de la philosophie classique allemande, aux confins du siècle des Lumières et du romantisme) a développé cette idée, admettant que l'univers n'a ni commencement ni temps. Il expliquait tous les processus de l'Univers par les lois de la mécanique, décrites par Isaac Newton peu avant sa naissance. La position initiale de Kant est en désaccord avec la conclusion de Newton sur la nécessité d'une « première poussée » divine pour l'émergence du mouvement orbital des planètes. Selon Kant, l’origine de la composante tangentielle reste floue tant que le système solaire est considéré comme immuable, donné, en dehors de son histoire. Mais il suffit de supposer que l'espace interplanétaire dans des temps lointains était rempli de matière raréfiée, les particules élémentaires les plus simples interagissant les unes avec les autres d'une certaine manière, alors une réelle opportunité se présente sur la base des lois physiques pour expliquer, sans recourir aux l'aide des forces divines, l'origine et la structure du système solaire. Cependant, Kant n'est pas athée, il reconnaît l'existence de Dieu, mais ne lui attribue qu'un seul rôle : la création de la matière sous la forme du chaos initial avec ses lois inhérentes. Tout développement ultérieur de la matière se produit naturellement, sans l'intervention de Dieu. Kant a étendu ses conclusions au domaine de la biologie, affirmant que l'Univers infiniment ancien et infiniment grand présente la possibilité de l'émergence d'un nombre infini d'accidents, à la suite desquels l'émergence de tout produit biologique est possible. Cette philosophie, à laquelle on ne peut nier la logique des conclusions (mais pas des postulats), fut le terrain fertile pour l'émergence du darwinisme (le darwinisme - du nom du naturaliste anglais Charles Darwin - au sens étroit - une direction de la pensée évolutionniste, dont les adeptes d'accord avec les idées fondamentales de Darwin sur la question de l'évolution, selon laquelle le facteur principal (mais pas le seul) de l'évolution est la sélection naturelle). Les observations des mouvements des planètes par les astronomes des XVIIIe et XIXe siècles ont confirmé le modèle cosmologique de l’Univers de Kant, qui est passé d’une hypothèse à une théorie et, à la fin du XIXe siècle, il était considéré comme une autorité incontestable. Même le soi-disant « paradoxe du ciel nocturne » n’a pas pu ébranler cette autorité. Pourquoi ce paradoxe ? car dans le modèle de l'Univers kantien la somme des luminosités des étoiles devrait créer une luminosité infinie, mais le ciel est sombre ! L'explication de l'absorption d'une partie de la lumière des étoiles par des nuages de poussière situés entre les étoiles ne peut être considérée comme satisfaisante, car selon les lois de la thermodynamique, tout corps cosmique commence finalement à dégager autant d'énergie qu'il en reçoit (cependant, cela est devenu connu seulement en 1960). Modèle d'univers en expansion En 1915 et 1916, Einstein a publié les équations de la relativité générale (il convient de noter qu'il s'agit de la théorie la plus complète et la plus minutieusement testée et confirmée à ce jour). Selon ces équations, l’Univers n’est pas statique, mais est en expansion avec décélération simultanée. Le seul phénomène physique qui se comporte de cette façon est une explosion, à laquelle les scientifiques ont donné le nom de « Big Bang » ou « Big Bang chaud ». Mais si l’Univers visible est une conséquence du Big Bang, alors cette explosion a eu un début, il y a eu une Cause Première, il y a eu un Concepteur. Au début, Einstein a rejeté une telle conclusion et a avancé en 1917 l'hypothèse de l'existence d'une certaine « force répulsive » qui arrête le mouvement et maintient l'Univers dans un état statique pendant un temps infini. Cependant, l'astronome américain Edwin Hubble (1889-1953) a prouvé en 1929 que les étoiles et les amas d'étoiles (galaxies) s'éloignent les uns des autres. Cette soi-disant « récession galactique » a été prédite par la formulation originale de la relativité générale. Le modèle de l'Univers d'Einstein est devenu le premier modèle cosmologique basé sur les conclusions de la théorie générale de la relativité. Cela est dû au fait que c'est la gravité qui détermine l'interaction des masses sur de grandes distances. Par conséquent, le noyau théorique de la cosmologie moderne est la théorie de la gravité – la théorie de la relativité générale. Cinq ans plus tard, en 1922, le physicien et mathématicien soviétique Alexander Friedman, sur la base de calculs rigoureux, montra que l’Univers d’Einstein ne pouvait pas être stationnaire et immuable. Friedman l’a fait sur la base du principe cosmologique qu’il a formulé. Elle repose sur deux hypothèses : l'isotropie et l'homogénéité de l'Univers. L'isotropie de l'Univers s'entend comme l'absence de directions distinctes, l'identité de l'Univers dans toutes les directions. L'homogénéité de l'Univers s'entend comme la similitude de tous les points de l'Univers, faisant des observations à partir desquelles nous verrons partout un Univers isotrope. Aujourd’hui, la plupart des scientifiques sont d’accord avec ce principe. Les résultats des observations modernes montrent que les éléments structurels des étoiles et des galaxies lointaines, les lois physiques auxquelles elles obéissent et les constantes physiques sont les mêmes dans toute la partie observable de l'Univers, y compris la Terre. De plus, on sait que la matière dans l’Univers est rassemblée en « amas » – étoiles, systèmes stellaires et galaxies. Mais la répartition de la matière à plus grande échelle est uniforme. Friedman, sur la base du principe cosmologique, a prouvé que les équations d’Einstein ont d’autres solutions non stationnaires, selon lesquelles l’Univers peut soit s’étendre, soit se contracter. En même temps, nous parlions d'agrandir l'espace lui-même, c'est-à-dire sur l'augmentation de toutes les distances dans le monde. L'univers de Friedman ressemblait à une bulle de savon gonflée, dont le rayon et la surface augmentaient continuellement. Les preuves en faveur du modèle de l'Univers en expansion ont été obtenues en 1929, lorsque l'astronome américain Edwin Hubble a découvert, en étudiant les spectres de galaxies lointaines, le décalage vers le rouge des raies spectrales (un déplacement des raies vers l'extrémité rouge du spectre). Cela a été interprété comme une conséquence de l'effet Doppler - un changement de fréquence ou de longueur d'onde d'oscillation dû au mouvement de la source d'ondes et de l'observateur l'un par rapport à l'autre. Le décalage vers le rouge a été expliqué par le fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres à un rythme qui augmente avec la distance. Selon des mesures récentes, cette augmentation du taux d'expansion est d'environ 55 km/s par million de parsecs. Après cette découverte, la conclusion de Friedman sur la nature non stationnaire de l’Univers a été confirmée et le modèle d’un Univers en expansion a été établi en cosmologie. Le retrait des galaxies que nous observons est une conséquence de l’expansion de l’espace dans un Univers fini et fermé. Avec une telle expansion de l’espace, toutes les distances dans l’Univers augmentent, tout comme les distances entre les grains de poussière à la surface d’une bulle de savon qui se gonfle. Chacun de ces grains de poussière, comme chacune des galaxies, peut à juste titre être considéré comme un centre d'expansion. La théorie du Big Bang Le Big Bang est un modèle cosmologique généralement accepté qui décrit le développement précoce de l'Univers, à savoir le début de l'expansion de l'Univers, avant lequel l'Univers était dans un état singulier. Il est désormais courant de combiner automatiquement la théorie du Big Bang et le modèle de l’Univers chaud, mais ces concepts sont indépendants et historiquement, il existait également le concept d’un Univers initial froid à proximité du Big Bang. C’est la combinaison de la théorie du Big Bang avec la théorie d’un Univers chaud, étayée par l’existence d’un fond diffus cosmologique, qui est examinée plus en détail. Idées modernes de la théorie du Big Bang et de la théorie de l’Univers chaud : Selon les concepts modernes, l’Univers que nous observons aujourd’hui est né il y a 13,7 ± 0,13 milliards d’années d’un état initial « singulier » et n’a cessé de s’étendre et de se refroidir depuis lors. Selon les limites connues de l'applicabilité des théories physiques modernes, le moment le plus précoce pouvant être décrit est considéré comme le moment de l'époque de Planck avec une température d'environ 1 032 K (température de Planck) et une densité d'environ 1 093 g/cm. ³ ( densité de Planck). L’Univers primitif était un environnement hautement homogène et isotrope avec une densité d’énergie, une température et une pression inhabituellement élevées. À la suite de l'expansion et du refroidissement, des transitions de phase se sont produites dans l'Univers, similaires à la condensation d'un liquide à partir d'un gaz, mais en relation avec des particules élémentaires. Environ 10 à 35 secondes après le début de l'époque de Planck (le temps de Planck est de 10 à 43 secondes après le Big Bang, moment auquel l'interaction gravitationnelle s'est séparée des autres interactions fondamentales), une transition de phase a provoqué l'expansion exponentielle de l'Univers. Cette période s’appelait l’inflation cosmique. Après la fin de cette période, le matériau de construction de l’Univers était le plasma de quarks et de gluons. Au fil du temps, la température a chuté à des valeurs auxquelles la transition de phase suivante, appelée baryogenèse, est devenue possible. A ce stade, les quarks et les gluons se combinent pour former des baryons tels que les protons et les neutrons. Dans le même temps, une formation asymétrique de matière, qui prédominait, et d'antimatière, qui s'annihilaient mutuellement, se transformant en rayonnement, s'est produite simultanément. Une nouvelle baisse de température a conduit à la transition de phase suivante : la formation de forces physiques et de particules élémentaires sous leur forme moderne. Vint ensuite l’ère de la nucléosynthèse, au cours de laquelle les protons, se combinant avec les neutrons, formèrent les noyaux du deutérium, de l’hélium-4 et de plusieurs autres isotopes légers. Après une nouvelle baisse de température et une expansion de l'Univers, le point de transition suivant s'est produit, où la gravité est devenue la force dominante. 380 mille ans après le Big Bang, la température a tellement baissé que l'existence d'atomes d'hydrogène est devenue possible (avant cela, les processus d'ionisation et de recombinaison des protons avec des électrons étaient en équilibre). Après l’ère de la recombinaison, la matière est devenue transparente au rayonnement qui, se propageant librement dans l’espace, nous parvient sous la forme d’un fond diffus cosmologique. L'histoire du développement des idées sur le Big Bang : L'ouvrage du physicien Albert Einstein, « Fondements de la théorie générale de la relativité », a été publié, dans lequel il a achevé la création d'une théorie relativiste de la gravité. Einstein, sur la base de ses équations de champ, a développé l'idée d'un espace à courbure constante dans le temps et dans l'espace (le modèle de l'Univers d'Einstein, marquant la naissance de la cosmologie), a introduit la constante cosmologique Λ. ( Par la suite, Einstein a qualifié l’introduction de la constante cosmologique de l’une de ses plus grandes erreurs ; Il est déjà devenu clair à notre époque que Λ- membre joue un rôle vital dans l’évolution de l’Univers). W. de Sitter a proposé un modèle cosmologique de l'Univers (modèle de Sitter) dans son ouvrage « Sur la théorie de la gravité d'Einstein et ses conséquences astronomiques ». Mathématicien et géophysicien soviétique A.A. Friedman a trouvé des solutions non stationnaires à l'équation gravitationnelle d'Einstein et a prédit l'expansion de l'Univers (un modèle cosmologique non stationnaire connu sous le nom de solution de Friedman). Si nous extrapolons cette situation au passé, nous devrons conclure qu'au tout début, toute la matière de l'Univers était concentrée dans une région compacte, à partir de laquelle elle commençait son expansion. Étant donné que des processus explosifs se produisent très souvent dans l'Univers, Friedman a émis l'hypothèse qu'au tout début de son développement se trouve également un processus explosif - le Big Bang. Le mathématicien allemand G. Weyl a noté que si la matière est placée dans le modèle de De Sitter, qui correspond à un Univers vide, elle devrait s'étendre. La nature non statique de l’Univers de Sitter a également été abordée dans le livre d’A. Eddington, publié la même année. K. Wirtz a découvert une faible corrélation entre les diamètres angulaires et les vitesses de récession des galaxies et a suggéré qu'elle pourrait être liée au modèle cosmologique de De Sitter, selon lequel la vitesse de récession des objets distants devrait augmenter avec leur distance. K.E. Lundmark puis Strömberg, qui reprirent les travaux de Wirtz, n’obtinrent pas de résultats convaincants, et Strömberg affirma même qu’« il n’y a aucune dépendance des vitesses radiales avec la distance au Soleil ». Cependant, il était clair que ni le diamètre ni la luminosité des galaxies ne pouvaient être considérés comme des critères fiables pour déterminer leur distance. L'expansion d'un Univers non vide a également été évoquée dans le premier ouvrage cosmologique du théoricien belge Georges Lemaître, publié la même année. L'article de Lemaître "Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant expliquant les vitesses radiales des nébuleuses extragalactiques" a été publié. Le coefficient de proportionnalité entre vitesse et distance obtenu par Lemaitre était proche de celui trouvé par E. Hubble en 1929. Lemaitre fut le premier à affirmer clairement que les objets habitant l'Univers en expansion, dont la répartition et la vitesse devraient faire l'objet de la cosmologie , ne sont pas des étoiles, mais des systèmes stellaires géants, des galaxies. Lemaitre s'est appuyé dans son rapport sur les résultats de Hubble, dont il a fait la connaissance alors qu'il était aux États-Unis en 1926. Le 17 janvier, les Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis ont reçu des articles d'Humason sur la vitesse radiale de NGC 7619 et de Hubble, intitulés « Relation entre la distance et la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques ». Une comparaison de ces distances avec les vitesses radiales a montré une nette dépendance linéaire de la vitesse sur la distance, maintenant appelée à juste titre loi de Hubble. Le radioastronome soviétique Tigran Shmaonov a découvert expérimentalement un rayonnement micro-ondes sonore d'une température d'environ 3K. Les radioastronomes américains A. Penzias et R. Wilson ont découvert le rayonnement de fond cosmique et mesuré sa température. Il s'est avéré qu'elle était exactement de 3 K. Il s'agissait de la plus grande découverte en cosmologie depuis la découverte par Hubble de l'expansion générale de l'Univers en 1929. La théorie de Gamow fut entièrement confirmée. Actuellement, ce rayonnement est appelé rayonnement relique ; le terme a été introduit par l'astrophysicien soviétique I.S. Chklovski. Le satellite WMAP mesure l’anisotropie du rayonnement cosmique de fond micro-ondes avec un haut degré de précision. Associées aux données de mesures précédentes (COBE, Hubble Space Telescope, etc.), les informations obtenues ont confirmé le modèle cosmologique ΛCDM et la théorie de l'inflation. L'âge de l'Univers et la répartition massique de divers types de matière ont été établis avec une grande précision (matière baryonique - 4 %, matière noire - 23 %, énergie noire - 73 %). Le satellite Planck a été lancé et mesure désormais l'anisotropie du rayonnement de fond cosmique micro-ondes avec une précision encore plus élevée. Gros rebond Cette intéressante théorie alternative au Big Bang suggère qu’il existait un autre univers avant le nôtre. Ainsi, si la naissance de l'Univers, à savoir le Big Bang, était considérée comme un phénomène unique, alors dans cette théorie, elle n'est qu'un maillon d'une chaîne de réactions, à la suite de laquelle l'Univers se reproduit constamment. Il découle de la théorie que le Big Bang n'est pas le début du temps et de l'espace, mais est apparu à la suite de la compression extrême d'un autre Univers dont la masse, selon cette théorie, n'est pas nulle, mais seulement proche de celle-ci. valeur, alors que l’énergie de l’Univers est infinie. Au moment de la compression extrême, l'Univers avait une énergie maximale contenue dans un volume minimum, à la suite de quoi un rebond important s'est produit et un nouvel Univers est né, qui a également commencé à s'étendre. Ainsi, les états quantiques qui existaient dans l’ancien Univers ont simplement été modifiés par le Grand Rebond et transférés vers le nouvel Univers. Le nouveau modèle de la naissance de l'Univers est basé sur la théorie de la gravité quantique en boucle, qui permet de regarder au-delà du Big Bang. Avant cela, on croyait que tout dans l'Univers apparaissait à la suite d'une explosion, de sorte que la question de ce qui l'avait précédé n'était pratiquement pas soulevée. Cette théorie appartient aux théories de la gravité quantique et combine la théorie de la relativité générale et les équations de la mécanique quantique. Cela a été proposé dans les années 1980. des scientifiques tels que E. Ashtekar et L. Smolin. La théorie de la gravité quantique en boucle dit que le temps et l'espace sont discrets, c'est-à-dire sont constitués de parties individuelles ou de petites cellules quantiques. À petite échelle d’espace et de temps, aucune cellule ne crée une structure discontinue divisée, mais à grande échelle, un espace-temps lisse et continu apparaît. La naissance du nouvel Univers a eu lieu dans des conditions extrêmes qui ont forcé les cellules quantiques à se séparer les unes des autres, ce processus a été appelé le Grand Rebond, c'est-à-dire L’univers n’est pas apparu de rien, comme lors du Big Bang, mais a commencé à s’étendre rapidement à partir d’un état comprimé. M. Bojovald a cherché à obtenir des informations sur l'Univers précédant le nôtre, pour lequel il a quelque peu simplifié certains modèles gravitationnels quantiques et équations de la théorie de la gravité quantique en boucle. Ces équations incluent plusieurs paramètres de l'état de notre Univers, nécessaires pour découvrir à quoi ressemblait l'Univers précédent. Les équations contiennent des paramètres complémentaires qui permettent de décrire l'incertitude quantique sur le volume de l'Univers avant et après le Big Bang, et reflètent le fait qu'aucun des paramètres de l'Univers précédent n'a été préservé après le Big Bounce, ils sont donc absents. dans notre Univers. En d'autres termes, à la suite d'une chaîne sans fin d'expansion, de compression et d'explosion, puis une nouvelle expansion, non pas identique, mais des Univers différents se forment. Théorie des cordes et théorie M L’idée selon laquelle l’univers peut constamment se reproduire semble raisonnable à de nombreux scientifiques. Certains pensent que notre Univers est né de fluctuations quantiques (oscillations) dans l'Univers précédent. Il est donc probable qu'à un moment donné, une telle fluctuation puisse survenir dans notre Univers et qu'un nouvel Univers apparaisse, quelque peu différent du présentez-en un. Les scientifiques vont plus loin dans leur raisonnement et supposent que des oscillations quantiques peuvent se produire en n'importe quelle quantité et n'importe où dans l'Univers, ce qui entraîne l'apparition non pas d'un nouvel Univers, mais de plusieurs à la fois. C’est la base de la théorie inflationniste de l’origine de l’Univers. Les univers résultants sont différents les uns des autres, différentes lois physiques y opèrent, alors qu'ils sont tous situés dans un immense mégaunivers, mais isolés les uns des autres. Les partisans de cette théorie soutiennent que le temps et l’espace ne sont pas apparus à la suite du Big Bang, mais ont toujours existé dans une série infinie de compression et d’expansion des Univers. Une sorte de développement de la théorie inflationniste est la théorie des cordes et sa version améliorée - la théorie M, ou la théorie des membranes, basées sur la cyclicité de l'univers. Selon la théorie M, le monde physique se compose de dix dimensions spatiales et d'une dimension temporelle. Dans ce monde, il existe des espaces, appelés branes, dont l'un est notre Univers, composé de trois dimensions spatiales. Le Big Bang est le résultat d'une collision de branes, qui se sont dispersées sous l'influence d'une énorme quantité d'énergie, puis leur expansion a commencé, se ralentissant progressivement. Le rayonnement et la matière libérés à la suite de la collision se sont refroidis et des galaxies sont apparues. Entre les branes se trouve une énergie de densité positive, accélérant à nouveau l'expansion, qui après un certain temps ralentit à nouveau. La géométrie de l'espace devient plate. Lorsque les branes sont à nouveau attirées les unes vers les autres, les vibrations quantiques deviennent plus fortes, la géométrie de l'espace se déforme et les sites de telles déformations dans le futur deviennent les embryons de galaxies. Lorsque les branes entrent en collision, le cycle se répète. Créationnisme Cette théorie de la vision du monde vient du mot latin « créations » - « création ». Selon ce concept, notre Univers, notre planète et l'humanité elle-même sont le résultat de l'activité créatrice de Dieu ou du Créateur. Le terme « créationnisme » est apparu à la fin du XIXe siècle et les partisans de cette théorie revendiquent la véracité de l’histoire de la création du monde telle que racontée dans l’Ancien Testament. Fin du 19ème siècle. Il y a eu une accumulation rapide de connaissances dans divers domaines scientifiques (biologie, astronomie, physique) et la théorie de l'évolution s'est généralisée. Tout cela a conduit à une contradiction entre la connaissance scientifique et la vision biblique du monde. On peut dire que le créationnisme est apparu comme une réaction des chrétiens conservateurs aux découvertes scientifiques, en particulier au développement évolutif de la nature vivante et inanimée, qui à cette époque devenait dominante et rejetait l'émergence de toutes choses à partir de rien. Conclusion
L'univers est la totalité de tout ce qui existe physiquement. C'est la totalité de l'espace, du temps, de toutes les formes de matière. Cependant, le terme Univers peut être interprété comme espace, monde ou nature. Les observations astronomiques ont permis d'établir l'origine de l'Univers et son « âge » approximatif qui, selon les dernières données, est de 13,73 ± 0,12 milliards d'années. Cependant, parmi certains scientifiques, il existe un point de vue concernant l'origine de l'Univers, selon lequel l'Univers n'est jamais apparu, mais a existé pour toujours et existera pour toujours, ne changeant que dans ses formes et ses manifestations. À la plus grande échelle, la structure de l’Univers est un espace en expansion rempli d’une structure irrégulière semblable à une éponge. Les parois de cette structure spongieuse de l'Univers sont des amas de milliards de galaxies stellaires. Les distances entre les galaxies les plus proches les unes des autres sont généralement d’environ un million d’années-lumière. Chaque galaxie stellaire est composée de centaines de milliards d’étoiles en orbite autour d’un noyau central. La taille des galaxies peut atteindre des centaines de milliers d'années-lumière. Les étoiles sont principalement constituées d’hydrogène, l’élément chimique le plus abondant dans l’univers. Il n’existe pas de point de vue unique quant à savoir si l’Univers est infini ou fini en espace et en volume. Cependant, l’Univers observable, qui comprend tous les endroits susceptibles de nous affecter depuis le Big Bang, est fini parce que la vitesse de la lumière est finie. L'événement associé à l'origine de l'Univers et censé marquer le début de l'Univers est appelé le Big Bang. Selon le modèle mathématique du Big Bang, au moment où il s'est produit, toute la matière et l'énergie de l'Univers actuellement observable étaient concentrées en un point avec une densité infinie. Après le Big Bang, l’Univers a commencé à s’étendre rapidement, prenant sa forme moderne. Étant donné que la relativité restreinte suggère que la matière ne peut pas parcourir la vitesse de la lumière, il semble paradoxal qu'après 13,7 milliards d'années dans un espace-temps fixe, deux galaxies puissent être séparées par 93 milliards d'années-lumière. C'est une conséquence naturelle de la théorie de la relativité générale. L'espace peut s'étendre indéfiniment, donc si l'espace entre deux galaxies « s'étend », alors elles peuvent s'éloigner l'une de l'autre à des vitesses ou plus rapides que la vitesse de la lumière.
1) le monde entier comme la totalité de toutes choses (objets réellement existants), infinies dans le temps et dans l'espace et infiniment diverses dans les formes d'existence ; 2) la partie habitée du monde ; 3) un objet de cosmologie accessible à l'observation astronomique.
Excellente définition
Définition incomplète ↓
UNIVERS
du grec « oikumene » - terre peuplée et habitée) - « tout ce qui existe », « un tout mondial global », « la totalité de toutes choses » ; la signification de ces termes est ambiguë et déterminée par le contexte conceptuel. On peut distinguer au moins trois niveaux du concept « Univers ».
1. L'univers en tant qu'idée philosophique a une signification proche du concept d'« univers » ou de « monde » : « monde matériel », « être créé », etc. Il joue un rôle important dans la philosophie européenne. Les images de l'Univers dans les ontologies philosophiques ont été incluses dans les fondements philosophiques de la recherche scientifique sur l'Univers.
2. L'Univers en cosmologie physique, ou l'Univers dans son ensemble, est un objet d'extrapolation cosmologique. Au sens traditionnel, il s'agit d'un système physique global, illimité et fondamentalement unique (« L'Univers est publié en un seul exemplaire » - A. Poincaré) ; le monde matériel considéré d'un point de vue physique et astronomique (A. L. Zelmanov). Les différentes théories et modèles de l’Univers sont considérés de ce point de vue comme non équivalents les uns aux autres d’un même original. Cette compréhension de l'Univers dans son ensemble était justifiée de différentes manières : 1) par référence à la « présomption d'extrapolabilité » : la cosmologie prétend représenter l'ensemble du monde dans le système de connaissance avec ses moyens conceptuels, et jusqu'à preuve du contraire , ces réclamations doivent être acceptées dans leur intégralité ; 2) logiquement, l'Univers est défini comme un tout global global, et d'autres Univers ne peuvent pas exister par définition, etc. La cosmologie classique newtonienne a créé une image de l'Univers, infinie dans l'espace et le temps, et l'infini était considéré comme une propriété attributive de l'Univers. Univers. Il est généralement admis que l'Univers infini et homogène de Newton a « détruit » l'ancien cosmos. Cependant, les images scientifiques et philosophiques de l'Univers continuent de coexister dans la culture, s'enrichissant mutuellement. L'univers newtonien a détruit l'image du cosmos antique uniquement dans le sens où il séparait l'homme de l'univers et les opposait même.
C’est dans la cosmologie relativiste non classique que la théorie de l’Univers a été construite pour la première fois. Ses propriétés se sont révélées complètement différentes de celles de Newton. Selon la théorie de l'Univers en expansion, développée par Friedman, l'Univers dans son ensemble peut être à la fois fini et infini dans l'espace, et dans le temps il est de toute façon fini, c'est-à-dire qu'il a eu un début. A. A. Friedman croyait que le monde, ou l’Univers en tant qu’objet de la cosmologie, est « infiniment plus étroit et plus petit que l’univers-monde du philosophe ». Au contraire, l'écrasante majorité des cosmologistes, sur la base du principe d'uniformité, a identifié les modèles de l'Univers en expansion avec notre Métagalaxie. Le moment initial de l'expansion de la métagalaxie était considéré comme le « début absolu de tout », d'un point de vue créationniste, comme la « création du monde ». Certains cosmologues relativistes, considérant le principe d'uniformité comme une simplification insuffisamment justifiée, considéraient l'Univers comme un système physique global à plus grande échelle que la Métagalaxie, et la Métagalaxie seulement comme une partie limitée de l'Univers.
La cosmologie relativiste a radicalement changé l'image de l'Univers dans la vision scientifique du monde. En termes idéologiques, il revenait à l’image du cosmos antique dans le sens où il reliait à nouveau l’homme et l’Univers (en évolution). Un autre pas dans cette direction fut le principe anthropique en cosmologie. L'approche moderne de l'interprétation de l'Univers dans son ensemble repose, d'une part, sur la distinction entre l'idée philosophique du monde et l'Univers comme objet de cosmologie ; deuxièmement, ce concept est relativisé, c'est-à-dire que sa portée est corrélée à un certain niveau de connaissance, de théorie ou de modèle cosmologique - dans un sens purement linguistique (indépendamment de leur statut objectif) ou dans un sens objectif. L'Univers était interprété, par exemple, comme « le plus grand ensemble d'événements auxquels nos lois physiques, extrapolées d'une manière ou d'une autre, peuvent être appliquées » ou « pourraient être considérés comme physiquement liés à nous » (G. Bondi).
Le développement de cette approche a été le concept selon lequel l'Univers en cosmologie est « tout ce qui existe ». pas dans un sens absolu, mais seulement du point de vue d'une théorie cosmologique donnée, c'est-à-dire d'un système physique de la plus grande échelle et du plus grand ordre, dont l'existence découle d'un certain système de connaissances physiques. Il s'agit d'une frontière relative et transitoire du méga-monde connu, déterminée par les possibilités d'extrapolation du système de connaissances physiques. L’Univers dans son ensemble ne signifie pas dans tous les cas le même « original ». Au contraire, différentes théories peuvent avoir pour objets des originaux différents, c'est-à-dire des systèmes physiques d'ordres et d'échelles de hiérarchie structurelle différents. Mais toutes les prétentions à représenter un tout mondial dans un sens absolu restent sans fondement. Lors de l’interprétation de l’Univers en cosmologie, il faut faire une distinction entre potentiellement existant et réellement existant. Ce qui est considéré comme inexistant aujourd’hui pourrait demain entrer dans le domaine de la recherche scientifique, s’avérer exister (du point de vue de la physique) et être inclus dans notre compréhension de l’Univers.
Ainsi, si la théorie de l’Univers en expansion décrivait essentiellement notre Métagalaxie, alors la théorie de l’Univers inflationniste (« gonflement »), la plus populaire dans la cosmologie moderne, introduit le concept de nombreux « autres univers » (ou, en termes de langage empirique , objets extra-métagalactiques) aux propriétés qualitativement différentes. La théorie inflationniste reconnaît donc une violation mégascopique du principe d’uniformité de l’Univers et introduit, dans son sens, le principe de diversité infinie de l’Univers. I. S. Shklovsky a proposé d'appeler l'ensemble de ces univers le « Métaverse ». La cosmologie inflationniste ravive sous une forme spécifique, c'est-à-dire l'idée de l'infinité de l'Univers (Métaverse) comme sa diversité infinie. Des objets comme la Métagalaxie sont souvent appelés « miniunivers » dans la cosmologie inflationniste. Les minivers naissent de fluctuations spontanées du vide physique. De ce point de vue, il s’ensuit que le moment initial de l’expansion de notre Univers, la Métagalaxie, ne doit pas nécessairement être considéré comme le début absolu de tout. Ce n'est que le moment initial de l'évolution et de l'auto-organisation de l'un des systèmes cosmiques. Dans certaines versions de la cosmologie quantique, le concept d’Univers est étroitement lié à l’existence de l’observateur (« le principe de participation »). « Donner naissance à des observateurs et à des participants à un stade limité de son existence n’est-il pas, à son tour, acquis. L'univers à travers leurs observations cette tangibilité que l'on appelle réalité ? N'est-ce pas un mécanisme d'existence ? (A.J. Wheeler). La signification du concept d'Univers dans ce cas est déterminée par une théorie basée sur la distinction entre l'existence potentielle et réelle de l'Univers dans son ensemble à la lumière du principe quantique.
3. L'Univers en astronomie (Univers observable, ou Univers astronomique) est une zone du monde couverte par des observations, et maintenant en partie par des expériences spatiales, c'est-à-dire « tout ce qui existe » du point de vue des moyens d'observation et des méthodes de recherche disponible en astronomie.
L'Univers astronomique est une hiérarchie de systèmes cosmiques d'échelle et d'ordre de complexité croissants qui ont été successivement découverts et étudiés par la science. C'est le système solaire, notre système stellaire. Galaxie (dont l'existence a été prouvée par W. Herschel au XVIIIe siècle). Métagalaxie découverte par E. Hubble dans les années 1920. Actuellement, les objets de l'Univers qui sont éloignés de nous à une distance d'env. 9 à 12 milliards d'années-lumière.
Tout au long de l'histoire de l'astronomie jusqu'à la 2ème moitié. 20ième siècle Dans l'Univers astronomique, les mêmes types de corps célestes étaient connus : planètes, étoiles, gaz et poussières. L'astronomie moderne a découvert des types de corps célestes fondamentalement nouveaux et jusqu'alors inconnus, y compris des objets ultradenses dans les noyaux des galaxies (représentant peut-être des trous noirs). De nombreux états de corps célestes dans l'Univers astronomique se sont révélés nettement non stationnaires, instables, c'est-à-dire situés aux points de bifurcation. On suppose que l'écrasante majorité (jusqu'à 90 à 95 %) de la matière de l'Univers astronomique est concentrée dans des formes invisibles, encore inobservables (« masse cachée »).
Allumé : Fridman A. A. Izbr. travaux. M., 1965 ; L'infini et l'univers. M., 1970 ; Univers, astronomie, philosophie. M., 1988 ; L'astronomie et l'image moderne du monde. M., 1996 ; Bondy H. Cosmologie. Cambr., 1952 ; Munit!. M. Espace, Temps et Création. New York 1965.
Excellente définition
Définition incomplète ↓
L’espace est exploré par les scientifiques et les philosophes depuis des temps immémoriaux. Les sciences naturelles modernes jugent l’existence cosmique quelque peu différemment de ce qu’elles étaient dans un passé récent. Il indique cinq niveaux dans l'état de l'Univers : hypomonde, micromonde, macromonde, mégamonde et hypermonde. D'un point de vue philosophique, l'existence même de ces niveaux d'un monde matériel unique ne signifie rien de plus que leur absence de frontières absolues et insurmontables et la relation relative entre elles.
Malgré les différences quantitatives et qualitatives incontestables entre les mondes répertoriés, ils sont interconnectés par des processus spécifiques de transitions mutuelles. La Terre, par exemple, est un macrocosme. Mais en tant que planète du système solaire, elle agit simultanément comme un élément du mégamonde. A cet égard, il convient de rappeler la loi de transition des valeurs quantitativesse transforme en qualitatifs, ce qui indique non seulement des sauts naturels, mais aussi leur conditionnalité objective. Le sens de cette loi est qu'elle ne permet aucun mystère dans les caractéristiques des sauts, mais vise directement la pensée à révéler le mécanisme spécifique du processus tout à fait naturel de leur existence, à refléter fidèlement le contenu quantitatif des sauts qualitatifs dans la science ( théories physiques, chimiques, biologiques).
La structure du monde a toujours occupé l’esprit des gens éclairés. Comment est apparu tout ce qui existe autour, et selon quelles lois se développe-t-il ? Comment est née la vie et a-t-elle un avenir ? D’où vient Homo sapiens sur la planète Terre ? L’humanité pensante s’est posée toutes ces questions et d’autres questions éternelles sur l’existence tout au long de l’histoire de son développement. Aujourd’hui, il est déjà possible de répondre de manière très précise à la question de l’origine du monde sur la base de faits et d’hypothèses scientifiques.
Il a été établi que l’Univers a entre 15 et 20 milliards d’années. Les théories scientifiques et philosophiques de l'évolution du monde ne contestent plus aujourd'hui que l'Univers était à l'origine complètement ionisé, homogène et opaque. Naturellement, il n’y avait pas d’étoiles à l’époque. Et le plasma ne transmettait aucun rayonnement. Mais au fil du temps, la lumière est « entrée » dans l’Univers, et cela s’est probablement produit à la suite de ce qu’on appelle le big bang. Cependant, la question se pose : qu’est-ce qui a alors « explosé » dans l’Univers ? Les scientifiques pensent qu'une substance incroyablement dense chauffée à des milliards de degrés a explosé, dont le caillot était de très petite taille par rapport à l'Univers actuel. Aucun atome ne pourrait exister dans cette substance. Depuis lors, l’Univers a commencé à s’étendre et à changer structurellement et fonctionnellement. Les scientifiques sont convaincus que cette expansion est éternelle et sans fin. Après des centaines de millions d’années, les étoiles et leurs amas, les galaxies, ont commencé à se former à partir d’un nuage de gaz chauds en expansion continue.
L'une des 10 milliards de galaxies observables est la Voie Lactée, qui abrite le système solaire et l'une de ses neuf planètes, la Terre. Cette minuscule planète est très éloignée du centre de la galaxie, environ 2/3 de son rayon. La galaxie elle-même est immense - environ cent milliards d'étoiles, le diamètrele disque mesure 100 000 années-lumière (une année-lumière est la distance parcourue par un rayon de lumière en 1 an à la vitesse de la lumière 300 000 km/sec.). Cela signifie que la lumière mettra 100 000 ans pour traverser le disque galactique d'un bout à l'autre en diamètre. À titre de comparaison, la lumière parcourt la distance entre le Soleil et la Terre en seulement 8 minutes. Il y a plusieurs millions d'années, en raison de la compression de la matière interstellaire, la température au centre de la galaxie dépassait 10 à 12 millions de degrés Celsius. Puis les réactions thermonucléaires ont commencé et le Soleil, une étoile ordinaire de notre galaxie qui nous donne la vie, « s’est allumé ». La Terre reçoit du Soleil la quantité de chaleur et de lumière nécessaire à la vie des organismes vivants. Les scientifiques pensent que le Soleil disposera de suffisamment de « carburant » atomique pour environ 5 milliards d’années.
Les photographies de certaines galaxies prises avec de grands télescopes nous étonnent par la beauté et la variété de leurs formes : ce sont de puissants vortex de nuages d'étoiles et d'énormes boules régulières. Il existe également des galaxies déchiquetées et complètement informes. Et pourtant, pour l’instant, pour les Terriens, l’Univers est une masse mystérieuse et sacrée de matière (ses différents types). On sait seulement qu'il (selon les astrophysiciens) est constitué d'environ 93 % d'hydrogène et 7 % d'hélium. Tous les autres éléments pris ensemble ne représentent pas plus de 0,16 %. L'hydrogène « brûle » en hélium, qui se transforme en éléments lourds. Ce processus vital a commencé à servir d’« horloge » pour déterminer l’âge de l’Univers ou son chronomètre. Si l'on en croit les calculs des scientifiques, il s'avère que notre Univers est très jeune. Ce concept a donné aux philosophes de la nature une raison de juger que l'idée de Newton du monde en tant que mécanisme est dépassée et qu'elle devrait être considérée, comme au début du bouddhisme, comme un organisme capable de génération spontanée, d'auto-développement et de transition vers d'autres. États. Cette position philosophique est proche en esprit de celle des médecins, puisqu’elle met en avant la « logique » de la vie de l’organisme en constante évolution du Cosmos. Ainsi, le phénomène bien connu de « décalage vers le rouge » des raies spectrales permet de comprendre comment, en raison d'une diminution de l'énergie et de la fréquence naturelle des photons en interaction avec les champs gravitationnels, lorsque la lumière se déplace pendant plusieurs millions d'années dans l'espace intergalactique , de nouvelles étoiles meurent et naissent.
Les changements évolutifs, bien sûr, traversent tous les objets cosmiques de l'Univers - galaxies, étoiles, planètes, y compris la Terre, qui est passée d'un corps cosmique « mort » à la biosphère - la région d'existence des corps vivants. Les activités de tous les organismes vivants et de la société humaine, a souligné l'éminent scientifique russe V.I. Vernadsky l'a qualifié de force géologique puissante et il a traité la pensée scientifique comme un phénomène cosmique. Dans l'un des chapitres précédents, nous avons déjà parlé de la théorie de Vernadsky, selon laquelle la biosphère doit nécessairement passer à un nouvel état - la noosphère (sphère de l'esprit). De nombreux points de ce concept philosophique méritent un examen particulièrement attentif. Le modèle proposé par Vernadsky donne une nouvelle évaluation de l'état actuel de l'Univers et donne aux penseurs des raisons de croire que l'espace-temps a son propre début objectif et aura donc sa propre fin objective, puisqu'avec la matière-rayonnement, il est né d’un certain « vide primaire ». Alors soit tout mourra dans un effondrement gravitationnel, soit le rayonnement de matière se dissipera dans un espace-temps « étiré » à l’infini.
Naturellement, toute personne réfléchie se pose une question philosophique : pourquoi les scientifiques rejettent-ils la version biblique de la création du monde à partir de rien en 7 jours au gré du Tout-Puissant comme étant fantastique et, sans aucun doute, acceptent-ils comme réalité la naissance de l'espace. -le temps, la matière-rayonnement, complètement par accident en quelques fractions de seconde ? , en réalité sous l'action d'une force « surnaturelle » ? Il ne s’agit pas tant d’une question religieuse que philosophique, impliquant une pensée critique et évaluative. En science et en médecine, l’esprit humain pénètre naturellement davantage dans les secrets des lois de l’Univers. En philosophie, à cet égard, une idée idéologique, humanitaire et morale fondamentalement nouvelle est née sur la compréhension des connaissances scientifiques modernes sur le monde. Les scientifiques et les philosophes ont été confrontés à la tâche de repenser radicalement les visions du monde établies. C'est le résultat d'une réflexion sur les informations reçues sur le monde, qui diffèrent à bien des égards des constructions scientifiques naturelles existantes. La philosophie, sans remplacer la science et sans corriger ses conclusions, s'efforce d'adopter une vision du monde et un point de vue axiologique par rapport à celles-ci.
Une compréhension critique (philosophique) de l'image scientifique du monde au niveau des idées scientifiques générales modernes qui viennent d'émerger n'est plus suffisante aujourd'hui, car elle l'identifie à la compréhension philosophique du développement personnel matériel, où une personne agit comme l'un des les fragments de l'existence de la matière, complétés et en même temps limités par la forme sociale du mouvement. Une telle compréhension du monde et de l'homme qui s'y trouve ne reflète pas tous les problèmes idéologiques liés à l'intégration des connaissances scientifiques dans l'image philosophique générale moderne de l'existence. Une vision axiologique particulière est requise, dans laquelle une personne se réalise non pas à la périphérie, mais au centre d'un monde intégral, ce qui présuppose l'évolution de divers niveaux structurels de la matière vers une forme rationnelle de son auto-mouvement (anthropocentrisme).
À notre époque, où, d'une part, dans les conditions du progrès scientifique et technologique, la connaissance purement rationnelle pénètre en grande quantité dans la conscience des masses et, d'autre part, la culture elle-même dissipe sans but sa précieuse énergie spirituelle, le La formation d’une nouvelle vision scientifique du monde est plus contradictoire et beaucoup plus complexe que jamais. Dans le cadre de cela, trop de types différents de raisonnements généraux, de directions originales et d'approches pour justifier l'essence et les formes de « reproduction » des problèmes philosophiques éternels sont apparus. Mais néanmoins, quelque chose de commun se révèle dans divers enseignements philosophiques lors de la compréhension critique des problèmes de l'existence humaine, de leurs implications sociales, ce qui permet de synthétiser des connaissances naturelles et humanitaires, des opinions, des jugements, etc. Rappelons le raisonnement des Kantiens selon lequel les problèmes philosophiques sont, dès le début, pour ainsi dire « ancrés » dans la conscience générique de l'homme. Ils n'existent généralement pas en eux-mêmes et sont a priori « donnés » à tout le monde ; c'est juste que pour certains philosophes ils « sonnent » plus nettement, tandis que pour d'autres c'est l'inverse. De là, nous pouvons conclure : la philosophie est un art particulier de l’esprit humain pour « voir » et comprendre différemment le monde de la nature, les choses et les phénomènes, leur connexion et interdépendance universelles.
Ainsi, la philosophie, ayant un statut de vision du monde dans la culture spirituelle, remplit de nombreux concepts, théories et idées des disciplines des sciences naturelles, y compris médicales, d'une signification particulière d'affirmation de la vie. Et étant un système des principes les plus généraux d'approche de l'étude spirituelle-intellectuelle de la réalité, il joue un rôle méthodologique (d'orientation). Il s'agit d'un désir ciblé de comprendre le rôle et l'importance de l'activité mentale humaine dans la connaissance et la transformation qualitative de l'Univers. Il est dommage qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore apprécié le pouvoir de la philosophie, qui consiste en une recherche mentale intense. pour la vérité, la conscience de la bonté et la compréhension de la beauté du monde. Nous devons encore nous interroger sur ces valeurs éternelles au 21e siècle, tant les philosophes professionnels que les médecins philosophes. Nous parlons des mêmes questions philosophiques de l'intégration de la connaissance scientifique, formant une image holistique du monde, des principes et de l'essence de l'Univers, du sens de la vie des gens, du potentiel de l'esprit humain. Cette connaissance nous permet de mieux comprendre et d'apprécier plus adéquatement les réalisations de la science moderne. Aujourd'hui, une telle fonction d'intégration est assurée par les principes scientifiques et philosophiques récemment développés de co-évolution universelle (N Moiseev). Ils permettent une prise en compte globale des problèmes fondamentaux de la mécanique, de la physique, de la chimie, de la biologie et de la médecine.
Le concept d'une image holistique du monde se transforme en un modèle abstrait (philosophique) qui aide à comprendre la « logique » du développement personnel de l'Univers. Ce concept philosophique stimule et active l'auto-amélioration de l'esprit humain, comprenant l'existence naturelle du monde inanimé et vivant. La compréhension philosophique du monde a commencé avec la construction d'une image physique de l'Univers. Avec cela, la science aujourd'hui s'en sort assez bien. Mais les horizons de la représentation scientifique et de la compréhension du monde physique de la nature sont en constante expansion Et par conséquent, jusqu'à présent, la science n'a pas été en mesure de relier le monde physique au monde sémantique. Et un tel besoin est attendu depuis longtemps - cela est reconnu par les représentants à l'esprit philosophique de toutes les sciences exactes. Le monde est un, ils ont à juste titre Nous croyons, bien qu’à la fois multidimensionnelle et très diversifiée. Sa multidimensionnalité est clairement « visible » à la surface des phénomènes et des événements. Cependant, elle n’est pas encore suffisamment développée d’un point de vue philosophique, n’épuisant pas tout le volume de l’existence. Néanmoins, la diversité du monde ne présuppose qu'une incohérence sémantique apparente. Ceci, pourrait-on dire, est irréductible. ité et conduit les scientifiques à la philosophie. Le phénomène de compréhension philosophique a nécessité un exploit incroyable de la part des scientifiques, le développement de la plus haute capacité à créer une image holistique de Après tout, le concept même de «l'image du monde» est, en principe, une science naturelle et comprend des dispositions sur la structure, la systématicité de l'Univers, mais en même temps, il s'avère être en dehors des limites du monde. sciences naturelles. Si un scientifique-philosophe s'efforce d'embrasser et de décrire mentalement le monde dans son ensemble, il doit y inclure non seulement la société, mais aussi les mondes problématiques (parfois paradoxaux), l'intelligence cosmique et bien plus encore.
L'image philosophique générale du monde contient des connaissances purement humaines : une attitude émotionnelle et morale envers le monde, son évaluation du point de vue des destinées des peuples, de l'humanité dans son ensemble. Il est impossible de calculer physiquement tous les paramètres de l'Univers, le nombre d'étoiles et de planètes qu'il contient. Selon l'estimation la plus prudente, elle comprend au moins un milliard de milliards (10 18) d'étoiles. Environ 10 millions de milliards (1 %) d’entre eux sont semblables à notre Soleil. Si nous supposons que seulement 1 % des étoiles comme le Soleil possèdent des systèmes planétaires, parmi lesquels se trouve au moins une planète similaire à notre Terre, il s’avère alors que des centaines de milliers de milliards de planètes pourraient abriter une vie similaire à la nôtre. Ce nombre est si énorme que la place de la Terre dans l’Univers semble très modeste. Voici un exemple de synthèse de la pensée scientifique et philosophique d'un astrophysicien moderne.
Comprenons maintenant la question posée d'un point de vue purement philosophique, c'est-à-dire en nous tournant vers la limite de l'existence pour la pensée humaine. Si nous sommes prêts à admettre (peut-être avec quelques doutes) la propagation à grande échelle de la vie dans l'Univers, alors il sera tout à fait naturel d'admettre mentalement (philosophiquement) la possibilité de l'existence illimitée de l'Esprit Universel, bien que dans différentes phases. de son développement. Considérant cette question d’un point de vue philosophique, il est logique de supposer que diverses cultures planétaires sont d’une manière ou d’une autre connectées entre elles dans la conscience cosmique. La prédisposition psychologique et spirituelle des gens aux fantasmes est capable d'amener jusqu'à l'absurdité l'idée du monde qui leur est révélée grâce aux méthodes scientifiques de cognition. Il semble que l'existence humaine prescrit aux gens deux choses opposées : d'une part, lutter, maîtriser le monde, y chercher un sens, atteindre la perfection spirituelle, et d'autre part, admettre que l'Univers, à partir de la substance dont nous sommes issus, est complètement indifférent à nos recherches. Il est sans âme dans son essence, destructeur dans ses « actions ». Il s’ensuit que la mentalité moderne de l’humanité aura besoin d’une manière particulière d’interpréter l’existence de l’Univers.
Il est cependant clair que le monde qui entoure l’homme est en train de changer radicalement à notre époque. Cela devient beaucoup plus complexe et dynamique. L'existant commence à s'écarter de l'évidence (spéculatif), comme dans le système héliocentrique de Copernic, et cesse donc d'être explicable au niveau de la pensée de la culture quotidienne et de ses paradigmatiques mythologiques. Cette culture cesse d'être suffisante pour l'adaptation humaine au nouveau monde. L’image religieuse statique du monde, avec son explication sacrée et irrationnelle de l’existence naturelle et sociale, de la place de l’homme dans ce monde, du sens, des objectifs et des normes de sa vie, est également insuffisante. La pensée scientifique fournit de nouvelles explications à des phénomènes sans ambiguïté dans leur caractère concret, impersonnel et mécaniste. La tâche de la philosophie moderne est étroitement liée au problème scientifique, qui repose sur le désir de construire et de justifier une image holistique du monde, conçue pour servir à l'orientation d'une personne conformément à ses idéaux de valeurs.
La tâche de la philosophie est de « rappeler » à la science avec sa vision visionnaire le système réellement existant de connexions objectives qui sous-tendent l’existence et la connaissance humaine. En ce sens, on peut parler de certaines fonctions prédictives de la philosophie par rapport aux sciences naturelles. Par exemple, les scientifiques modernes pensent que l’Univers est né d’un big bang. Cependant, il est intéressant de noter que la théorie du Big Bang a été dans une certaine mesure anticipée par l'intuitionniste A. Bergson dès 1907. L'auteur du livre « Creative Evolution » a émis l'hypothèse que le but de l'évolution n'est pas en avance, mais réside dans « l'explosion » initiale, à la suite de laquelle les processus de vie ont commencé. En réponse à un certain nombre de nouvelles demandes philosophiques, ainsi qu'aux fins de leur explication idéologique actualisée, les scientifiques ont fait des découvertes d'une importance énorme, qui n'impliquaient rien de moins qu'une vision fondamentalement différente de l'Univers.
La physique du XXIe siècle a posé de manière décisive la question : est-il possible de construire une image objective du monde qui existe indépendamment de la conscience humaine ? Le monde que les astronomes observent et par rapport auquel la physique théorique effectue ses calculs existe-t-il exactement sous la forme sous laquelle il apparaît aux humains ? Le scientifique M. Rewis écrit : « Les physiciens, confrontés à de nouvelles données expérimentales, ont abandonné pour toujours les modèles mécaniques rectilignes de l’Univers en faveur de l’idée selon laquelle l’esprit humain joue un rôle essentiel dans tous les événements physiques. » Je me souviens que les alchimistes cherchaient aussi, sans théorie développée, expérimentalement, c'est-à-dire empiriquement, à transformer certaines substances en d'autres. Ils croyaient sincèrement que tôt ou tard ils découvriraient une substance phénoménale, qu’ils présentaient comme une « pierre philosophale » à partir de laquelle toutes les autres pourraient être obtenues. Cette idée a été rejetée par la science théorique lorsqu’il est devenu clair que les éléments chimiques ne peuvent pas être décomposés à l’aide de méthodes chimiques conventionnelles.
Actuellement, l'évolution des éléments chimiques associée à leur décomposition due à des processus radioactifs a été découverte. Cela signifie que la pensée scientifique a pénétré non seulement dans des zones à grande échelle mesurées en millions d’années-lumière, mais également dans des zones de l’ordre de billionièmes de centimètre. Et c’est ici que des caractéristiques physiques et des propriétés chimiques fondamentalement différentes ont été découvertes. Ainsi, selon un certain nombre de physiciens modernes, la présence d’une certaine longueur fondamentale – un quantum d’espace – est possible. Considérer des distances inférieures à cette longueur est aussi dénué de sens que de parler, par exemple, d'une quantité de radium inférieure à un de ses atomes, car ce ne sera plus un élément chimique donné. Ainsi, les scientifiques admettent l’existence d’une sorte d’« espace » d’atomes. De là découle la reconnaissance par la philosophie d'un temps minimum, à l'intérieur duquel la notion de phase, c'est-à-dire de différences de temps, perd son sens. Du vaste champ des problèmes philosophiques de la science et des options pour ses solutions qui surgissent spontanément dans les limites de la culture intellectuelle de chaque époque historique, la science n'utilise que quelques idées et principes métaphysiques comme orientations. Nous parlons de lignes directrices selon lesquelles la science trouve des moyens de résoudre les problèmes de la vie qui se posent. L'écrivain français A. France (1844-1924) a noté avec humour que le modèle philosophique du monde est aussi semblable à l'Univers réel que, par exemple, un globe, sur lequel seules sont appliquées des lignes de longitude et de latitude, est semblable à l'Univers réel. La Terre elle-même. Et avec cette comparaison figurative, il a exprimé avec une précision surprenante l'essence de la philosophie, qui ne donne au scientifique que des lignes directrices générales, mais aussi réelles que des parallèles et des méridiens, non dessinés par personne sur Terre, mais étant néanmoins objectivement des indicateurs d'orientation sur le terrain.
Bien entendu, les potentiels heuristiques et prédictifs de la philosophie ne suppriment pas en eux-mêmes le problème de l’application pratique de ses idées et principes en science. Cette application présuppose un type particulier de recherche, dans lequel les structures catégorielles développées par la philosophie sont adaptées aux problèmes de la science. Ce processus est associé à la concrétisation des catégories, à leur transformation en idées et principes de l'image scientifique du monde et en principes méthodologiques exprimant les idéaux et les normes d'une science particulière. L'homme moderne ne peut s'empêcher de réfléchir au problème de son comportement sur Terre et dans l'espace. Mais sans un contrôle compétent des forces de la nature, il est impuissant à se contrôler. Réfléchissant philosophiquement sur lui-même et sur son destin, il cherche, à travers son propre esprit, à comprendre théoriquement la « logique » illogique de la matière qui le constitue. L'homme étudie constamment la nature qui l'entoure, la vie, ses manifestations dans l'Espace, cherche des moyens de la contrôler, veut l'améliorer.
Aujourd’hui, la science, dans son essence, devient entièrement anthropologique. En d'autres termes, l'approche anthropomorphique de l'étude de l'Univers conduit au fait que la connaissance scientifique la plus fondamentale devient une projection du monde de la nature humaine aléatoire et transitoire, car toute connaissance scientifique non seulement reflète la réalité objective, mais agit également comme une forme de manifestation des forces essentielles de l'homme. Tout ce qui est naturel, jusqu'au temps et à l'espace physiques, est désormais considéré comme quelque chose qui a une certaine signification par rapport à la position du connaisseur et du gestionnaire. L’homme devient désormais véritablement « la mesure de toutes choses ».