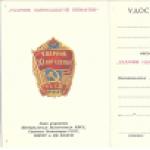Quels peuples ont habité l'empire du califat arabe sous Harun ar Rashid.
Prérequis historiques à l'émergence
Le noyau initial du califat était la communauté musulmane créée par le prophète Mahomet au début du 7e siècle à Hijaz (Arabie occidentale) - la ummah. À la suite des conquêtes musulmanes, un immense État a été créé, qui comprenait la péninsule arabique, l'Irak, l'Iran, la majeure partie de la Transcaucasie (en particulier les hauts plateaux arméniens, les territoires caspiens, la plaine de Colchis, ainsi que des régions de Tbilissi) , Asie centrale, Syrie, Palestine, Egypte, Afrique du Nord, la majeure partie de la péninsule ibérique, Sind.
De la fondation du califat () à la dynastie abbasside ()
Cette période comprend l'ère des 4 premiers califes, « marchant sur le droit chemin » (ar-râshidin) - Abu Bakr (632-634), Umar (634-644), Usman (644-656) et Ali (656-661 ) et la domination des Omeyyades (661-750).
conquêtes arabes
En taille, leur empire, qui s'est formé en moins de cent ans, dépassait celui de Rome, et cela s'avérait d'autant plus étonnant qu'au début, après la mort de Mahomet, on pouvait craindre que même les petits succès de l'Islam, qu'il a réalisé en Arabie, s'effondrerait. Muhammad, mourant, n'a laissé aucun héritier, et après sa mort (632) une dispute s'éleva entre les Mecquois et les Médinois sur la question de son successeur. Au cours des discussions, Abu Bakr a été choisi comme calife. Pendant ce temps, avec la nouvelle de la mort de Mahomet, presque toute l'Arabie, à l'exception de La Mecque, Médine et Taif, a immédiatement quitté l'islam. Avec l'aide de Médinois et de Mecquois croyants, Abou Bakr a pu ramener à l'Islam une Arabie vaste mais désunie; Surtout, le soi-disant Sayfullah «l'épée d'Allah» l'a aidé dans cette tâche - un commandant expérimenté Khalid ibn al-Walid, qui a vaincu le prophète il y a seulement 9 ans au mont Care; Khalid a vaincu la 40 000e armée des partisans du faux prophète Musailima dans le soi-disant. "clôture de la mort" à Akrab (633). Immédiatement après la pacification du soulèvement des Arabes, Abou Bakr, poursuivant la politique de Mahomet, les mena à la guerre contre les possessions byzantines et iraniennes.
Les limites du califat se sont quelque peu resserrées: les Omeyyades survivants Abd ar-Rahman I ont jeté les premières bases en Espagne () d'un émirat indépendant de Cordoue, qui depuis 929 est officiellement intitulé "califat" (929-). 30 ans plus tard, Idris, l'arrière-petit-fils du calife Ali et donc également hostile aux Abbassides et aux Omeyyades, fonde au Maroc la dynastie alide des Idrisides (-) dont la capitale est la ville de Tudga ; le reste de la côte septentrionale de l'Afrique (Tunisie, etc.) fut en effet perdu au profit du Califat abbasside, lorsque le gouverneur d'Aghlab, nommé par Harun ar-Rashid, fut le fondateur de la dynastie Aghlabide à Kairouan (-). Les Abbassides n'ont pas jugé nécessaire de reprendre leur politique étrangère agressive contre les chrétiens ou d'autres pays, et bien que des affrontements militaires aient surgi de temps à autre aux frontières est et nord (comme les deux campagnes infructueuses de Mamun contre Constantinople), cependant, en général, le califat vivait paisiblement.
On note une caractéristique des premiers Abbassides telle que leur cruauté despotique, sans cœur et, de plus, souvent insidieuse. Parfois, comme pour le fondateur de la dynastie, elle était un objet ouvert de la fierté du calife (le surnom "Bloodshed" a été choisi par Abu-l-Abbas lui-même). Certains des califes, du moins le rusé al-Mansur, qui aimait à se vêtir devant le peuple des vêtements hypocrites de la piété et de la justice, préféraient, dans la mesure du possible, agir par tromperie et exécuter des personnes dangereuses en cachette, en berçant d'abord leur prudence avec les serments et les grâces. Avec al-Mahdi et avec Harun ar-Rashid, la cruauté a été obscurcie par leur générosité, cependant, le renversement perfide et féroce de la famille vizir des Barmakids, extrêmement utile pour l'État, mais imposant une certaine bride au souverain, est pour Harun l'un des actes les plus dégoûtants du despotisme oriental. Il faut ajouter que sous les Abbassides, un système de torture a été introduit dans les procédures judiciaires. Même le philosophe religieusement tolérant Mamun et ses deux successeurs ne sont pas trop exempts du reproche de tyrannie et de dureté de cœur envers les personnes qui leur sont désagréables. Kremer trouve (Culturgesch. d. Or., II, 61 ; comparer Müller : Historical Isl., II, 170) que les tout premiers Abbassides montrent des signes de folie césarienne héréditaire, qui s'intensifie encore plus chez les descendants.
A titre de justification, on ne peut que dire que pour réprimer l'anarchie chaotique dans laquelle se trouvaient les pays de l'islam lors de l'établissement de la dynastie abbasside, inquiétée par les adhérents des Omeyyades renversés, contournés Alids, Kharijites prédateurs et divers sectaires persans de des mesures terroristes radicales étaient peut-être une simple nécessité. Apparemment, Abu-l-Abbas a compris le sens de son surnom "Bloodshed". Grâce à la formidable centralisation que l'homme sans cœur mais le brillant politicien al-Mansur a réussi à introduire, les sujets ont pu jouir de la paix intérieure, et les finances de l'État ont été mises en place de manière brillante. Même le mouvement scientifique et philosophique dans le califat remonte au même cruel et insidieux Mansur (Masudi : "Golden Meadows"), qui, malgré son avarice notoire, traitait la science avec encouragement (c'est-à-dire, avant tout, des objectifs pratiques et médicaux) . Mais, d'un autre côté, il reste incontestable que l'épanouissement du califat n'aurait guère été possible si Saffah, Mansur et leurs successeurs gouvernaient l'État directement, et non par l'intermédiaire de la talentueuse famille de vizirs des Barmakides des Perses. Jusqu'à ce que cette famille soit renversée () par le déraisonnable Harun ar-Rashid, accablé par sa tutelle, certains de ses membres étaient les premiers ministres ou proches conseillers du calife de Bagdad (Khalid, Yahya, Jafar), d'autres occupaient des postes gouvernementaux importants dans les provinces (comme Fadl), et tous ensemble sont parvenus, d'une part, à maintenir pendant 50 ans l'équilibre nécessaire entre Perses et Arabes, qui a donné au califat sa forteresse politique, et d'autre part, à restaurer l'antique sassanide vie, avec sa structure sociale, avec sa culture, avec son mouvement mental.
"L'âge d'or" de la culture arabe
Cette culture est généralement appelée arabe, car l'organe de la vie mentale pour tous les peuples du califat est devenu la langue arabe, - c'est pourquoi ils disent : "Arabe art", "Arabe sciences », etc. ; mais en substance, il s'agissait principalement des vestiges de la culture sassanide et ancienne perse en général (qui, comme on le sait, a également beaucoup adopté de l'Inde, de l'Assyrie, de Babylone et, indirectement, de la Grèce). Dans les parties occidentales asiatiques et égyptiennes du califat, nous observons le développement des vestiges de la culture byzantine, tout comme en Afrique du Nord, en Sicile et en Espagne - la culture des romains et des romano-espagnols - et leur homogénéité est imperceptible, si l'on exclut le lien qui les relie - la langue arabe. On ne peut pas dire que la culture étrangère héritée du califat s'est élevée qualitativement sous les Arabes: les bâtiments architecturaux irano-musulmans sont plus bas que les anciens parsis, de même, les produits musulmans en soie et en laine, les ustensiles ménagers et les bijoux, malgré leur charme, sont inférieur aux produits anciens.
Mais d'autre part, à l'époque musulmane abbasside, dans un vaste État uni et ordonné, avec des voies de communication soigneusement aménagées, la demande d'articles de fabrication iranienne a augmenté et le nombre de consommateurs a augmenté. Les relations pacifiques avec les voisins ont permis de développer un remarquable commerce extérieur de troc : avec la Chine par le Turkestan et - par mer - par l'archipel indien, avec les Bulgares de la Volga et la Russie par le royaume des Khazars, avec l'émirat espagnol, avec tout le Sud L'Europe (à l'exception peut-être de Byzance), avec les côtes orientales de l'Afrique (d'où, tour à tour, l'ivoire et les noirs étaient exportés), etc. Le principal port du califat était Bassorah. Le marchand et l'industriel sont les personnages principaux des contes arabes ; divers hauts fonctionnaires, chefs militaires, scientifiques, etc. n'ont pas honte d'ajouter à leurs titres le surnom d'Attar ("moskateur"), Heyat ("tailleur"), Javhariy ("bijoutier"), etc. Cependant, la nature de l'industrie islamo-iranienne n'est pas tant la satisfaction de besoins pratiques que le luxe. Les principaux articles de production sont les tissus de soie (mousseline, satin, moiré, brocard), les armes (sabres, poignards, cottes de mailles), les broderies sur toile et cuir, les ouvrages tressés, les tapis, les châles, les ivoires et métaux ciselés, gravés, sculptés, mosaïques, faïences et verrerie; moins souvent des articles purement pratiques - papier, tissu et laine de chameau.
Le bien-être de la classe agricole (pour des raisons pourtant imposables, non démocratiques) a été relevé par la restauration des canaux d'irrigation et des barrages, qui ont été lancés sous les derniers Sassanides. Mais même selon la conscience des écrivains arabes eux-mêmes, les califes n'ont pas réussi à amener la capacité de paiement du peuple à un niveau tel que celui atteint par le système fiscal de Khosrow I Anushirvan, bien que les califes aient ordonné que les livres cadastraux sassanides soient traduits en arabe à dessein à cet effet.
L'esprit persan s'empare également de la poésie arabe, qui désormais, à la place des chants bédouins, donne les œuvres raffinées du basrien Abu Nuwas ("arabe Heine") et d'autres poètes de cour Harun ar-Rashid. Apparemment, non sans influence persane (Brockelman : "Gesch. d. arab. Litt.", I, 134) une historiographie correcte se pose, et après la "Vie de l'Apôtre" compilée par Ibn Ishak pour Mansur, un certain nombre d'historiens laïques apparaissent également. Du persan, Ibn al-Mukaffa (vers 750) traduit le "Livre des rois" sassanide, l'adaptation pahlavi des paraboles indiennes sur "Kalila et Dimna" et diverses œuvres philosophiques gréco-syro-persanes, que Bassora, Kufa obtiennent tout d'abord connaître, puis et Bagdad. La même tâche est accomplie par des personnes d'une langue plus proche des Arabes, les anciens sujets persans des chrétiens araméens de Jondishapur, Harran, etc. De plus, Mansur s'occupe également de la traduction en arabe du grec médical, et en même temps travaux mathématiques et philosophiques (Masudi: "Golden Meadows") . Harun donne les manuscrits apportés des campagnes d'Asie Mineure pour traduction au médecin Jondishapur John ibn Masaveih (qui s'est même engagé dans la vivisection et était alors médecin de la vie pour Mamun et ses deux successeurs), et Mamun a arrangé, déjà spécifiquement à des fins philosophiques abstraites, un conseil spécial de traduction à Bagdad et a attiré des philosophes (Kindi). Sous l'influence de la philosophie gréco-syro-persane, le travail de commentaire sur l'interprétation du Coran se transforme en philologie arabe scientifique (Basrian Khalil, Basrian Persian Sibaveyhi ; le professeur de Mamun est le Kufi Kisviy) et la création de la grammaire arabe, la collection philologique d'œuvres de la littérature populaire préislamique et omeyyade (Muallakat, Hamasa, poèmes Khozeilit, etc.).
L'âge des premiers Abbassides est aussi connu comme une période de plus haute tension de la pensée religieuse de l'islam, comme une période de fort mouvement sectaire : les Perses, qui se convertissent alors massivement à l'islam, intègrent presque complètement la théologie musulmane dans leur propres mains et a suscité une lutte dogmatique animée, parmi lesquelles les sectes hérétiques, décrites même sous Les Omeyyades, ont reçu leur développement, et la théologie-jurisprudence orthodoxe a été définie sous la forme de 4 écoles, ou interprétations: sous Mansur - le plus progressiste Abu Hanifa à Bagdad et le conservateur Malik à Médine, sous Harun - le relativement progressiste ash-Shafi'i, sous Mamun - ibn Hanbal. L'attitude du gouvernement envers ces orthodoxies n'a pas toujours été la même. Sous Mansur, un partisan des Mu'tazilites, Malik a été fouetté jusqu'à la mutilation. Puis, durant les 4 règnes suivants, l'orthodoxie prévalut, mais lorsque Mamun et ses deux successeurs élevèrent (depuis 827) le mutazilisme au rang de religion d'État, les adeptes des interprétations orthodoxes furent soumis à des persécutions officielles pour « anthropomorphisme », « polythéisme », etc., et sous al-Mu'tasim a été fouetté et torturé par le saint imam ibn-Hanbal (). Bien sûr, les califes pouvaient sans crainte fréquenter la secte mu'tazilite, car sa doctrine rationaliste du libre arbitre de l'homme et de la création du Coran et son penchant pour la philosophie ne pouvaient sembler politiquement dangereux. Aux sectes à caractère politique, comme, par exemple, les Kharijites, les Mazdakites, les chiites extrémistes, qui soulevaient parfois des soulèvements très dangereux (le faux prophète Moqanna au Khorasan sous al-Mahdi, 779, le brave Babek en Azerbaïdjan sous Mamun et al -Mutasim, etc. ), l'attitude des califes était répressive et impitoyable même à l'époque du pouvoir suprême du califat.
Chute du califat
Perte du pouvoir politique des califes
Les témoins de la désintégration progressive de X. étaient des califes : le déjà mentionné Mutawakkil (847-861), l'Arabe Néron, très apprécié par les orthodoxes ; son fils Muntasir (861-862), qui monta sur le trône, ayant tué son père avec l'aide des gardes turcs, Mustain (862-866), Al-Mutazz (866-869), Mukhtadi I (869-870), Mutamid (870-892), Mutadid (892-902), Muktafi I (902-908), Muktadir (908-932), Al-Qahir (932-934), Al-Radi (934-940), Muttaqi (940 -944), Mustakfi (944-946). En leur personne, le calife est passé du dirigeant d'un vaste empire au prince d'une petite région de Bagdad, à l'inimitié et à la réconciliation avec ses voisins parfois plus forts, parfois plus faibles. À l'intérieur de l'État, dans leur capitale Bagdad, les califes sont devenus dépendants de la magistrale garde prétorienne turque, que Mutasim (833) a jugé bon de former. Sous les Abbassides, l'identité nationale des Perses renaît (Goldzier : « Muh. Stud. », I, 101-208). L'extermination imprudente par Harun des Barmakids, qui savaient rallier l'élément persan à l'arabe, a conduit à la discorde entre les deux peuples. Sous Mamun, le fort séparatisme politique de la Perse s'exprime dans la fondation de la dynastie tahiride au Khorasan (821-873), qui s'avère être le premier symptôme de la sécession imminente de l'Iran. Après les Tahirides (821-873), des dynasties indépendantes naquirent : les Saffarides (867-903 ; voir), les Samanides (875-999 ; voir), les Ghaznavides (962-1186 ; voir), et la Perse échappa aux mains de les califes. En Occident, l'Egypte, avec la Syrie, fit sécession sous le règne des Tulunides (868-905) ; Certes, après la chute des Tulunides, la Syrie et l'Égypte furent à nouveau sous le contrôle des gouverneurs abbassides pendant 30 ans ; mais en 935 Ikhshid fonda sa dynastie (935-969), et depuis lors pas une seule région à l'ouest de l'Euphrate (La Mecque et Médine appartenaient également aux Ikhshids) n'était soumise au pouvoir séculier des califes de Bagdad, bien que leurs droits en tant que spirituel les souverains étaient reconnus partout (sauf, bien sûr, l'Espagne et le Maroc) ; une pièce de monnaie était frappée à leur nom et une prière publique (khutba) était lue.
Persécution de la libre pensée
Sentant leur affaiblissement, les califes (les premiers - Al-Mutawakkil, 847) décidèrent qu'ils devaient gagner un nouveau soutien pour eux-mêmes - dans le clergé orthodoxe, et pour cela - renoncer à la libre pensée mutazilite. Ainsi, depuis l'époque de Mutawakkil, parallèlement à l'affaiblissement progressif du pouvoir des califes, il y a eu une augmentation de l'orthodoxie, la persécution des hérésies, de la libre pensée et de l'hétérodoxie (chrétiens, juifs, etc.), la persécution religieuse de la philosophie , sciences naturelles et même exactes. Une puissante nouvelle école de théologiens, fondée par Abul-Hasan al-Ash'ari (874-936), qui a quitté le mu'taziliteisme, mène des polémiques scientifiques avec la philosophie et la science profane et gagne l'opinion publique. Cependant, en fait, pour tuer le mouvement mental des califes, avec leur pouvoir politique de plus en plus décroissant, ils n'ont pas pu, et les philosophes arabes les plus glorieux (les encyclopédistes Basri, Farabi, Ibn Sina) et d'autres scientifiques ont vécu sous la sous les auspices des souverains vassaux justement en ce qu'à l'époque (-c.), lorsqu'officiellement à Bagdad, dans le dogme islamique et dans l'opinion des masses, la philosophie et les sciences non scolastiques étaient reconnues comme impies ; et la littérature vers la fin de ladite époque a produit le plus grand poète arabe libre-penseur Ma'arri (973-1057) ; dans le même temps, le soufisme, qui s'était très bien enraciné dans l'islam, avec nombre de ses représentants persans, est passé à une libre-pensée complète.
Califat du Caire
Les derniers califes de la dynastie abbasside
Le calife abbasside, c'est-à-dire, par essence, un petit prince de Bagdad avec un titre, était un jouet entre les mains de ses commandants turcs et de ses émirs mésopotamiens : sous Al-Radi (934-941), une position spéciale de maire (« émir -al-umarâ ») a été établie. Pendant ce temps, dans les environs, dans l'ouest de la Perse, la dynastie chiite des Bouyides, qui s'était séparée des Samanides en 930, avançait (voir). En 945, les Buyids ont capturé Bagdad et l'ont possédée pendant plus de cent ans, avec le titre de sultans, et à cette époque il y avait des califes nominaux : Mustakfi (944-946), Al-Muti (946-974), Al- Taï (974-991), Al-Qadir (991-1031) et Al-Qaim (1031-1075). Bien que par calculs politiques, pour contrebalancer les Fatimides, les sultans-Buids chiites se sont appelés vassaux, "émirs al-umar" du califat sunnite de Bagdad, mais, en substance, ils ont traité les califes comme des prisonniers, avec un manque de respect et un mépris absolus, philosophes patronnés et sectaires libres penseurs, et à Bagdad même, le chiisme a fait des progrès.
Invasion seldjoukide
Une lueur d'espoir pour se débarrasser des oppresseurs éclaira les califes en la personne du nouveau conquérant, le sultan turc Mahmud Ghaznevi (997-1030), qui, après avoir créé son propre immense sultanat à la place de l'État samanide qu'il avait renversé, se montra un ardent sunnite et introduisit partout l'orthodoxie ; cependant, il a enlevé les médias et certains autres biens uniquement aux petits Buyids et a évité les affrontements avec les principaux Buyids. Sur le plan culturel, les campagnes de Mahmud se révélèrent très désastreuses pour les pays qu'il conquit, et en 1036 un terrible malheur frappa toute l'Asie musulmane : les Turcs seldjoukides commencèrent leurs conquêtes dévastatrices et portèrent le premier coup mortel à la civilisation musulmane asiatique. , déjà secoué par les Turcs Ghaznévides . Mais les califes s'améliorèrent: en 1055, le chef des Seldjoukides, Togrul-bek, entra à Bagdad, libéra le calife du pouvoir des Bouyides hérétiques et, à leur place, il devint lui-même sultan; en 1058, il accepta solennellement une investiture d'Al-Qa'im et l'entoura de signes extérieurs de révérence. Al-Qaim (décédé en 1075), Mukhtadi II (1075-1094) et Al-Mustazhir (1094-1118) vivaient dans le contentement matériel et le respect, en tant que représentants de l'église musulmane, et Al-Mustarshid (1118-1135) Seljukid Mas 'ud a accordé à Bagdad et à la majeure partie de l'Irak un gouvernement laïc indépendant, qui est resté avec ses successeurs : Ar-Rashid (1135-1136), Al-Muktafi (1136-1160), Al-Mustanjid (1160-1170) et Al-Mustadi ( 1170) -1180).
La fin de X. Fatimide, tant détesté par les Abbassides, fut mise par le fidèle sunnite Saladin (1169-1193). La dynastie ayyoubide égypto-syrienne (1169-1250) fondée par lui honora le nom du calife de Bagdad.
Invasion mongole
Profitant de la faiblesse de la dynastie seldjoukide désintégrée, l'énergique calife An-Nasir (1180-1225) décida d'élargir les frontières de son petit Bagdad Kh. et osa lutter contre le puissant Khorezmshah Muhammad ibn Tekesh, qui s'avança à la place des Seljukides. ibn Tekesh a ordonné une réunion de théologiens pour transférer X. du clan d'Abbas au clan d'Ali et a envoyé des troupes à Bagdad (1217-1219), et An-Nasir a envoyé une ambassade aux Mongols de Gengis Khan, les invitant à envahir Khorezm. Ni An-Nasir (mort en 1225) ni le Calife Az-Zahir (1220-1226) ne virent la fin de la catastrophe qu'ils avaient provoquée, qui détruisit culturellement, matériellement et mentalement les pays islamiques d'Asie. Les derniers califes de Bagdad étaient Al-Mustansir (1226-1242) et le complètement insignifiant et médiocre Al-Mustasim (1242-1258), qui en 1258 a cédé la capitale aux Mongols Hulagu et a été exécuté 10 jours plus tard avec la plupart des membres. de sa dynastie. L'un d'eux s'enfuit en Egypte, et là le sultan mamelouk Baibars (-), afin d'avoir un soutien spirituel pour son sultanat, l'éleva au rang de « calife » sous le nom de Mustansir (). Les descendants de cet abbasside restèrent califes nominaux sous les sultans du Caire jusqu'à ce que le pouvoir des Mamelouks soit renversé par le conquérant ottoman Selim Ier (1517). Afin d'avoir toutes les données officielles de leadership spirituel sur l'ensemble du monde islamique, Selim I a forcé le dernier de ces califes et le dernier de la famille abbasside, Motawakkil III, à renoncer solennellement à ses droits et à son titre de calife en faveur de
Dans les anciennes sources russes, il est également connu sous les noms Royaume d'Agaria et Royaume d'Ismaël, qui l'inclut ainsi dans la liste générale des royaumes (empires) du monde connus des livresques en Russie de cette époque.
YouTube encyclopédique
1 / 5
✪ Califat arabe (russe) Histoire du Moyen Âge.
✪ Califat arabe/brièvement
✪ Califat arabe et son effondrement. 6 cellules Histoire du Moyen Age
✪ Islam, Arabes, Califat
✪ Histoire| Conquêtes islamiques et califat arabe
Les sous-titres
Communauté de Médine
Le noyau initial du califat était la communauté musulmane, la ummah, créée par le prophète Mahomet au début du VIIe siècle au Hijaz (Arabie occidentale). Initialement, cette communauté était petite et était une formation proto-étatique de nature super-religieuse, similaire à l'état mosaïque ou aux Premières Communautés du Christ. À la suite des conquêtes musulmanes, un immense État a été créé, qui comprenait la péninsule arabique, l'Irak, l'Iran, la majeure partie de la Transcaucasie (en particulier les hauts plateaux arméniens, les territoires caspiens, les basses terres de Colchis, ainsi que des régions de Tbilissi) , Asie centrale, Syrie, Palestine, Egypte, Afrique du Nord, la majeure partie de la péninsule ibérique, Sind.
Califat juste (632-661)
Après la mort du prophète Mahomet en 632, le califat juste a été créé. Il était dirigé par quatre califes justes : Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan et Ali ibn Abu Talib. Pendant leur règne, la péninsule arabique, le Levant (Sham), le Caucase, une partie de l'Afrique du Nord de l'Égypte à la Tunisie et les hauts plateaux iraniens ont été inclus dans le califat.
Califat omeyyade (661-750)
La position des peuples non arabes du califat
En payant une taxe foncière (kharaj) en échange de la protection et de l'immunité de l'État musulman, ainsi qu'une taxe d'entrée (jizya), les Gentils avaient le droit de pratiquer leur religion. Même les décrets précités de "Umar, il a été fondamentalement reconnu que la loi de Muhammad n'est armée que contre les polythéistes païens ; les "gens de l'Écriture" - chrétiens, juifs - peuvent, en payant une redevance, rester dans leur religion ; en comparaison avec les Byzance, où toute hérésie chrétienne était persécutée, la loi islamique, même sous Omar, était relativement libérale.
Étant donné que les conquérants n'étaient pas du tout préparés à des formes complexes d'administration de l'État, même "Umar a été contraint de préserver l'ancien mécanisme d'État byzantin et iranien bien établi pour l'énorme État nouvellement formé (avant Abdul-Malik, même le bureau n'était pas conduit en arabe), - et donc les gentils n'ont pas été privés d'accès à de nombreux postes gouvernementaux. pendant son temps ou après lui; -Malik et ses courtisans proches de lui étaient chrétiens (l'exemple le plus célèbre est le Père Jean de Damas).Néanmoins, parmi les peuples conquis, il y avait une grande tendance à renoncer à leur ancienne foi -chrétienne et Parsi- et accepter volontairement l'Islam. loi de 700, ne payait pas d'impôts ; au contraire, selon la loi d'Omar, il recevait un salaire annuel du gouvernement et était complètement égal aux gagnants; des postes gouvernementaux supérieurs lui ont été offerts.
D'autre part, les vaincus devaient se convertir à l'islam aussi par conviction intime ; - comment expliquer autrement l'adoption massive de l'islam, par exemple, par ces chrétiens hérétiques qui, auparavant, dans le royaume de Khosrov et dans l'empire byzantin, ne pouvaient être détournés de la foi de leurs pères par aucune persécution? Évidemment, l'islam, avec ses dogmes simples, parlait assez bien à leur cœur. De plus, l'Islam n'apparaissait pas aux chrétiens, ni même aux Parsis, comme une sorte d'innovation abrupte : en bien des points il était proche des deux religions. On sait que pendant longtemps l'Europe n'a vu dans l'islam, vénérant hautement Jésus-Christ et la Sainte Vierge, rien de plus qu'une des hérésies chrétiennes (par exemple, l'archimandrite arabe orthodoxe Christopher Zhara a soutenu que la religion de Mahomet est la même arianisme )
L'adoption de l'islam par les chrétiens puis - ensuite - par les Iraniens a eu des conséquences extrêmement importantes, tant religieuses qu'étatiques. L'Islam, au lieu d'Arabes indifférents, a acquis chez ses nouveaux adeptes un tel élément pour lequel croire était un besoin essentiel de l'âme, et comme c'étaient des gens instruits, ils (les Perses beaucoup plus que les chrétiens) se sont engagés à la fin de cette période avec le traitement scientifique de la théologie musulmane et, combiné avec lui la jurisprudence, sujets qui jusque-là n'avaient été que modestement développés par un petit cercle d'Arabes musulmans qui, sans aucune sympathie de la part du gouvernement omeyyade, restaient fidèles aux enseignements du prophète.
Il a été dit plus haut que l'esprit général qui a imprégné le califat au premier siècle de son existence était le vieil arabe (ce fait, beaucoup plus clair encore que dans la réaction du gouvernement omeyyade contre l'islam, s'est exprimé dans la poésie d'alors, qui a continué à se développer brillamment les mêmes thèmes païens tribaux et gais qui étaient également décrits dans les poèmes en vieil arabe). Pour protester contre le retour aux traditions préislamiques, un petit groupe de compagnons (« sahabs ») du prophète et de leurs héritiers (« tabiins ») s'est formé, qui a continué à observer les préceptes de Mahomet, conduit dans le silence du capitale qu'elle a quittée - Médine et dans certains endroits dans d'autres lieux du travail théorique du Califat sur l'interprétation orthodoxe du Coran et sur la création d'une sunna orthodoxe, c'est-à-dire sur la définition des traditions véritablement musulmanes, selon lesquelles le il faudrait reconstruire la vie impie du contemporain Omeyyade X. Ces traditions, qui prônaient entre autres la destruction du principe tribal et l'unification égalitaire de tous les musulmans au sein de la religion musulmane, sont parvenues aux étrangers nouvellement convertis. , évidemment, au cœur plus que l'attitude anti-islamique arrogante des sphères arabes dirigeantes, et donc l'école théologique de Médine, bouchée, ignorée par les Arabes purs et le gouvernement, a trouvé un soutien actif dans les nouveaux musulmans non arabes.
Il y avait peut-être des inconvénients bien connus pour la pureté de l'islam de la part de ces nouveaux adeptes croyants : en partie inconsciemment, en partie même consciemment, des idées ou des tendances ont commencé à s'y glisser, étrangères ou inconnues de Mahomet. Probablement, l'influence des chrétiens (A. Müller, « Ist. Isl. », II, 81) explique l'apparition (à la fin du VIIe siècle) de la secte Murjiites, avec sa doctrine de l'incommensurable miséricordieux longanimité du Seigneur. , et la secte Kadarite, qui est la doctrine du libre arbitre de l'homme, a préparé le triomphe des Mu'tazilites ; probablement, le monachisme mystique (sous le nom de soufisme) a d'abord été emprunté par les musulmans aux chrétiens syriens (A. f. Kremer "Gesch. d. herrsch. Ideen", 57); dans le bas En Mésopotamie, des chrétiens musulmans convertis ont rejoint les rangs de la secte républicaine-démocrate des Kharijites, également opposée au gouvernement incrédule omeyyade et aux croyants orthodoxes médinois.
Un avantage encore plus à double tranchant dans le développement de l'islam a été la participation des Perses, qui est venue plus tard, mais plus activement. Une partie importante d'entre eux, ne pouvant se débarrasser de l'ancienne vision perse séculaire selon laquelle la «grâce royale» (farrahi kayaniq) ne se transmet que par l'hérédité, a rejoint la secte chiite (voir), qui se tenait derrière la dynastie Ali ( époux de Fatima, fille du prophète) ; d'ailleurs, défendre les héritiers directs du prophète signifiait pour les étrangers constituer une opposition purement légale contre le gouvernement omeyyade, avec son désagréable nationalisme arabe. Cette opposition théorique prit un sens bien réel lorsque Umar II (717-720), le seul des Omeyyades dévoué à l'islam, s'avisa de mettre en œuvre les principes du Coran favorables aux musulmans non arabes et, ainsi, a introduit la désorganisation dans le système de gouvernement omeyyade.
30 ans plus tard, les Perses chiites du Khorasan ont renversé la dynastie des Omeyyades (dont les restes ont fui vers l'Espagne ; voir l'article connexe). Certes, en raison de la ruse des Abbassides, le trône de X. est allé (750) non pas aux Alids, mais aux Abbassides, également parents du prophète (Abbas est son oncle; voir l'article correspondant), mais, en tout cas Dans ce cas, les attentes des Perses étaient justifiées : sous les Abbassides, ils reçurent un avantage d'État et lui insufflèrent un nouveau souffle. Même la capitale de X. a été déplacée aux frontières de l'Iran: d'abord - à Anbar, et depuis l'époque d'Al-Mansur - encore plus près, à Bagdad, presque aux mêmes endroits où se trouvait la capitale des Sassanides; et pendant un demi-siècle, les membres de la famille des vizirs des Barmakides, descendants de prêtres persans, devinrent les conseillers héréditaires des califes.
Califat abbasside (750-945, 1124-1258)
Premiers Abbassides
Les limites du califat se sont quelque peu rétrécies: les Omeyyades survivants Abd ar-Rahman I ont jeté les premières bases en Espagne () d'un émirat indépendant de Cordoue, qui depuis 929 est officiellement intitulé "califat" (929-). 30 ans plus tard, Idris, l'arrière-petit-fils du calife Ali et donc également hostile aux Abbassides et aux Omeyyades, fonde au Maroc la dynastie alide des Idrisides (-) dont la capitale est la ville de Tudga ; le reste de la côte septentrionale de l'Afrique (Tunisie, etc.) fut en effet perdu au profit du Califat abbasside, lorsque le gouverneur d'Aghlab, nommé par Harun ar-Rashid, fut le fondateur de la dynastie Aghlabide à Kairouan (-). Les Abbassides n'ont pas jugé nécessaire de reprendre leur politique étrangère agressive contre les chrétiens ou d'autres pays, et bien que des affrontements militaires aient surgi de temps à autre aux frontières est et nord (comme les deux campagnes infructueuses de Mamun contre Constantinople), cependant, en général, le califat vivait paisiblement.
On note une caractéristique des premiers Abbassides telle que leur cruauté despotique, sans cœur et, de plus, souvent insidieuse. Parfois, comme pour le fondateur de la dynastie, elle était un objet ouvert de la fierté du calife (le surnom "Bloodshed" a été choisi par Abu-l-Abbas lui-même). Certains des califes, du moins le rusé al-Mansur, qui aimait à se vêtir devant le peuple des vêtements hypocrites de la piété et de la justice, préféraient, dans la mesure du possible, agir par tromperie et exécuter des personnes dangereuses en cachette, en berçant d'abord leur prudence avec les serments et les grâces. Avec al-Mahdi et avec Harun ar-Rashid, la cruauté a été obscurcie par leur générosité, cependant, le renversement perfide et féroce de la famille vizir des Barmakids, extrêmement utile pour l'État, mais imposant une certaine bride au souverain, est pour Harun l'un des actes les plus dégoûtants du despotisme oriental. Il faut ajouter que sous les Abbassides, un système de torture a été introduit dans les procédures judiciaires. Même le philosophe religieusement tolérant Mamun et ses deux successeurs ne sont pas trop exempts du reproche de tyrannie et de dureté de cœur envers les personnes qui leur sont désagréables. Kremer trouve (Culturgesch. d. Or., II, 61 ; comparer Müller : Historical Isl., II, 170) que les tout premiers Abbassides montrent des signes de folie césarienne héréditaire, qui s'intensifie encore plus chez les descendants.
A titre de justification, on ne peut que dire que pour réprimer l'anarchie chaotique dans laquelle se trouvaient les pays de l'islam lors de l'établissement de la dynastie abbasside, inquiétée par les adhérents des Omeyyades renversés, contournés Alids, Kharijites prédateurs et divers sectaires persans de des mesures terroristes radicales étaient peut-être une simple nécessité. Apparemment, Abu-l-Abbas a compris le sens de son surnom "Bloodshed". Grâce à la formidable centralisation que l'homme sans cœur, mais le brillant politicien al-Mansur, a réussi à introduire, les sujets ont pu jouir de la paix intérieure, et les finances de l'État ont été mises en place d'une manière brillante.
Même le mouvement scientifique et philosophique dans le califat remonte au même cruel et insidieux Mansur (Masudi : "Golden Meadows"), qui, malgré son avarice notoire, traitait la science avec encouragement (c'est-à-dire, avant tout, des objectifs pratiques et médicaux) . Mais, d'un autre côté, il reste incontestable que l'épanouissement du califat n'aurait guère été possible si Saffah, Mansur et leurs successeurs gouvernaient l'État directement, et non par l'intermédiaire de la talentueuse famille de vizirs des Barmakides des Perses. Jusqu'à ce que cette famille soit renversée () par le déraisonnable Harun ar-Rashid, accablé par sa tutelle, certains de ses membres étaient les premiers ministres ou proches conseillers du calife de Bagdad (Khalid, Yahya, Jafar), d'autres occupaient des postes gouvernementaux importants dans les provinces (comme Fadl), et tous ensemble sont parvenus, d'une part, à maintenir pendant 50 ans l'équilibre nécessaire entre Perses et Arabes, qui a donné au califat sa forteresse politique, et d'autre part, à restaurer l'antique sassanide vie, avec sa structure sociale, avec sa culture, avec son mouvement mental.
"L'âge d'or" de la culture arabe
Cette culture est généralement appelée arabe, car la langue arabe est devenue l'organe de la vie mentale pour tous les peuples du califat, - c'est pourquoi ils disent : "Arabe art", "Arabe sciences », etc. ; mais en substance, il s'agissait principalement des vestiges de la culture sassanide et, en général, de la culture de la vieille perse (qui, comme on le sait, a également adopté une grande partie de l'Inde, de l'Assyrie, de Babylone et, indirectement, de la Grèce). Dans les parties occidentales asiatiques et égyptiennes du califat, nous observons le développement des vestiges de la culture byzantine, tout comme en Afrique du Nord, en Sicile et en Espagne - la culture des romains et des romano-espagnols - et leur homogénéité est imperceptible, si l'on exclut le lien qui les relie - la langue arabe. On ne peut pas dire que la culture étrangère héritée du califat s'est élevée qualitativement sous les Arabes: les bâtiments architecturaux irano-musulmans sont plus bas que les anciens parsis, de même, les produits musulmans en soie et en laine, les ustensiles ménagers et les bijoux, malgré leur charme, sont inférieur aux produits anciens. [ ]
Mais d'autre part, à l'époque musulmane abbasside, dans un vaste État uni et ordonné, avec des voies de communication soigneusement aménagées, la demande d'articles de fabrication iranienne a augmenté et le nombre de consommateurs a augmenté. Les relations pacifiques avec les voisins ont permis de développer un remarquable commerce extérieur de troc : avec la Chine par le Turkestan et - par mer - par l'archipel indien, avec les Bulgares de la Volga et la Russie par le royaume des Khazars, avec l'émirat espagnol, avec tout le Sud L'Europe (à l'exception, peut-être, de Byzance), avec les rives orientales de l'Afrique (d'où, à leur tour, l'ivoire et les esclaves étaient exportés), etc. Le port principal du califat était Bassorah.
Le marchand et l'industriel sont les personnages principaux des contes arabes ; divers hauts fonctionnaires, chefs militaires, scientifiques, etc. n'ont pas honte d'ajouter à leurs titres le surnom d'Attar ("moskateur"), Heyat ("tailleur"), Javhariy ("bijoutier"), etc. Cependant, la nature de l'industrie islamo-iranienne n'est pas tant la satisfaction de besoins pratiques que le luxe. Les principaux articles de production sont les tissus de soie (mousseline, satin, moiré, brocard), les armes (sabres, poignards, cottes de mailles), les broderies sur toile et cuir, les ouvrages tressés, les tapis, les châles, les ivoires et métaux ciselés, gravés, sculptés, ouvrages en mosaïque, produits en faïence et en verre; moins souvent des articles purement pratiques - papier, tissu et laine de chameau.
Le bien-être de la classe agricole (pour des raisons pourtant imposables, non démocratiques) a été relevé par la restauration des canaux d'irrigation et des barrages, qui ont été lancés sous les derniers Sassanides. Mais même selon la conscience des écrivains arabes eux-mêmes, les califes n'ont pas réussi à amener la capacité de paiement du peuple à un niveau tel que celui atteint par le système fiscal de Khosrov I Anushirvan, bien que les califes aient ordonné que les livres cadastraux sassanides soient traduits en arabe à dessein à cet effet.
L'esprit persan s'empare également de la poésie arabe, qui désormais, à la place des chants bédouins, donne les œuvres raffinées du basrien Abu Nuwas ("arabe Heine") et d'autres poètes de cour Harun ar-Rashid. Apparemment, non sans influence persane (Brockelman : "Gesch. d. arab. Litt.", I, 134) une historiographie correcte se pose, et après la "Vie de l'Apôtre" compilée par Ibn Ishak pour Mansur, un certain nombre d'historiens laïques apparaissent également. Du persan, Ibn al-Mukaffa (vers 750) traduit le «Livre des rois» sassanide, l'adaptation pahlavi des paraboles indiennes sur «Kalila et Dimna» et diverses œuvres philosophiques gréco-syro-persanes, que Bassora, Kufa obtiennent tout d'abord connaître, puis et Bagdad. La même tâche est accomplie par des personnes d'une langue plus proche des Arabes, les anciens sujets persans des chrétiens araméens de Jondishapur, Harran, etc.
De plus, Mansur (Masudi: "Golden Meadows") s'occupe de la traduction en arabe des ouvrages médicaux grecs, et en même temps - mathématiques et philosophiques. Harun donne les manuscrits apportés des campagnes d'Asie Mineure pour traduction au médecin Jondishapur John ibn Masaveih (qui s'est même engagé dans la vivisection et était alors médecin de la vie pour Mamun et ses deux successeurs), et Mamun a arrangé, déjà spécifiquement à des fins philosophiques abstraites, un conseil spécial de traduction à Bagdad et a attiré des philosophes (Kindi). Sous l'influence de la philosophie gréco-syro-persane, le travail de commentaire sur l'interprétation du Coran se transforme en philologie arabe scientifique (Basrian Khalil, Basrian Persian Sibaveyhi ; le professeur de Mamun est le Kufi Kisviy) et la création de la grammaire arabe, la collection philologique d'œuvres de la littérature populaire préislamique et omeyyade (poèmes Mouallaki, Hamasa, Khozeilit, etc.).
L'âge des premiers Abbassides est aussi connu comme une période de plus haute tension de la pensée religieuse de l'islam, comme une période de fort mouvement sectaire : les Perses, qui se convertissent alors massivement à l'islam, intègrent presque complètement la théologie musulmane dans leur propres mains et a suscité une lutte dogmatique animée, parmi lesquelles les sectes hérétiques, décrites même sous Les Omeyyades, ont reçu leur développement, et la théologie et la jurisprudence orthodoxes ont été définies sous la forme de 4 écoles, ou interprétations: sous Mansur - le plus progressiste Abu Hanif à Bagdad et le conservateur Malik à Médine, sous Harun - le relativement progressiste ash-Shafi'i, sous Mamun - ibn Hanbal. L'attitude du gouvernement envers ces orthodoxies n'a pas toujours été la même. Sous Mansur, un partisan des Mu'tazilites, Malik a été fouetté jusqu'à la mutilation.
Puis, durant les 4 règnes suivants, l'orthodoxie prévalut, mais lorsque Mamun et ses deux successeurs élevèrent (depuis 827) le mutazilisme au rang de religion d'État, les adeptes des interprétations orthodoxes furent soumis à des persécutions officielles pour « anthropomorphisme », « polythéisme », etc., et sous al-Mu'tasim a été fouetté et torturé par le saint imam ibn-Hanbal (). Bien sûr, les califes pouvaient sans crainte fréquenter la secte mu'tazilite, car sa doctrine rationaliste du libre arbitre de l'homme et de la création du Coran et son penchant pour la philosophie ne pouvaient sembler politiquement dangereux. Aux sectes à caractère politique, comme, par exemple, les Kharijites, les Mazdakites, les chiites extrémistes, qui soulevaient parfois des soulèvements très dangereux (le faux prophète Moqanna au Khorasan sous al-Mahdi, 779, le brave Babek en Azerbaïdjan sous Mamun et al -Mutasim, etc. ), l'attitude des califes était répressive et impitoyable même à l'époque du pouvoir suprême du califat.
Perte du pouvoir politique des califes
Les témoins de la désintégration progressive de X. étaient des califes : le déjà mentionné Mutawakkil (847-861), l'Arabe Néron, très apprécié par les orthodoxes ; son fils Muntasir (861-862), qui monta sur le trône, ayant tué son père avec l'aide des gardes turcs, Mustain (862-866), Al-Mutazz (866-869), Mukhtadi I (869-870), Mutamid (870-892), Mutadid (892-902), Muktafi I (902-908), Muktadir (908-932), Al-Qahir (932-934), Al-Radi (934-940), Muttaqi (940 -944), Mustakfi (944-946). En leur personne, le calife est passé du dirigeant d'un vaste empire au prince d'une petite région de Bagdad, à l'inimitié et à la réconciliation avec ses voisins parfois plus forts, parfois plus faibles. À l'intérieur de l'État, dans leur capitale Bagdad, les califes sont devenus dépendants de la magistrale garde prétorienne turque, que Mutasim (833) a jugé bon de former. Sous les Abbassides, l'identité nationale des Perses renaît (Goldzier : « Muh. Stud. », I, 101-208). L'extermination imprudente par Harun des Barmakids, qui savaient rallier l'élément persan à l'arabe, a conduit à la discorde entre les deux peuples.
Persécution de la libre pensée
Sentant leur affaiblissement, les califes (les premiers - Al-Mutawakkil, 847) décidèrent qu'ils devaient gagner un nouveau soutien pour eux-mêmes - dans le clergé orthodoxe, et pour cela - renoncer à la libre pensée mutazilite. Ainsi, depuis l'époque de Mutawakkil, parallèlement à l'affaiblissement progressif du pouvoir des califes, il y a eu une augmentation de l'orthodoxie, la persécution des hérésies, de la libre pensée et de l'hétérodoxie (chrétiens, juifs, etc.), la persécution religieuse de la philosophie , sciences naturelles et même exactes. Une nouvelle puissante école de théologiens, fondée par Abul-Hasan al-Ash'ari (874-936), qui a quitté le mutazilisme, mène des polémiques scientifiques avec la philosophie et la science profane et gagne l'opinion publique.
Cependant, en fait, pour tuer le mouvement mental du calife, avec leur pouvoir politique de plus en plus décroissant, ils n'ont pas pu, et les philosophes arabes les plus glorieux (les encyclopédistes Basri, Farabi, Ibn Sina) et d'autres scientifiques ont vécu sous le sous les auspices des souverains vassaux justement en ce qu'à l'époque (- c.), lorsqu'officiellement à Bagdad, dans le dogme islamique et dans l'opinion des masses, la philosophie et les sciences non scolastiques étaient reconnues comme impies ; et la littérature vers la fin de ladite époque a produit le plus grand poète arabe libre-penseur Ma'arri (973-1057) ; dans le même temps, le soufisme, qui s'était très bien enraciné dans l'islam, avec nombre de ses représentants persans, est passé à une libre-pensée complète.
Califat du Caire
Les chiites (vers 864) devinrent également une force politique puissante, en particulier leur branche des Carmates (q.v.) ; lorsqu'en 890 la forte forteresse Dar al-Hijra a été construite en Irak par les Qarmates, qui est devenue un bastion pour l'État prédateur nouvellement formé, depuis lors "tout le monde avait peur des ismaéliens, mais ils n'étaient personne", selon les mots du L'historien arabe Noveyria, et les Qarmates se sont débarrassés comme ils l'ont voulu, en Irak, en Arabie et à la frontière syrienne. En 909, les Qarmates réussirent à fonder une dynastie en Afrique du Nord
La patrie des Arabes est l'Arabie (ou plutôt la péninsule arabique), ainsi nommée par les Turcs et les Farces (Perses). L'Arabie est située au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de la Méditerranée. La partie sud de la péninsule est plus propice à la vie - il y a beaucoup d'eau ici, il pleut. Les Arabes nomades sont appelés « Bédouins » (peuple du désert). À la fin du VIe - début du VIIe siècle, les Arabes étaient au stade de la transition du système primitif au féodalisme. La Mecque était le plus grand centre commercial.La nature du califat arabe et des sociétés islamiques,
qui sont contrôlés par le clergé. 
Les Arabes étaient à l'origine des idolâtres. À partir de 610, le prophète Mahomet a commencé à prêcher une nouvelle religion islamique. En 622, le Prophète a déménagé (hijrat) de La Mecque à Médine. De retour à La Mecque en 630, Mahomet fonde l'État arabe. La plupart des Arabes se sont convertis à l'islam. Le livre fondamental de l'Islam - le Coran se compose de 114 sourates. Un musulman fidèle doit se conformer à cinq conditions principales : 1) connaître la formule pour témoigner de l'unité d'Allah ; 2) prier ; 3) observer le jeûne ; 4) faire l'aumône ; 5) si possible, visiter les lieux saints (hajj) - La Mecque. Après le prophète Mahomet, les califes (successeur, adjoint) ont commencé à gouverner le pays. L'histoire de l'État arabe est divisée en trois périodes :
- 630-661 ans. La période du règne du prophète Mahomet et après lui quatre califes - Abu Bekr, Omar, Osman, Ali. La Mecque et Médine étaient les capitales du califat.
- 661-750 ans. Le règne de la dynastie des Omeyyades commençant par Mu'awiyah. La capitale du califat était la ville de Damas.
- 750-1258 ans. Le règne des Abbassides. Bagdad est la capitale depuis 762. Sous les Abbassides, à 120 km de Bagdad, dans la ville de Samira, la résidence du calife a été construite. Comment le califat arabe s'est-il développé au cours de l'histoire ?
Les Arabes tombèrent comme une avalanche sur Byzance et l'Iran. La raison de leur offensive réussie était: 1) une grande armée, en particulier une nombreuse cavalerie légère; 2) l'Iran et Byzance étaient épuisés par une longue guerre l'un contre l'autre ; 3) les riverains, épuisés par cette guerre, considéraient les Arabes comme des libérateurs. 
Au début du VIIIe siècle, les Arabes s'emparent de l'Afrique du Nord et en 711, menés par Tarig, traversent Gibraltar (le nom arabe est Jaballutarig, en l'honneur de Tarig) et conquièrent la péninsule ibérique. En 732, les Arabes perdent à la bataille de Poitiers et se replient vers le sud. Les troupes musulmanes ont conquis le Caucase et l'Asie centrale, à l'est, elles ont atteint la Chine et la vallée de l'Indus. À la fin du VIIe - la première moitié du VIIIe siècle, les frontières du califat s'étendaient de l'océan Atlantique à l'Inde et à la Chine. A la tête du pays se trouvait le calife, qui pendant la guerre était le commandant suprême.
Des canapés ont été créés pour gérer divers secteurs de l'économie: le canapé des affaires militaires était chargé de subvenir aux besoins de l'armée, le canapé des affaires intérieures contrôlait la collecte des impôts. Le divan de la poste joua un rôle important dans le califat. Des pigeons voyageurs ont même été utilisés. Toutes les affaires de l'État dans le califat étaient menées en arabe. Au sein du califat, le dinar d'or et le dirham d'argent étaient en circulation. Toutes les terres conquises étaient la propriété de l'État. Afin de prendre pied dans les territoires conquis, les Arabes ont largement pratiqué une politique de réinstallation. Celle-ci poursuivait deux objectifs :
- créer un soutien ethnique, à renforcer;
- relocaliser ceux qui étaient dans le soutien de l'État, pour libérer le trésor des paiements inutiles.
Les peuples, inclus de force dans le califat, se sont rebellés. En Asie centrale, sous la direction de Muganna en 783-785. un soulèvement éclata. Les enseignements de Muganna étaient basés sur les enseignements de Mazdak.
Sous le règne du calife Mokhtasim (833-842), les positions militaires des Turcs se renforcèrent, une armée spéciale fut créée, composée uniquement de Turcs. Dans la lutte contre Byzance et dans la répression des soulèvements, Mokhtasim a attiré les Turcs.
Dans les institutions de l'État, les Turcs occupaient des postes élevés, car ils connaissaient mieux les questions administratives.
La dynastie Tulun au pouvoir en Égypte était d'origine turque. À l'époque du gouverneur égyptien Ahmed ibn Tulun, une forte flottille a été construite, qui régnait sur la mer Méditerranée. Tulun a supervisé les travaux de construction et s'est occupé du bien-être des gens. Les historiens égyptiens appellent la période de son règne (868-884) le "temps d'or".
Au milieu du VIIIe siècle, l'Espagne s'est séparée du califat et un État indépendant est né ici - l'émirat de Cordoue. Au IXe siècle, l'Égypte, l'Asie centrale, l'Iran et l'Afghanistan se sont également séparés du califat.Au XIe siècle, tous les territoires du califat sont repris.