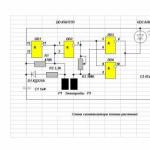Événements de février 1848 à Paris. Révolution française (1848)
Dans la suite de la révolution, après la répression du soulèvement social-révolutionnaire en juin 1848, le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, est élu président du nouvel État.
Conditions préalables
Louis Philippe en 1845
François Guizot
Chambre des députés sous Louis Philippe
Louis Philippe en Gargantua dévorant les richesses du peuple. Caricature de O. Daumier
Louis Philippe est arrivé au pouvoir en 1830 lors de la Révolution bourgeoise-démocratique de juillet, qui a renversé le régime réactionnaire des Bourbons en la personne de Charles X. Les dix-huit années du règne de Louis Philippe (la soi-disant monarchie de juillet) ont été caractérisées par un abandon progressif des idées du libéralisme, des scandales plus fréquents et une corruption croissante. Finalement, Louis-Philippe rejoint la Sainte Alliance réactionnaire des Rois de Russie, d'Autriche et de Prusse. Bien que les mots d'ordre républicains dominaient parmi les combattants des barricades de 1830, ce n'était pas seulement la bourgeoisie, et pas seulement la grande bourgeoisie, qui possédait finalement les fruits de leur victoire, mais une fraction de la bourgeoisie - les financiers. Les mots du banquier Lafitte après la proclamation du duc d'Orléans comme roi - « désormais les banquiers régneront ! s'est avéré prophétique.
Au milieu des années 1840, il y avait des signes d'une crise sociale et juridique en France. Malgré la révolution industrielle croissante, les faillites de masse sont devenues plus fréquentes, le nombre de chômeurs a augmenté et les prix ont constamment augmenté. En 1845-1847, le pays a subi de graves mauvaises récoltes. "Roi-bourgeois", "roi du peuple", Louis-Philippe ne convenait plus qu'aux roturiers (les légendes sur sa "simplicité" et les promenades populistes le long des Champs Elysées sans sécurité avec un parapluie sous le bras se sont vite lassés des gens du commun) , mais aussi la bourgeoisie. Le plus grand mécontentement était causé par l'ordre de qualification établi du suffrage, dans lequel ceux qui payaient 200 francs d'impôts directs jouissaient du suffrage actif (le droit d'élire) et de 500 francs - passif (le droit d'être élu) ; au total, ainsi, en 1848, il y avait 250 000 électeurs (sur 9,3 millions d'hommes adultes - c'est le nombre d'électeurs devenus avec l'introduction du suffrage universel après la révolution).
En fait, le parlement était élu, et plus encore élu en son sein, par la grande bourgeoisie. Louis Philippe a fréquenté ses parents et amis, embourbés dans des escroqueries financières et des pots-de-vin. L'attention du gouvernement est attirée sur l'aristocratie monétaire, à laquelle le roi accorde plus de préférence qu'au peuple : hauts fonctionnaires, banquiers, grands marchands et industriels, pour qui les conditions les plus favorables sont créées dans la politique et le commerce. Dans l'intérêt de la bourgeoisie financière, l'État est artificiellement maintenu au bord de la faillite (les dépenses publiques extraordinaires sous Louis Philippe sont deux fois plus élevées que sous Napoléon, constamment en guerre), ce qui permet aux financiers de prêter aux État à des conditions extrêmement défavorables pour le Trésor. Le sommet de la bourgeoisie s'est également enrichi de contrats de toutes sortes, notamment ferroviaires, dont l'accès s'est fait par la corruption et la fraude boursière, ruinant les petits investisseurs et s'appuyant sur la connaissance d'informations privilégiées dont disposaient les députés, les membres du gouvernement et leurs entourage. Tout cela a entraîné un certain nombre de scandales de corruption, en particulier en 1847, qui ont créé dans la société une attitude envers le groupe dirigeant comme un solide gang de voleurs et de criminels. Selon Karl Marx, « La Monarchie de Juillet n'était qu'une société par actions pour l'exploitation de la richesse nationale française ; ses dividendes étaient répartis entre les ministres, les chambres, 240 000 électeurs et leurs sbires. Louis-Philippe était le directeur de cette société<…>Ce système était une menace constante, un dommage constant au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, à la navigation, aux intérêts de la bourgeoisie industrielle, qui dans les journées de juillet écrivait sur sa bannière gouvernement à bon marché "
Tout cela a provoqué un mécontentement croissant à l'égard du régime de Juillet, dans lequel les travailleurs ont fusionné avec leurs maîtres - des représentants de la bourgeoisie industrielle, qui s'opposaient au royaume des banquiers. Au parlement, ce mécontentement prend la forme de discours de l'opposition dite "dynastique" (orléaniste) - menée par Adolphe Thiers et Odillon Barrot. Le principal point de mécontentement de la bourgeoisie était la qualification électorale extrêmement élevée, qui coupait de la vie politique une partie importante de cette classe, ainsi que les représentants des professions libres qui lui étaient associées. En conséquence, la conviction s'est largement répandue que le système électoral devait être changé. A la Chambre des députés, la demande d'élargissement du suffrage se fait de plus en plus entendre. L'intelligentsia réclamait la mise à disposition de tels pour les "talents" (gens de professions libérales), on demandait l'abaissement des diplômes, et enfin le parti le plus radical, emmené par Ledru-Rollin (le seul républicain radical au parlement), réclamait le suffrage universel . Cependant, le roi a obstinément rejeté toute idée de changement politique. Ces sentiments étaient soutenus en lui par le ministre le plus influent des sept dernières années de son règne - François Guizot, qui devint chef de cabinet en 1847. Il a refusé toutes les demandes de la chambre d'abaisser la qualification électorale.
| révolutions 1848-1849 |
|---|
| France |
| Empire autrichien : |
| L'Autriche |
| Hongrie |
| République Tchèque |
| Croatie |
| Voïvodine |
| Transylvanie |
| Slovaquie |
| Galice |
| Slovénie |
| Dalmatie et Istrie |
| Lombardie et Venise |
| Allemagne |
| Prusse du Sud (Grande Pologne) |
| États italiens : |
| Sicile |
| Royaume de Naples |
| États pontificaux |
| Toscane |
| Piémont et duchés |
| Pologne |
| Valachie et Moldavie |
| Brésil |
Il n'est pas surprenant qu'au cours de ces années, plus de dix attentats aient été commis contre le roi. Ils ont été commis à la fois par des membres de sociétés secrètes (par exemple, Fieschi de la "Société des droits de l'homme" Auguste Blanqui, qui a fusillé le roi le 28 juillet 1835), et par des solitaires qui partageaient les idées des radicaux. Le niveau de haine dans la société envers la monarchie au pouvoir a augmenté rapidement. En 1840, Georges Darmes, qui attenta à la vie du roi, qui obtint un emploi de polisseur au palais, fut interrogé lors de l'enquête sur sa profession. « Tueur de tyrans », répondit-il fièrement. « Je voulais sauver la France.
La crise économique de l'automne 1847 a frappé toutes les couches de la société, à l'exception de l'oligarchie financière - de la grande bourgeoisie industrielle aux ouvriers, exacerbant le mécontentement général face à la situation existante. À la fin de 1847, à la suite de la crise, jusqu'à 700 000 travailleurs se sont retrouvés dans la rue ; le chômage dans des secteurs tels que l'ameublement et la construction a atteint les 2/3. Pour les ouvriers, la crise est doublement insupportable, car elle survient sur fond de famine provoquée par une mauvaise récolte en 1846 et une maladie de la pomme de terre - en 1847, le prix des denrées alimentaires double, elle débouche sur des émeutes de la faim avec la défaite des boulangeries réprimées par les troupes. Dans ce contexte, l'orgie de l'oligarchie des banquiers et des fonctionnaires corrompus semblait doublement insupportable.
K. Marx décrit ainsi l'atmosphère sociale à la veille de la révolution : « Les factions de la bourgeoisie française qui ne participaient pas au pouvoir criaient : « Corruption ! » Le peuple criait : « À bas les grands voleurs ! A bas les assassins !<Долой крупных воров! Долой убийц!>"Lorsque, en 1847, sur les plus hautes scènes de la société bourgeoise, se jouaient publiquement ces mêmes scènes qui conduisent d'ordinaire le prolétariat lumpen aux tanières de la débauche, aux hospices et aux asiles d'aliénés, au box des accusés, à la servitude pénale et à l'échafaud . La bourgeoisie industrielle y voyait une menace pour ses intérêts, la petite bourgeoisie s'indignait moralement, l'imagination du peuple s'indignait. Paris a été inondé de pamphlets<…>qui, avec plus ou moins d'esprit, a exposé et dénoncé la domination de l'aristocratie financière" .
L'occasion d'une explosion massive d'indignation ne s'est pas fait attendre.
Opposition à 1848
Armand Marra
Les forces opposées au régime se répartissaient en : « opposition dynastique », c'est-à-dire la partie libérale des orléanistes, mécontente de la ligne trop conservatrice de Guizot, républicains de droite et républicains de gauche.
dirigeant opposition dynastiqueétait Odilon Barrot, qui a lancé le mot d'ordre : « Réformer pour éviter la révolution ». Adolphe Thiers rejoint l'opposition dynastique avec ses partisans, qui dans les années 1830 était l'un des piliers du régime, mais ensuite écarté par Guizot, plus à droite. Signe de la crise du régime, le journaliste Emile Girardin, connu pour son manque de scrupules et son instinct politique aigu, passe du côté de l'opposition, qui crée une faction de "conservateurs progressistes" au parlement.
Opposition de droite républicaine regroupés autour du journal Nacional, édité par l'homme politique Marra. Le contributeur le plus célèbre à cet article était le député et poète Lamartine, qui en 1848 était au sommet de sa popularité, à la fois pour son éloquence parlementaire et pour son Histoire des Girondins récemment publiée, une apologie de ces républicains bourgeois modérés.
Opposition de gauche républicaine, ou « Rouges », unissent les démocrates petits-bourgeois et les socialistes proprement dits, et se regroupent autour du journal Reforma édité par Ledru-Rollin (Ledru-Rollin lui-même n'était pas un partisan du socialisme, mais le socialiste Louis Blanc, l'auteur du journal populaire brochure "Organisation du travail" ; Friedrich Engels a également écrit pour elle).
Enfin, des vestiges de sociétés secrètes communistes et anarchistes ont continué d'exister, écrasés à la fin des années 1830: ces vestiges ont été étroitement infiltrés par des agents de police provocateurs (comme l'a montré le procès de 1847 de la soi-disant Firebomb Conspiracy). Les figures les plus énergiques des sociétés secrètes, Blanqui et Barbes, ont été emprisonnées après le soulèvement de 1839. La plus grande des sociétés secrètes était la "Société des Saisons" blanquiste et communiste, comptant jusqu'à 600 personnes; il était dirigé par un ouvrier mécanique Albert.
Renversement de la monarchie
Banquets réformistes
Le mouvement anti-régime a pris la forme de campagnes pour une réforme électorale, suivant le modèle des chartistes anglais. Il porte le nom banquets réformistes. Afin de propager les réformes, et en même temps de contourner les interdictions strictes d'unions et de réunions, d'abord à Paris, puis dans les grandes villes de province, de riches participants au mouvement réformiste organisèrent des banquets publics, dont le nombre d'"invités", en écoutant les discours des orateurs, totalisaient des milliers de personnes - autrement dit, sous couvert de banquets, des rassemblements de partisans de la réforme se sont effectivement tenus. L'idée appartenait à Odilon Barrot, mais l'idée fut reprise par les républicains puis par les radicaux, qui commencèrent également à organiser des banquets avec la participation d'orateurs ouvriers et socialistes comme Louis Blanc. Si lors des banquets organisés par l'opposition modérée, les revendications n'allaient pas au-delà de la réduction de moitié de la qualification électorale et de l'octroi du droit de vote aux "talents", alors lors des banquets du groupe "Réformes", ils parlaient ouvertement du suffrage universel, que les radicaux considéraient comme objectif principal, et les socialistes - comme condition préalable indispensable à la restructuration des relations sociales. Ainsi, lors d'un banquet le 7 novembre à Lille, des toasts ont été portés "pour les travailleurs, pour leurs droits inaliénables"à quoi Ledru-Rollin répondit : "Le peuple n'est pas seulement digne de se représenter, mais... il ne peut être suffisamment représenté que par lui-même". Guizot et le roi, cependant, ne voient pas ces banquets comme une menace sérieuse. "Enrichissez-vous, messieurs, et vous deviendrez des électeurs", a déclaré Guizot d'un ton moqueur au Parlement aux partisans de la réforme. Néanmoins, Guizot a pris la décision de mettre fin à la campagne de banquets, qui a finalement provoqué l'explosion.
Banquet le 22 février
Le 14 février, le ministre de l'Intérieur, Duchâtel, interdit un banquet, prévu le 19 février par le comité du XIIe arrondissement (Faubourg Saint-Marceau), avec la participation d'officiers de la Garde nationale. Les organisateurs ont tenté de sauver la mise en déplaçant le banquet au 22 et dans un coin relativement éloigné des Champs Elysées. La commission des banquets a contesté le droit du gouvernement d'interdire un événement privé. 87 députés ont promis d'assister au banquet et ont programmé une rencontre avec les participants le 22 février à midi à l'église Saint-Pierre. Madeleine, d'où la procession devait se diriger vers le lieu du banquet. La Commission a appelé les gardes nationaux à venir à cette réunion en uniforme mais sans armes. Dans le même temps, les organisateurs s'attendaient, s'étant solennellement présentés sur le lieu du banquet et y ayant trouvé un policier muni d'un ordre d'interdiction, à exprimer une protestation formelle, à se disperser puis à former un pourvoi en cassation. Cependant, pour le Cabinet, l'affaire était de nature fondamentale, puisqu'elle était liée à la question de l'interdiction des réunions sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de cortège. En conséquence, le 21 février, au Parlement, Duchâtel déclare l'interdiction totale du banquet, menaçant d'un ton dur les organisateurs, parmi lesquels se trouvent de nombreux officiers de la garde nationale, qu'en cas de désobéissance, il utiliserait la force. Dans la soirée, les organisateurs, après la réunion, ont décidé d'annuler le banquet. Dans la nuit du 22 février, une annonce gouvernementale interdisant le banquet a été collée. Mais cela ne pouvait plus rien affecter : « la machine tourne », comme disait Odillon Barrot à l'hémicycle. Le soir du 21 février, une grande effervescence régnait à Paris, les foules se rassemblaient, et P. Annenkov se rappela avoir entendu un jeune homme dire : « Paris tentera sa chance demain ». Les chefs de l'opposition modérée sont terrifiés, s'attendant à l'apaisement des troubles et à d'inévitables représailles : Mérimée les compare à « des cavaliers qui ont accéléré leurs chevaux et ne savent pas les arrêter ». Les dirigeants des radicaux ont envisagé la question de la même manière : lors d'un meeting tenu à la rédaction de Reforma, ils ont décidé de ne pas participer au discours, afin de ne pas donner aux autorités une raison d'écraser leur parti, et le journal a publié un appel aux Parisiens pour qu'ils restent chez eux. Ainsi, aucun des politiciens de l'opposition ne croyait à la possibilité d'une révolution.
Le début du soulèvement
Le 22 février, au petit matin, une foule de personnes se rassemble sur la place de la Madeleine, désignée par les organisateurs du banquet comme lieu de rassemblement. Au début, ce sont surtout des ouvriers, puis ils sont rejoints par un cortège d'étudiants. Avec l'arrivée des étudiants, la foule acquit une certaine organisation et se dirigea vers le Palais Bourbon (où siégeait le parlement) en chantant la Marseillaise et en criant : « A bas Guizot ! Vive la réforme ! La foule a fait irruption dans le palais Bourbon, qui, en raison de l'heure matinale, était encore vide, puis s'est déplacée vers le boulevard des Capucins jusqu'au bâtiment du ministère des Affaires étrangères, la résidence de Guizot (il, en plus du gouvernement, a également dirigé ce ministère); là, elle a été repoussée par les troupes, mais ne s'est pas dispersée, mais est allée à d'autres points de la ville. Les tentatives des dragons et de la police pour disperser la foule ont échoué. Le soir, la foule avait détruit le magasin d'armes et par endroits commencé à construire des barricades. A 16 heures, le roi donne un ordre pour l'entrée des troupes dans Paris et la mobilisation de la garde nationale. Cependant, le 22 février, les événements donnaient encore l'impression d'émeutes de rue ordinaires pour Paris à cette époque, et la révolution qui n'avait en rien commencé. "Les Parisiens ne font jamais de révolution en hiver", a déclaré Louis-Philippe à cette occasion. Les rédacteurs de Reforma du 22 février au soir s'accordent également à dire que « la situation n'est pas de nature à faire une révolution ».
Le véritable soulèvement a commencé dans la nuit du 23 février, lorsque les quartiers ouvriers de Paris (traditionnellement républicains) ont été couverts de barricades. Comme il a été calculé plus tard, plus d'un millier et demi de barricades sont apparues dans la capitale. Des foules d'ouvriers ont fait irruption dans des magasins d'armes et ont pris possession d'armes. Louis Philippe ne voulait pas utiliser les troupes pour réprimer le soulèvement, car l'armée était impopulaire et il craignait que, voyant que le roi suive les traces de Charles X, la Garde nationale ne soutienne le soulèvement et qu'il y ait une répétition de l'insurrection. événements de 1830. Par conséquent, il a cherché à mettre fin aux troubles par les forces de la Garde nationale elle-même. Cependant, les gardes nationaux, venus des quartiers bourgeois et eux-mêmes partisans de la réforme électorale, refusent catégoriquement de tirer sur le peuple, et certains d'entre eux passent même du côté des rebelles. En conséquence, les troubles n'ont fait que s'intensifier. Les principales revendications qui unissent tous les Parisiens mécontents sont la démission de Guizot et la mise en place de réformes.
Démission du gouvernement et fusillade boulevard des Capucines
Tournage sur le Boulevard des Capucines. Lithographie
Le passage de la Garde nationale aux côtés des rebelles effraya le monarque, et Louis-Philippe accepta la démission du gouvernement Guizot à 15h00 le 23 février et annonça sa décision de former un nouveau cabinet de personnalités dynastiques de l'opposition avec la participation de Thiers. et Odillon Barrot. Le comte Louis-Mathieu Molay est désigné premier ministre. La nouvelle de la démission de Guizot est accueillie avec enthousiasme par l'aile bourgeoise-libérale du mouvement, qui considère ses objectifs atteints et appelle les combattants des barricades à cesser le combat. Les républicains, dont le principal soutien était les ouvriers, ainsi que la petite bourgeoisie et les étudiants, n'acceptèrent pas ce remplacement. "Molay ou Guizot, c'est pareil pour nous", disaient-ils. "Le peuple des barricades tient des armes à la main et ne les déposera que lorsque Louis-Philippe sera renversé de son trône.". Cependant, la réassurance des masses bourgeoises laissa les républicains isolés et, à la longue, menaça de retourner la garde nationale contre eux. Bien que les barricades n'aient pas été démantelées, la tension est retombée. De plus, le peuple commença à désarmer les troupes démoralisées, qui abandonnèrent leurs armes sans résistance.
Cependant, dans la soirée, vers 22 h 30, sur le boulevard des Capucines près de l'hôtel Vendôme, où se trouvait le ministère des Affaires étrangères, les troupes ont ouvert le feu sur la foule, ce qui a immédiatement détérioré la situation et provoqué une explosion qui a détruit la monarchie.
Les détails de cet incident restent un sujet de controverse à ce jour. Les deux parties se sont mutuellement blâmées: les militaires républicains de l'exécution non provoquée d'une foule non armée, les militaires ont affirmé que la fusillade avait commencé après qu'un coup de pistolet ait été tiré sur les troupes de la foule. Indépendamment de qui a effectivement tiré le premier coup de feu, qui a servi de signal pour un massacre, la situation elle-même était sans aucun doute le fruit d'une provocation consciente des républicains, qui s'efforçaient d'aggraver la situation autant que possible.
Marrast prononce un discours sur les morts.
Procession avec les corps des morts.
La foule, avec des torches et des chants, a parcouru les rues pour célébrer la victoire, et a finalement atteint le coin de la rue et le boulevard des Capucines, où Guizot était censé être dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, et a commencé à crier : "A bas Guizot !" L'édifice était gardé par un bataillon du 14e régiment d'infanterie de ligne qui, le protégeant, bloquait le boulevard. Par la suite, les chefs de cortège ont affirmé qu'ils avaient initialement l'intention de contourner le boulevard des Capucines, afin d'éviter un conflit avec les troupes ; cependant, la foule s'est tournée vers le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Un certain Pannier-Lafontaine, ancien militaire, en a pris la responsabilité : de son propre aveu, sous l'influence de la parole de quelqu'un que rien n'avait été fait et que par conséquent le mouvement serait étranglé, il a décidé de diriger la foule vers le ministère et persuada deux relayeurs, qui dirigeaient la foule, de changer de route. Lorsque les soldats ont bloqué le boulevard, protégeant le ministère, la foule a commencé à les presser agressivement, essayant de pénétrer dans le bâtiment et a tenté de saisir leurs armes ; Pannière-Lafontaine et plusieurs autres gardes nationaux entourent le lieutenant-colonel Courant, qui commande le bataillon, exigeant qu'il donne l'ordre aux troupes de se séparer et de laisser passer la foule. Courant les refuse et donne l'ordre d'attacher les baïonnettes. A ce moment, un coup de feu retentit, tiré par on ne sait qui. Le sergent Giacomoni a témoigné qu'il a vu un homme dans la foule avec un pistolet visant le colonel ; une balle a blessé le soldat Henri, qui se tenait non loin du commandant, au visage. Selon d'autres versions, le coup de feu aurait été tiré par les soldats, soit par accident, soit par malentendu. D'une manière ou d'une autre, le coup de feu a servi de signal, et les soldats, qui étaient dans un état d'extrême tension nerveuse, ont spontanément ouvert le feu sur la foule. Plus de 50 personnes ont été blessées, 16 d'entre elles ont été tuées. La foule se précipita en criant : « Trahison ! Nous sommes en train d'être tués !" Peu de temps après, une charrette a été apportée de la rédaction du Nacional (le journal des républicains modérés), cinq cadavres y ont été placés et ils ont commencé à les transporter le long des boulevards, s'illuminant avec une torche en criant : « Vengeance ! Des gens sont tués !" Une impression particulière a été faite par le cadavre d'une jeune fille, qui a montré à la foule, soulevant, une sorte de travailleur.
Une foule de gens en colère, criant et jurant, suivit la charrette. Sur les boulevards, des arbres ont été abattus et des omnibus retournés, les plaçant en barricades. L'insurrection s'embrase avec une vigueur renouvelée, maintenant le mot d'ordre est ouvertement lancé : « Vive la République ! Au matin, une proclamation est apparue sur les murs, rédigée dans Reform (le journal des républicains radicaux), qui disait : « Louis Philippe nous a fait tuer, comme Charles X ; qu'il aille après Charles X".
Renonciation
Défaite du poste de Château d'Or. Peinture de E. Hagnauer
Dans la soirée, Louis-Philippe nomme le plus libéral Thiers à la tête du gouvernement à la place de Molay. Dans la matinée, à la suggestion de Thiers, il accepte finalement de proposer une réforme électorale et de convoquer des élections anticipées à la Chambre des députés. Mais il était trop tard, les rebelles n'acceptaient rien d'autre que l'abolition de la monarchie. C'est au moment même où le roi accepte le rapport de Thiers et donne des ordres de réformes (vers 10 heures du matin), que les rebelles font irruption dans le Palais Royal, où ils combattent avec la garnison du poste de Château d'Or, qui protège le accès au palais par la direction du Palais-Royal Piano. Ce choc laissa du temps au roi, durant lequel il nomma d'abord à la place de Thiers le plus libéral encore Odilon Barrot, l'un des principaux orateurs des banquets réformistes, puis, sur l'insistance de la famille, qui comprit que cela ne pouvait sauver la situation, il a signé l'abdication. Le roi abdique en faveur de son petit-fils Louis-Philippe, 9 ans, comte de Paris, sous la régence de sa mère Hélène, duchesse d'Orléans. Après cela, il monta dans un fiakre bon marché, attelé d'un seul cheval, et, sous l'escorte d'un cuirassier, se rendit à Saint-Cloud. Cela s'est passé vers 12h00. À ce moment-là, le peuple avait capturé et incendié la caserne du Château d'Or et avait rapidement fait irruption dans les Tuileries, le trône royal fut transporté place de la Bastille et solennellement brûlé. Le roi et sa famille s'enfuirent en Angleterre comme Charles X, exauçant ainsi littéralement la volonté des rebelles.
gouvernement provisoire
Des bénévoles dans la cour de l'Hôtel de Ville
Immédiatement après l'abdication du roi, la duchesse d'Orléans avec le jeune comte de Paris se présente au palais Bourbon (siège de la Chambre des députés). La majorité orléaniste les reçoit debout et est prête à proclamer roi le comte de Paris, mais sous la pression de la foule qui remplit le palais Bourbon, elle hésite ; le débat a commencé. A ce moment, la salle était remplie d'une nouvelle foule de personnes armées, criant: "Répudiation!" « A bas la salle ! Nous n'avons pas besoin de députés ! Sortez des marchands éhontés, vive la république ! Le plus radical des députés, Ledru-Rollin, réclame la création d'un gouvernement provisoire, soutenu par Lamartine. En conséquence, la majorité des députés ont fui, la minorité restante, ainsi que les personnes qui remplissaient le palais, ont approuvé la liste du gouvernement, qui a été compilée par les rédacteurs en chef du journal républicain modéré Nacional. Le gouvernement était dirigé par Lamartine. Dans le même temps, républicains et socialistes radicaux se réunissent à la rédaction de Reform et dressent leur liste. Cette liste coïncidait généralement avec la liste du "Nacional", mais avec l'adjonction de plusieurs personnes, dont Louis Blanc et le chef de la "Société des Saisons" secrète, le communiste Albert.
Suivant la tradition révolutionnaire, ils se rendirent à l'hôtel de ville et y proclamèrent un nouveau gouvernement. Suite à cela, le gouvernement du "Nacional" est venu à l'Hôtel de Ville du Palais Bourbon. En conséquence, le groupe « Nacional » et le groupe « Réformé » parviennent à un accord : la liste des « Nacional » est élargie de quatre nouveaux ministres, dont Louis Blanc et Albert, devenus ministres sans portefeuille, et Ledru-Rollin, qui a reçu le poste de ministre de l'Intérieur, et est resté à la mairie . Le poste de préfet de la police parisienne a été approuvé par un autre associé de Ledru-Rollin, Cossidière, qui l'avait auparavant obtenu sans mise en demeure préalable : il s'est simplement présenté à la préfecture entouré de républicains armés - ses camarades d'une société secrète et s'est déclaré préfet . Le célèbre physicien et astronome François Arago, qui était député, qui a rejoint le cercle réformé, a reçu dans le nouveau gouvernement les postes de ministres de l'armée et de la marine (dans la liste de Ledru-Rollin, il a été désigné comme ministre des Postes) .
Les républicains modérés menés par Lamartine, et plus encore les représentants de « l'opposition dynastique » qui étaient au gouvernement, ne voulaient pas proclamer une république, arguant que seule la nation entière avait le droit de trancher cette question. Pourtant, le matin du 25 février, la mairie est remplie d'une manifestation de masse menée par le médecin communiste Raspail, qui donne 2 heures au gouvernement pour proclamer la république, promettant, sinon, de revenir à la tête de 200 mille Parisiens et faire une nouvelle révolution. La République est aussitôt proclamée. Cependant, la demande de remplacer la bannière tricolore (qui s'était discréditée aux yeux des ouvriers de Paris pendant les années de Louis Philippe) par une bannière rouge, Lamartine réussit à la repousser : en guise de compromis, il fut décidé d'ajouter une bannière rouge rosette à l'arbre. Pour apaiser les masses de la bourgeoisie provinciale, pour qui le mot « république » était associé aux souvenirs de la terreur jacobine, le gouvernement abolit la peine de mort.
Les élections à l'Assemblée constituante étaient prévues pour le 23 avril. En préparation de ces élections, le gouvernement a apporté deux changements importants. Un décret du 4 mars instaure le suffrage universel pour les hommes de plus de 21 ans. A cette époque, aucun pays au monde ne disposait d'un droit de vote aussi étendu, pas même l'Angleterre, qui se considérait comme une pionnière des libertés démocratiques.
En même temps, cependant, le gouvernement provisoire s'aliène la paysannerie. La France dans son ensemble accueille calmement la nouvelle de la révolution et ses commissaires, nommés dans les départements par Ledru-Rollin à la place des préfets royaux. Le principal problème du nouveau gouvernement était le problème du déficit financier - puisque l'oligarchie financière ne voulait plus prêter au gouvernement, et le gouvernement ne voulait pas imposer une collecte forcée à la grande bourgeoisie ou confisquer les propriétés des Orléans, comme le proposaient les radicaux. Du coup, à l'initiative de Garnier-Pages (ministre des Finances, républicain très modéré du cercle Nacional et grand financier), il fut décidé de couvrir le déficit aux dépens des paysans, à un moment, pour une année, majorant de 45% (45 centimes par franc) les 4 impôts directs. Dans le même temps, on assurait aux ouvriers que l'impôt retombait sur les grands propriétaires terriens aristocratiques et remboursait au fisc le fameux milliard de francs que leur versaient les Bourbons (en compensation des pertes de la Révolution), tandis qu'on expliquait aux paysans que l'impôt a été introduit en raison des caprices des ouvriers et des coûts des expériences socialistes avec les « ateliers nationaux ». L'« impôt de 45 centimes » suscita chez les paysans la haine de la république et activa les sympathies bonapartistes qui ne s'éteignirent jamais en eux (l'époque de l'Empire fut pour eux un âge d'or). La collecte de l'impôt a conduit à l'été 1848 à des troubles paysans de masse.
La lutte des républicains de gauche et de droite
L'idée d'une "république sociale"
Louis Blanc à la Commission de Luxembourg
Il s'est avéré que les ouvriers et les républicains bourgeois avaient des conceptions différentes de la république elle-même. Chez les travailleurs, l'idée d'une république se combinait avec l'idée non seulement d'égalité et de suffrage universel, mais aussi de justice sociale et d'élimination de la pauvreté, que cette république devait assurer. Cette idée s'est exprimée dans le slogan : « Vive la république, démocratique et sociale ! ».
Les idées de Louis Blanc sur "l'organisation du travail" étaient particulièrement populaires parmi les ouvriers. Dans un pamphlet du même nom, Louis Blanc développe l'idée que chacun doit avoir le "droit au travail" et que l'Etat est tenu d'assurer ce droit aux citoyens en organisant et en soutenant les associations ouvrières - "ateliers nationaux", toutes les dont le revenu (moins le nécessaire à la production) appartiendrait à leur travail. Le 25 février, une grande manifestation ouvrière se présente à l'hôtel de ville avec des banderoles sur lesquelles est inscrit : « Organisation du travail ! - et exigé la mise en place immédiate du ministère du Progrès. Du gouvernement, cette demande n'a été soutenue que par Blanc. Cependant, sous la pression des ouvriers, le gouvernement provisoire adopte ses premiers décrets aux déclarations vaguement socialistes, promettant de "garantir l'existence de l'ouvrier par le travail", "d'assurer du travail à tous les citoyens" et reconnaissant le droit et la nécessité des ouvriers "de s'associer pour jouir des fruits légitimes de leur travail". Au lieu du ministère du Progrès, le gouvernement a décidé de créer une "commission gouvernementale pour les travailleurs", qui devait élaborer des mesures pour améliorer la condition de la classe ouvrière. Le Palais du Luxembourg a été affecté à la commission, c'est pourquoi il a reçu le nom de "Commission du Luxembourg".
Par cette démarche, le Gouvernement Provisoire retire de l'Hôtel de Ville les éléments dangereux pour lui, représentant la banlieue ouvrière de Paris. La Commission luxembourgeoise, en plus d'élaborer des projets de solutions à la question du travail, a également agi comme une commission de conciliation dans les conflits entre ouvriers et patrons (Louis Blanc était un partisan constant du compromis de classe, ce qui lui a fait condamner les soulèvements ouvriers tant en juin 1848 et plus tard pendant la Commune) . Des décrets sont adoptés pour réduire la journée de travail d'1 heure (à 10 heures à Paris et à 11 heures en province), baisser le prix du pain, doter les associations ouvrières d'un million de francs restant de la liste civile de Louis Philippe, de restituer aux pauvres les biens de première nécessité hypothéqués, sur l'admission des ouvriers dans la garde nationale. 24 bataillons de "gardes mobiles" (dits "mobiles") ont été créés, principalement issus de jeunes ouvriers marginalisés âgés de 15 à 20 ans, avec un salaire de 1,5 franc par jour; par la suite, il a servi de force de frappe au gouvernement dans la répression des soulèvements ouvriers.
Par un décret du 26 février, les « Ateliers nationaux » sont créés pour les chômeurs, à l'extérieur - conformément aux idées de Louis Blanc. En fait, ils se sont organisés dans le but de discréditer ces idées aux yeux des ouvriers, comme l'a admis ouvertement la ministre du Commerce Marie, qui les dirigeait : selon Marie, ce projet « prouvera aux ouvriers eux-mêmes tout le vide et la fausseté des théories sans vie."
Dans les ateliers, les ouvriers organisés sur le plan militaire s'adonnaient exclusivement à des travaux non qualifiés (essentiellement des travaux de creuseurs), recevant pour cela 2 francs en un jour. Bien que les ateliers n'aient été introduits que dans quelques grandes villes, bientôt plus de 100 000 personnes y travaillaient. Au fil du temps, le gouvernement, sous prétexte de la lourdeur d'ateliers économiquement inefficaces, a baissé les salaires à 1,5 franc par jour, puis a réduit le nombre de jours de travail à deux par semaine. Pendant les cinq jours restants, les ouvriers de l'atelier recevaient un franc.
Événements du 16 avril
Le 16 avril, une foule d'ouvriers de 40 000 personnes s'est rassemblée sur le Champ de Mars pour discuter des élections à l'état-major général de la garde nationale, et de là s'est déplacée vers l'hôtel de ville avec des revendications : « Le peuple demande une république démocratique, la abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme et de l'organisation du travail par l'association. La manifestation était organisée par des clubs et des membres de la Commission luxembourgeoise, qui cherchaient à expulser les orléanistes (membres de "l'opposition dynastique") du gouvernement et à obtenir un report des élections à l'Assemblée constituante, puisque, selon eux (assez justifiées par les événements), lors d'élections précipitées sans agitation républicaine préalable de longue durée, en province, les forces conservatrices l'emporteront.
Le bruit se répandit dans les quartiers bourgeois de Paris que les socialistes voulaient faire un coup d'État, liquider le gouvernement provisoire et mettre au pouvoir un gouvernement communiste de Louis Blanc, Blanca, Cabet et Raspail.
Le ministre de l'Intérieur, Ledru-Rollin, qui avait lui-même auparavant négocié avec ses camarades réformistes Louis Blanc et le préfet de police Cossidières d'utiliser une manifestation ouvrière pour expulser les orléanistes du gouvernement, après avoir hésité, s'est rangé du côté du gouvernement contre les socialistes et ordonna de battre la garde nationale. Les gardes nationaux se sont rendus à l'hôtel de ville, les armes à la main et ont crié : "A bas les communistes !". La manifestation s'est terminée en vain et les positions des socialistes au gouvernement ont été complètement sapées.
Événements 15 mai
Le 23 avril, des élections ont eu lieu pour l'Assemblée constituante. Les élections ont été accompagnées de discours de travail. Un soulèvement armé a lieu à Rouen : les ouvriers accusent les autorités de truquer les élections, ce qui fait que leurs candidats ne passent pas, mais plusieurs conservateurs extrêmement antisocialistes passent. À la suite d'affrontements entre ouvriers et soldats et gardes nationaux, une centaine de prolétaires, dont des femmes et des enfants, ont été tués et blessés. A Limoges, les ouvriers, qui accusent également les autorités de fraude électorale, saisissent la préfecture et forment un comité qui dirige la ville pendant deux semaines.
Le 4 mai, s'ouvrait l'Assemblée constituante. En elle, sur 880 sièges, 500 appartenaient aux républicains conservateurs (c'est-à-dire la direction Nacional), 80 représentants de la démocratie radicale (c'est-à-dire la direction réformée) et 300 monarchistes (principalement orléanistes). Pour diriger le pouvoir exécutif, l'Assemblée élit une Commission exécutive de cinq membres (Arago, Garnier-Pages, Marie, Lamartine et Ledru-Rollin) présidée par Arago - tous gens du "Nacional" et de la "Réforme", assez hostiles à la socialistes (bien que les ouvriers, par inertie, aient d'abord placé leurs espoirs sur Ledru-Rollin). L'assemblée porte un regard très négatif sur les ouvriers parisiens et leurs prétentions socialistes ; les ouvriers l'ont remboursé. Le 15 mai, une manifestation de 150 000 personnes a eu lieu contre l'Assemblée, à laquelle se sont joints des gardes nationaux armés. Le slogan de la manifestation était un soulèvement armé en faveur de la Pologne (à cette époque, les troubles ont commencé dans les parties prussienne et autrichienne de la Pologne). Les manifestants firent irruption au Palais Bourbon, où siégeait l'Assemblée, et réclamèrent d'abord l'appui armé des Polonais. Cependant, alors le tanneur Hubert (sorti de prison, où il avait conspiré contre Louis Philippe) monta sur le podium et cria : "Au nom du peuple, je déclare l'Assemblée nationale dissoute !". Un nouveau gouvernement est proclamé, composé de dirigeants socialistes et radicaux (
Révolutions de 1848-1849
Révolutions européennes de 1848, qui s'appelaient le "Printemps des Nations" et "l'Année des Révolutions", ont commencé le 12 janvier 1848 en Sicile puis, en grande partie grâce à la révolution en France, se sont étendues à de nombreux pays européens.
Bien que la plupart des révolutions aient été rapidement réprimées, elles ont gravement affecté l'histoire de l'Europe.
[modifier] Pays non concernés
La Grande-Bretagne, le Royaume des Pays-Bas, l'Empire russe (y compris le Royaume de Pologne) et l'Empire ottoman sont les seuls grands États européens à avoir traversé cette période sans révolution civile. Les pays scandinaves n'ont été que peu touchés par les révolutions en Europe, bien qu'une constitution ait été approuvée au Danemark le 5 juin 1849. Il n'y a pas eu de révolution formelle dans la Principauté de Serbie, mais elle a activement soutenu la révolution serbe dans l'empire des Habsbourg.
Dans l'Empire russe en 1825, il y a eu un soulèvement des décembristes - une tentative ratée de coup d'État, qui a commencé le matin et a été réprimée à la tombée de la nuit. La stabilité relative de la Russie était due à l'incapacité des groupes révolutionnaires à communiquer entre eux. Dans le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, des émeutes ont eu lieu en 1830-1831, le soulèvement de novembre et le soulèvement de Cracovie en 1846. Le dernier soulèvement a eu lieu en 1863-65, le soi-disant soulèvement de janvier, mais il n'y a pas eu de soulèvement en 1848.
Bien qu'il n'y ait pas eu de bouleversements politiques majeurs en soi dans l'Empire ottoman, des troubles politiques se sont produits dans certains de ses États vassaux.
En Grande-Bretagne, la classe moyenne a été apaisée par l'affranchissement général de la réforme électorale de 1832, suivi du développement du mouvement chartiste, qui a adressé une pétition au Parlement en 1848.
L'abrogation des tarifs agricoles protectionnistes - les soi-disant "lois sur le maïs" - en 1846 a quelque peu ralenti l'activité prolétarienne.
Pendant ce temps, malgré le fait que la population de l'Irlande britannique a été réduite par une grande famine, le parti Young Ireland en 1848 a tenté de renverser la domination britannique. Leur rébellion, cependant, fut bientôt réprimée.
La Suisse est également restée calme en 1848, bien qu'elle ait traversé une guerre civile l'année précédente. L'introduction de la Constitution fédérale suisse en 1848 a été une révolution de masse qui a jeté les bases de la société suisse d'aujourd'hui.
Révolution de 1848 en France(fr. Révolution Française de 1848) - la révolution démocratique bourgeoise en France, l'une des révolutions européennes de 1848-1849. Les tâches de la révolution étaient l'établissement des droits civils et des libertés. Le 24 février 1848, elle aboutit à l'abdication du roi Louis Philippe Ier, autrefois libéral, et à la proclamation de la Seconde République. Dans la suite de la révolution, après la répression du soulèvement social-révolutionnaire en juin 1848, le neveu de Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, est élu président du nouvel État.
Plan.
Introduction
1. Révolution de 1848 en France.
2. Révolution en Allemagne.
3. Révolution dans l'empire autrichien.
4. Révolution de 1848 en Italie.
Conclusion.
Bibliographie.
Introduction
En 1848-1849. de nouvelles révolutions ont éclaté dans un certain nombre de pays d'Europe occidentale et centrale. Ils couvraient la France, l'Allemagne, l'empire autrichien, les États italiens. Jamais l'Europe n'a connu une telle intensification de la lutte, une telle ampleur de soulèvements populaires et une montée en puissance des mouvements de libération nationale. Bien que l'intensité de la lutte n'ait pas été la même dans les différents pays, les événements se sont développés différemment, une chose ne faisait aucun doute : la révolution avait acquis une ampleur paneuropéenne.
Vers le milieu du XIXème siècle. Les ordres féodaux-absolutistes dominaient encore tout le continent et, dans certains États, l'oppression sociale était étroitement liée à l'oppression nationale. Le début de l'explosion révolutionnaire est rapproché par les mauvaises récoltes de 1845-1847, la « maladie de la pomme de terre » ; privant la couche la plus pauvre de la population du principal produit alimentaire, et se développe en 1847. Immédiatement dans plusieurs pays, la crise économique. Les entreprises industrielles, les banques, les bureaux de commerce ont été fermés. Une vague de faillites a augmenté le chômage.
La révolution a commencé en février 1848 en France, puis a couvert presque tous les États d'Europe centrale. En 1848-1849. Les événements révolutionnaires prirent une ampleur sans précédent. Ils ont fusionné la lutte de diverses sections de la société contre l'ordre féodal-absolutiste, pour la démocratisation du système social, les actions des travailleurs, pour l'amélioration de la situation matérielle et des garanties sociales, la lutte de libération nationale des peuples opprimés et le puissant mouvement d'unification en Allemagne et en Italie.
1. Révolution de 1848 en France
À la fin de 1847, une situation révolutionnaire s'était développée en France. Les malheurs des travailleurs causés par l'exploitation capitaliste ont été encore plus intensifiés en raison de la mauvaise récolte de pommes de terre et de céréales et de la crise économique aiguë qui a éclaté en 1847. Le chômage a pris un caractère massif. Parmi les travailleurs, les pauvres des villes et des campagnes, une haine brûlante contre la monarchie de juillet bouillonnait. Dans de nombreuses régions de France en 1846-1847. des émeutes de la faim éclatent. L'insatisfaction de plus en plus ouverte à l'égard du « royaume des banquiers » embrassait de larges cercles de la petite et moyenne bourgeoisie, et même de grands industriels et commerçants. La session législative, qui s'ouvrit le 28 décembre 1847, se déroula dans une atmosphère orageuse. Les discours des orateurs de l'opposition ont dénoncé le gouvernement Guizot dans la vénalité, l'extravagance, la trahison des intérêts nationaux. Mais toutes les demandes de l'opposition ont été rejetées. L'impuissance de l'opposition libérale s'est également révélée lors de la campagne du banquet, lorsque le banquet prévu le 28 février a été interdit : l'opposition libérale, qui avait le plus peur des masses, a refusé ce banquet. Une partie des démocrates et socialistes petits-bourgeois, ne croyant pas aux forces de la révolution, a exhorté les "gens du peuple" à rester chez eux.
Malgré cela, le 22 février, des dizaines de milliers de Parisiens ont envahi les rues et les places de la ville, points de rassemblement pour le banquet interdit. Les manifestants étaient dominés par des travailleurs des banlieues et des étudiants. Dans de nombreux endroits, des escarmouches éclatent avec la police et les troupes, les premières barricades apparaissent, dont le nombre ne cesse de croître. La Garde nationale a hésité à combattre les rebelles et, dans un certain nombre de cas, les gardes se sont rangés à leurs côtés.
Il serait utile de noter que la politique intérieure et étrangère de la monarchie de juillet dans les années 30-40 du XIXe siècle. progressivement conduit au fait que les couches les plus diverses de la population se sont révélées opposées au régime - ouvriers, paysans, une partie de l'intelligentsia, de la bourgeoisie industrielle et commerciale. Le roi perdait de son autorité et même certains ormanistes insistaient sur la nécessité de réformes. La domination de l'aristocratie financière a suscité une indignation particulière dans le pays. La qualification foncière élevée n'a permis qu'à 1% de la population de participer aux élections. Dans le même temps, le gouvernement Guizot rejette toutes les revendications de la bourgeoisie industrielle pour l'élargissement du suffrage. "Enrichissez-vous, messieurs. Et vous deviendrez des électeurs », a été la réponse du Premier ministre aux partisans de l'abaissement des qualifications foncières.
La crise politique qui s'était amplifiée depuis le milieu des années 1940 a été exacerbée par les difficultés économiques qui ont frappé le pays. En 1947, une réduction de la production s'amorce, le pays est balayé par une vague de faillites. La crise a augmenté le chômage, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté, ce qui a encore aggravé la situation de la population et exacerbé le mécontentement à l'égard du régime.
L'opposition s'est également sensiblement développée au sein de la bourgeoisie. L'influence du parti républicain s'est accrue. Convaincu que le gouvernement a décidé de ne pas faire de concessions, l'opposition a été forcée de se tourner vers les masses pour obtenir un soutien. À l'été 1947, une vaste campagne de banquets politiques publics a commencé en France, au cours de laquelle, au lieu de postes, des discours ont été prononcés critiquant le gouvernement et exigeant des réformes. Les discours de banquet des républicains modérés, la politique des journaux et la dénonciation de la vénalité de l'appareil d'État ont soulevé les masses et les ont poussés à l'action. Le pays était à la veille de la révolution. Le 23 février, le roi Louis Philippe, effrayé par le développement des événements, destitue le gouvernement Guizot. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme et les personnalités de l'opposition étaient prêtes à se satisfaire de ce qui avait été réalisé. Mais dans la soirée, une colonne de manifestants non armés a été la cible de tirs de militaires gardant le ministère des Affaires étrangères. Les rumeurs de cette atrocité se sont rapidement répandues dans toute la ville, soulevant toute la population ouvrière de Paris. Des milliers d'ouvriers, d'artisans, d'étudiants ont construit près d'un millier et demi de barricades du jour au lendemain, et le lendemain, 24 février, tous les bastions de la ville étaient dans les rivières des rebelles.
Le roi Louis-Philippe s'empresse d'abdiquer en faveur de son jeune petit-fils, le comte de Paris, et s'enfuit en Angleterre. Le peuple insoumis s'empare du palais des Tuileries, le trône royal - symbole de la monarchie - est transféré place de la Bastille et solennellement incendié.
Lors d'une réunion de la Chambre des députés, les libéraux ont tenté de préserver la monarchie, mais leurs plans ont été contrecarrés par le peuple. Des foules de rebelles armés ont fait irruption dans la salle de réunion, exigeant la proclamation d'une république. Sous leur pression, les députés sont contraints d'élire un gouvernement provisoire.
L'avocat Dupont de L'er, participant aux révolutions de la fin du XVIIIe siècle en 1830, est élu président du Gouvernement provisoire, mais en fait celui-ci est dirigé par le libéral modéré Lamartine, qui prend le poste de ministre des Affaires étrangères. Affaires. Le gouvernement comprenait sept républicains de droite, deux démocrates (Ledru - Rolin et Floccon), ainsi que deux socialistes - un journaliste de talent Louis Blanc et un ouvrier - le mécanicien Alexander Albert.
Le 25 février, sous la pression du peuple armé, le Gouvernement provisoire proclame la France République. Les titres de noblesse ont également été abolis, des décrets ont été publiés sur la liberté de réunion politique et de la presse, et un décret sur l'introduction du suffrage universel pour les hommes de plus de 21 ans. Mais le gouvernement n'a pas touché à la monnaie d'État, qui s'était développée sous la monarchie de Juillet. Elle se limitait uniquement à la purge de l'appareil d'État. Dans le même temps, le régime le plus libéral d'Europe s'établit en France.
Dès les premiers jours de la révolution, parallèlement aux slogans démocratiques généraux, les travailleurs ont présenté des revendications pour la reconnaissance législative du droit au travail. Le 25 février, un décret a été adopté qui garantissait un tel droit aux travailleurs, proclamant les obligations de l'État de fournir du travail à tous les citoyens et abrogeait l'interdiction de former des associations de travailleurs.
En réponse à la demande d'organisation du ministère du Travail et du Progrès, le gouvernement provisoire a créé une "Commission gouvernementale pour les travailleurs", qui était censée prendre des mesures pour améliorer la situation des travailleurs. Lun Blanc en est devenu le président, A.Alber en est devenu l'adjoint. Pour les travaux de la commission, ils ont fourni des locaux au Palais du Luxembourg, sans le doter ni de pouvoirs réels ni de fonds. Cependant, à l'initiative de la commission, le gouvernement provisoire crée à Paris des bureaux de recherche d'emploi pour les chômeurs. La Commission luxembourgeoise a également essayé de jouer le rôle d'arbitre dans la résolution des conflits du travail entre employeurs et travailleurs.
Pour lutter contre le chômage de masse, le gouvernement s'est tourné vers l'organisation des travaux publics. A Paris, des ateliers nationaux sont créés, où entrent des entrepreneurs en faillite, des petits employés, des artisans et des ouvriers en perte de revenu. Leur travail consistait à replanter des arbres sur les boulevards parisiens, à creuser, à paver les rues. Ils étaient payés de la même manière - 2 francs par jour. Mais en mai 1848, lorsque plus de 100 000 personnes sont entrées dans les ateliers, il n'y avait pas assez de travail dans la ville pour tout le monde et les ouvriers ont commencé à ne prendre que 2 jours par semaine (pour le reste des jours, ils payaient un franc). En créant des ateliers nationaux, le gouvernement espérait apaiser les tensions dans la capitale et assurer l'adhésion des ouvriers au système républicain. Dans le même but, des décrets ont été pris sur la réduction de la journée de travail à Paris de 11 heures à 10 heures (en province de 12 à 11 heures), et la baisse du prix du pain, le retour aux pauvres des choses bon marché de prêteurs sur gages, etc.
La garde mobile du 24e bataillon, composée de mille personnes chacune, recrutée parmi les éléments déclassés (clochards, mendiants, criminels) va devenir l'épine dorsale du nouveau gouvernement. "Mobils" - ont été placés dans une position privilégiée. Ils recevaient des salaires relativement élevés et de bons uniformes.
Le maintien des ateliers nationaux, la création d'une garde mobile et le paiement anticipé des intérêts sur les emprunts de l'État compliquent la situation financière du pays. Dans un effort pour sortir de la crise, le gouvernement provisoire a augmenté les impôts directs sur les propriétaires (y compris les propriétaires et les locataires de terres) de 45%, ce qui a provoqué un fort mécontentement parmi les paysans. Cet impôt a non seulement détruit les espoirs des paysans d'améliorer leur situation après la révolution, mais a également sapé leur confiance dans le système républicain, qui a ensuite été utilisé par les monarchistes.
Dans cette situation, le 23 avril 1848, des élections à l'Assemblée constituante ont eu lieu dans le pays. La plupart des sièges (500 sur 880) ont été remportés par des républicains de droite. L'Assemblée constituante a confirmé l'inviolabilité du système républicain en France, mais a en même temps rejeté de manière décisive la proposition de créer un ministère du Travail. Les députés ouvriers se voient interdire de se présenter dans la salle de réunion et la loi adoptée par le nouveau gouvernement menace d'emprisonnement pour avoir organisé des rassemblements armés dans les rues de la ville. Le général Cavaignac, adversaire de la démocratie, est nommé ministre de la Guerre.
Le 15 mai, une manifestation de 150 000 personnes a lieu à Paris pour demander aux députés de l'Assemblée constituante de soutenir le soulèvement de libération nationale en Pologne. Cependant, les troupes gouvernementales dispersent les Parisiens. Les clubs révolutionnaires sont fermés, mais les dirigeants Albert, Raspail, Blanqui sont arrêtés. La Commission luxembourgeoise a également été officiellement fermée. Cavaignac renforce la garnison parisienne, attirant de nouvelles troupes dans la ville.
La situation politique est devenue de plus en plus tendue. Tout le cours des événements a conduit à une explosion inévitable. Le 22 juin, le gouvernement a émis un ordre de dissoudre les ateliers nationaux. Les hommes célibataires âgés de 18 à 25 ans qui y travaillaient étaient invités à rejoindre l'armée, les autres devaient être envoyés dans les provinces pour travailler des terres dans des zones marécageuses au climat insalubre. Le décret sur la dissolution des ateliers provoqua un soulèvement spontané dans la ville.
Le soulèvement a commencé le 23 juin, couvrant les quartiers populaires et la banlieue parisienne. Il a été suivi par 40 000 personnes. Le soulèvement a éclaté spontanément et n'avait pas de direction unifiée. Les combats étaient menés par des membres de sociétés révolutionnaires, contremaîtres d'ateliers nationaux. Le lendemain, l'Assemblée constituante, déclarant l'état de siège à Paris, transfère les pleins pouvoirs au général Cavaignac. Le gouvernement avait une énorme supériorité dans les forces, cent cinquante mille soldats réguliers de la garde mobile et nationale ont été tirés contre les rebelles. L'artillerie a été utilisée pour réprimer le soulèvement, détruisant des quartiers entiers. La résistance des ouvriers dura quatre jours, mais le soir du 26 juin, le soulèvement était écrasé. Les massacres ont commencé dans la ville. Onze mille personnes ont été abattues sans procès ni enquête. Plus de quatre mille cinq cents travailleurs pour avoir participé au soulèvement ont été exilés aux travaux forcés dans les colonies d'outre-mer. Le soulèvement de juin des ouvriers parisiens a été un tournant dans la révolution de 1848 en France, après quoi il a commencé à décliner fortement.
Après la répression de l'insurrection, l'Assemblée constituante élit le général Cavaignac à la tête du gouvernement. L'état de siège se poursuit à Paris. Les clubs révolutionnaires ont été fermés. A la demande des entrepreneurs, l'Assemblée constituante annule le décret sur la réduction d'une heure de la journée de travail, dissout les ateliers nationaux de la province. Dans le même temps, le décret sur l'impôt de quarante-cinq centimes sur les propriétaires et locataires de terres est resté en vigueur.
En novembre 1848, l'Assemblée constituante adopte la constitution de la Deuxième République. La constitution n'a pas garanti le droit au travail promis après la révolution de février, ni proclamé les libertés et droits civils fondamentaux. Après la répression du soulèvement de juin, la bourgeoisie française avait besoin d'un gouvernement fort capable de résister au mouvement révolutionnaire. À cette fin, le poste de président a été créé, doté de pouvoirs extrêmement étendus. Le président était élu pour quatre ans et était totalement indépendant du parlement : il nommait et révoquait lui-même les ministres, les hauts fonctionnaires et les officiers, commandait les forces armées et dirigeait la politique étrangère.
Le pouvoir législatif était confié au parlement monocaméral - l'assemblée législative, qui était élue pour trois ans et n'était pas sujette à une dissolution anticipée. En rendant le président et le parlement indépendants l'un de l'autre, la constitution a donné lieu à un conflit inévitable entre eux, et en dotant le président d'un pouvoir fort, elle lui a donné la possibilité de réprimer le parlement.
En décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu président de la France. Aux élections, il remporte 80 % des suffrages, obtenant non seulement le soutien de la bourgeoisie, qui aspire au pouvoir fort, mais aussi une partie des ouvriers qui votent pour lui afin que la candidature du général Cavaignac ne passe pas. Les paysans (la plus grande partie de la population) ont également voté pour Bonaparte, qui croyait que le neveu de Napoléon Ier protégerait également les intérêts des petits propriétaires terriens. Devenu président, Bonaparte resserre le régime politique. Les républicains sont expulsés de l'appareil d'État et la majorité des sièges à l'Assemblée législative élus en mai 1849 sont obtenus par les monarchistes, réunis dans le parti de l'ordre. Un an plus tard, l'Assemblée législative a adopté une nouvelle loi électorale, qui a établi une condition de résidence de trois ans. Environ trois millions de personnes ont été privées de leurs droits.
Dans les cercles dirigeants de France, la désillusion vis-à-vis du système parlementaire grandissait et le désir d'un gouvernement ferme qui protégerait la bourgeoisie de nouveaux soulèvements révolutionnaires s'intensifiait. Après s'être emparé de la police et de l'armée, le 2 décembre 1851, Louis Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. L'Assemblée législative a été dissoute et des politiciens hostiles au président ont été arrêtés. La résistance républicaine à Paris et dans d'autres villes a été écrasée par les troupes. Dans le même temps, pour apaiser l'opinion publique, le président rétablit le suffrage universel. Le coup d'État a permis à Louis Bonaparte de prendre complètement le pouvoir dans le pays. Le 2 décembre 1852, le Président se proclame Empereur Napoléon III. 8 millions de Français ont voté pour la restauration de l'empire.
Le régime du pouvoir personnel de l'empereur a été établi dans le pays. Le Parlement, composé du Corps législatif, qui n'avait pas le droit d'initiative législative, et du Sénat, nommé par l'empereur, n'avait pas de pouvoirs réels. Sur la base des propositions de l'empereur, les lois ont été élaborées par le Conseil d'État. Les sessions des chambres du parlement se tenaient dans les coulisses, les rapports à leur sujet n'étaient pas publiés. Les ministres étaient nommés personnellement par l'empereur et n'étaient responsables que devant lui. La presse était sous le contrôle de la censure, les journaux étaient fermés pour la moindre infraction. Les républicains ont été contraints d'immigrer de France. Pour protéger les intérêts des grands propriétaires, Napoléon III renforce la bureaucratie, l'armée et la police. L'influence de l'Église catholique s'accrut.
Le régime bonapartiste s'appuie sur la grande bourgeoisie industrielle et financière et bénéficie du soutien d'une partie importante de la paysannerie. La particularité du bonapartisme en tant que forme de gouvernement est la combinaison de méthodes de terreur militaire et policière avec des manœuvres politiques entre différents groupes sociaux. S'appuyant idéologiquement sur l'Église, le régime bonapartiste tente de se faire passer pour un pouvoir national.
Le gouvernement encourage les entrepreneurs, et pendant les années du Second Empire (1852-1870) une révolution industrielle s'achève en France. Arrivé au pouvoir, Napoléon III a déclaré que le Second Empire serait un État pacifique, mais en fait, tout au long des 18 années de son règne, il a mené une politique étrangère agressive. Au cours de ces années, la France a participé à la guerre de Crimée avec la Russie, en alliance avec le Royaume de Sardaigne - dans la guerre avec la Russie, a mené des guerres coloniales agressives au Mexique, en Chine et au Vietnam.
Révolution en Allemagne
Le développement socio-économique et politique de l'Allemagne dans les années 30 et 40 du XIXe siècle a montré que sans éliminer les vestiges de la fragmentation féodale du pays hérités du Moyen Âge, son progrès ultérieur est impossible.
La bourgeoisie libérale des États allemands exigeait la convocation d'un parlement entièrement allemand et l'abolition des privilèges Junker. L'aile gauche et radicale de l'opposition appelait à l'élimination des distinctions de classe, à la proclamation d'une république et à l'amélioration de la situation matérielle des pauvres.
Le renforcement de l'opposition de la bourgeoisie et la croissance simultanée de l'activité des travailleurs à la fin des années quarante témoignent de l'aggravation rapide de la situation politique. La nouvelle qu'une république avait été proclamée en France ne fit que hâter l'inévitable explosion révolutionnaire.
A Baden, la France voisine, les manifestations ont commencé le 27 février. La pétition déposée par les libéraux et les démocrates au parlement parlait de la liberté de la presse, de la liberté de réunion, de l'introduction d'un jury, de la création d'une milice populaire et de la convocation d'un parlement national entièrement allemand. Le duc Léopold a été contraint d'accepter la plupart de ces demandes et d'introduire des ministres libéraux dans le gouvernement. Les événements de mars 1848 se sont également déroulés approximativement dans les autres petits États de l'ouest et du sud-ouest de l'Allemagne. Partout, les monarques effrayés ont été contraints de faire des concessions et de permettre aux figures de l'opposition d'accéder au pouvoir.
Bientôt, des troubles populaires ont également balayé la Prusse. Le 3 mars, les ouvriers et artisans qui descendent dans les rues de Cologne encerclent la mairie et exigent la mise en œuvre immédiate de réformes démocratiques. De Cologne, le mouvement s'est rapidement propagé vers l'est, atteignant la capitale prussienne le 7 mars. A partir de ce jour, les manifestations ne se sont pas arrêtées dans les rues et les places de Berlin, qui se sont transformées à partir du 13 mars en affrontements sanglants entre les manifestants et les troupes et la police.
Le 18 mars, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV promet d'introduire une constitution, annonce l'abolition de la censure et convoque un parlement. Mais les affrontements entre manifestants et troupes se sont poursuivis et les 18 et 19 mars se sont transformés en batailles de barricades dans tout Berlin. Les rebelles - ouvriers, artisans, étudiants, occupaient une partie de la ville et le 19 mars, le roi fut contraint d'ordonner le retrait des troupes de la capitale.
Dans le même temps, un nouveau gouvernement est formé, dirigé par des représentants de l'opposition libérale, Kamygauzen et Hanseman. Les bourgeois de Berlin créent une garde civile et se chargent de maintenir l'ordre dans la ville. Le 22 mai à Berlin, l'Assemblée constituante de Prusse a été convoquée, qui devait adopter la constitution de l'État.
En mai 1848, un parlement entièrement allemand commença ses travaux à Francfort-sur-le-Main, élu au suffrage universel par la population de tous les États allemands. La plupart de ses députés étaient la bourgeoisie libérale et l'intelligentsia. Lors des réunions parlementaires, un projet de constitution unifiée pour tous les États allemands a été discuté, la question de l'avenir de l'Allemagne, les options «Grand allemand» (avec la participation de l'Autriche) et «Petit allemand» (sans l'Autriche) pour unifier le pays a été discuté.
Mais le Parlement de Francfort n'est pas devenu une autorité centrale entièrement allemande. Le gouvernement qu'il a élu n'avait ni les moyens ni l'autorité pour mener une quelconque politique. Le pouvoir réel est resté entre les mains des monarques allemands individuels, qui n'avaient aucune intention de renoncer à leurs droits souverains. Des actions spontanées et dispersées pouvaient effrayer les classes dominantes, mais pas assurer la victoire de la révolution. De plus, la menace du mouvement ouvrier grandissant, inclinait de plus en plus les bourgeois à faire des compromis avec la noblesse et la monarchie. En Prusse, après la répression d'une tentative de soulèvement des ouvriers de Berlin, le roi déjà en juin 1848 renvoya le gouvernement libéral de Camphausen, et bientôt le suivant, le libéral Hamsemann, tomba également. A l'automne, les réactionnaires sont de nouveau au pouvoir, poussant le roi à disperser l'Assemblée constituante.
En décembre 1848, l'Assemblée est dissoute, et à la suite de cela, la constitution accordée par le roi est mise en vigueur. Il a conservé la promesse de liberté de mars, mais a donné au monarque le droit d'abroger toute loi adoptée par le Landtag (Parlement). En mai 1849, une nouvelle loi électorale est adoptée en Prusse, divisant les électeurs en trois classes selon le montant des impôts payés. De plus, chaque classe a élu un nombre égal d'électeurs, qui, à leur tour, ont élu des députés à la chambre basse du parlement par vote ouvert. Un an plus tard, cette loi devient partie intégrante de la nouvelle constitution, accordée par le roi, qui remplace la constitution de 1848.
Entre-temps, en mars 1849, le Parlement de Francfort adopte la Constitution impériale. Il prévoyait l'établissement d'un pouvoir impérial héréditaire en Allemagne et la création d'un parlement bicaméral. Une place particulière dans la constitution était occupée par les "droits fondamentaux du peuple allemand". Ils établirent l'égalité de tous devant la loi, abolirent les privilèges et les titres de noblesse. Dans le même temps, pour la première fois dans l'histoire, les Allemands se sont vu garantir les libertés et droits civils fondamentaux - l'inviolabilité de la personne et de la propriété privée, la liberté de conscience, la liberté de presse, d'expression et de réunion. Tous les "relations de servage" ont également été abolies, bien que les paysans aient dû racheter les droits fonciers.
Ainsi, les conservateurs, avec le soutien des libéraux, ont réussi à inscrire le principe monarchique dans la constitution, contrairement aux revendications des quelques démocrates qui insistaient sur la création d'une république démocratique unique. Le parlement de Francfort, dans lequel l'"orientation petite allemande" l'a emporté, a décidé de transférer la couronne impériale au roi de Prusse. Mais il refusa résolument de l'accepter des mains de l'assemblée créée par la révolution. À leur tour, les monarques des États allemands ont déclaré qu'ils refusaient de reconnaître le pouvoir des organes centraux créés sur la base de la constitution.
Les républicains et les démocrates se sont efforcés de défendre la constitution et de la mettre en pratique. En mai-juin 1849, ils soulevèrent des soulèvements pour la défense de la constitution en Saxe, en Rhénanie, à Bade et dans le Palatinat. Cependant, ils ont tous été réprimés et à Bade et dans le Palatinat, les troupes prussiennes ont participé à la répression des soulèvements.
La révolution en Allemagne a été vaincue et n'a pas atteint son objectif principal - l'unification nationale du pays. Contrairement à la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, elle est restée inachevée : elle n'a pas conduit à l'élimination de la monarchie et des autres vestiges du Moyen Âge. Cependant, de nombreux vestiges de la féodalité ont été détruits. La Prusse et d'autres États allemands avaient des constitutions qui accordaient à la population les libertés et droits civils fondamentaux.
L'unification nationale de l'Allemagne n'a pas eu lieu démocratiquement. Elle a été remplacée par une autre voie d'unification, dans laquelle la monarchie prussienne a joué un rôle de premier plan.
Conclusion
Ainsi, résumant les travaux, nous avons découvert qu'en 1848-1849, les pays d'Europe occidentale et centrale étaient en proie à des révolutions. L'Europe a connu une guerre aggravée, des soulèvements populaires et des mouvements de libération nationale. En France, en Allemagne, dans l'Empire autrichien et en Italie, les événements se sont développés différemment, cependant, la révolution a acquis un caractère paneuropéen. Précédée par la révolution dans tous les pays, une situation économique difficile causée par la famine, les mauvaises récoltes, le chômage. Les événements révolutionnaires ont uni divers segments de la population contre l'ordre féodal-absolutiste.
Au début de 1848, l'Europe entre dans une période mouvementée de révolutions et de soulèvements révolutionnaires qui engloutissent un vaste territoire de Paris à Budapest, de Berlin à Palerme. Différents dans leurs buts et objectifs, tous ces événements ont été caractérisés par la participation active des larges masses populaires, qui ont été le principal moteur de ces actions et ont supporté le poids de la lutte.
troubles populaires
Les années pré-révolutionnaires ont été marquées par des troubles populaires dans presque tous les pays européens. En France, l'année 1847 est marquée par de nombreuses actions des masses populaires, qui se déroulent un peu partout, principalement sous la forme de troubles alimentaires : les pauvres des villes et des campagnes s'attaquent aux entrepôts de céréales et aux boutiques des spéculateurs. Le mouvement de grève s'est largement répandu. Le gouvernement a brutalement traité les participants à ces discours.
En Angleterre, le mouvement chartiste revit, des rassemblements de masse ont lieu. Une nouvelle pétition préparée pour être soumise au Parlement contenait une critique acerbe de l'ordre social existant et demandait l'octroi de la liberté nationale à l'Irlande.
En Allemagne, au début du printemps 1847, des soulèvements spontanés des masses ont eu lieu dans un certain nombre de villes. Les troubles dans la capitale de la Prusse - Berlin étaient particulièrement graves. Les 21 et 22 avril, le peuple affamé est descendu dans la rue pour protester contre la cherté et l'indifférence des autorités aux besoins de la population. Plusieurs boutiques ont été détruites, des vitres ont été brisées dans le palais de l'héritier du trône.
Sur la base de l'aggravation des contradictions de classe, les humeurs révolutionnaires du prolétariat se sont élevées. Dans le même temps, l'opposition de la petite et moyenne bourgeoisie grandissait, et dans certains pays, par exemple en France, également de parties de la grande bourgeoisie industrielle, mécontentes de la domination de l'aristocratie financière.
Révolution en France
Journées de février à Paris
Une explosion révolutionnaire en France eut lieu au début de 1848. Le 22 février, un autre banquet de partisans de la réforme parlementaire était prévu à Paris. Les autorités ont interdit le banquet. Cela provoqua une grande indignation parmi les masses. Au matin du 22 février, l'agitation régnait dans les rues de Paris. Une colonne de manifestants, dominée par des ouvriers et des étudiants, se dirige vers le Palais Bourbon en chantant la Marseillaise et en criant : « Vive la Réforme ! », « A bas Guizot ! ». Sans se diriger vers le bâtiment du palais, les manifestants se sont dispersés dans les rues avoisinantes et ont commencé à démonter le trottoir, à renverser les omnibus et à ériger des barricades.
Des troupes envoyées par le gouvernement ont dispersé les manifestants dans la soirée et ont pris le contrôle de la situation. Mais le lendemain matin, la lutte armée dans les rues de Paris reprend. Effrayé par les informations selon lesquelles le soulèvement grandissait et que la Garde nationale exigeait un changement à la tête du ministère, le roi Louis-Philippe destitua Guizot et nomma de nouveaux ministres considérés comme des partisans de la réforme.
Contrairement aux calculs des milieux dirigeants, ces concessions ne satisfont pas les masses populaires de Paris. Les affrontements entre le peuple rebelle et les troupes royales se poursuivent. Elles se sont particulièrement intensifiées après l'exécution provocatrice de manifestants non armés le soir du 23 février. De nouvelles barricades ont été érigées dans les rues. Leur nombre total a atteint un millier et demi. Cette nuit-là, le soulèvement a pris un caractère plus organisé. A la tête du peuple insurgé se trouvaient des membres de sociétés secrètes révolutionnaires, principalement des ouvriers et de petits artisans.
Au matin du 24 février, presque tous les points stratégiques de la capitale sont capturés par les rebelles. La panique régnait dans le palais. Sur les conseils de ses proches collaborateurs, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, et s'enfuit en Angleterre. Guizot y disparut également.
L'abdication du roi n'a pas arrêté le développement de la révolution. Les combats de rue à Paris se sont poursuivis. Les détachements révolutionnaires prennent possession du palais des Tuileries. Le trône royal fut sorti dans la rue, installé sur la place de la Bastille et brûlé sur le bûcher sous les exclamations jubilatoires d'une foule de milliers de personnes.
Révolution en Allemagne
Spectacles paysans
Presque simultanément avec les événements révolutionnaires dans les villes, des soulèvements révolutionnaires de paysans ont commencé. Ils étaient les plus répandus dans le sud et le sud-ouest de l'Allemagne.
La Prusse est également touchée par le mouvement. Les paysans, armés de faux, de fourches et de haches, expulsent les forestiers et les anciens, abattent les forêts du maître, attaquent les châteaux nobles, exigent la délivrance de documents féodaux et les brûlent aussitôt sur le bûcher ; les propriétaires terriens ou leurs gérants sont contraints de signer des obligations renonçant à tous les droits féodaux. Dans certains endroits, les paysans ont brûlé les châteaux et les bureaux des propriétaires terriens. Les maisons des grands usuriers et des spéculateurs ont également été attaquées.
Contrairement à la France à la fin du XVIIIe siècle, où les soulèvements anti-féodaux de la paysannerie ont reçu le soutien de la bourgeoisie révolutionnaire, en Allemagne en 1848, la bourgeoisie a cherché des accords avec la noblesse contre les mouvements populaires. La lâcheté et l'indécision de la bourgeoisie allemande étaient dues en partie à sa faiblesse, mais plus encore à son lien avec la classe féodale et à sa dépendance totale vis-à-vis des autorités. D'autre part, la paysannerie allemande de cette période était déjà différente de la paysannerie française de la fin du XVIIIe siècle. Dans la campagne allemande au milieu du XIXème siècle. la différenciation des classes était déjà allée loin ; A cela s'ajoute l'influence d'une propagande contre-révolutionnaire active, menée auprès des paysans par les propriétaires terriens et leurs proches. En conséquence de tout cela, le mouvement paysan en Allemagne en 1848 ne s'est pas aussi répandu qu'en France en 1789-1794.
Insurrection des Polonais à Poznań
La révolution de mars en Prusse a donné un élan à la montée du mouvement de libération nationale à Poznan, une région polonaise qui faisait partie du royaume prussien. Un comité national a été formé à Poznań, dans lequel les grands propriétaires terriens ont joué le rôle principal. Une députation envoyée à Berlin a présenté des demandes pour l'organisation du corps polonais et la nomination de Polonais à des postes administratifs et autres à Poznań. Le gouvernement prussien a accepté d'accepter ces demandes. Plus tard, une demande a également été présentée pour la reconnaissance de la langue polonaise comme langue officielle à Poznań.
Les masses populaires de Posen se sont soulevées pour lutter pour l'indépendance de la Prusse. Début avril, les détachements d'insurgés polonais comptaient déjà 15 à 20 000 personnes. Ils se composaient principalement de paysans, mais les commandants étaient majoritairement issus de la noblesse. La direction générale appartenait à l'éminent révolutionnaire polonais Mieroslavsky.
A la veille de 1848, il y avait de nombreuses preuves d'une nouvelle explosion révolutionnaire imminente. De toutes les factions de la bourgeoisie française, l'aristocratie financière s'est avérée la moins capable de gouverner le pays. La force intérieure de l'alliance démocratique entre les ouvriers et la petite bourgeoisie s'est immédiatement fait sentir dès que le cours des événements a uni ces classes dans une révolte commune contre l'oppression de l'aristocratie financière.
Le 22 février, des milliers de Parisiens, emmenés par des ouvriers et des étudiants de banlieue, envahissent les places. Des troupes et des gardes municipaux se sont mis en travers du chemin des manifestants. Les premières barricades apparaissent. Le lendemain, les escarmouches et les combats se multiplient. Le nombre de barricades augmentait constamment. Cela a semé la confusion dans les bataillons de la Garde nationale. Aux cris de « Vive la réforme ! », « A bas Guizot ! intensifié.
Fin 23 février, le roi Louis Philippe avait décidé de sacrifier Guizot. Le comte Molin, orléaniste libéral, est nommé chef du nouveau gouvernement. Mais les ouvriers, qui retenaient les leçons de 1830, ne se laissèrent pas tromper et continuèrent à lutter contre la monarchie. « A bas Louis-Philippe ! criaient les ouvriers.
Le 23 février, un événement tragique a eu lieu dans le centre de Paris : des manifestants non armés se dirigeant vers l'immeuble où habitait Guizot ont été abattus. Des milliers de Parisiens se précipitent dans la bataille. En une nuit, ils ont construit plus de 1 500 barricades. Le soulèvement contre la monarchie prit un caractère véritablement populaire. Sa force organisatrice était constituée de membres des sociétés républicaines secrètes. Au matin du 24 février, la lutte reprend avec une vigueur renouvelée. Le peuple s'est emparé de presque toutes les mairies des arrondissements. Les soldats ont commencé à fraterniser avec la population. A midi, ils ont commencé à prendre d'assaut la résidence royale. Louis-Philippe, convaincu du désespoir de la situation, accepte d'abdiquer en faveur de son jeune petit-fils, le comte de Paris.
Les membres des barricades, faisant irruption dans la salle de réunion du parlement, s'exclamèrent : « Vive la république ! Les rebelles ont décidé d'élire un gouvernement provisoire. En outre, un comité non autorisé de "délégués du peuple" a été formé pour surveiller en permanence les actions du gouvernement. Le rôle dirigeant dans le gouvernement a été conservé par les ministres bourgeois-républicains. Une "commission gouvernementale pour les travailleurs" est créée, qui devient le "ministère de la bonne volonté".
Plus concrètement signifiaient les décrets sur la réduction d'une heure de la journée de travail, sur la baisse du prix du pain, sur la mise à disposition du million de francs restant de l'ancien roi aux associations ouvrières, sur le retour des objets mis en gage par les pauvres dans les prêteurs sur gage, sur la suppression des restrictions de classe pour entrer dans la garde nationale, sur l'introduction en France du suffrage universel pour les hommes de plus de 21 ans.
Le contenu historique de la révolution de 1848 était la reconstruction politique du système bourgeois. Cependant, les postes conquis par le prolétariat étaient extrêmement fragiles. La principale source de faiblesse était les illusions qui prévalaient parmi les masses laborieuses quant à la possibilité d'une réorganisation pacifique de la société en coopération avec la bourgeoisie républicaine.
Afin de modifier le rapport de force et de chasser le prolétariat des positions qu'il avait conquises, le gouvernement provisoire a tenté de scinder ses rangs. A cette fin, il a cherché à arracher les éléments lumpen-prolétariens de la classe ouvrière et à s'y opposer en créant une "garde nationale mobile".
Le projet de "garde mobile" avait deux objectifs. Premièrement, cette mesure a contribué à la création rapide d'une force armée ; deuxièmement, le gouvernement espérait utiliser la jeunesse ouvrière au chômage contre le prolétariat révolutionnaire. La création d'"ateliers nationaux" où des ouvriers qualifiés s'occupaient d'aménager les rues et de planter des arbres était également liée aux calculs d'une scission des ouvriers.
Le gouvernement espérait que les « ateliers nationaux » deviendraient son pilier dans la lutte contre les sentiments révolutionnaires ; à cette fin, ils ont été dotés d'une structure paramilitaire. L'un des rares actes progressistes du gouvernement provisoire fut l'adoption en avril 1848 d'une loi abolissant l'esclavage dans les colonies françaises.
L'isolement des forces prolétariennes révolutionnaires a contribué à l'affaiblissement des positions de la classe ouvrière. Dans une bien plus grande mesure, la bourgeoisie a réussi à diviser la classe ouvrière et la petite bourgeoisie. Tout cela a contribué à l'affaiblissement des forces de la démocratie. Lors des élections de Assemblée constituante tenues les 23 et 24 avril, les républicains bourgeois l'ont emporté. Les ouvriers parisiens sont saisis de la détermination de défendre les acquis et les revendications de la république. Pour la première fois, les ouvriers des "ateliers nationaux" ont pris une part active à la manifestation du 15 mai. En mai-juin 1848, le mouvement de grève continue de s'intensifier. Le 22 juin, des manifestations et des rassemblements ouvriers débutent dans les rues de Paris sous les slogans : « A bas la Constituante ! », « Diriger ou travailler !
Le matin du 23 juin, la construction de barricades a commencé dans les régions de l'Est. Le 24 juin au matin, l'Assemblée constituante transfère les pleins pouvoirs au général Cavaignac.
Le soulèvement des ouvriers à Paris en juin 1848 est spontané. Néanmoins, il s'embrasa à la vitesse d'un feu de forêt. Le nombre total de rebelles a atteint 40 à 45 000 personnes. Les slogans des rebelles étaient : « Du pain ou du plomb ! », « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ! », « A bas l'exploitation de l'homme par l'homme ! Au premier rang des rebelles se trouvaient des constructeurs de machines, des cheminots.
Les forces des rebelles n'étaient pas couvertes par une direction unique, mais des tentatives ont quand même été faites pour établir une interaction. La principale raison de la fragmentation des forces rebelles était l'absence d'une organisation unifiée du prolétariat. Les dirigeants du prolétariat parisien sont emprisonnés après le 15 mai, leurs clubs sont fermés.
Au matin du 24 juin, les rebelles lancent une nouvelle offensive. Mais ils ne purent consolider leur succès. Faute de direction et d'un plan général de lutte, ils se mettent sur la défensive et laissent l'initiative à l'ennemi. Dans la soirée du 24 juin, les troupes gouvernementales lancent une contre-offensive. Avant le 25 juin Cavaignac réussi à créer une énorme prépondérance de forces.
Il est instructif que dès 1848 la bourgeoisie ait utilisé contre les ouvriers insurgés une telle arme favorite de propagande calomnieuse que d'attribuer la montée du mouvement révolutionnaire aux activités subversives des "agents étrangers".
Le 26 juin, le soulèvement ouvrier est finalement écrasé. Au total, 11 000 personnes ont été tuées - la couleur du prolétariat parisien.
Deuxième République
 La répression de l'insurrection marqua un tournant dans les traditions de l'histoire française moderne : pour la première fois, la décision du sort du pays passa du Paris révolutionnaire à une province propriétaire bourgeoise et propriétaire. La défaite du prolétariat a renforcé les bases d'un renforcement de la réaction. Les élections municipales d'août 1848 sont presque unanimement remportées par les monarchistes. La nouvelle constitution a introduit un parlement monocaméral - Assemblée législativeélu pour 3 ans au suffrage universel.
La répression de l'insurrection marqua un tournant dans les traditions de l'histoire française moderne : pour la première fois, la décision du sort du pays passa du Paris révolutionnaire à une province propriétaire bourgeoise et propriétaire. La défaite du prolétariat a renforcé les bases d'un renforcement de la réaction. Les élections municipales d'août 1848 sont presque unanimement remportées par les monarchistes. La nouvelle constitution a introduit un parlement monocaméral - Assemblée législativeélu pour 3 ans au suffrage universel.
Les principales limitations du président étaient qu'il était élu pour un mandat de quatre ans sans droit de réélection pour les quatre années suivantes et qu'il n'avait pas le droit de dissoudre l'Assemblée législative. Néanmoins, l'énorme pouvoir du président lui a donné l'occasion d'exercer une forte pression sur le parlement.
Lors de l'élection présidentielle de 1848, il obtient le plus de voix Louis Napoléon, qui a attiré la sympathie de la plupart de la grande bourgeoisie, qui aspirait à un pouvoir monarchique ferme. Elle devint l'étendard des forces les plus diverses unies contre la république bourgeoise. Le 20 décembre 1848, il accède à la présidence de la République.
L'objectif immédiat des monarchistes était d'obtenir la dissolution rapide de l'Assemblée constituante et son remplacement par un nouveau parlement. Le point culminant de l'activité de l'assemblée fut la nouvelle loi électorale adoptée le 31 mai 1850, qui priva la masse des travailleurs contraints de changer fréquemment de lieu de résidence à la recherche de travail. La liberté de réunion a encore été restreinte. En mars 1850, la "loi Fallu" est votée, qui place l'instruction publique sous le contrôle du clergé. Au cours de 1850-1851, la France a finalement été transformée en un État autoritaire.
62, 63, 64, 65, 66
La France sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.
Restauration
Restauration des Bourbons - la restauration du pouvoir des monarques-représentants de la dynastie des Bourbons en France pour la période de 1814 à 1830, caractérisée par des ordres contradictoires des monarques, une situation politique instable dans le pays.
Les conditions offertes aux Français par le premier traité de paix de Paris (30 mai 1814) sont très généreuses : la France reste dans les frontières de 1792 et n'a pas à payer d'indemnité. Napoléon est exilé à l'île d'Elbe, et Talleyrand, qui négocie avec la partie française, convainc les alliés de restaurer la dynastie des Bourbons en France en la personne du frère du dernier roi. Ce prince d'âge moyen, dont on disait qu'il n'avait "rien appris et rien oublié", devint le roi Louis XVIII. Il proposa au peuple français une Charte constitutionnelle, extrêmement libérale et confirmant toutes les réformes les plus importantes de l'époque de la révolution.
Les problèmes de rétablissement de la paix en Europe se sont avérés si complexes que les représentants des États européens se sont réunis pour un congrès à Vienne. Les divergences entre les grandes puissances ont conduit à la conclusion d'accords secrets séparés entre elles et à la menace de guerre. A cette époque, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe vers le sud de la France, d'où il dirigea un cortège triomphal vers Paris. Dans le camp des alliés, les différends apparus au Congrès de Vienne sont instantanément oubliés, Louis XVIII s'enfuit en Belgique et Wellington rencontre Napoléon à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Après la défaite, Napoléon est condamné à perpétuité. emprisonné et exilé à St. Hélène.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle. la plupart des Français étaient occupés par des affaires personnelles et faisaient peu d'efforts pour s'exprimer dans l'arène politique. En effet, sous le règne d'une cour anachronique, de deux chambres (députés et pairs) et de ministres et hommes politiques successifs), aucun événement significatif n'a eu lieu dans le pays. A la cour, il y avait un groupe ultra-royaliste dirigé par le frère du roi, le comte d'Artois. Louis XVIII ne voulait pas leur céder le pouvoir, mais après sa mort en 1825 d'Artois monta sur le trône sous le nom de Charles X. La loi sur le droit du fils aîné à hériter des biens a été rejetée, mais une autre loi a été adoptée prévoyant une compensation financière aux nobles dont les terres ont été confisquées pendant la révolution. Les efforts des milieux financiers pour limiter Karl avec des mesures constitutionnelles l'ont incité à signer des décrets qui contredisaient la constitution - des "ordonnances" (25 juillet 1830). Les ordonnances prévoyaient la dissolution de la chambre basse, la double réduction du nombre de députés, l'exclusion des listes électorales de tous les titulaires de brevets commerciaux et industriels et la restriction du cercle des électeurs aux seuls grands propriétaires fonciers (c'est-à-dire , principalement des nobles), l'introduction d'un système d'autorisations préalables pour la publication de journaux et de magazines. En réponse à cette tentative de coup d'État, l'opposition a appelé la population à résister au gouvernement. Des manifestations ont eu lieu dans les rues de Paris, qui se sont transformées en soulèvement. Le 29 juillet 1830, le peuple prend possession du palais des Tuileries par une bagarre. Sous la pression des masses, Charles X abdique et s'enfuit en Angleterre. Les organisateurs du complot, dont Talleyrand et Adolphe Thiers, créent un gouvernement provisoire qui donne la couronne à Louis Philippe, duc d'Orléans.
Monarchie de Juillet
La révolution de 1830 entraîne un changement de roi, mais nullement de régime.
La nouvelle constitution, adoptée le 14 août 1830, a conservé bon nombre des dispositions de l'ancienne Charte. Les droits de la Chambre des députés ont été légèrement élargis et le nombre d'électeurs a augmenté (de 100 000 à 240 000) en raison d'une certaine réduction de la qualification foncière. Les privilèges du sommet de la bourgeoisie commerciale, industrielle et bancaire ont été consolidés, qui a acquis le plein pouvoir dans le pays. Pas étonnant que Louis Philippe ait commencé à être appelé le "roi-bourgeois".
Dans les années 1840, la construction de chemins de fer a commencé, accompagnée d'un boom des investissements spéculatifs. Une mauvaise récolte en Europe en 1847 et une pénurie de pain dans de nombreuses régions laissaient présager la famine, et la hausse des prix a conduit à l'appauvrissement massif des travailleurs urbains. La famine a indirectement affecté le marché des changes de Londres en provoquant des sorties de capitaux de Paris. Cela prédéterminait une crise financière majeure en France. Dans cette position, le roi a poursuivi obstinément une politique qui était dans son propre intérêt et dangereuse pour tous les autres investisseurs français.
Le ministre royal, François Guizot, contrôlait toutes les activités du gouvernement, soudoyant la plupart des députés. De cette façon, sans aucune violation apparente des privilèges constitutionnels, il pourrait bloquer tous les canaux légaux par lesquels l'opposition pourrait agir. Face à la menace de faillite, des banquiers et des entrepreneurs lésés ont organisé des rassemblements de protestation pour intimider le roi afin qu'il fasse des concessions. Cependant, le roi comptait sur une répétition du soulèvement de 1830 et son appel à la foule. Cette fois, la foule est moins accommodante et Louis Philippe doit abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, et fuir en Angleterre. Les rebelles encerclent la Chambre des députés et demandent la proclamation d'une république.
Révolution de février en France en 1848 et la Deuxième République.
Révolution de 1848.
Le gouvernement provisoire était constamment menacé et la situation n'a été sauvée que par la promesse du ministre du Travail de fournir un emploi à de nombreux chômeurs et d'organiser les soi-disant. "ateliers nationaux" (dans le cadre desquels ils appréhendaient différents types de travaux publics). Ces ateliers s'inscrivaient dans le cadre du projet de socialisme coopératif esquissé dans les publications du journaliste Louis Blanc, qui venait d'être nommé ministre du Travail. Au printemps 1848, des milliers de chômeurs et de sans-abri arrivent à Paris de province pour trouver du travail dans les ateliers. Une série de manifestations de rue massives a convaincu le gouvernement que si les ateliers n'étaient pas immédiatement démantelés et les travailleurs dispersés, la situation finirait par devenir incontrôlable. La liquidation des ateliers nationaux a été annoncée et les provinciaux ont eu la possibilité de rentrer chez eux ou de rejoindre l'armée. Les meneurs des manifestations, conscients du danger de représailles inévitables, décidèrent de soulever un soulèvement. Les ordres de liquidation des ateliers sont ignorés, les ouvriers prennent les armes et se rendent aux barricades. Le général Louis Cavaignac retire les troupes gouvernementales et laisse les rebelles se disperser dans tout Paris. Pendant quatre jours, du 23 au 26 juin 1848, les combats de rue ne s'arrêtent pas dans la ville, aboutissant à la répression brutale du soulèvement.
Seconde République.
Début novembre, une nouvelle constitution pour la république a été publiée. Elle garantissait le suffrage universel, une assemblée représentative unique et l'élection populaire du président. L'introduction du suffrage universel était une tentative de contrer la minorité radicale urbaine avec une masse de votes paysans conservateurs. Lors de l'élection du président de la République (10 décembre 1848), le prince Louis Napoléon, neveu du défunt empereur et successeur des traditions bonapartistes, devance de façon inattendue tous les principaux candidats.
Louis Napoléon a déjoué l'Assemblée, gagné la confiance de l'armée et négocié un soutien financier avec un groupe de banquiers qui espéraient le garder sous leur contrôle. Comme le président ne pouvait constitutionnellement rester en fonction pour un second mandat et que l'Assemblée législative a rejeté la proposition de Louis Napoléon de réviser cette disposition, il a, sur la recommandation de ses conseillers, décidé d'organiser un coup d'État. Le 2 décembre 1851, Louis Napoléon et ses partisans prennent le pouvoir dans le pays, répriment les troubles de masse et organisent un plébiscite pour réviser la constitution. Après avoir reçu un vote de confiance, Louis Napoléon a rédigé une constitution autoritaire, établissant essentiellement le pouvoir impérial. Certes, le nom de "Second Empire" n'est apparu que le 2 décembre 1852, lorsque, à la suite des résultats d'un plébiscite national, le souverain du pays fut proclamé empereur Napoléon III.
Les principaux événements de la révolution de 1848 - 1849 en France
Introduction
A la veille de la révolution
Période de février de la révolution
Création d'une république bourgeoise
Insurrection des ouvriers parisiens de juin
Élection de Louis Napoléon à la présidence
Montée du mouvement démocratique au printemps 1849 Défaite de la révolution
Conclusion
Liste des sources et de la littérature
Introduction
L'année 1848 fut l'une des plus mouvementées de l'histoire du XIXe siècle. Les révolutions et les mouvements de libération nationale ont balayé presque tous les pays d'Europe : la France, l'Allemagne, l'Empire autrichien, les États italiens. Jamais l'Europe n'a connu une telle intensification de la lutte, une telle ampleur de soulèvements populaires et une montée en puissance des mouvements de libération nationale. Bien que l'intensité de la lutte n'ait pas été la même dans les différents pays, les événements se sont développés différemment, une chose ne faisait aucun doute : la révolution avait acquis une ampleur paneuropéenne.
Vers le milieu du XIXème siècle. Les ordres féodaux-absolutistes dominaient encore tout le continent et, dans certains États, l'oppression sociale était étroitement liée à l'oppression nationale. Le début de l'explosion révolutionnaire est rapproché par les mauvaises récoltes de 1845-1847, la « maladie de la pomme de terre », qui prive les couches les plus pauvres de la population du principal produit alimentaire, et la crise économique qui éclate en 1847 dans plusieurs pays. immediatement. Les entreprises industrielles, les banques, les bureaux de commerce ont été fermés. Une vague de faillites a augmenté le chômage.
La révolution a commencé en février 1848 en France. Les événements en France sont devenus l'étincelle qui a déclenché des soulèvements libéraux dans de nombreux États européens.
En 1848-1849. Les événements révolutionnaires prirent une ampleur sans précédent. Ils ont fusionné la lutte des différentes couches de la société contre l'ordre féodal-absolutiste, pour la démocratisation du système social, les protestations ouvrières pour l'amélioration de leur situation matérielle et des garanties sociales, la lutte de libération nationale des peuples opprimés et des puissants mouvement d'unification en Allemagne et en Italie.
La Révolution française de 1848 est restée dans la mémoire des contemporains et des participants principalement comme une tentative infructueuse de mettre en place une démocratie politique et une république sociale. Depuis plus d'un siècle, elle est considérée par l'historiographie mondiale sous le même angle de vue. La perception de cette révolution par ses contemporains et ses descendants a été influencée par des événements qui se sont déroulés principalement au cours de 1848. Parmi eux, deux tournants : le soulèvement des ouvriers de juin à Paris et le coup d'État bonapartiste. Ils ont barré les espoirs des révolutionnaires pour le triomphe des idéaux de justice sociale et de démocratie.
objectifde cet ouvrage est : de considérer les événements significatifs de la révolution de 1848 - 1849. en France.
Tâches:
1) considérer les événements précédant la révolution de 1848 ;
) pour caractériser la période de février de la révolution ;
) d'examiner comment s'est déroulée l'établissement de la république bourgeoise ;
) caractérisent le soulèvement de juin ;
) montrent comment Louis Napoléon a été élu président :
) pour caractériser les événements de 1849.
Le début de l'étude scientifique de la révolution de 1848 a été posé par K. Marx et F. Engels. Outre des articles de la Nouvelle Gazette du Rhin, deux ouvrages majeurs de Marx, publiés au début des années 50, sont consacrés à cette révolution - « La lutte des classes en France de 1848 à 1850 » et Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Dans ces travaux, la périodisation de la révolution a d'abord été donnée, son caractère a été déterminé, son cours a été tracé, le rôle des classes et des partis individuels dans celle-ci, les raisons de sa défaite et ses leçons politiques ont été analysés.
Dans l'historiographie soviétique, les problèmes de la révolution de 1848 ont été fructueusement développés dans les travaux de N. E. Zastenker, A. I. Molok et F. V. Potemkine. Passant aux moments clés de l'histoire de la révolution, ils ont soumis une analyse détaillée de la révolution industrielle et de ses conséquences socio-économiques (F. V. Potemkine), le soulèvement du prolétariat de juin (A. I. Molok).
Dans notre travail, nous avons utilisé des études plus récentes, notamment :
des ouvrages généraux sur l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe et de la France, ainsi que l'histoire de l'État et du droit des pays étrangers ;
l'ouvrage d'A.B. Reznikov consacré à l'analyse du rôle de la classe ouvrière dans les révolutions européennes de 1848-1849 ;
livre d'A.R. Ioannisyan, consacré à la révolution de 1848 en France ;
une étude de R. Farmonov consacrée à l'évolution de la pensée sociale et politique française dans la période considérée ;
l'ouvrage d'A. Yu. Smirnov, consacré au coup d'État du 2 décembre 1851 et Louis-Napoléon Bonaparte.
En plus de la recherche, les sources suivantes ont été utilisées dans le travail :
textes de proclamations révolutionnaires ;
mémoires d'un témoin oculaire des événements révolutionnaires - le grand penseur russe A. I. Herzen.
révolution france napoléon soulèvement
1. A la veille de la révolution
Louis Philippe est arrivé au pouvoir en 1830 lors de la Révolution bourgeoise-libérale de Juillet, qui a renversé le régime réactionnaire des Bourbons en la personne de Charles X. Les dix-huit années du règne de Louis Philippe (la soi-disant Monarchie de Juillet) se sont caractérisées par une départ des idées du libéralisme, augmentation des scandales et augmentation de la corruption. Finalement, Louis-Philippe rejoint la Sainte Alliance des Rois de Russie, d'Autriche-Hongrie et de Prusse. Le but de cette union basée sur le Congrès de Vienne en 1815 était de restaurer l'ordre en Europe qui existait avant la Révolution française de 1789. Cela s'est traduit, tout d'abord, par la domination renouvelée de la noblesse et le retour de ses privilèges. .
Au milieu des années 1840, il y avait des signes de crise sociale et économique en France. Malgré le boom industriel continu, les faillites massives sont devenues plus fréquentes, le nombre de personnes licenciées et sans emploi a augmenté et les prix ont constamment augmenté. En 1847, le pays a subi de graves mauvaises récoltes. Le "roi bourgeois", le "roi du peuple" Louis-Philippe ne convenait plus qu'au petit peuple (les légendes sur sa "simplicité" et les promenades populistes le long des Champs Elysées sans gardes avec un parapluie sous le bras se lassèrent vite du commun peuple), mais aussi la bourgeoisie. Tout d'abord, elle a été irritée par l'introduction du suffrage, dans lequel les votes n'étaient plus égaux, mais pondérés en fonction du revenu de l'électeur, ce qui réduisait en pratique l'influence de la bourgeoisie sur la législation. Louis Philippe ne fréquentait que ses parents et amis, embourbés dans des escroqueries financières et des pots-de-vin. Toute l'attention du gouvernement était tournée vers l'aristocratie monétaire, à laquelle le roi accordait une nette préférence : aux hauts fonctionnaires, banquiers, grands marchands et industriels, pour lesquels les conditions les plus favorables étaient créées dans la politique et les affaires.
Il y avait une croyance répandue que le système électoral devait être changé. A la Chambre des députés, on demande de plus en plus l'extension du suffrage à tous les contribuables, mais le roi rejette obstinément toute idée de changement politique. Ces sentiments étaient soutenus en lui par le ministre le plus influent des sept dernières années de son règne, François Guizot, devenu chef de cabinet en 1847. Il a refusé toutes les demandes de la chambre d'abaisser la qualification électorale.
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au cours de ces années, il y ait eu absolument plus de dix tentatives d'assassinat du roi. Ils ont été commis à la fois par des membres de sociétés secrètes et par des solitaires illettrés qui en avaient assez entendu parler de la propagande des radicaux.
À l'été 1847, les milieux d'opposition de la bourgeoisie française lancent une « campagne de banquet » à Paris. Lors des banquets, des discours ont été prononcés qui critiquaient les politiques gouvernementales. L'initiative de la campagne est venue d'un parti libéral modéré, surnommé "l'opposition dynastique". Ce parti n'allait pas plus loin que d'exiger une réforme électorale partielle, au moyen de laquelle les libéraux bourgeois espéraient renforcer la position fragile de la dynastie régnante. Le leader du parti, l'avocat Odilon Barrot, a lancé un slogan typique des libéraux modérés : « Réformer pour éviter la révolution ! Cependant, malgré les efforts de «l'opposition dynastique», les banquets en faveur de la réforme électorale ont progressivement pris un caractère plus radical. Lors d'un banquet à Dijon, une figure marquante de l'aile gauche des républicains bourgeois, l'avocat Ledru-Rollin, porte un toast : « A la Convention qui a sauvé la France du joug des rois !
En France, comme dans la plupart des pays européens, une explosion révolutionnaire couvait.
Une explosion révolutionnaire en France eut lieu au début de 1848. Le 22 février, un autre banquet de partisans de la réforme parlementaire était prévu à Paris. Les autorités ont interdit le banquet. Cela provoqua une grande indignation parmi les masses. Au matin du 22 février, l'agitation régnait dans les rues de Paris. Une colonne de manifestants se dirige vers le palais Bourbon en chantant la Marseillaise et en criant : « Vive la Réforme ! », « A bas Guizot ! ». Sans se diriger vers le bâtiment du palais, les manifestants se sont dispersés dans les rues avoisinantes et ont commencé à démonter le trottoir, à renverser les omnibus et à ériger des barricades.
Des troupes envoyées par le gouvernement ont dispersé les manifestants dans la soirée et ont pris le contrôle de la situation. Mais le lendemain matin, la lutte armée dans les rues de Paris reprend. Effrayé par les informations selon lesquelles le soulèvement grandissait et que la Garde nationale exigeait un changement à la tête du ministère, le roi Louis-Philippe destitua F. Guizot et nomma de nouveaux ministres considérés comme des partisans de la réforme.
Contrairement aux calculs des milieux dirigeants, ces concessions ne satisfont pas les masses populaires de Paris. Les affrontements entre le peuple rebelle et les troupes royales se poursuivent. Elles se sont particulièrement intensifiées après l'exécution provocatrice de manifestants non armés le soir du 23 février. De nouvelles barricades ont été érigées dans les rues. Leur nombre total a atteint un millier et demi. Cette nuit-là, le soulèvement a pris un caractère plus organisé. Les membres des sociétés révolutionnaires secrètes sont devenus les chefs du peuple insurgé.
Au matin du 24 février, presque tous les points stratégiques de la capitale sont capturés par les rebelles. La panique régnait dans le palais. Sur les conseils de ses proches collaborateurs, Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, et s'enfuit en Angleterre. Guizot y disparut également.
L'abdication du roi n'a pas arrêté le développement de la révolution. Les combats de rue à Paris se sont poursuivis. Les détachements révolutionnaires prennent possession du palais des Tuileries. Le trône royal fut sorti dans la rue, installé sur la place de la Bastille et brûlé sur le bûcher sous les exclamations jubilatoires d'une foule de milliers de personnes.
Les classes supérieures de la bourgeoisie ont continué à défendre la monarchie. Ils avaient peur du mot même de « république », qui leur rappelait l'époque de la dictature jacobine et de la terreur révolutionnaire de 1793-1794. Lors de la réunion de la Chambre des députés, les libéraux bourgeois ont tenté d'assurer le maintien de la monarchie. Ces plans ont été contrecarrés par des combattants de la barricade qui ont fait irruption dans la salle de réunion. Ouvriers armés et gardes nationaux réclamaient la proclamation d'une république. Le gouvernement provisoire est créé.
Le gouvernement provisoire comprenait sept républicains bourgeois de droite, regroupés autour de l'influent journal d'opposition Nacional, deux républicains de gauche - Ledru-Rollin et Floccon, ainsi que deux publicistes socialistes petits-bourgeois Louis Blanc et l'ouvrier Albert. L'avocat Dupont (de l'Eure), participant à la révolution de 1830, est élu président du gouvernement provisoire.Vieux décrépit et malade, il ne jouit pas d'une grande influence. Le véritable chef du gouvernement est le ministre des Affaires étrangères, le célèbre poète et historien Lamartine, républicain bourgeois de droite qui s'est fait connaître grâce à son talent d'orateur et à ses discours bruyants contre la monarchie de Juillet.
. Création d'une république bourgeoise
Malgré les revendications du peuple, le gouvernement n'était pas pressé de proclamer une république. Le 25 février, une députation ouvrière, dirigée par un vieux révolutionnaire, éminent savant (chimiste) et docteur Raspail, demande la proclamation immédiate d'une république. Raspail a déclaré que si cette demande n'était pas satisfaite dans les deux heures, il reviendrait à la tête d'une manifestation de 200 000 personnes. La menace fit son effet : avant même l'expiration du délai imparti, une république fut officiellement proclamée.
Le même jour, des désaccords éclatent entre la majorité bourgeoise du gouvernement provisoire et les ouvriers révolutionnaires de Paris sur la question de la couleur du drapeau national. Les manifestants ont exigé la reconnaissance du drapeau rouge - la bannière de la révolution et du changement social. Cette demande a été combattue par les milieux bourgeois, qui voyaient dans le drapeau tricolore un symbole de la domination du système bourgeois. Le gouvernement provisoire a décidé de conserver le drapeau tricolore, mais a accepté d'attacher une rosette rouge à son personnel (plus tard, il a été retiré). Les disputes sur cette question reflétaient les contradictions entre les différentes classes dans leur compréhension de la nature et des tâches de la révolution de Février.
Presque simultanément, un autre conflit éclata. La députation ouvrière exigea la publication immédiate d'un décret sur le « droit au travail ». La présence à Paris d'une immense masse de chômeurs rendit ce slogan extrêmement populaire auprès de larges couches de la population active. Après de longues objections, le gouvernement, à la suggestion de Louis Blanc, adopte un décret stipulant qu'il est tenu de "garantir l'existence de l'ouvrier par le travail" et de "donner du travail à tous les citoyens".
En février, devant le bâtiment où se réunissait le gouvernement provisoire, une manifestation massive de travailleurs a eu lieu avec des banderoles sur lesquelles étaient brodées les revendications : « Organisation du Travail », « Ministère du Travail et du Progrès », « Destruction de l'exploitation de l'homme par l'homme." À la suite d'un long débat, le gouvernement décide de créer une commission sur la question ouvrière, présidée par Louis Blanc et Albert. Pour les réunions de cette commission, qui comprenait des délégués des travailleurs, des représentants des entrepreneurs et plusieurs éminents économistes, le Palais du Luxembourg a été désigné. Mais la Commission luxembourgeoise n'a reçu aucun pouvoir réel et aucun moyen financier. La commission a été utilisée par la bourgeoisie pour instiller des illusions dans les masses et, après avoir endormi leur vigilance, gagner du temps pour renforcer leurs forces.
Louis Blanc exhorte les ouvriers à attendre patiemment la convocation de l'Assemblée constituante, censée résoudre tous les problèmes sociaux. Aux réunions de la commission et à l'extérieur de celle-ci, il propagea son projet d'associations ouvrières de l'industrie, subventionnées par l'État.
L'un des rares gains de la Révolution de Février a été la réduction de la journée de travail. A Paris et en province, la durée de la journée de travail dépassait alors 11-12 heures. Un décret du 2 mars 1848 fixe la journée de travail à 10 heures à Paris et à 11 heures en province. Cependant, de nombreux employeurs ne se sont pas conformés à ce décret et ont forcé les travailleurs à travailler plus longtemps ou ont fermé leurs entreprises. Le décret n'a pas satisfait les travailleurs, qui ont exigé une journée de travail de 9 heures.
Une autre réalisation de la révolution a été l'introduction du suffrage universel (pour les hommes de plus de 21 ans). La suppression de la caution obligatoire en espèces pour la presse a permis l'émergence d'un grand nombre de journaux démocratiques.
La Révolution de Février a assuré la liberté de réunion et a conduit à l'organisation de nombreux clubs politiques, tant à Paris qu'en province. Parmi les clubs révolutionnaires de 1848, la « Société des droits de l'homme » jouit de la plus grande influence. Proche de cette organisation se trouvait le "Club de la Révolution", son président était l'éminent révolutionnaire Armand Barbès. Parmi les clubs prolétariens révolutionnaires, la "Société républicaine centrale" se distingue par son importance, dont le fondateur et président est Auguste Blanqui. Début mars, ce club a exigé l'abolition de toutes les lois contre les grèves, l'armement général et l'inclusion immédiate de tous les ouvriers et chômeurs dans la garde nationale.
Une place particulière parmi les réalisations démocratiques de la Révolution de février fut occupée par le décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848 sur l'abolition de l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises.
Les révolutionnaires ont cherché une démocratisation décisive du système social et politique de la France. Mais le gouvernement provisoire s'y est opposé. Il a conservé presque inchangé la police et la bureaucratie qui existaient avant la révolution de février. Dans l'armée, les généraux monarchistes sont restés aux postes de direction.
Pour lutter contre le chômage, qui pourrait provoquer de nouveaux troubles révolutionnaires, le gouvernement provisoire organise début mars à Paris, puis dans quelques autres villes, des travaux publics dits "ateliers nationaux". Au 15 mai, il y avait 113 000 personnes en eux. Les ouvriers des ateliers nationaux, parmi lesquels se trouvaient des gens de diverses professions, étaient employés principalement comme creuseurs pour poser des routes et des canaux, planter des arbres, etc. En créant des ateliers nationaux, leurs organisateurs - les républicains bourgeois de droite - espéraient cette façon de détourner les travailleurs de participer à la lutte révolutionnaire.
La politique financière du gouvernement provisoire était entièrement déterminée par les intérêts de la grande bourgeoisie. Elle prend des mesures qui sauvent la Banque de France, menacée de faillite par la crise : elle instaure un taux de change obligatoire pour les billets de la banque et donne à la banque des forêts domaniales en garantie. Dans le même temps, le gouvernement impose de nouvelles charges financières à la petite bourgeoisie et à la paysannerie. L'émission de dépôts par les caisses d'épargne était limitée. Le gouvernement conserva presque tous les anciens impôts et, en outre, institua un impôt supplémentaire de 45 centimes sur chaque franc des quatre impôts directs perçus sur les propriétaires fonciers et les locataires.
Le sort des travailleurs a renforcé leur désir d'utiliser l'établissement d'une république pour lutter pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. A Paris et dans d'autres villes, il y a eu des manifestations ouvrières, des grèves, des attaques contre les entrepôts des marchands de céréales, les maisons des usuriers et les bureaux de perception des impôts sur les denrées alimentaires importées des villages.
Le mouvement agraire s'étendit et prit diverses formes. Des foules de paysans battent et chassent les forestiers, abattent les forêts domaniales, obligent les grands propriétaires à restituer les terres communales qu'ils ont saisies et obligent les usuriers à donner des billets à ordre. Une opposition sérieuse aux autorités a été provoquée par la levée d'un impôt foncier supplémentaire de 45 centimes. Cette taxe provoqua un grand mécontentement parmi les paysans.
Les élections à l'Assemblée constituante étaient prévues pour le 9 avril. Les organisations révolutionnaires démocratiques et socialistes étaient favorables au report des élections afin de mieux les préparer. Au contraire, les républicains bourgeois de droite s'opposent au report de l'Assemblée constituante, estimant que plus tôt les élections auront lieu, plus grandes seront leurs chances de gagner.
En mars, les clubs révolutionnaires de Paris organisent une grande manifestation populaire sous le mot d'ordre de reporter les élections à l'Assemblée constituante au 31 mai. Cependant, le gouvernement a rejeté cette demande. Les élections ont eu lieu le 23 avril.
Les élections apportent la victoire aux républicains bourgeois de droite, qui obtiennent 500 sièges sur 880. Les monarchistes orléanistes (partisans de la dynastie d'Orléans) et les légitimistes (partisans des Bourbons) rassemblent environ 300 candidats. Un nombre insignifiant de sièges, seulement deux, ont été reçus par les bonapartistes (partisans de la dynastie Bonaparte). Les démocrates et socialistes petits-bourgeois ont remporté 80 sièges.
Dans un certain nombre de villes industrielles, les élections ont été accompagnées de violents affrontements de rue. Ils ont pris un caractère particulièrement houleux à Rouen. Pendant deux jours, les 27 et 28 avril, les travailleurs insurgés ont mené ici de féroces batailles de barricades avec les troupes gouvernementales.
Dans une atmosphère aussi tendue, les sessions de l'Assemblée constituante s'ouvrent le 4 mai. Une nouvelle période s'ouvre dans l'histoire de la Révolution française de 1848.
La place du gouvernement provisoire fut prise par la commission exécutive. Le rôle décisif dans la Commission exécutive a été joué par les républicains de droite, étroitement liés à la grande bourgeoisie.
Dès les premiers jours de son activité, l'Assemblée constituante a retourné contre elle-même les couches démocratiques de Paris en rejetant le projet de loi portant création du ministère du Travail et du Progrès, en votant une loi restreignant le droit de pétition et en s'exprimant contre le mouvement révolutionnaire. clubs.
Afin d'influencer l'Assemblée constituante, le 15 mai, des clubs révolutionnaires organisent une grande manifestation populaire à Paris. Le nombre de ses participants a atteint près de 150 000. Les manifestants sont entrés dans le palais Bourbon, où se réunissait l'assemblée. Raspail donne lecture d'une pétition adoptée dans les clubs réclamant une assistance armée aux révolutionnaires polonais de Posen et une action décisive contre le chômage et la misère en France. La plupart des députés ont quitté la salle, qui a été investie par les manifestants. Après de longs débats, l'un des meneurs de la manifestation déclare l'Assemblée constituante dissoute. Un nouveau gouvernement a été immédiatement proclamé, qui comprenait des personnalités révolutionnaires de premier plan.
La dissolution de l'Assemblée constituante a été une erreur, prématurée et non préparée. Les larges masses populaires ne l'ont pas soutenu. Blanqui et Raspail, évaluant correctement les événements, même à la veille de la manifestation, mettent en garde contre des actions qui donneraient aux autorités un prétexte pour persécuter les révolutionnaires. Ces craintes se confirment bientôt : les troupes gouvernementales et des détachements de la garde nationale bourgeoise dispersent les manifestants désarmés. Blanqui, Raspail, Barbes, Albert et quelques autres révolutionnaires éminents sont arrêtés et emprisonnés. Les ouvriers de Paris ont perdu leurs meilleurs chefs.
. Insurrection des ouvriers parisiens de juin
Après le 15 mai, l'offensive de la contre-révolution s'intensifie de jour en jour. Le 22 mai, les clubs Blanca et Raspail ont été fermés et le 7 juin, une loi sévère a été promulguée interdisant les rassemblements de rue. Les troupes se rassemblaient à Paris. La presse contre-révolutionnaire attaque furieusement les ateliers nationaux, affirmant que leur existence entrave la relance de la « vie des affaires » et menace « l'ordre » dans la capitale.
juin, le gouvernement a publié un décret sur la liquidation des ateliers nationaux ; les travailleurs de plus de 25 ans qui y étaient employés étaient envoyés aux travaux de terrassement dans les provinces, et les travailleurs célibataires âgés de 18 à 25 ans étaient soumis à l'enrôlement dans l'armée. Les protestations ouvrières ont été repoussées par les autorités. La politique provocatrice du gouvernement pousse les ouvriers à la révolte. Le 23 juin, les ouvriers de Paris montent aux barricades.
L'insurrection de juin avait un caractère prolétarien prononcé. Des banderoles rouges flottaient sur les barricades aux cris : « Du pain ou du plomb ! », « Le droit au travail ! », « Vive la république sociale ! Dans leurs proclamations, les ouvriers insurgés réclamaient : dissoudre l'Assemblée constituante et traduire ses membres en justice, arrêter la Commission exécutive, retirer les troupes de Paris, donner au peuple lui-même le droit de rédiger une constitution, préserver l'ordre national ateliers, pour garantir le droit au travail. "Si Paris est enchaîné, alors toute l'Europe sera asservie", a déclaré une proclamation, soulignant l'importance internationale du soulèvement.
Pendant quatre jours, du 23 au 26 juin, il y a eu de féroces batailles de rue. D'un côté se sont battus 40 à 45 000 travailleurs, de l'autre - les troupes gouvernementales, les gardes mobiles et les détachements de la garde nationale avec un total de 250 000 personnes. Les actions des forces gouvernementales étaient dirigées par des généraux qui avaient auparavant combattu en Algérie. Ils ont maintenant appliqué leur expérience dans la répression du mouvement de libération du peuple algérien en France. A la tête de toutes les forces gouvernementales était placé le ministre de la guerre, le général Cavaignac, qui reçut des pouvoirs dictatoriaux. Le principal bastion du soulèvement était le faubourg Saint-Antoine ; les barricades érigées dans cette zone atteignaient le quatrième étage des maisons et étaient entourées de fossés profonds. La lutte aux barricades était menée en grande partie par les dirigeants des clubs révolutionnaires prolétariens, les ouvriers communistes Rakari, Barthélemy, les socialistes Pujol, Delacolonge et autres.
Au cœur des combats des insurgés se trouvait un plan d'opérations offensives élaboré par une personnalité révolutionnaire de premier plan, président du "Comité d'action" de la "Société des droits de l'homme", un ancien officier Kersozi. Ami de Raspail, maintes fois persécuté par la justice, Kersozy était très populaire dans les cercles démocrates parisiens. Tenant compte de l'expérience des insurrections précédentes, Kersozy prévoit une attaque concentrique sur l'hôtel de ville, sur les palais Bourbon et Tuileries en quatre colonnes, censés s'appuyer sur la banlieue ouvrière. Cependant, ce plan ne s'est pas concrétisé. Les rebelles ont été incapables de créer un seul centre dirigeant. Des détachements séparés étaient vaguement connectés les uns aux autres.
Le soulèvement de juin est une tragédie sanglante, dont les témoins oculaires ont donné une description vivante. A. I. Herzen a écrit :
"Le vingt-trois, à quatre heures avant le dîner, je me promenais sur les bords de la Seine... Les boutiques étaient fermées, les colonnes de la garde nationale aux visages menaçants allaient dans des directions différentes, le ciel se couvrait de des nuages; il pleuvait ... De puissants éclairs jaillissaient de derrière un nuage, des coups de tonnerre se succédaient, et au milieu de tout cela, il y avait un son mesuré et prolongé du tocsin ... avec lequel le prolétariat trompé appelait ses frères aux armes... De l'autre côté de la rivière, tout le monde barricades ont été construits dans les ruelles et les rues. Je vois, comme maintenant, ces visages sombres portant des pierres ; enfants, les femmes les ont aidés. Sur une barricade, apparemment terminée, un jeune polytechnique grimpe, hisse une banderole et chante d'une voix basse et tristement solennelle « La Marseillaise » ; tous les ouvriers chantaient, et le chœur de ce grand chant retentissait derrière les pierres de la barricade, captivait l'âme... L'alarme continuait...»
Le soulèvement a été réprimé. Une terreur brutale a commencé. Les vainqueurs achevèrent les rebelles blessés. Le nombre total de personnes arrêtées a atteint 25 000. Les participants les plus actifs au soulèvement ont été traduits devant un tribunal militaire. 3,5 mille personnes ont été exilées sans procès dans des colonies lointaines. Les quartiers populaires de Paris, Lyon et d'autres villes sont désarmés.
4. Élection de Louis - Napoléon à la présidence
La défaite de l'insurrection de juin signifiait la victoire de la contre-révolution bourgeoise en France. Le 28 juin, Cavaignac est nommé « chef de l'exécutif de la République française ». La dissolution de tous les ateliers nationaux (tant à Paris qu'en province), la fermeture des clubs révolutionnaires, le rétablissement d'une garantie monétaire pour les organes de presse périodique, l'abolition du décret sur la réduction de la journée de travail, ces sont les mesures contre-révolutionnaires prises par le gouvernement Cavaignac immédiatement après la défaite de l'insurrection de juin.
Novembre a été proclamée une constitution, rédigée par l'Assemblée constituante. Il a complètement ignoré les intérêts et les besoins des masses ouvrières et a interdit aux travailleurs d'organiser des grèves. A la tête de la république, la nouvelle constitution place le président, élu au suffrage universel pour quatre ans, et le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée législative, élue pour trois ans. Le suffrage ne s'est pas étendu à de nombreux groupes de travailleurs. Le président s'est vu accorder des droits extrêmement larges : la nomination et la révocation de tous les fonctionnaires et juges, le commandement des troupes et la direction de la politique étrangère. De cette façon, les républicains bourgeois espéraient créer un gouvernement fort capable de réprimer rapidement le mouvement révolutionnaire. Mais en même temps, donner au président un si grand pouvoir rendait inévitables les conflits entre lui et l'Assemblée législative.
Décembre 1848 élections du président de la République ont eu lieu. Six candidats ont été nommés. Les ouvriers avancés ont désigné Raspail, qui était alors en prison, comme leur candidat. Le candidat des républicains petits-bourgeois était l'ancien ministre de l'Intérieur, Ledru-Rollin. Les républicains bourgeois ont soutenu la candidature du chef du gouvernement - Cavaignac. Mais le candidat bonapartiste, le prince Louis Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu, ayant obtenu une écrasante majorité des suffrages aux élections.
Louis Bonaparte (1808-1873) était un homme aux capacités médiocres, distingué par une grande ambition. Il avait déjà tenté à deux reprises de s'emparer du pouvoir en France (en 1836 et 1840), mais avait échoué les deux fois. En 1844, alors qu'il était en prison, il écrivit la brochure "Sur l'élimination de la pauvreté", dans laquelle il prétendait démagogiquement être un "ami" des travailleurs. En fait, il était étroitement associé aux grands banquiers, qui payaient généreusement ses partisans et ses agents.
Pendant la Monarchie de Juillet, la clique bonapartiste était une bande d'aventuriers et n'avait aucune influence dans le pays. Maintenant, après la défaite du soulèvement de juin, la situation a changé. Les forces démocratiques étaient affaiblies. Les bonapartistes ont mené une agitation intensifiée en faveur de Louis Bonaparte, qui a eu une grande influence sur les paysans, qui espéraient qu'il allégerait leur situation, notamment en supprimant la taxe détestée de 45 centimes. Le succès des bonapartistes a également été aidé par l'auréole de Napoléon Ier, souvenir de ses victoires militaires.
Décembre Louis Bonaparte accède à la présidence et prête serment d'allégeance à la constitution républicaine. Le lendemain, un nouveau gouvernement est formé, dirigé par le monarchiste Odilon Barrot. Sa première étape a été l'expulsion des républicains de l'appareil d'État.
5. La montée du mouvement démocratique au printemps 1849. La défaite de la révolution
À l'hiver 1848/49, la situation économique de la France ne s'améliore pas : l'industrie et l'agriculture sont toujours en crise. La position des ouvriers restait difficile.
Au début d'avril 1849, dans le cadre des prochaines élections à l'Assemblée législative, le programme électoral du bloc des démocrates et socialistes petits-bourgeois est publié. Ses partisans se considéraient comme les successeurs des Jacobins, "Montagnes" 1793-1794, et s'appelaient "Nouvelle Montagne". Leur programme petit-bourgeois proposait un plan de réformes démocratiques, réclamait des réductions d'impôts, l'émancipation des peuples opprimés, mais contournait des questions telles que la durée de la journée de travail, le niveau des salaires, la liberté de grève et les syndicats.
Les élections de mai 1849 à l'Assemblée législative ont eu lieu. La plupart des sièges à l'Assemblée législative (environ 500) sont remportés par le bloc des partis monarchistes des orléanistes, légitimistes et bonapartistes, qui s'appelle alors le « parti de l'ordre ». Les républicains bourgeois de droite présentaient 70 candidats ; bloc des démocrates et des socialistes a obtenu 180 sièges.
Mai Assemblée législative a commencé ses travaux. Dès les premiers jours, des désaccords sur des questions de politique étrangère, étroitement liés à des désaccords sur des questions de politique intérieure, se sont révélés en son sein. Au centre se dressait la soi-disant question romaine. Dès avril 1849, le gouvernement français entreprit une expédition militaire aux frontières de la République romaine nouvellement émergée. La gauche républicaine s'oppose à cette intervention contre-révolutionnaire. Lors d'une réunion de l'Assemblée législative le 11 juin, Ledru-Rollin a proposé que le président et les ministres soient traduits en justice pour violation flagrante de la constitution, qui interdisait l'utilisation des forces armées de la France républicaine pour supprimer la liberté des autres peuples. L'Assemblée législative a rejeté la proposition de Ledru-Rollin. Alors les démocrates petits-bourgeois décidèrent d'organiser une manifestation pacifique de protestation.
La manifestation a eu lieu le 13 juin. Une colonne de plusieurs milliers de personnes désarmées se dirigea vers le palais Bourbon, où se réunissait l'Assemblée législative. Mais les troupes ont arrêté le cortège et dispersé ses participants, à l'aide d'armes. Ledru-Rollin et d'autres dirigeants des démocrates petits-bourgeois n'ont publié une proclamation qu'au dernier moment dans laquelle ils ont appelé le peuple aux armes pour défendre la constitution. Des poignées de personnes déterminées ont offert une résistance armée aux troupes, mais les leaders de la manifestation ont pris la fuite. Le soir, le mouvement était écrasé.
Les événements du 13 juin 1849 suscitent également une réaction dans les provinces. Dans la plupart des cas, l'affaire s'est limitée à des manifestations, qui ont été rapidement dispersées par les troupes. Les événements de Lyon prennent une tournure plus grave, où le 15 juin éclate un soulèvement d'ouvriers et d'artisans, menés par des sociétés secrètes. Dans le faubourg populaire de la Croix-Rousse, principal centre de l'insurrection lyonnaise de 1834, la construction de barricades commence. De nombreux détachements de soldats, appuyés par l'artillerie, sont déplacés contre les rebelles. La bataille a duré de 11 heures du matin à 5 heures du soir, les rebelles ont défendu chaque maison par un combat. 150 personnes ont été tuées et blessées, 700 ont été faites prisonnières, environ 2 000 ont été arrêtées et jugées. Les mineurs de Rives-de-Giers se sont portés au secours des ouvriers lyonnais, mais, ayant appris la défaite de l'insurrection, sont revenus en arrière.
Dans la nuit du 15 juin, 700 à 800 paysans se rassemblent dans les environs de la ville de Montluçon (Département de l'Allier), armés de fusils, fourches, bêches. Ayant reçu la nouvelle de l'issue infructueuse de la manifestation à Paris, les paysans rentrèrent chez eux.
La victoire remportée en juin 1849 par la contre-révolution bourgeoise sur les forces démocratiques coïncide avec l'amélioration de la situation économique en France, avec l'affaiblissement de la crise industrielle.
Conclusion
Révolution de 1848 - 1849 en France s'est déroulée en plusieurs étapes.
À la suite des événements de février, un gouvernement provisoire a été créé, qui comprenait sept républicains de droite, deux républicains de gauche et deux socialistes. Le véritable chef de ce gouvernement de coalition était un poète romantique et libéral modéré Lamartine - ministre des Affaires étrangères. La république est reconnue par le clergé et la grande bourgeoisie. Le compromis atteint par ce dernier a déterminé le caractère de cette étape de cette révolution démocratique bourgeoise.
Le gouvernement provisoire a publié un décret sur l'introduction du suffrage universel, a aboli les titres de noblesse et a promulgué des lois sur les libertés démocratiques. En France, le système politique le plus libéral d'Europe a été établi.
Une réalisation importante des travailleurs a été l'adoption d'un décret sur la réduction de la journée de travail, la création de centaines d'associations de travailleurs, l'ouverture d'ateliers nationaux qui ont donné aux chômeurs la possibilité de travailler.
Cependant, ces conquêtes ne purent être conservées. Le gouvernement provisoire, qui hérite d'une énorme dette publique, tente de sortir de la crise économique en augmentant les impôts des paysans et des petits propriétaires. Cela a suscité la haine des paysans pour le Paris révolutionnaire. Les grands propriétaires terriens nourrissaient ces sentiments.
Les élections à l'Assemblée constituante du 23 avril 1848 sont remportées par les républicains bourgeois. Le nouveau gouvernement était moins libéral, il n'avait plus besoin du soutien des socialistes. La législation qu'il a adoptée prévoit des mesures plus sévères pour lutter contre les manifestations et les rassemblements. Des répressions ont commencé contre les dirigeants du mouvement socialiste, ce qui a conduit au soulèvement de juin, qui a été brutalement réprimé.
Le soulèvement du 23 au 26 juin 1848 oblige la bourgeoisie à lutter pour l'établissement d'un gouvernement fort. Élue en mai 1849, l'Assemblée législative adopte une constitution selon laquelle tous les pouvoirs sont attribués au président de la république. Ils ont été élus en décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. Ce chiffre convenait non seulement à la bourgeoisie financière, mais aussi à la paysannerie, qui croyait que le neveu du grand Bonaparte protégerait les intérêts des petits propriétaires terriens.
Décembre 1851, Louis Napoléon a effectué un coup d'État, dissolvant l'Assemblée législative et transférant tout le pouvoir entre les mains du président (c'est-à-dire à lui-même).
Liste des sources et de la littérature
Sources
1. Herzen A. I. De l'autre côté / A. I. Herzen. - M. : Direct - Media, 2008 - 242 p.
Kouznetsov. DV Lecteur sur l'histoire des temps modernes en Europe et en Amérique. En 2 livres. Livre 1. Développement politique interne. Partie 2. XIXème siècle / D. V. Kuznetsov. - Blagovechtchensk : Maison d'édition de BSPU, 2010. - 434 p.
Littérature
4. Vologdine A.A. Histoire de l'État et du droit des pays étrangers / A. A. Vologdin. - M. : Lycée, 2005. - 575 p.
Histoire mondiale : En 24 volumes T.16 : L'Europe sous l'influence de la France. -Minsk; M. : Récolte ; AST, 2000. - 559 p.
Zastenker N. Révolution de 1848 en France / N. Zastenker.-M.: Uchpedgiz, 1948.- 204 p.
Histoire de l'Europe : En 8 vol.V.5 : De la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. avant la Première Guerre mondiale. - M. : Nauka, 2000. - 653 p.
Histoire de France : En 3 vol. Tome 2 / Rév. éd. A.Z. Manfred. - M. : Nauka, 1973. -586s.
Ioannisyan A.R. Révolution de 1848 en France et communisme / A. R. Ioannisyan. - M. : Nauka, 1989. - 296 p.
Marx K. La lutte des classes en France de 1848 à 1850 // Marx K., Engels F. Soch. Éd. 2. T. 7.-M. : Gospolitizdat, 1955. S. 5-110.
Marx K. Le dix-huitième brumaire de Louis Bonaparte // Marx K., Engels F op. Éd. 2. T. 8.-M. : Gospolitizdat, 1955. S. 115-217.
Révolutions de 1848-1849 en Europe / éd. FV Potemkine et A.I. Du lait. T. 1-2. - M. : Nauka, 1952.
13. Reznikov AB La classe ouvrière dans les révolutions européennes de 1848-1849. / A. B. Reznikov // Mouvement ouvrier international. Questions d'histoire et de théorie. T. 1.- M., 1976. S. 387-487.
Smirnov A.Yu. Coup d'État du 2 décembre 1851 par Louis-Napoléon Bonaparte dans le cadre de l'évolution politique de la Seconde République. - M, 2001.- 275 p.
Farmonov R. L'évolution de la pensée sociale et politique française sous la Seconde République (1848 - 1851). - M., 1992. - 311 p.
Tutorat
Besoin d'aide pour apprendre un sujet ?
Nos experts vous conseilleront ou vous fourniront des services de tutorat sur des sujets qui vous intéressent.
Soumettre une candidature indiquant le sujet dès maintenant pour connaître la possibilité d'obtenir une consultation.